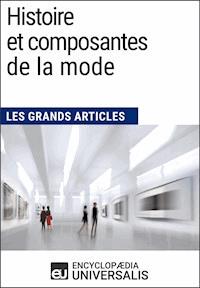
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Élément principal de tout art du costume, la silhouette évolue au gré des variations économiques et des changements qui affectent notre vie. Il revient aux modes vestimentaires de s'accommoder tant bien que mal de cet impératif.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341004213
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce Grand Article publié par Encyclopædia Universalis.
La collection des Grands Articles rassemble, dans tous les domaines du savoir, des articles : · écrits par des spécialistes reconnus ; · édités selon les critères professionnels les plus exigeants.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Histoire et composantes de la mode
Élément principal de tout art du costume, la silhouette évolue au gré des variations économiques et des changements qui affectent notre vie. Il revient aux modes vestimentaires de s’accommoder tant bien que mal de cet impératif. Entre standardisation et personnalisation, la mode, traversée par l’idéal paradoxal d’un Beau non point intemporel mais éphémère, va mettre en avant ou au contraire dissimuler certaines parties du corps humain selon des tendances qui appartiennent à son histoire. De la nécessité au bien d’agrément, du paraître et du bien-être, de la rareté à la surconsommation, le prêt-à-porter et les accessoires reflètent à leur tour ces mutations. Depuis l’entreprise familiale de main-d’œuvre jusqu’à l’industrie mondialisée, la « confection » change de style au rythme des saisons. Associés aux vêtements, les accessoires, indispensables ou d’ornement selon leurs usages, influent sur les attitudes et les comportements.
Ce secteur en pleine expansion est fortement marqué par la mondialisation, tant au niveau économique et technique qu’esthétique.
E.U.
1. Silhouette
Pendant des siècles, en Occident, l’esthétique du corps demeura tributaire de l’image de la maternité pour la femme, et de celle de la puissance et de la réussite chez l’homme. L’apparence du corps, domestiquée par le vêtement, régie par les modes successives, traduisait l’évolution des canons esthétiques de la société. Pour se socialiser, le corps s’est déformé : il « se donne, écrit France Borel, comme une matière première souple, malléable et transformable, une sorte de pâte à modeler se pliant docilement aux volontés et aux désirs sociaux ». C’est ainsi que l’histoire de la mode apparaît comme une longue suite de silhouettes parfois étranges et souvent antagonistes. Cette ordonnance régulière qui, au XXe siècle, égrène une silhouette nouvelle à chaque décennie, s’achève à la fin des années 1960.
Le brouillage qui survient alors est certes imputable au manque de recul historique, à cette « durée mémorable » et subjective décrite par Roland Barthes dans « Le Système de la mode » en 1967 : « Les changements de mode apparaissent réguliers si l’on considère une durée historique relativement longue, et irréguliers si l’on réduit cette durée aux quelques années qui précèdent le moment auquel on se place ; régulière de loin et anarchique de près, la mode semble ainsi disposer de deux durées : l’une proprement historique, l’autre que l’on pourrait appeler mémorable, parce qu’elle met en jeu la mémoire qu’une femme peut avoir des modes qui ont précédé la mode de l’année. » Mais cette confusion résulte également des profondes mutations sociologiques, économiques et esthétiques survenues depuis la fin des années 1960. L’image de la jeunesse s’est imposée comme critère quasi exclusif de beauté. Le corps s’est transformé. Plus grand, plus tonique, plus musclé, voulant préserver éternellement les attributs de la jeunesse, il est parvenu à soumettre le vêtement à ses exigences. Il nécessite désormais des soins sophistiqués, à tel point que dans la construction des apparences, au début du XXIe siècle, l’habillement apparaît presque comme secondaire...
• Une succession de silhouettes antagonistes
Ouvrant une nouvelle ère pour la mode, la Révolution française, en abolissant les lois somptuaires, le 8 brumaire de l’an II (29 octobre 1793), a permis à chacun de se vêtir à sa guise. Puis, la confection, fille de l’ère industrielle, s’est employée à démocratiser les innovations de la bourgeoisie. La silhouette masculine s’est stabilisée. L’homme a opté pour l’uniforme de la modernité. Oubliant la parure, il s’est enfermé dans un sombre complet-veston qui ne variera plus que dans le détail. La silhouette féminine, en revanche, a connu des transformations incessantes, de plus en plus rapides. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le corps féminin a fait l’objet de spectaculaires déformations. « En l’espace d’un demi-siècle, on a pu voir successivement le triomphe éclatant, insolent même, des ventres ballonnés, des reins ensellés, des tailles rétrécies, des hanches proéminentes, des ventres en avant, des dos voûtés, des thorax aplatis... un vrai défilé de toutes sortes de défauts ou tares, de tous les genres d’aspects, depuis la rondeur adipeuse jusqu’à l’extrême platitude » (Georges Hébert, Muscle et beauté plastique féminine, 1942).
L'évolution de la silhouette féminine en France, du début du XXe au début du XXIe siècle. En 2003-2004, une campagne nationale de mensurations a été réalisée par l'Institut français du textile et de l'habillement, afin d'apporter aux industriels de la mode de nouveaux barèmes leur permettant de réajuster leurs patrons en fonction des morphologies réelles de leurs clients.
• Le bouleversement de la Première Guerre mondiale
Les années 1920 voient une rupture fondamentale s’opérer dans l’ordre des apparences : les événements ont inversé les rôles et chamboulé le concept de féminité. La guerre, qui mit les femmes au travail, eut un impact direct sur la silhouette : les paniers, crinolines, tournures ou les jupons encombrants ont été supprimés, tout comme le corset qui, jusqu’à ce que Poiret l’élimine, avant guerre, enserrait le buste féminin. La simplification des formes et des usages, la généralisation du tailleur comme uniforme quotidien, le développement de caractéristiques pratiques (raccourcissement des jupes, apparition des poches, etc.) se sont propagés durant le conflit. La femme s’est libérée des carcans et artifices qui dessinaient jusqu’alors les volumes de son corps.





























