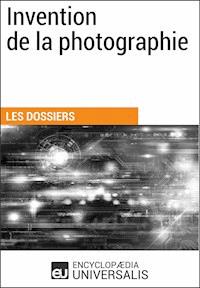
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La photographie intitulée
Point de vue pris d'une fenêtre de la propriété du Gras à Saint-Loup-de-Varennes, réalisée par Nicéphore Niépce sur une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée, est considérée comme la photographie la plus ancienne de l’histoire. Elle a probablement été obtenue en 1827. Mais le processus qui a conduit à la mise au point d'un dispositif fiable d'enregistrement de la lumière est antérieur de plusieurs siècles à cet événement. Il a été rendu possible au début du XIXe siècle grâce aux avancées obtenues lors des deux siècles précédents dans les domaines de la chimie et de l'optique. L’invention de Niépce n’est pas isolée : elle est portée par son temps et d’autres acteurs s’y trouvent associés. Dès l’origine, ce mouvement s'inscrit de manière cohérente dans l’histoire plus globale des révolutions industrielles. Comme elles, l’essor de la photographie s’inscrit dans une accélération du progrès technique qui affecte à la fois les modes de production et de consommation.
Ce
Dossier Universalis, composé d’articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis, rend compte de cet essor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002141
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Alphaspirit/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce dossier, consacré à l'Invention de la photographie, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles de ce dossier à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Invention de la photographie
La photographie intitulée Point de vue pris d’une fenêtre de la propriété du Gras à Saint-Loup-de-Varennes, réalisée par Nicéphore Niépce sur une plaque d’étain recouverte de bitume de Judée, est considérée comme la photographie la plus ancienne de l’histoire. Elle a probablement été obtenue en 1827.
Mais le processus qui a conduit à la mise au point d’un dispositif fiable d’enregistrement de la lumière est antérieur de plusieurs siècles à cet événement. Il a été rendu possible au début du XIXe siècle grâce aux avancées obtenues lors des deux siècles précédents dans les domaines de la chimie et de l’optique.
L’invention de Niépce n’est pas isolée : elle est portée par son temps et d’autres acteurs s’y trouvent associés. Dès l’origine, ce mouvement s’inscrit de manière cohérente dans l’histoire plus globale des révolutions industrielles. Comme elles, l’essor de la photographie s’inscrit dans une accélération du progrès technique qui affecte à la fois les modes de production et de consommation. Ce dossier, composé d’articles empruntés au fonds de l’Encyclopædia Universalis, rend compte de cet essor.
E.U.
AUTOCHROME
Décrite simultanément en 1869 par Louis Ducos du Hauron et par Charles Cros, la sélection trichrome, ou reproduction automatique des couleurs, consistait à prendre, sur trois films en noir et blanc, trois photographies distinctes du même sujet à travers trois filtres bleu, vert et rouge. Ainsi réalisait-on l’analyse des composantes primaires d’un sujet coloré, dont la restitution était obtenue par la projection sur un même écran des trois diapositifs en noir et blanc à travers les mêmes filtres bleu, vert et rouge. Pour simplifier ce dispositif complexe qui ne pouvait s’appliquer qu’aux natures mortes, et qui nécessitait trois projecteurs, les frères Auguste et Louis Lumière présentent le 30 mai 1904 à l’Académie des sciences leur invention, l’autochrome, capable de reproduire les couleurs en une seule prise. Il s’agit d’une plaque photographique en verre, en noir et blanc, que l’on enduit d’une mosaïque de particules microscopiques de fécule de pomme de terre, teintes en bleu, vert et rouge, jouant le rôle de filtres. Développée en diapositive, la plaque conserve cette trame de microfiltres et restitue par transparence les couleurs originales. Commercialisée en 1907, l’autochrome est resté jusqu’en 1935 le principal support de la photographie en couleurs.
Hervé LE GOFF
BAYARD HIPPOLYTE (1801-1887)
Hippolyte Bayard est considéré comme un des quatre inventeurs de la photographie aux côtés des Français Joseph-Nicéphore Niépce, Jacques-Louis-Mandé Daguerre et de l’Anglais William-Henri Fox Talbot. Inventeur certes, mais malheureux et amer. On lui doit en effet le procédé du positif direct, qui n’a pas été reconnu par les pouvoirs publics et qu’il a finalement peu pratiqué. Bayard est aussi et surtout l’un des premiers grands producteurs d’images, et ce dès le début des années 1840. Utilisant les différents procédés mis au point par ses confrères – le daguerréotype, le négatif papier puis le négatif verre à l’albumine –, il a développé une œuvre importante, abordant tour à tour le portrait, la vue d’architecture, la nature morte, où les objets photographiés – des statuettes, voire des ustensiles de jardinage – sont autant de signes de la présence du photographe.
• Un inventeur de procédés photographiques
Hippolyte Bayard est né le 20 janvier 1801 à Breteuil-sur-Noye (Oise). Fils d’un juge de paix, il commence sa vie professionnelle comme clerc de notaire. En 1825, il gagne Paris, où il entre au ministère des Finances comme commis de 4e classe au service des contributions directes. Il sera promu commis principal de 1re classe en juillet 1845. Comment ce modeste employé bascule-t-il dans l’aventure de la découverte de la photographie ? Nous l’ignorons. Les explications données par ses contemporains évoquent les pêches du verger familial, recouvertes de papier découpé aux initiales de son père et marquées à maturité par l’action de la lumière. Nous savons aussi que Bayard a noué des liens dans les milieux artistiques, où les recherches de Daguerre sont connues bien avant l’annonce officielle de l’invention de la photographie, annonce faite par François Arago, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, le 7 janvier 1839. Avant que le procédé de Daguerre ne soit explicité le 19 août de la même année, l’Anglais Talbot s’empresse de faire valoir à Paris l’antériorité de ses recherches sur la fixation et la conservation d’images de la chambre obscure et présente à Londres ses dessins photogéniques sur papier dont les valeurs sont d’abord inversées (selon le principe du négatif). L’image photographique de Daguerre, baptisée daguerréotype, a la qualité d’être directement positive et la limite d’être unique : elle se matérialise sur une plaque de cuivre recouverte d’une feuille d’argent.
Bayard n’ignore pas ces déclarations. Il se lance lui aussi dans des recherches sur le papier durant les premiers mois de l’année 1839. Un cahier conservé à la Société française de photographie en témoigne. Bayard y note avoir commencé ses essais le 1er février 1839. Il écrit y avoir obtenu des épreuves positives directes le 20 mars et présenté des échantillons à plusieurs personnalités, dont Arago le 20 mai. Le 10 juin, il affirme avoir réalisé des vues de statues en quinze minutes et de paysages en vingt minutes. Sans dévoiler sa méthode, il expose plusieurs de ses images à une fête de charité organisée au profit des victimes d’un tremblement de terre à la Martinique, manifestation évoquée par le Moniteur, le 22 juillet 1839. Bayard soumet parallèlement ses épreuves à l’Académie des beaux-arts, qui en rend compte le 2 novembre 1839. L’Académie apprécie les atouts du papier, plus facile à transporter et à utiliser en voyage que le daguerréotype et reconnaît que « ce procédé doit être, pour les arts, d’une utilité pratique et usuelle véritablement appréciable ». Mais elle en souligne aussi les imperfections : les petites dimensions des images, leur manque de netteté dans les détails et la longueur du temps de pose. En dépit des demandes d’éclaircissement sur sa méthode, Bayard reste silencieux. Au début de l’année 1840, Talbot envoie plusieurs épreuves, positives, à l’Académie des sciences, qui en rend compte le 10 février.
Bayard, auquel on reproche toujours son silence, explique brièvement sa méthode de positif direct, dans une communication lue le 24 février. Son procédé reprend la préparation des dessins photogéniques de Talbot. Le papier sensibilisé est noirci à la lumière. Il est ensuite imprégné d’une solution d’iodure de potassium avant d’être placé dans la chambre noire et exposé à la lumière. Cette dernière fait blanchir le papier et l’image qui se forme est positive. Mais, le 2 mars 1840, le chimiste Jean-Louis Lassaigne revendique la priorité de cette préparation – un papier teint en brun violacé par le sous-chlorure d’argent et imprégné d’une solution d’iodure de potassium – qu’il a utilisée pour calquer des gravures de façon directe et qu’il avait présentée à l’Académie le 8 avril 1839. Bayard est cependant le premier à l’appliquer à la chambre noire. Impuissant à faire reconnaître officiellement son procédé, il se photographie en noyé, le 18 octobre 1840, et déplore dans une lettre jointe l’injustice dont il est victime : l’État français célèbre le procédé de Daguerre et oublie le sien.
De son côté, Talbot continue à informer l’Académie des sciences de l’avancement de ses recherches et annonce, au début de l’année 1841, qu’il est parvenu à augmenter de façon significative la sensibilité du papier placé dans la chambre noire grâce à une nouvelle préparation. Bayard réagit immédiatement en apportant la preuve, indiscutable cette fois, de l’antériorité de sa découverte, qu’on appelle aujourd’hui l’image latente. Dans une lettre, lue devant l’Académie des sciences le 8 février 1841, il demande l’ouverture d’un pli cacheté du 11 novembre 1839. Le pli renferme un négatif papier préparé dans une solution de chlorure de sodium, enduit d’une couche de nitrate d’argent et sensibilisé aux vapeurs d’iode. À l’issue de l’exposition dans la chambre noire, aucune trace n’est visible sur le papier. L’image existe pourtant, révélée sous l’action des vapeurs de mercure. Talbot ne réplique pas mais dépose, ce même 8 février 1841, un brevet pour son procédé négatif-positif. C’est sur la base du procédé de Talbot, où le développement du négatif se fait dans une solution d’acide gallique et non aux vapeurs de mercure, que vont se développer les recherches ultérieures.
• L’œuvre photographique
En se photographiant en noyé, Bayard fixe son image d’inventeur maudit. Mais d’un autre côté, il inaugure son œuvre de photographe primitif. Il s’agit en effet de la première mise en scène avec personnage de l’histoire de la photographie. Avec cet autoportrait morbide, Bayard n’est plus dans l’expérimentation d’un procédé mais dans la production d’une œuvre. Jusqu’au début des années 1840, il continue à produire des positifs directs. Les statuettes en plâtre utilisées pour ses premiers essais se font de plus en plus nombreuses ; il les assemble en de véritables sujets, toujours équilibrés autour d’un axe central de la composition. Bayard, qui explore le genre de l’autoportrait, inscrit parfois son corps dans ces arrangements. Il délaisse bientôt le positif direct pour le procédé négatif-positif de Talbot. Trouvant ses sujets à proximité de chez lui, dans son jardin ou son quartier des Batignolles, Bayard joue des variations, ajoutant ou modifiant la place des objets dans ses natures mortes, habillant ou disposant différemment ses personnages, ou encore passant de la vue horizontale à la vue verticale, comme l’a si bien montré l’historien Michel Frizot dans son essai Bayard en son jardin. Variations sans thème (1986).
De 1842 à 1845 environ, Bayard pratique parallèlement le daguerréotype. Outre les vues du château de Blois réalisées avec son élève François-Auguste Renard à la demande de l’architecte Duban, on lui connaît également une vue du château de Dampierre (Yvelines) aménagé par Duban toujours, de nombreux autoportraits et portraits de ses proches, dont le peintre Jules Ziegler. À partir de 1847, il profite des améliorations apportées par le Lillois Blanquart-Evrard au procédé de Talbot pour photographier de nombreux monuments parisiens : la place de la Concorde, l’arc de Triomphe, la cathédrale Notre-Dame. Il est un des premiers à abandonner le négatif papier au profit du négatif verre à l’albumine mis au point par Niépce de Saint-Victor, un procédé loué pour sa finesse mais peu pratiqué à cause de la longueur des temps de pose. En 1849, les vues d’architecture de cet inventeur-photographe sont justement remarquées à l’Exposition des produits de l’industrie où il remporte une médaille d’argent : « Jamais aucun opérateur, en aucun pays, n’a produit sur papier des vues aussi détaillées, aussi pures de contours, aussi fraîches et vigoureuses d’effet », écrit dans son rapport Léon de Laborde. Les vues d’architecture présentées à l’Exposition universelle de Londres, en 1851, remportent un succès équivalent. 1851 est d’ailleurs une année riche pour la photographie. Elle correspond à la naissance de la Société héliographique, première société de photographie composée d’amateurs, artistes, scientifiques et écrivains. Bayard, qui fait partie du comité, se montre intéressé au cours des différentes séances par les procédés de tirages, visant notamment à réduire leur temps de fabrication par des réactifs chimiques. À une époque où les épreuves s’obtiennent à la lumière du soleil, il invite plusieurs membres de la société à une séance de tirage à la lumière électrique.
En juin 1851, en même temps que quatre jeunes photographes – Edouard Baldus, Henri Le Secq, Gustave Le Gray et Auguste Mestral – Bayard est sélectionné par la commission des Monuments historiques, pour photographier un certain nombre de monuments français. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de la première commande publique de photographie, aujourd’hui connue et célébrée sous le nom de Mission héliographique. Bayard doit accomplir sa mission en Normandie. Mais pas plus qu’il n’a honoré une commande de six vues passée par cette institution en août 1849, il n’honorera celle de la Mission héliographique. Il n’a remis aucun tirage, aucun négatif à l’administration alors qu’il a bien réalisé des images. Une dizaine ont pu être récemment rattachées à cette commande et quelques-unes ont même été diffusées par Blanquart-Évrard dans l’album Souvenirs photographiques (1853). Bayard qui était reconnu pour la qualité de ses vues d’architecture, à la veille de la commande, semble avoir refusé de se mesurer à ses jeunes confrères dont la plupart deviendront des figures réputées.
C’est d’ailleurs en 1851 que le manipulateur habile reprend le pas sur le photographe. Il sait obtenir des ciels aux nuages bien dessinés grâce à l’utilisation d’un second négatif superposé au premier et s’illustre, en association avec son ancien élève Renard, dans la reproduction d’œuvres d’art – de gravures notamment – réalisées à l’aide de négatifs sur verre de grandes dimensions.
Bayard devient un membre actif de la Société française de photographie, fondée en 1854. À l’Exposition universelle de 1855 puis à celle de Bruxelles en 1856, il déçoit par ses envois. Les observateurs ont l’impression de faire face à des vues qu’ils connaissent déjà : reproductions de statuettes de Vénus, de bas-reliefs et de gravures. Le 24 janvier 1863, quelques mois avant sa retraite du ministère des Finances, où il a accompli toute sa carrière, un décret impérial le nomme chevalier de la Légion d’honneur. Dans la foulée, il ouvre avec Bertall un studio de portraits carte de visite rue de la Madeleine à Paris, avant de se retirer à Nemours. Ce n’est qu’un siècle après sa mort, en 1986, qu’une première exposition lui est consacrée en France. La Société française de photographie (Paris), dont il fut un des membres fondateurs, ainsi que le musée J. Paul Getty (Californie) conservent la plus grande partie de son œuvre.
Anne de MONDENARD





























