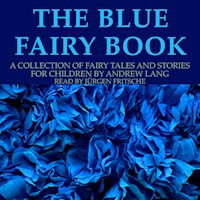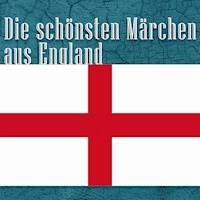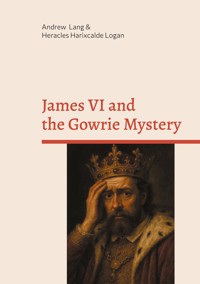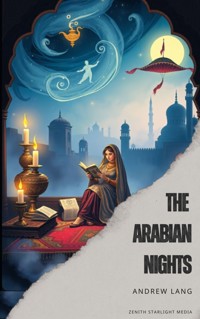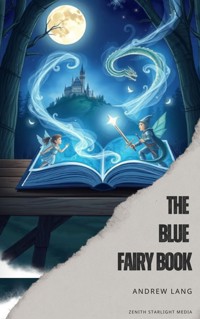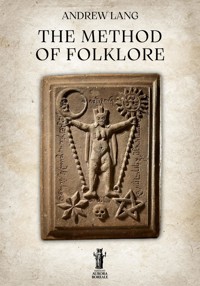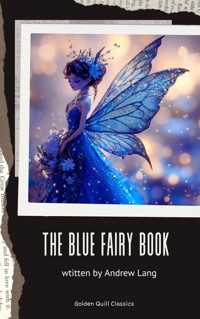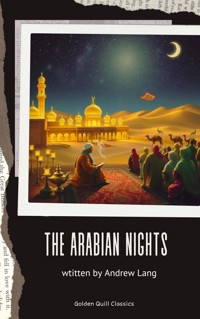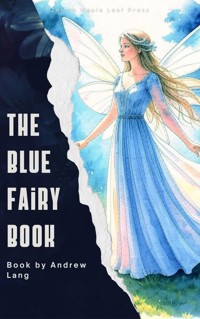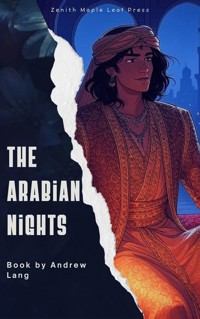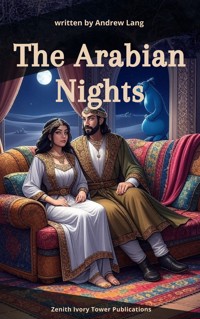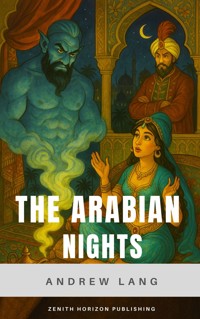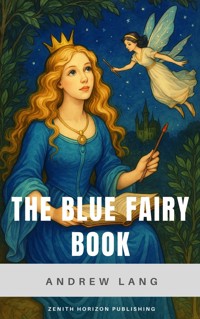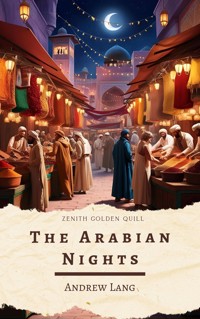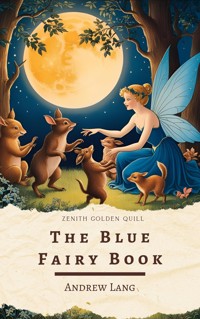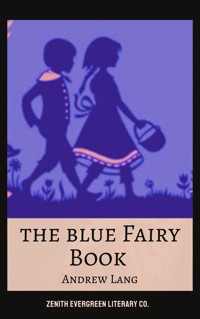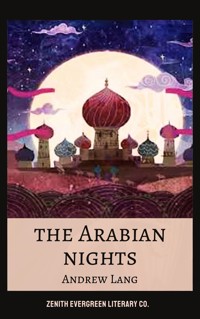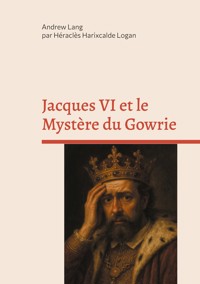
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'affaire du Gowrie : un complot oublié ou un mensonge historique ? Le 5 août 1600, à Perth, le roi Jacques VI d'Écosse - futur Jacques Ier d'Angleterre - échappe de peu à ce que l'Histoire officielle présente comme une tentative d'assassinat orchestrée par les frères Ruthven, comtes de Gowrie. Leur mort brutale, suivie d'un procès posthume, efface toute trace de contestation. Mais quatre siècles plus tard, les zones d'ombre demeurent. Pourquoi les preuves reposent-elles presque uniquement sur le témoignage d'un notaire véreux, faussaire avéré, qui changea sans cesse sa version ? Pourquoi le clan Logan, puissant propriétaire terrien descendant du premier roi d'Ecosse, fut-il sacrifié sur l'autel d'une accusation douteuse ? Et surtout : à qui profitait réellement le crime ? Dans ce livre, le lecteur découvrira la traduction commentée de l'ouvrage d'Andrew Lang (1902), l'un des rares historiens à avoir tenté de reconstituer l'affaire à partir des archives officielles. Mais il trouvera aussi le regard personnel du traducteur Héraclès Harixcalde Logan - descendant direct de la lignée Logan de Restalrig - qui interroge les fondements d'un récit imposé par la raison d'État. Entre enquête historique et mémoire familiale, La Conspiration de Gowrie révèle une justice aux ordres, une manipulation politique, et les racines d'un mensonge fondateur de la monarchie anglaise moderne. Un tabou de l'Histoire que l'on n'avait pas intérêt à rouvrir... jusqu'à aujourd'hui.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ne sois pas ce qu’ils ont fait de toi.
Logan, X-Men
Armoiries du Gowrie
Traduction française de l’original publié en 1902 par
LONGMANS, GREEN, AND CO. 39 Paternoster row, London New York and Bombay
Table des Matières
Avant-propos et note d’intentions du traducteur
INTRODUCTION
Chapitre I - LE MYSTÈRE ET LES PREUVES
Chapitre II - LE MASSACRE DES RUTHVEN
Chapitre III - LE NARRATIF DU ROI
Chapitre IV - NARRATIF DU ROI 2. LA TOURELLE
Chapitre V - LE RÉCIT DE HENDERSON
Chapitre VI - LE CAS SINGULIER DE M. ROBERT OLIPHANT
Chapitre VII - JUSTIFICATION CONTEMPORAINE : RUTHVEN
Chapitre VIII - LA THEORIE D’UNE RIXE ACCIDENTELLE
Chapitre IX - LA CRITIQUE CLERICALE CONTEMPORAINE
Chapitre X - AUTRES CRITIQUES CONTEMPORAINES
Chapitre XI - LE ROI ET LES RUTHVEN
Chapitre XII - LOGAN DE RESTALRIG
Chapitre XIII - LES SECRETS DE SPROT
Chapitre XIV - LE LAIRD ET LE NOTAIRE
Chapitre XV - LES ULTIMES CONFESSIONS DU NOTAIRE
Chapitre XVI - QU’EST-CE QUE LA LETTRE IV ?
Chapitre XVII - DÉDUCTIONS SUR LES LETTRES DU COFFRET
APPENDICES
NOTES DE BAS DE PAGE
Présentation de l’éditeur
Avant-Propos et note d’intentions du traducteur
L’incident du Gowrie a fait couler beaucoup d’encre et, à n’en pas douter, il en fera encore couler. Cet épisode est sans doute passé inaperçu pour la majorité des lecteurs français peu familiers de l’histoire britannique. Même en Angleterre, il demeure recouvert d’une chape de plomb : un véritable tabou, qu’on évite d’aborder. Beaucoup, en effet, pressentent que leurs fondations historiques reposent sur un vilain mensonge.
Et pour cause : cet incident fut une charnière historique majeure. Il marque le moment où Jacques VI, fils de Marie Stuart – élevée en captivité auprès d’Élisabeth à Westminster dans l’attente de sa succession – consolida son pouvoir en écartant définitivement l’influence catholique et française des affaires politiques du royaume. Car si la mise à mort de Marie Stuart avait déjà levé une première menace existentielle, il restait encore, dans le nord du royaume, plusieurs épées de Damoclès… ou opportunités, selon le point de vue. L’« affaire du Gowrie » permit de frapper deux coups d’un seul : neutraliser la puissante maison Ruthven de Gowrie et anéantir le clan Logan de Restalrig.
Si je prends aujourd’hui la peine de me consacrer à cette traduction, c’est que j’y trouve un intérêt très personnel. Je suis en effet descendant et chef de lignée des Logan de Restalrig, une famille qui tire son origine du roi Robert II d’Écosse et s’unit aux Stuart. Depuis 1609, notre nom est frappé d’infamie en raison de cette affaire. La découverte récente de mes liens avec le clan Logan – une sorte d’anamnèse – m’a poussé à revisiter ces événements. Après mes récits L’Apocalypse de Logan et Le Retour des Templiers, je saisis ici l’occasion de partager un regard direct sur cette histoire, tout en laissant au lecteur la liberté de se forger sa propre opinion.
L’ouvrage d’Andrew Lang, que je propose ici, n’est pas exempt de biais : s’il n’accable pas complètement les Ruthven et les Logan, il tend toutefois à donner crédit à la version officielle de Jacques VI, celle d’un complot dirigé contre lui. Pourtant, à sa lecture, je n’ai pu m’empêcher de sourire devant la fragilité des « preuves » et le ridicule de certaines conclusions. Le lecteur attentif, doué d’un peu de jugeote et capable de lire entre les lignes, y verra clair : les accusations reposent essentiellement sur les faux témoignages d’un notaire véreux, George Sprot, qui fabriqua lui-même de toutes pièces les lettres brandies au tribunal, changeant sans cesse sa version et avouant à répétition ses parjures. Elles s’appuyaient aussi sur des revirements de juges achetés, sur des rumeurs d’alcoolisme concernant Logan, et sur des ragots visant à noircir sa personnalité. Or, d’après ce qu’attestent les sources, Logan de Restalrig fut l’un des plus proches confidents de Marie Stuart. Si l’on considère les faits avec lucidité, il apparaît moins comme un conspirateur que comme un homme acculé : conscient d’un complot dirigé contre lui, dévasté par la mort de sa reine, il tenta de sauver ce qui pouvait l’être. Il vendit et transmit ses terres avant la forfaiture, arrangea la protection de sa famille contre les représailles à venir, et affronta la tempête avec ruse, courage et bienveillance. Paradoxalement, sa mauvaise réputation le protégea : mieux valait passer pour un ivrogne douteux que finir mort.
Il faut rappeler qu’il était alors le plus grand propriétaire terrien de la région d’Édimbourg, détenteur de la concession du port de Leith, redouté pour sa dureté en affaires mais allié aux familles les plus nobles d’Écosse. Grand créancier, il était loin de l’image d’un débauché ruiné et irresponsable qu’on a voulu coller à son nom. De même, les frères Ruthven semblaient d’un caractère irréprochable, hormis leurs inclinaisons catholiques. Lang affirme que si complot royal il y eut, il aurait nécessairement impliqué la connaissance préalable du clan Ruthven. Mais faut-il alors s’interroger : une branche du clan Ruthven aurait-elle sacrifié deux frères et le comte de Gowrie pour gagner les faveurs royales ?
Quand on étudie leur cas, on constate que leur exclusion du pouvoir fut brève. Les soupçons de magie noire et de pratiques occultes ont nourri leur légende, jusqu’à les présenter comme les premiers « vampires ». Au XXᵉ siècle encore, un Grey Gowrie (Ruthven) se retrouve lié à Boris Johnson, Margaret Thatcher et même dans l’entourage de Lady Diana… De quoi relancer cette question centrale : à qui profitait le crime ?
Une autre raison qui m’a conduit à traduire ce récit est sa richesse documentaire. Publié en 1902, il se fonde sur de nombreuses archives désormais reconnues comme des pièces majeures de l’histoire de cet incident.
Enfin, j’espère que cette réédition contribuera à rappeler combien la justice anglaise fut – et demeure peut-être encore – soumise aux intérêts du pouvoir profond, prête à réécrire l’histoire sur la base d’un mensonge. Symbole frappant : le tribunal de Perth fut construit sur les ruines de la maison des Gowrie, lieu où Jacques VI aurait été soi-disant détenu par les frères Ruthven sur ordre du laird Logan.
Et c’est justement à Perth, dans cette même ville chargée de mémoire, que je comparaîtrai bientôt pour avoir brisé la vitre qui abrite la Pierre de Destinée. Là où jadis commença notre bannissement, pourra peut-être s’ouvrir le retour de Logan de Restalrig, et sa réhabilitation dans les mémoires.
J’ai retiré une liste d’arguments de ma propre lecture de ce document, pour vous mettre sur la piste, car il sera peut-être difficile à aborder pour un public sans connaissances préalables du sujet.
Logan n’avait rien à gagner et tout à perdre.
Logan n’exprime pas la culpabilité dans ses actions, mais plutôt la crainte et la dépression : vente de ses biens, achat de bateaux, voyages à Londres et en Europe, brouilles avec femme et enfants, toutefois il les plaça avec précautions chez des précepteurs et ses femmes se remarièrent dans son entourage.
Logan a été jugé à titre posthume, son corps inhumé et porté au tribunal pour trahison : pourquoi ne pas le juger de son vivant ? Les événements eurent lieu de 1600 et le jugement en 1608, après sa mort.
Sprot le notaire a un comportement parasitaire et absolument corrompu, il gravite autour des puissances d’argent et n’hésite pas à user de sa fonction pour faire chanter ses victimes. Son seul caractère et ses aveux devraient suffire à innocenter Logan.
On remarquera Logan comme un personnage flexible, pieux, réaliste, prompt à parler aux Catholiques comme aux Réformés, il est propriétaire de Fastcastle le château le plus imprenable d’Ecosse.
Si Logan était si mauvais qu’on le dit, pourquoi ne se serait-il pas débarrassé de Sprot, des lettres compromettantes, etc.
Jacques VI avait tout à gagner de ce procès et distribua privilèges et paiements sur la saisie des biens de Logan de Restalrig. On comprend pourquoi une chape de plomb pèse sur le sujet…
Beaucoup des témoignages furent rendus sous la contrainte, les juges changeaient d’avis sur la véracité des preuves entre deux séances et après réception d’un salaire…
Introduction
Une vieille dame écossaise, il y a quatre générations, avait coutume de dire : « C’est un grand réconfort de penser qu’au Jour du Jugement, nous saurons enfin toute la vérité sur la Conspiration de Gowrie. »
Depuis que l’auteur, enfant, lut les Tales of a Grandfather (Contes d’un Grand-père), et partagea la déception du roi Jacques lorsqu’il découvrit qu’il n’y avait pas un pot d’or, mais un homme en armes, dans la tourelle, il avait supposé que nous savions tout de cette affaire : à savoir qu’il s’agissait d’un complot pour capturer le roi, le conduire à Fastcastle, et « voir comment le pays le prendrait », comme dans le cas de la Conspiration des Poudres.
Mais de même que le père Gérard a tenté de montrer que l’affaire des Poudres pouvait avoir été un complot ourdi par Cecil, de même les historiens modernes doutent que le mystère de Gowrie n’ait pas été une conspiration fomentée par le roi Jacques lui-même. M. Hume Brown paraît pencher vers cette opinion dans le second volume de son History of Scotland, et le Dr Masson, dans sa précieuse édition du Register of the Privy Council, est également dubitatif.
M. Louis Barbé, dans sa Tragedy of Gowrie House, plaide résolument contre le roi. Ainsi, j’ai été tenté d’étudier de nouveau cette vieille énigme, et je me suis convaincu que des historiens tels que Sir Walter Scott, M. Frazer Tytler et M. Hill Burton n’avaient pas tort : le complot ne fut pas celui du roi, mais bien l’entreprise désespérée de deux très jeunes hommes. L’objet précis demeure obscur dans le détail, mais le but était probablement de voir comment une Église et un pays profondément mécontents « réagiraient ». En travaillant sur cette énigme fascinante, j’ai utilisé des documents manuscrits jusqu’ici inédits. Les plus curieux d’entre eux — les interrogatoires et papiers du « country writer », Sprot — avaient été brièvement résumés dans les Memorials of the Earls of Haddington de Sir William Fraser. Mon attention fut attirée sur cette source par le Révérend John Anderson, des Archives générales (General Register House), qui avait aidé Sir William Fraser dans la compilation de son ouvrage. Le comte de Haddington eut la générosité de me permettre de faire copier ces documents, que Lady Cecily Baillie-Hamilton eut la bonté de rechercher et de redécouvrir au milieu d’une énorme masse de papiers légués par le savant premier comte.
En lisant les Calendars of the Hatfield MSS., j’avais remarqué que plusieurs lettres du possible conspirateur, Logan de Restalrig, étaient en possession du marquis de Salisbury, qui eut l’amabilité d’autoriser la prise de photographies de quelques spécimens. Celles-ci furent comparées, par M. Anderson, aux prétendues « lettres du complot » de Logan conservées à Édimbourg ; tandis que des photographies de ces mêmes « lettres du complot » furent comparées avec les lettres authentiques de Logan à Hatfield, par M. Gunton, à l’acuité et à l’énergie duquel je dois la plus vive gratitude. Les résultats de cette comparaison tranchent l’énigme de trois siècles.
Les autres manuscrits, jusqu’ici ignorés, ne se trouvent pas dans un lieu plus obscur que le Record Office de Londres, et j’ignore comment ils purent échapper à l’attention des auteurs précédents. Au Register of the Privy Council du Dr Masson je dois la suite d’une étrange aventure de M. Robert Oliphant, dont le rôle dans ce mystère, jusqu’ici négligé, est décisif — si l’on accepte les preuves, point sur lequel le lecteur devra se former sa propre opinion. Pour les copies faites au Record Office, je suis redevable au soin et à l’exactitude de Mlle E. M. Thompson.
À l’érudition et au zèle de M. Anderson, dans cette « plus longue et plus pénible chasse » (ainsi que Jacques qualifia sa chasse du matin du fatal 5 août), je dois les plus profondes obligations. Les séductions d’une conclusion romanesque ne l’ont jamais tenté à quitter le droit chemin de l’impartialité historique.
Je dois également remercier M. Henry Paton pour ses copies soignées des manuscrits de Haddington, ses extraits des comptes du Trésor, et d’autres recherches.
Pour la permission de reproduire le tableau de Fastcastle du Révérend M. Thomson de Duddingston, je suis redevable à l’amabilité de Mme Blackwood-Porter. La peinture, probablement de 1820, montre, comparée à la photographie actuelle, les destructions infligées par le vent et les intempéries à l’ancienne forteresse.
Mes obligations envers Sir James Balfour Paul (Lyon King of Arms) pour les informations concernant des points d’héraldique doivent aussi être chaleureusement reconnues.
Depuis la rédaction de ce livre, l’auteur a eu l’occasion de lire une Apology for the Ruthvens du défunt Andrew Bisset. Ce traité, facile à négliger, est intitulé Sir Walter Scott et occupe les pages 172 à 303 dans Essays on Historical Truth [0a], ouvrage depuis longtemps épuisé.
Sur de nombreux points, M. Bisset s’accorde avec M. Barbé dans sa Tragedy of Gowrie House, et mes réponses à M. Barbé valent aussi pour son prédécesseur.
Mais M. Bisset ne trouva aucune preuve que le roi eût conçu un complot contre Gowrie. Par une modification de l’hypothèse contemporaine de Sir William Bowes, il suggéra qu’une querelle entre le roi et le Maître de Ruthven survint dans la tourelle, provoquée par un outrage atroce que le roi aurait infligé au Maître. Cette hypothèse, pour diverses raisons, ne mérite pas de discussion. M. Bisset semblait attribuer les papiers de Sprot à une co-rédaction du roi et de Sir Thomas Hamilton — ce que nos nouveaux documents infirment.
Un critique qui, comme M. Bisset, accusait le roi d’avoir empoisonné le prince Henri et bien d’autres personnes, ne saurait être considéré comme un historien impartial.
Chapitre I LE MYSTÈRE ET LES PREUVES
Il est des énigmes dans les annales de la plupart des peuples ; des devinettes posées par le Sphinx du Passé à la curiosité des nouvelles générations. Ces questions ne concernent guère l’historien scientifique, occupé à forger des constitutions, manier des statistiques, noter le progrès, la dégénérescence—bref, l’évolution humaine. Ces hautes matières, ces courants de tendance, constituent l’étoffe de l’histoire, mais les problèmes de caractère et d’action personnels intéressent encore certains esprits en quête. Parmi ces énigmes, presque la plus obscure, la « Conspiration de Gowrie », est notre sujet.
Cette affaire est l’un des mystères obsédants du passé, l’un de ces problèmes que personne n’a résolus. Les événements eurent lieu en 1600, mais l’intérêt qu’ils suscitèrent fut si vif que la croyance à la culpabilité ou à l’innocence des deux frères nobles qui périrent un après-midi d’août devint un mot d’ordre partisan, un shibboleth dans les Guerres des Saints contre les Malignants, dans la lutte des Cavaliers et des Têtes-Rondes. Depuis, le problème n’a cessé d’attirer les curieux, tout comme l’énigme de Perkin Warbeck, le vrai caractère de Richard III, le visage réel derrière « le Masque de Fer », l’identité de la Fausse Pucelle, et l’innocence ou la culpabilité de Marie Stuart.
À certains égards, le mystère de Gowrie est nécessairement moins séduisant que celui de « la plus belle et la plus impitoyable Reine de la terre ». Il n’y a pas de femme dans l’histoire. Le monde, bien sûr, lorsque les Ruthven moururent, appliqua aussitôt la maxime : cherchez la femme. La femme en cause, disait-on, était la belle reine Anne de Danemark, épouse de Jacques VI. Cette dame charmante et frivole, « très, très femme », fit assurément de son mieux, par sa conduite, pour encourager l’idée qu’elle fut la cause de ces peines. De même, lorsque le Bonny Earl Moray—l’homme le plus grand et le plus beau d’Écosse—mourut comme un lion abattu par des loups, le peuple chanta :
C’était un noble galant,
Et il courait l’anneau,
Et le Beau Comte Moray,
Il eût pu être roi.
C’était un noble galant,
Et il jouait au gant,
Et le Beau Comte Moray,
Il était l’amour de la Reine.
D’un côté, une belle Reine unie à Jacques VI, pédant et bouffon. De l’autre, d’abord le Bonny Earl, puis le comte de Gowrie, tous deux jeunes, braves, beaux, tous deux soudain tués par les amis du Roi : nul ne savait pourquoi. L’opinion des pieux, de la Kirk, du peuple, et même des politiciens, sauta à la conclusion erronée que les jeunes gens périrent, comme Königsmarck, parce qu’ils étaient beaux et aimés, parce que la Reine était belle et bienveillante, et que le Roi était laid, perfide et jaloux. La rumeur disait aussi, du moins la tradition, que Gowrie « aurait pu être roi », idée examinée en Annexe A. On tenait là une explication de la mise à mort des Ruthven sur le modèle cher au roman. Le spirituel roi Jamie (qui, s’il n’était pas toujours sensé, traitait du moins sa fantasque épouse avec beaucoup de bon sens) devait jouer le rôle du roi Marc de Cornouailles face au sire Tristan qu’aurait été Gowrie. Pour cette théorie, nous montrerons qu’il n’existe aucune preuve ; et, à force de « chercher la femme », l’imagination trouva deux hommes. On dit tour à tour que la Reine aimait Gowrie, et qu’elle aimait son frère, le Maître de Ruthven, un garçon de dix-neuf ans—si elle ne les aimait pas tous deux à la fois. Il est curieux que l’affaire n’ait pas donné naissance à des ballades ; si c’est le cas, aucune ne nous est parvenue.
En vérité, il n’y eut pas de femme dans l’affaire, ce qui, bien sûr, rend le mystère bien moins palpitant que celui de Marie Stuart, pour qui tant d’épées et de plumes se sont levées. L’intérêt de caractère et d’amour fait défaut. Du caractère de Gowrie, et même de sa religion, hormis son érudition et son charme, nous ne savons presque rien. Nourrissait-il cette passion la plus forte et la plus sacrée, la vengeance ? L’a-t-il couvée en Italie, où la vengeance était plus subtile et plus retorse qu’en Écosse ? Cette passion se mêlait-elle à la veine de fanatisme de sa nature ? Avait-il guetté son heure, rêvant, par-delà les mers, de juvéniles songes de vengeance et d’ambition ? Tout cela n’a rien d’improbable et, si c’était vrai, expliquerait tout ; mais les preuves font défaut. Si Gowrie avait vraiment cultivé l’héritage de vengeance pour un père tué et une mère outragée ; s’il avait étudié les subtilités du crime italien, médité un complot à l’italienne jusqu’à le juger faisable, et communiqué sa vision au jeune frère qu’il retrouva au foyer—le mystère deviendrait limpide.
Quant au roi Jacques, nous le connaissons bien. Le nourrisson « lésé dans le sein de sa mère » ; menacé par des conjurés avant sa naissance ; effrayé, enfant, par un maître dur ; brutalisé ; harangué ; capturé ; insulté ; gouverné tantôt par des favoris débauchés, tantôt par de pieux forbans : Jacques devint naturellement dissimulateur, et trahit le meurtrier de son père d’un baiser. Il fut terrorisé jusqu’à la dissimulation ; il pouvait être cruel ; il devint, autant qu’il le put, tyran. Mais, quoique n’étant pas le lâche abject de la tradition, Jacques (ainsi qu’il l’observa lui-même) n’était pas homme à risquer sa vie dans une rixe hasardeuse, sur l’espoir que ses ennemis périraient tandis qu’il s’échapperait. Pour lui, une trahison de ce genre, une affaire d’épées et de poignards sur escaliers, en tourelles et en chambres, au cœur d’une ville de loyauté douteuse, n’avait p. 5 certainement aucun attrait. De plus, il avait le sens de l’humour. Telle a été l’opinion de nos meilleurs historiens—Scott, M. Tytler et M. Hill Burton ; mais des auteurs enthousiastes ont toujours embrassé la cause des victimes, les Ruthven, si jeunes, si braves, si beaux, si prématurément abattus, pour ainsi dire sur leur propre seuil. D’autres auteurs, tels que le Dr Masson à notre époque, et M. S. R. Gardiner, se sont abstenus de conclure, ou ont tenté la via media ; ils ont penché vers l’idée que les Ruthven moururent dans une rixe accidentelle, provoquée par un accès de frayeur nerveuse et sans mobile chez le Roi. Ainsi, la question reste pendante, le problème non résolu. Pourquoi la joyeuse chasse de Falkland, en ce clair matin d’août, se termina-t-elle par l’échauffourée sanglante dans la maison de ville de Perth ; par la mort des Ruthven ; par le tumulte dans la cité ; par la chevauchée du Roi vers sa demeure à travers un crépuscule sombre et ruisselant ; par la mise côte à côte des deux frères morts, tandis que le vieux serviteur de famille pleure au-dessus de leurs corps ; et par les lamentations de la Reine et de ses dames au palais de Falkland, lorsque les torches introduisent le cortège dans la cour du palais, et que l’étrange récit de la tuerie est rapporté sous des formes diverses, « les versions se heurtant si fort qu’aucun homme ne pouvait être certain de rien » ? Où résidait la vérité réelle ?
Ce problème, auquel les pages suivantes sont consacrées, est bien plus sombre et plus complexe que celui des coupables « Lettres du Coffret » attribuées à Marie, Reine d’Écosse. La Reine écrivit ces lettres, dans la frénésie d’une passion criminelle ; ou bien elle en écrivit des fragments, le reste ayant été altéré ou forgé. Dans un cas comme dans l’autre, ses mobiles, et ceux des éventuels faussaires, sont distincts et humains. La Reine aimait un homme, et en haïssait un autre à mort ; ou bien ses ennemis souhaitaient prouver que tels étaient ses penchants. La certitude absolue nous échappe, mais, dans les deux hypothèses, mobiles et desseins sont intelligibles.
Il n’en va pas ainsi du mystère de Gowrie. Le Roi, fils de Marie, après avoir chassé pendant quatre heures, se rend en visite chez lord Gowrie, un voisin. Après le déjeuner, ce noble et son frère sont tués, chez eux, par les gens du Roi. Le Roi livre aussitôt sa version des faits ; il n’en dévie jamais sur aucun point essentiel, mais l’histoire est presque incroyable. En sens inverse, les hommes abattus ne peuvent parler, et un seul d’entre eux, si tous deux étaient innocents, eût pu dire ce qui advint. Or l’un de leurs apologistes, sur le moment, produisit une version des événements qui est, hors de tout doute, audacieusement mensongère. Il était aisé de critiquer et de tourner en ridicule la version du Roi ; mais la version opposée, inconnue jusqu’ici des historiens, se détruit elle-même par ses flagrantes faussetés. Par nature, comme on le verra, aucun récit rendant compte d’événements aussi extravagants ne pouvait être aisément crédible, tant les circonstances paraissent extraordinaires, sans mobile et inexplicables. Si l’on essaie la thèse d’un complot ourdi par le Roi, on se heurte au fait que son complot n’eût pu réussir sans la collaboration volontaire et véhémente de l’une de ses victimes—chose qu’aucun homme ne saurait prévoir. Si l’on adopte l’idée que les victimes avaient tendu un piège au Roi, on n’a qu’une vague conjecture sur son but, son objet et sa méthode. La lumière ultérieure qui sembla tomber sur l’affaire, comme nous le verrons, n’a fait qu’épaissir ce qui était déjà obscur. L’iniquité inconcevable du Gouvernement, plus tard, jette un tel discrédit sur tous ceux qui étaient de son côté qu’on serait naturellement, quoiqu’illogiquement, enclin à croire que, dès l’origine, le Roi fut le conspirateur. Mais cela, nous le constaterons, était presque, voire tout à fait, une impossibilité physique.
Malgré ces embrouilles, je puis, en l’espèce, parvenir à une conclusion satisfaisante pour moi-même, chose que, dans l’affaire des Lettres du Coffret et de la Reine Marie, je n’ai pu faire. [7] Il ne fait aucun doute, dans mon esprit, que le comte de Gowrie et son frère tendirent un piège au roi Jacques, et tombèrent dans la fosse qu’ils avaient creusée.
À quelle fin précise ils avaient projeté de s’emparer de la personne du Roi, ce qu’ils comptaient faire de lui une fois qu’ils l’auraient tenu, doit demeurer matière à conjecture. Mais qu’ils avaient l’intention de s’emparer de lui, je n’en doute aucunement.
Ces pages, sur un problème si ancien et si controversé, n’auraient pas été écrites si je n’avais pas eu la chance d’obtenir maints documents manuscrits inédits. Certains, du moins, éclaircissent l’énigme seconde, celle de la suite du problème de 1600. Différents lecteurs tireront sans doute des conclusions différentes de quelques autres pièces, mais nul ne doutera, peut-être, qu’elles projettent d’étranges lumières nouvelles sur les mœurs et la morale écossaises. Le plan adopté ici ressemble quelque peu à celui du poème de M. Browning, The Ring and the Book. Les personnages racontent leur propre histoire du même ensemble d’événements, dans lesquels ils furent plus ou moins intimement impliqués. Cela entraîne inévitablement quelques redites, mais je ne vois pas de plan moins ouvert à l’objection.
Il faut, bien sûr, garder à l’esprit que toutes les preuves sont de nature suspecte. Le Roi, s’il était le conspirateur, ou même s’il était innocent, devait se disculper ; et, à dire vrai, la parole de Sa Majesté n’était pas de celles dont on puisse se reposer. Cependant, lui seul fut contre-interrogé, par un catéchiste sagace et hostile, et cela sous serment, quoique non devant un tribunal. Le témoignage de sa suite, et de quelques autres personnes présentes, fut également reçu sous serment, trois mois après les faits, devant une commission parlementaire, « Les Seigneurs des Articles ». Nous verrons que, neuf ans plus tard, une commission similaire fut honteusement trompée par le Gouvernement du Roi, celui-ci étant en Angleterre. Mais la nature des preuves, dans ce second cas, était entièrement différente : elle ne reposait pas sur les dépositions sous serment d’un nombre de nobles, gentilshommes et citoyens, mais sur une question de graphie, comparatio literarum, comme dans l’affaire des Lettres du Coffret. Que les témoins de 1600 ne se soient pas parjurés, lors du procès consécutif à la mise à mort des Ruthven, c’est ce que j’ai à soutenir. Ensuite, nous avons les dépositions, arrachées sous la torture, de trois des serviteurs du comte tué, trois semaines après les événements. Un tel témoignage n’a plus aujourd’hui valeur probante ; mais on montrera que les déclarations faites par ces hommes torturés ne compromettent le comte et son frère que par incidence, et d’une manière que les déposants eux-mêmes n’aperçurent probablement pas. Ils nièrent toute connaissance d’un complot, rejetèrent l’idée d’un complot du comte, et laissèrent échapper, incidemment, ce qui était suspect, sans percevoir la portée de leurs propres propos.
Enfin, nous avons le témoignage du seul homme vivant, hormis le Roi, qui fût présent au point central des événements. Que cet homme ait été un caractère très faux et fuyant, sans doute accessible aux pots-de-vin, richement récompensé, je l’admets volontiers. Mais je crois que l’on peut rendre probable, par des preuves jusqu’ici négligées, qu’il se trouvait réellement là au moment crucial et que, toutes réserves faites pour son caractère et sa position, son témoignage s’ajuste aux faits ; tandis que, si on le rejette, aucune hypothèse ne parvient à rendre compte de lui et de son rôle dans l’aventure. En bref, le récit du Roi, presque incroyable qu’il paraisse, offre la seule explication qui ne soit pas démontrablement impossible. À cette conclusion, je le répète, je ne suis entraîné par aucun attendrissement pour ce prince dépourvu d’attendrissement, le « doucereux roi Jamie ». Il n’était pas homme à dire la vérité, « s’il pouvait imaginer mieux ». Mais là où d’autres corroborations sont impossibles, par la nature des circonstances, les faits corroborent le récit du Roi. Sa version les « imbrique » ; si extravagants qu’ils soient, ils cessent d’être incohérents. Nulle autre hypothèse ne produit la cohérence : chaque conjecture s’effondre devant des faits démontrés.
Chapitre II LE MASSACRE DES RUTHVEN
Au mois d’août 1600, Sa Majesté le roi d’Écosse, Jacques, sixième du nom, avait plus que jamais besoin de se distraire par les plaisirs de la chasse. Les choses tournaient à rebours de son gré dans toutes les directions. « Sa très chère sœur », la reine Élisabeth (comme il l’appelait avec une certaine pathétique ironie), semblait devoir « durer aussi longtemps que le Soleil ou la Lune », et elle était d’une humeur exécrable. Son ministre, Cecil, paraissait plus mal disposé que de coutume à l’égard du roi d’Écosse, tandis que le rival du ministre, le comte d’Essex, avait proposé à Jacques des plans pour une démonstration militaire à la frontière. L’argent était encore plus rare qu’à l’ordinaire ; les Highlands plus turbulents que jamais ; des rumeurs de nouvelles conspirations contre la liberté du roi circulaient partout ; et, par-dessus tout, une Convention des États venait de refuser, en juin, d’accorder à Sa Majesté une large subvention. À cela s’ajoutait l’irritation qu’un vieux et fidèle serviteur, le colonel Stewart, souhaitât quitter le pays pour prendre du service en Angleterre contre les rebelles irlandais. Cet homme, seize ans auparavant, avait contribué à l’arrestation et à l’exécution du comte de Gowrie ; or le jeune comte, fils du défunt, venait de rentrer du Continent en Écosse, et le colonel Stewart craignait que Gowrie ne cherchât à venger son père. C’est pourquoi il désirait partir en Irlande.
Avec tous ces soucis, le roi avait besoin du réconfort que lui apportait la chasse au cerf dans son parc de Falkland. Il commanda un nouvel habit de chasse ; celui-ci fut livré au début du mois d’août et (fait singulier) payé immédiatement. Sa tenue était faite d’un drap vert venu d’Angleterre, et ses bas de rechange étaient ornés de cinq onces d’argent. Ses bottes portaient des revers de velours brodés ; ses meilleurs bas étaient enrichis d’une lourde broderie d’or ; il alla même jusqu’à acheter un cheval neuf. Ses gentilshommes – John Ramsay, John Murray, George Murray et John Auchmuty – furent vêtus, aux frais du roi, de casaques en drap vert, semblables à celles de leur maître. [12a]
Ainsi équipés, le roi et sa suite se levèrent tôt, le mardi 5 août, quittèrent l’agréable demeure de Falkland, avec ses tours rondes et robustes qui avaient récemment protégé Jacques d’une attaque de son cousin, le fougueux Frank Stewart, comte de Bothwell ; puis ils se rendirent aux écuries du parc. « Le temps, » écrit Sa Majesté, « était merveilleusement agréable et de saison. » [12b] Toute la joyeuse compagnie de chasse était là ; « Tell True » et les autres chiens jappaient, impatients au bout de leurs laisses ; le duc de Lennox et le comte de Mar, amis d’enfance de Jacques et hommes honorables, étaient les principaux nobles présents ; la foule comprenait encore deux ou trois membres de la fidèle famille des Erskine, cousins du comte de Mar, ainsi qu’un certain docteur Herries, remarquable par son pied bot.
Aux écuries, on quitta les chevaux de selle pour prendre les destriers de chasse. On sellait, on montait, le roi avait déjà le pied à l’étrier, lorsqu’un jeune gentilhomme, le Maître de Ruthven, arriva au galop depuis la ville de Falkland. Il s’était mis en route dès l’aube depuis la maison urbaine de son frère, le comte de Gowrie, à Perth, distante d’une douzaine de milles. Il n’avait que dix-neuf ans, était grand, beau, et frère de la demoiselle d’honneur préférée de la reine, Mistress Béatrix Ruthven. On a souvent dit qu’il était lui-même Gentilhomme de la Chambre, mais on ne trouve aucune trace d’une dépense à son nom dans les comptes royaux : en fait, il avait sollicité cette charge, mais ne l’avait pas encore obtenue. [13] Toutefois, si l’on en croit le roi (ce qui reste une question d’appréciation), Jacques « aimait le jeune Maître comme un frère ».
Le Maître s’approcha du roi et entra en conversation avec lui. Le récit de ce qu’il dit sera donné plus loin. Pour l’instant, contentons-nous des dépositions faites sous serment, lors du procès de novembre, par les gentilshommes de la suite royale et autres témoins. Parmi eux, le duc de Lennox affirma ce qui suit : ils chassèrent le cerf et l’abattirent. Au lieu de rentrer à Falkland pour déjeuner (car la chasse avait ramené le cortège, en cercle, tout près de la demeure), le roi ordonna au duc de l’accompagner à Perth, à une douzaine de milles, « pour parler au comte de Gowrie ». Sa Majesté partit alors en avant. Lennox envoya son valet chercher son épée et un cheval frais (un autre fut dépêché derrière le roi) ; puis il remonta à cheval et suivit. Lorsqu’il rejoignit Jacques, celui-ci dit : « Vous ne devinerez jamais l’affaire pour laquelle je chevauche ; je vais chercher un trésor à Perth. Le Maître de Ruthven (Maître Alexandre Ruthven) m’a assuré avoir trouvé un homme avec une cruche pleine de pièces d’or de grand aloi. » Jacques demanda aussi à Lennox ce qu’il pensait du Maître, dont il jugeait l’attitude fort étrange. « Rien d’autre qu’un honnête et discret gentilhomme, » répondit le duc. Le roi donna alors des détails sur le trésor ; Lennox dit trouver l’histoire invraisemblable, ce qu’elle était, plus ou moins. Jacques pria ensuite Lennox de n’en rien dire à Ruthven, qui voulait garder le secret. À une lieue de Perth, le Maître galopa en avant, pour prévenir son frère, le comte, lequel vint à la rencontre du cortège royal, à pied, accompagné de quelques amis, près de la ville. [14] Il était alors environ une heure de l’après-midi.
La suite royale, composée de treize nobles et gentilshommes, entra alors dans la demeure du comte. Elle faisait face à la rue, comme le château de Falkland, et possédait à l’arrière des jardins descendant jusqu’au Tay.
La situation et la disposition de la maison de Gowrie doivent être bien comprises. En descendant South Street, ou Shœ Gait, la rue principale de Perth — alors une petite ville fort agréable — on trouvait, à angle droit, deux autres rues : à gauche Water Gate, à droite Spey Gate. En arrivant au bas de South Street, on avait en face la porte de la demeure des Gowrie, prolongée, sur la droite, par le mur du jardin. Sur la gauche, se dressaient les maisons de Water Gate, habitées par de riches bourgeois et des gentilshommes. Beaucoup comprendront mieux le site si l’on se figure descendre, à Oxford, l’une des rues perpendiculaires à la High Street, en direction de la rivière : on verrait alors le collège de Merton face à soi, tandis que la rue se prolonge, sur la gauche, par de vieilles demeures comme Beam Hall. Ainsi la porte de la maison des Gowrie, en face, ressemblait à la tour-porche de Merton ; elle ouvrait sur une cour quadrangulaire, la cour d’honneur, appelée The Close.
Derrière la demeure s’étendait le jardin, puis coulait le Tay, comme l’Isis derrière Merton et Corpus. Dans la cour de Gowrie House, sur la droite et faisant face à l’entrée, s’élevait un corps de bâtiments en forme de L renversé (┐). Le rez-de-chaussée était occupé par des offices domestiques. À l’angle du ┐ se trouvait l’entrée principale. Plus près encore de l’observateur, sur la droite, une porte donnait accès à un escalier à vis étroit et sombre, qu’on appelait « le Turnpike noir ».
L’intérieur était disposé comme suit : passé la porte principale, on entrait dans le grand hall. De là, une porte ouvrait, sur la gauche, sur une salle à manger plus petite. Le hall lui-même possédait une porte donnant sur le jardin, accessible par un escalier extérieur. L’escalier d’honneur, qui partait du hall, menait à la Grande Galerie, édifiée et décorée par le défunt comte. Celle-ci s’étendait au-dessus de la salle à manger et du hall, et, vers la droite, était séparée, par une cloison et une porte, d’une vaste chambre du même étage appelée « la Chambre de la Galerie ». À l’extrémité de cette chambre, sur la gauche en avançant, une porte conduisait à une « ronde », petite tourelle circulaire servant de cabinet de travail. Une fenêtre donnait sur la porte d’entrée, l’autre sur la rue. De la rue, on pouvait apercevoir un homme se tenant à la fenêtre de cette tourelle. Une autre porte de la Chambre de la Galerie s’ouvrait sur l’étroit escalier en vis, dit Turnpike noir, permettant d’accéder à l’étage depuis la cour, sans passer par l’entrée principale ni l’escalier d’honneur.
Ainsi, pour citer un poète qui écrivait alors que la demeure existait encore (1638) :
« Le palais se montre, digne d’être nommé la Blanche Salle de Perth, Avec ses vergers pareils à ceux des Hespérides. »
Ce palais fut détruit en 1807 pour faire place à une prison et aux bâtiments du comté ; mais ses parties les plus intéressantes étaient depuis longtemps déjà en ruines. [18] En 1774, l’antiquaire M. Cant écrivait qu’après la rébellion de 1745, le palais avait été transformé en caserne d’artillerie. « On n’y voit plus que les vestiges de sa grandeur passée. » Les armoiries des nobles et des gentilshommes qui résidaient alors à Spey Gate et Water Gate se distinguaient encore sur les murs de leurs maisons. On dit qu’un fragment de l’ancien palais subsiste aujourd’hui dans l’auberge du Gowrie Inn.
C’est dans ce palais que le roi fut conduit par Gowrie. Il fut installé dans la salle à manger attenante au grand hall ; dans ce hall même, Lennox, Mar et le reste de la suite royale patientaient,
s’impatientaient même, car apparemment aucun repas n’avait été préparé, et l’on mit longtemps avant de servir même une boisson pour désaltérer Sa Majesté. Gowrie et son frère le Maître allaient et venaient, chuchotaient à leurs serviteurs, tandis que sir Thomas Erskine envoyait un bourgeois de la ville lui acheter une paire de bas de soie verte à Perth. [19] Il voulait être à son aise pour dîner.
Laissons la suite royale dans le hall, et le roi dans la salle à manger attenante ; notons ce que les nobles et gentilshommes de son escorte déclarèrent, lors du procès de novembre, à propos des événements de cette matinée d’août.
Mar n’avait pas vu le Maître à Falkland ; après la chasse, il ne rejoignit James qu’à deux ou trois milles de Perth. Drummond d’Inchaffray avait salué le Maître à Falkland, avant que celui-ci ne s’entretînt avec le roi aux écuries. Il le vit ensuite converser avec James, à l’extérieur, durant un quart d’heure environ. Le Maître quitta alors le roi. Inchaffray l’invita à déjeuner, mais il déclina : « Sa Majesté m’a ordonné de l’accompagner », dit-il. (D’après d’autres témoignages, il avait déjà déjeuné à Falkland.) Inchaffray prit alors son repas en ville, puis se remit en route vers sa maison. Sur la route, il rejoignit Lennox, Lindores, Urchill, Hamilton de Grange, Finlay Taylor, le roi et le Maître, qui chevauchaient vers Perth. Il se joignit à eux et entra avec eux dans la demeure des Gowrie.
Aucun autre témoin n’apporta de variante à ce récit de Lennox jusqu’ici. Mais quatre domestiques de James, dont un cellérier et un portier, se trouvaient aussi à Gowrie House, en plus des nobles et gentilshommes.
Revenons au récit de Lennox : le dîner ne fut prêt pour Sa Majesté qu’une heure après son arrivée, soit vers deux heures. Évidemment, on ne l’attendait pas, ou bien Gowrie ne voulait pas que cela se sache ; lui-même avait dîné entre midi et une heure, avant l’arrivée du roi. L’intendance du comte ne put fournir qu’une épaule de mouton, une volaille et un malheureux tétras, en plus de quelques viandes froides : maigre repas pour un roi ! On disait que le comte avait projeté de quitter Perth l’après-midi.
Lorsque James en fut au dessert, Gowrie, qui l’avait servi, entra dans le hall et invita la suite royale à prendre son repas. Quand ils eurent presque fini, Gowrie revint dans le hall et fit circuler une coupe de grâce, dans laquelle tous trinquèrent à la santé du roi. Lennox se leva alors pour rejoindre James — qui, avec le Maître, venait de traverser le hall — mais Gowrie lui dit : « Sa Majesté est montée à l’étage pour quelque affaire discrète. » Puis il demanda la clef du jardin, sur les bords du Tay, et s’y rendit avec Lindores, le boiteux Dr Herries, et d’autres, où ils mangèrent des cerises.
C’est alors que l’écuyer de Gowrie, maître d’écurie, M. Thomas Cranstoun — qui avait longtemps vécu en France et était revenu en avril avec le comte — accourut en criant : « Le roi est monté à cheval et s’enfuit par l’Inch ! » (l’Inch de Perth, où jadis s’était livrée la fameuse bataille des clans). Gowrie cria : « Aux chevaux ! aux chevaux ! » mais Cranstoun répondit : « Votre monture est à Scone », à deux milles de là, de l’autre côté du Tay. Pourquoi le comte avait-il laissé son cheval si loin, alors que les hommes de sa condition se déplaçaient rarement à pied ? Nous pourrons nous en demander la raison plus tard.