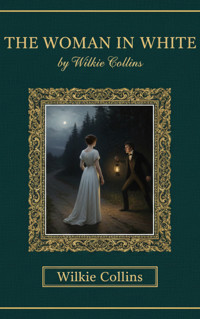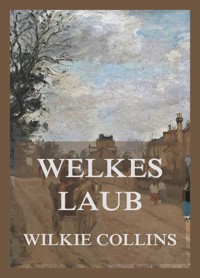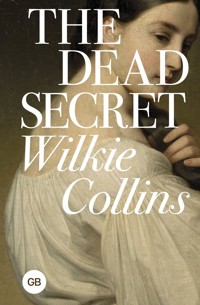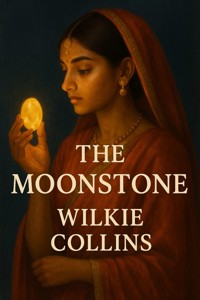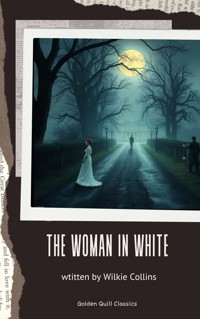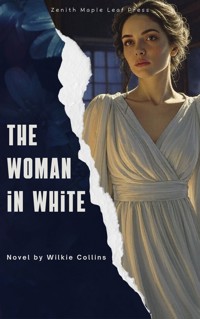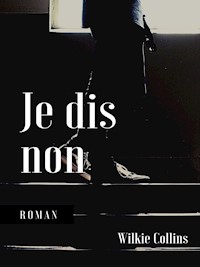
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
En 1881, la jeune Emily Brown et sa meilleure amie Cecilia Wyvil sont pensionnaires dans une école pour jeunes filles. Peu avant les vacances estivales, Emily, apprend qu'une jeune professeur est renvoyée. Avant de partir, cette jeune femme confie à Emily, qui est orpheline, qu'elle a connu son père mais se refuse à lui en dire beaucoup plus. Quelques temps après, grâce à Cecilia, Emily a quitté la pension et trouvé un travail de secrétaire chez sir Jarvis Redwood. Malheureusement, Emily doit rapidement se rendre à Londres, sa tante est gravement malade. Et là, elle découvre qu'on lui cache quelque chose sur lé décès de son père. Décidée, obstinée, Emily fera tout pour découvrir les véritables causes de cette mort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je dis non
Je dis nonLIVRE PREMIER À LA PENSIONLIVRE DEUXIÈME À LONDRESLIVRE TROISIÈME NETHERWOODSLIVRE QUATRIÈME VILLÉGIATURELIVRE CINQUIÈME AU COTTAGELIVRE SIXIÈME ICI ET LÀLIVRE SEPTIÈME LE CLINKLIVRE HUITIÈME SARAH JETHROCONCLUSION CAUSERIE DANS L’ATELIERPage de copyrightJe dis non
Wilkie Collins
LIVRE PREMIER À LA PENSION
CHAPITRE PREMIER LE SOUPER CLANDESTIN
En dehors du dortoir, la nuit était paisible et sombre.
Une petite pluie tombait dans le jardin, trop doucement pour qu’on pût l’entendre ; grâce à l’absence de vent, pas une feuille ne bougeait ; le chien de garde s’était endormi, les chats étaient rentrés ; pas un souffle ne troublait le silence de la terre sous un ciel couleur de suie.
À l’intérieur du dortoir, la nuit n’était pas moins noire et moins paisible.
Miss Ladd connaissait trop bien ses devoirs de maîtresse de pension pour tolérer une lumière nocturne ; par conséquent, les élèves, fidèles observatrices de la règle, devaient être profondément endormies. De temps en temps pourtant, le calme absolu était légèrement troublé par l’une ou l’autre des jeunes filles se retournant sur son lit. C’était le seul bruit perceptible, puisqu’on ne saisissait même pas celui de la respiration des dormeuses.
Le premier son qui vint rappeler la vie et son animation fut purement machinal : c’était une horloge qui le causait. Venant des basses régions du logis, l’organe du père Temps déclara que, dans une heure, il serait minuit.
Une douce voix s’éleva languissamment du côté de la porte.
« Émily ! disait-elle, il est onze heures. »
Il n’y eut pas de réponse. Au bout de quelques instants, la voix languissante reprit sur un ton plus haut :
« Émily ! »
Une jeune fille, dont le lit était au fond du dortoir, soupira sous la pesante chaleur de la nuit, et dit ensuite :
« Est-ce vous, Cécilia ?
– Oui.
– Que voulez-vous ?
– Je commence à avoir faim, Émily. Est-ce que la nouvelle ne dort pas encore ? »
La nouvelle se chargea de répondre avec autant de promptitude que d’aigreur :
« Non, elle ne dort pas. »
Ayant un but particulier en perspective, les cinq vierges sages de la première classe de miss Ladd se tenaient éveillées depuis une heure, dans l’espoir que l’étrangère finirait par s’endormir, et voilà à quel résultat cette veille aboutissait ! Le bruit d’un fou rire courut tout autour de la pièce, tandis que la nouvelle pensionnaire, mortifiée et blessée, exprimait nettement sa façon de penser à ce sujet.
« Vous me traitez indignement ! Vous vous méfiez de moi parce que je suis étrangère !
– Dites que nous ne vous connaissons pas, et vous serez plus près de la vérité, dit Émily, prenant la parole au nom de ses camarades.
– Comment pourriez-vous me connaître, puisque je ne suis arrivée que d’hier soir ? Je vous ai déjà dit que je m’appelle Francine de Sor. Maintenant, si vous voulez le savoir, j’ai dix-neuf ans et je viens des Indes occidentales. »
Ce fut encore Émily qui se chargea d’interpréter les sentiments de l’assistance.
« Mais pourquoi êtes-vous venue ici ? demanda-t-elle. Qui a jamais entendu parler d’une jeune fille entrant en pension juste au moment où commencent les vacances ? Vous avez dix-neuf ans, dites-vous ? Je suis d’un an plus jeune que vous et mon éducation est finie. Il y a parmi nous une autre pensionnaire d’un an plus jeune que moi et dont l’éducation est également terminée. Que vous reste-t-il encore à apprendre, à votre âge ?
– Tout ! s’écria l’originaire des Indes occidentales en fondant en larmes. Je ne suis qu’une pauvre créature ignorante ; votre éducation aurait dû vous enseigner à me plaindre au lieu de vous moquer de moi. Je vous déteste ! C’est indigne ! indigne ! »
Quelques jeunes filles se mirent de nouveau à rire ; une autre, celle qui avait parlé la première, prit le parti de Francine.
« Ne faites pas attention à leurs rires, miss de Sor ; oui, c’est vrai, vous avez raison de nous accuser de manquer d’égards. »
Francine de Sor essuya ses yeux.
« Merci, qui que vous soyez, dit-elle vivement.
– Je m’appelle Cécilia Wyvil. Ce n’était peut-être pas précisément gentil à vous de nous dire que vous nous détestez. Mais comme, de notre côté, nous avions oublié les lois de la politesse, ce que nous avons de mieux à faire, c’est de vous demander pardon. »
Cette manifestation généreuse sembla déplaire à celle des jeunes filles qui, selon toute apparence, régnait sur ses compagnes.
« Je peux vous dire une chose, Cécilia, fit-elle avec animation, c’est que vous ne me dépasserez pas en générosité. Allumez une bougie, je me dénoncerai moi-même si miss Ladd nous découvre. J’ai l’intention de donner une poignée de main à la nouvelle, et comment le pourrais-je dans l’obscurité ? Miss de Sor, mon nom de famille est Brown, et je suis la reine du dortoir. C’est moi, et non Cécilia, qui vous présente nos excuses si nous vous avons offensée. Cécilia est ma meilleure amie, mais je ne lui permets pas d’usurper mes droits… Oh ! quelle ravissante robe de nuit ! »
La lumière de la bougie venait de lui montrer Francine assise sur son lit et étalant autour de son cou assez de vraie dentelle pour faire perdre à l’altière souveraine tout sentiment de la dignité royale.
« Sept schellings six pence ! » dit Émily dédaigneusement en portant son regard sur sa propre robe.
L’une après l’autre, toutes les jeunes filles cédèrent à l’attrait de la vraie dentelle. Les sveltes et les potelées, les blondes et les brunes, vinrent en longues draperies blanches tourner autour de la nouvelle élève, pour arriver bien vite à cette commune conclusion : « Que son père doit être riche ! »
Cette personne, si favorisée de la fortune sous le rapport de l’argent, l’était-elle à un égal degré quant à la beauté physique ?
La disposition des lits plaçait Francine de Sor entre Cécilia à droite et Émily à gauche. Si, par quelque hasard fantastique, un homme – disons, par respect des convenances, un médecin, marié, et suivi de la vigilante miss Ladd – était entré dans le dortoir et qu’on lui eût demandé ensuite ce qu’il pensait de ses occupantes, il n’aurait pas même mentionné Francine. Aveugle pour les coûteuses splendeurs de sa robe de nuit, il se serait borné à remarquer la longue distance du nez à la bouche, le menton opiniâtre, …[Page 6 et 7 absentes de l’édition reproduite – Texte anglais correspondant reproduit en note][1]... En attendant, ses adorables yeux bleus se reposaient tendrement sur les tartes.
L’esprit dominateur d’Émily s’empara des rênes du gouvernement et sut assigner à chacune des jeunes filles présentes le rôle le mieux en rapport avec ses facultés.
« Miss de Sor, montrez-moi votre main. Ah ! oui, je m’en doutais. C’est vous qui avez le poignet le plus solide ; vous déboucherez les bouteilles. Mais si vous laissez sauter un seul bouchon, pas une goutte de limonade ne vous humectera le gosier. Effie, Annis, Priscilla, comme vous êtes notoirement très paresseuses, c’est vous donner un vrai témoignage de bonté que de vous procurer du travail. Effie, débarrassez la table de toilette, faites disparaître peignes, brosses et miroirs. Annis, déchirez les feuilles de votre cahier de versions, elles nous serviront d’assiettes… Non ! c’est moi qui déballerai, que personne ne touche aux corbeilles ! Priscilla, ma chère, vous avez les plus jolies oreilles du monde, c’est vous qui ferez sentinelle près de la porte. Cécilia, quand vous aurez fini de dévorer les tartes des yeux, vous prendrez les ciseaux (permettez-moi, miss de Sor, de m’excuser de la façon mesquine dont cette pension est tenue : les fourchettes et les couteaux sont comptés et mis sous clef tous les soirs)… je vous disais donc, Cécilia, de prendre une paire de ciseaux et de découper le gâteau dont vous voudrez bien ne pas garder la plus grosse part. Êtes-vous prêtes ? Très bien. Maintenant prenez modèle sur moi. Causez si bon vous semble, mais pas trop fort. Un mot avant de commencer. En pareil cas, les hommes portent des santés ; imitons les hommes. L’une de vous est-elle capable de formuler un toast ? Non. Cela retombe sur moi comme d’habitude. Voici mon premier toast : À bas les pensions ! à bas les maîtresses ! surtout la dernière venue !… Miséricorde ! comme ça pique. »
Le gaz de la limonade venait de prendre la discoureuse à la gorge, ce qui arrêta brusquement le cours de son éloquence. Personne ne s’en plaignit. Sauf les estomacs faibles, qui donc se soucie d’éloquence en face d’une table bien servie ? Il n’y avait pas d’estomacs faibles dans le dortoir. Avec quelle inépuisable énergie buvaient et mangeaient les jeunes élèves de miss Ladd ! Avec quel entrain elles profitaient du délicieux privilège de dire des folies ! Et – hélas ! hélas ! – combien furent vains plus tard leurs essais pour renouveler le plaisir alors sans mélange de se bourrer de tartes et de limonade !
Dans l’œuvre incompréhensible de la création, il ne semble pas y avoir de bonheur humain, pas même celui des pensionnaires, qui soit jamais complet. Au moment où la fête tirait à sa fin, elle fut troublée par un avertissement de la sentinelle placée près de la porte.
« Soufflez la bougie ! dit à voix basse Priscilla, il y a quelqu’un dans l’escalier. »
CHAPITRE II BIOGRAPHIE DANS LE DORTOIR
La bougie fut éteinte aussitôt et chacune des jeunes filles se glissa silencieusement jusqu’à son lit, prêtant l’oreille.
Pour seconder la vigilance de la sentinelle, on avait laissé la porte entr’ouverte, précaution qui permit d’entendre craquer les marches du vieil escalier. Au bout d’une minute, le silence se rétablit, puis le grincement continua de nouveau, mais plus faible cette fois et pour disparaître bientôt. Le calme naturel de l’heure de minuit ne fut plus troublé.
Qu’est-ce que cela signifiait ?
Est-ce qu’une des nombreuses subordonnées de miss Ladd avait entendu le bruit des voix et était montée pour surprendre les jeunes filles en flagrant délit ? Jusque-là la chose n’avait rien d’extraordinaire. Mais était-il probable que le sentiment du devoir d’une sous-maîtresse se fût modifié au milieu des escaliers et l’eût fait rebrousser chemin ? Cette supposition devenait absurde dès qu’on l’examinait. Et pourtant quelle autre explication imaginer ? Francine fut la première à suggérer une hypothèse. Saisie d’un brusque frisson sur son lit, elle s’écria :
« Pour l’amour du ciel, rallumez la bougie ! c’est un fantôme !
– Débarrassez le souper, folles que vous êtes, afin que le fantôme ne puisse pas nous dénoncer à miss Ladd. »
C’est avec ce conseil pratique qu’Émily étouffa une panique imminente. On ferma la porte, la bougie fut rallumée, toute trace du souper disparut. Pendant cinq minutes encore, on tendit l’oreille du côté de l’escalier. Aucun son ne se fit entendre ; ni sous-maîtresse, ni fantôme de sous-maîtresse ne parut sur le seuil du dortoir.
Ayant mangé son souper, Cécilia n’avait plus d’inquiétude ; elle pouvait mettre toute sa lucidité d’esprit au service de ses camarades.
« Eh bien, voulez-vous que je vous dise, reprit-elle de sa voix douce et persuasive, je crois que lorsque nous avons entendu le craquement, il n’y avait personne dans l’escalier. La nuit, ces vieilles maisons ont presque toujours des bruits étranges. Vous savez qu’on assure que ces escaliers ont plus de cent ans. »
Les jeunes filles échangèrent des regards rassurés, mais elles ne dirent pas un mot : on attendait l’opinion de la reine. Émily, selon sa coutume, justifia la confiance qu’on avait en elle en découvrant un procédé ingénieux pour mettre à l’épreuve l’explication de Cécilia.
« Continuons de causer, dit-elle ; si Cécilia a raison, toutes les maîtresses sont endormies, et nous n’avons rien à craindre d’elles. Si Cécilia se trompe, nous ne tarderons pas à voir surgir l’une ou l’autre à la porte. Ne vous effrayez pas, miss Francine ; être surprise en train de causer pendant la nuit ne rapporte qu’une réprimande. Être surprise avec une lumière rapporte une punition. Éteignez la bougie. »
Mais Francine croyait trop sincèrement au fantôme pour être ébranlée.
« Oh ! ne me laissez pas dans l’obscurité ! dit-elle toute frémissante. Si nous sommes découvertes, je subirai la punition.
– Vous vous y engagez sur l’honneur ? demanda Émily.
– Oui ! oui ! »
La reine, qui était d’humeur enjouée, reprit :
« Ne sera-ce pas drôle de voir une grande fille de cet âge débuter comme pensionnaire par une punition ? Causons donc. Puis-je vous demander si vous êtes étrangère, miss de Sor ?
– Mon père est un gentilhomme espagnol, répondit Francine avec dignité.
– Et votre maman ?
– Maman est Anglaise.
– Et vous avez toujours vécu aux Indes occidentales ?
– J’ai toujours vécu à l’île de San-Domingo. »
Émily comptait sur ses doigts les particularités ainsi récemment découvertes sur le caractère de la fille de M. de Sor : Ignorante, – superstitieuse, – riche.
« Savez-vous, ma chère, – pardonnez ma familiarité, – savez-vous que vous êtes une créature fort intéressante ? Il faut absolument que, pour l’agrément du dortoir, vous nous en disiez un peu plus sur votre compte. Qu’avez-vous fait toute votre vie ? Et surtout qu’est-ce qui vous amène ici ? Avant que vous commenciez, je dois, au nom de toute l’assistance, vous poser une condition. Sous aucun prétexte, ne vous avisez de nous donner des renseignements instructifs sur les Indes occidentales. »
Francine désappointa son auditoire.
Elle ne demanderait pas mieux que de satisfaire la curiosité de ces demoiselles ; mais elle était tout à fait incapable de disposer les événements dans l’ordre nécessaire au plus simple récit.
Émily serait donc obligée de lui venir en aide en la questionnant.
Le résultat justifia, dans une certaine mesure, cette curiosité. On sut du moins à quoi s’en tenir sur les raisons qui motivaient l’entrée en pension d’une nouvelle élève au commencement des vacances.
Le frère aîné de M. de Sor lui avait laissé un magnifique domaine à San-Domingo, et de plus une belle fortune, argent comptant, à une seule condition, c’est qu’il continuerait à résider dans l’île. La question de la dépense devenue ainsi indifférente à sa famille, Francine avait été envoyée en Angleterre et spécialement recommandée à miss Ladd, comme une jeune fille pourvue de superbes espérances, mais, en même temps, dépourvue de l’éducation la plus élémentaire. Sur le conseil de miss Ladd elle-même, le voyage avait été arrangé de manière à ce qu’on pût employer les vacances au travail. Francine devait être emmenée à Brighton, où elle recevrait les leçons d’excellents maîtres. Avec une avance de six semaines, on pouvait lui faire réparer quelque peu le temps perdu et lui épargner, à la rentrée des classes, la mortification de se voir reléguer au même rang que les plus petites élèves de la maison.
Dès que l’interrogatoire de Francine de Sor fut arrivé là, on ne le poursuivit pas plus loin. L’intérêt en était fort diminué maintenant ; on savait le mot de la plus attrayante énigme. Francine, avec une certaine finesse, se donna le mérite d’avoir pensé elle-même à raconter son histoire.
« Est-ce que ce n’est pas mon tour ? dit-elle. N’ai-je pas le droit de savoir aussi qui vous êtes ? Puis-je vous prier de commencer, miss Émily ? Tout ce que vous m’avez dit jusqu’à présent, c’est que votre nom de famille est Brown. »
Émily leva la main pour réclamer le silence.
Le mystérieux craquement de l’escalier avait-il donc résonné de nouveau ? Non, le bruit qui venait de frapper la fine oreille d’Émily partait des lits placés en face du sien. N’étant plus tenues en éveil ni par la curiosité, ni par l’inquiétude, Effie, Annis et Priscilla avaient succombé à la double influence d’une nuit chaude et d’un souper copieux. Elles dormaient ! elles dormaient de tout leur cœur, et la plus grosse des trois ronflait, – mais doucement, ainsi qu’il convient à une jeune lady.
N’importe ! en sa qualité de reine, Émily avait à cœur la tenue correcte du dortoir, et, devant la nouvelle, elle fut choquée de l’inconvenance de ce sommeil trop expressif.
« Si jamais cette fille attrape un amoureux, dit-elle avec indignation, je regarderai comme mon devoir d’avertir l’infortuné avant qu’il l’épouse. Elle porte le nom ridicule d’Euphémia. Ses yeux sont ternes, ses cheveux fades, son teint incolore. Naturellement il doit vous déplaire d’entendre ronfler. Pardon si je vous tourne le dos, je m’en vais lui jeter ma pantoufle à la tête. »
La douce voix de Cécilia – voix très endormie – s’éleva en faveur de la miséricorde.
« Elle ne peut pas s’en empêcher, la pauvre Effie, et réellement ce n’est pas assez bruyant pour nous gêner.
– Vous, du moins, cela ne vous gêne pas. Un peu de courage, Cécilia. Nous sommes fort éveillées par ici, et Francine trouve que c’est à notre tour de nous ouvrir à elle. »
Un murmure, s’éteignant doucement dans un long soupir, fut la seule réponse de Cécilia. La charmante fille venait de succomber à son tour à l’influence soporifique du souper et de la température. Un instant la contagion somnolente parut même sur le point de se communiquer à Francine ; sa large bouche s’ouvrit dans un interminable bâillement.
« Allons ! bonne nuit ! » lui dit Émily.
Mais Francine se ranima instantanément.
« Non, dit-elle, vous vous trompez bien si vous vous imaginez que je vais dormir. Je vous écoute avec un vif intérêt, miss Émily. »
Émily ne parut pas en humeur de l’intéresser. Elle parla du temps qu’il faisait.
« Il me semble que le vent se lève, » dit-elle.
Le doute à ce sujet était impossible, on entendait bruire les feuilles, et la pluie tombait avec force contre les fenêtres.
Francine, ainsi que son menton le proclamait aux physionomistes, était fort entêtée. Résolue à en venir à ses fins, elle employa le système d’Émily, elle posa des questions.
« Y a-t-il longtemps que vous êtes pensionnaire ?
– Trois ans.
– Avez-vous des frères et sœurs ?
– Je suis fille unique.
– Votre père et votre mère sont-ils vivants ? »
Émily se redressa subitement.
« Attendez, dit-elle. Je crois qu’on l’entend de nouveau.
– Le craquement de l’escalier ?
– Oui. »
Ou elle se trompait, ou le changement survenu au dehors ne permettait pas de saisir aussi bien qu’auparavant les bruits légers de l’intérieur. Le vent continuait à s’élever, et son passage à travers les grands arbres du jardin rappelait l’assaut des vagues sur la grève. Sous son souffle, la pluie, devenue une violente averse, se précipitait en rafales sur les vitres.
« On dirait presque une tempête, n’est-ce pas ? » dit Émily.
La dernière question de Francine n’avait pas encore reçu de réponse. Elle la renouvela obstinément.
« Ne vous inquiétez pas du temps qu’il fait et parlez-moi de votre père et de votre mère. Sont-ils vivants encore ? »
La réponse d’Émily ne se rapporta qu’à un seul de ses parents.
« Ma mère est morte avant que mon âge me permît de sentir sa perte.
– Et votre père ? »
Émily répondit en parlant d’une sœur de son père.
« Ma tante a toujours été une seconde mère pour moi. Mon histoire est, sur un point, la contre-partie de la vôtre. Vous êtes devenue riche tout à coup, et moi je suis, non moins brusquement, devenue pauvre. La fortune de ma tante devait être la mienne au cas où je lui survivrais. Mais cette fortune a été entraînée dans la déconfiture d’une banque. Maintenant, ma tante doit joindre les deux bouts avec un revenu de deux cents livres, et moi, en quittant la pension, il me faudra gagner ma vie.
– Sûrement votre père peut vous venir en aide ? dit Francine avec persistance.
– Sa fortune consistait en terres (la voix de la jeune fille tremblait). Le domaine, qui est substitué, revenait au plus proche héritier mâle. »
La timidité délicate qui recule à l’idée de réveiller un souvenir douloureux ou pénible ne comptait point parmi les faiblesses de Francine.
« Dois-je comprendre que votre père est mort ? »
Les gens dépourvus de tact nous tiennent à leur merci. D’une voix basse et grave, qui révélait une sensibilité contenue, Émily finit par céder à l’importune questionneuse.
« Oui, dit-elle, mon père est mort.
– Il y a longtemps ?
– D’autres diraient peut-être qu’il y a longtemps. J’aimais extrêmement mon père. Depuis quatre ans qu’il est mort, je ne peux pas parler de lui sans que mon cœur se gonfle à éclater. Je ne me laisse pas facilement accabler par le chagrin, miss Francine ; mais cette mort a été si brusque ! Quand je l’ai apprise, il était déjà dans sa tombe. Et il était si bon pour moi ! si bon pour moi ! »
La vive et gaie petite créature, l’altière souveraine du dortoir, l’âme de la pension, cacha sa figure dans ses mains et fondit en larmes.
Étonnée et – pour lui rendre justice – un peu confuse, Francine chercha à s’excuser. Émily était trop généreuse pour lui garder rancune de sa cruelle obstination.
« Non, je n’ai rien à pardonner. Ce n’est pas votre faute. Les autres jeunes filles à qui leur père manque ont des mères, des frères, des sœurs ; elles prennent plus facilement leur parti d’une perte comme la mienne. Ne vous excusez pas.
– Mais je voudrais vous persuader de ma sympathie, reprit Francine, dont la figure, la voix et les manières n’exprimaient cependant que l’indifférence. Quand mon oncle est mort en nous laissant tout son argent, papa a été bouleversé, mais il comptait sur le temps pour se guérir de son chagrin.
– Jusqu’ici, Francine, ce grand guérisseur s’est trouvé impuissant avec moi. Peut-être ai-je une mauvaise nature, mais l’espoir d’une future réunion dans un monde meilleur est trop faible et trop lointain pour me consoler. Laissons cela. Parlons plutôt de la bonne créature endormie à côté de vous. Vous ai-je dit que j’aurai à gagner mon pain au sortir de pension ? Cécilia s’est informée dans ses lettres à sa famille et m’a découvert un emploi. Pas celui de gouvernante. Quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je vais vous expliquer de quoi il s’agit. »
Dans ce bref intervalle, le temps avait changé encore, le vent soufflait toujours avec force, mais la pluie diminuait de violence ; du moins, son clapotement ne résonnait plus sur les carreaux.
Émily commença. Pleine de gratitude envers son amie, elle ne songea point à observer l’air ennuyé avec lequel Francine s’installait sur son oreiller pour écouter les louanges de Cécilia. La plus ravissante des pensionnaires ne pouvait guère intéresser une jeune personne gratifiée par la nature d’un long menton opiniâtre et d’yeux percés d’une façon absolument malheureuse. Le récit, qu’accompagnaient les plaintes monotones du vent, coulait doucement des lèvres d’Émily. Peu à peu les yeux de Francine se fermèrent pour se rouvrir au bout d’un instant et se refermer encore. À un certain point de sa narration, la mémoire d’Émily resta indécise entre deux événements. S’étant arrêtée afin de réfléchir, la jeune fille remarqua le silence de Francine. Elle l’examina. Miss de Sor dormait.
« Elle aurait pu me prévenir qu’elle était fatiguée, fit tranquillement Émily. Eh bien, ce que j’ai à faire de mieux, c’est d’éteindre ma bougie et de suivre son exemple. »
Au moment où elle prenait l’éteignoir, la porte du dortoir s’ouvrit subitement du dehors. Une grande femme, drapée dans une robe noire, se tenait sur le seuil, les yeux fixés sur Émily.
CHAPITRE III MISS JETHRO
La main étroite et effilée de la femme désignait la bougie.
« Ne l’éteignez pas ! »
Tout en parlant, la femme faisait du regard le tour de la pièce pour s’assurer que les autres jeunes filles étaient bien endormies.
Émily laissa retomber l’éteignoir.
« Naturellement, vous comptez nous dénoncer, dit-elle. Je suis la seule éveillée, miss Jethro : mettez la faute sur moi.
– Je n’ai nullement l’intention de vous dénoncer, mais j’ai quelque chose à vous dire. »
Elle fit une pause et repoussa de la main les lourds bandeaux noirs rayés de gris qui lui couvraient les tempes. Ses yeux larges, sombres, un peu obscurcis, se posaient sur Émily avec une expression de curiosité douloureuse.
« Quand vos amies se réveilleront, demain matin, vous pourrez leur dire que la nouvelle maîtresse, si antipathique à tous, a quitté la pension. »
Pour cette fois, la promptitude d’esprit d’Émily fut en défaut.
« Vous partez ! dit-elle avec étonnement, vous qui n’êtes ici que depuis Pâques ! »
Miss Jethro poursuivit, sans paraître s’apercevoir de l’air effaré d’Émily :
« Je ne suis pas très forte, puis-je m’appuyer un peu sur votre lit ? »
Remarquable en toute occasion par son imperturbable sang-froid, miss Jethro avait la voix tremblante en présentant cette requête : requête assez singulière, puisqu’il y avait là des chaises à sa disposition.
Émily lui fit place avec la physionomie de quelqu’un qui rêve.
« Je vous demande pardon, miss Jethro, mais une chose que je ne puis souffrir, c’est d’être intriguée. Si votre intention n’est pas de nous dénoncer, pourquoi êtes-vous ici ? »
L’explication de miss Jethro ne fut pas de nature à calmer la surprise excitée par sa façon d’agir.
« J’ai été assez vile, répliqua-t-elle, pour écouter à la porte, et je vous ai entendue parler de votre père. Je voulais en entendre davantage. Voilà pourquoi je suis entrée.
– Vous avez connu mon père ! s’écria Émily.
– Je crois l’avoir connu. Mais son nom est si commun, il y a tant de James Brown en Angleterre, que je crains de me tromper. Vous venez de dire qu’il est mort depuis près de quatre ans. Pouvez-vous mentionner quelque particularité qui éclaircirait mes doutes ? Mais vous trouvez peut-être que je prends là une grande liberté… »
Émily l’interrompit.
« Je vous aiderais bien volontiers, dit-elle ; seulement, à cette époque, j’étais malade, et on m’avait envoyée chez des amis en Écosse pour essayer du changement d’air. La nouvelle de la mort de mon père occasionna une rechute. Des semaines s’écoulèrent avant que je fusse assez forte pour voyager, des semaines et des semaines avant qu’on me permit de visiter sa tombe. Je ne puis que vous répéter ce que m’a dit ma tante. Il a succombé à une maladie de cœur. »
Miss Jethro tressaillit.
Émily la regarda pour la première fois avec une ombre de méfiance dans les yeux.
« Qu’ai-je dit qui ait pu vous étonner à ce point ?
– Rien ; je suis nerveuse par ce temps d’orage, ne faites pas attention à moi. »
Brusquement elle revint à ses questions :
« Pourriez-vous me dire la date exacte du décès de votre père ?
– Certainement. Il a eu lieu le 30 septembre, il y aura bientôt quatre ans… »
Elle attendit une réponse. Miss Jethro demeura silencieuse.
« Et nous sommes aujourd’hui le 30 juin 1881, continua Émily. Maintenant vous voilà au fait. Était-ce mon père que vous connaissiez ? »
Miss Jethro répondit, comme poussée par une sorte d’impulsion machinale, en employant les mêmes termes :
« C’était votre père que je connaissais. »
L’instinct de défiance d’Émily persistait encore.
« Je ne l’ai jamais entendu parler de vous, » dit-elle.
Dans sa jeunesse, l’institutrice avait dû être fort belle. Ses grands traits réguliers donnaient encore l’idée d’un type impérial, quoique décelant peut-être une origine hébraïque. À l’observation d’Émily : « Je ne l’ai jamais entendu parler de vous, » un flot de sang vint colorer ses joues pâles, et ses yeux ternes eurent un rapide éclair. Quittant pour une seconde sa place sur le lit, elle se leva et fit quelques pas afin de dominer l’émotion qui la secouait de la tête aux pieds.
« Que cette nuit est chaude ! » dit-elle avec un soupir.
Puis elle ajouta, sans transition :
« Je ne suis pas surprise que votre père ne m’ait point nommée devant vous. »
Elle prononçait nettement, mais sa figure était devenue plus pâle qu’auparavant, presque livide. Elle se rassit sur le lit.
« Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous avant que je m’en aille, demanda-t-elle, quelque chose qui ne vous imposerait aucune obligation envers moi ? »
Ses yeux noirs, jadis d’une irrésistible beauté, avaient pris une expression de tristesse suppliante, dont Émily fut émue ; la généreuse fille se reprocha d’avoir pu douter de l’amie de son père.
« Est-ce que vous pensez à lui, dit-elle doucement, lorsque vous désirez m’être utile ? »
Miss Jethro ne répondit pas directement.
« Vous aimiez votre père, n’est-ce pas ? dit-elle dans un faible murmure. Vous disiez justement à votre camarade que vous ne pouviez penser à lui sans que votre cœur se gonflât ?
– Je n’ai dit que la vérité, » répliqua simplement Émily.
Miss Jethro frissonna – par cette nuit si chaude – frissonna comme si un courant d’air glacial eût passé sur elle.
Émily étendit la main, les yeux brillants du sentiment affectueux éveillé en elle.
« Je crains de ne pas vous avoir rendu justice, dit-elle ; voulez-vous me pardonner et m’accorder une poignée de main ? »
Miss Jethro se recula brusquement.
« Voyez donc la bougie, » dit-elle vivement.
La bougie était sur le point de s’éteindre, Émily offrit encore sa main ; miss Jethro ne voulut pas la voir.
« Il me reste tout juste assez de lumière pour retrouver mon chemin jusqu’à la porte. Bonne nuit et adieu ! »
Émily avait eu le temps de saisir un pli de sa robe.
« Pourquoi ne voulez-vous pas me donner la main ? » demanda-t-elle.
La mèche de la bougie venait de tomber, les laissant dans les ténèbres. Émily tenait toujours résolument la robe.
Avec ou sans lumière, elle était déterminée à obtenir une explication de miss Jethro.
Elles avaient jusqu’alors parlé d’un ton contenu, de crainte d’éveiller les dormeuses. L’obscurité produisit son effet habituel et leur fit encore baisser la voix.
« Assurément, murmurait Émily, l’amie de mon père doit être mon amie.
– Ne parlons pas de cela.
– Pourquoi ?
– Vous ne pourrez jamais être mon amie.
– Et pourquoi pas ?
– Laissez-moi partir. »
La dignité d’Émily lui interdisait de nouvelles instances.
« Pardon de vous avoir retenue contre votre gré, » dit-elle.
Ses doigts lâchèrent l’étoffe.
De son côté, miss Jethro céda subitement.
« Je regrette d’avoir montré tant d’obstination, reprit-elle ; si vous me méprisez, je n’aurai, après tout, que ce que je mérite… »
Son souffle brûlant passa sur le visage d’Émily ; elle se pencha vers elle comme pour une confession.
« Sachez donc que je suis indigne de votre confiance, indigne de votre amitié.
– Je ne vous crois pas. »
Miss Jethro soupira amèrement.
« Jeune, confiante et généreuse ! Autrefois, j’étais comme vous. »
Elle fit une pause pour comprimer l’explosion de désespoir prête à lui échapper. Au bout d’un instant, elle reprenait d’une voix ferme :
« Qu’il soit donc fait selon votre volonté ! Quelqu’un – j’ignore s’il appartient à cette maison ou s’il est étranger – quelqu’un m’a trahie près de la directrice. Une misérable dans ma situation soupçonne tout le monde sans motif et sans excuse. Je vous ai entendues causer, quand régulièrement vous auriez dû dormir. Vous m’avez toutes en aversion. Qui sait si celle qui m’a dénoncée n’était pas parmi vous ? Supposition absurde pour un esprit bien équilibré ! Je montai la moitié des escaliers, puis, honteuse de moi-même, je retournai dans ma chambre. Que n’ai-je pu y trouver le sommeil ! Enfin, cela ne devait pas être. Mes soupçons me tinrent éveillée, je me levai de nouveau. Vous savez ce que j’ai entendu de l’autre côté de la porte et pourquoi cela m’a intéressée. Votre père ne m’a jamais dit qu’il avait une fille. Miss Brown, ici, était pour moi une miss Brown quelconque ; je n’avais pas le moindre pressentiment de ce que vous étiez. Mais que vous importe tout cela ? Miss Ladd a été miséricordieuse, elle me laisse partir sans me démasquer. Ne devinez-vous pas ce qui est arrivé ?… Non ? Pas encore ?… Est-ce l’innocence ou la bonté qui vous rend la compréhension si lente ? Écoutez ! je n’ai obtenu mon admission dans cette maison respectable qu’au moyen de fausses références, et la fraude s’est découverte. À présent, voyez s’il est possible d’être l’amie d’une femme telle que moi ! Encore une fois, bonne nuit et adieu !
– Dites-moi bonne nuit, mais non pas adieu, repartit Émily. Permettez-moi de vous revoir.
– Jamais ! »
Le bruit d’une porte refermée avec soin retentit faiblement, dans les ténèbres. Elle avait parlé, elle était partie. Émily ne devait plus la rencontrer jamais.
Malheureuse, intéressante, incompréhensible créature ! problème examiné par Émily tant qu’elle ne dormit pas, fantôme de ses rêves dès que le sommeil eut fermé ses yeux.
« Est-elle bonne ou mauvaise ? se demandait la jeune fille. Elle est fausse et vile, puisqu’elle écoutait aux portes ; elle est loyale, puisqu’elle m’a fait cet aveu déshonorant. Une amie de mon père, et elle ignorait qu’il eût une fille ! Intelligente, distinguée, elle s’abaisse à se servir de fausses références ! Qui pourrait concilier de telles anomalies ? »
L’aurore vint éclairer la fenêtre, l’aurore du jour mémorable qui, pour Émily, devait commencer une nouvelle vie. Les années étaient devant elle, et les années, dans leur cours, révèlent les mystères de la mort et de la vie.
CHAPITRE IV LE MAÎTRE DE DESSIN
Francine fut éveillée le lendemain par l’une des bonnes qui lui apportait son déjeuner sur un plateau. Surprise de cet encouragement à la paresse dans une institution consacrée à la pratique de toutes les vertus, elle regarda autour d’elle. Le dortoir était désert.
« Toutes ces demoiselles sont au travail depuis deux heures, miss, dit la bonne, il y a bel âge que le déjeuner est fini. C’est la faute de miss Émily qui n’a pas voulu qu’on vous éveillât, en disant qu’on n’avait pas besoin de vous en bas et que, par conséquent, mieux valait vous traiter comme une visiteuse. Miss Cécilia était tourmentée à l’idée que vous vous passeriez de votre déjeuner, et vous l’a fait réserver par la femme de charge. Excusez, miss, si le thé est froid ; c’est aujourd’hui le grand jour où nous sommes sens dessus dessous.
Interrogée au sujet du « grand jour » et de ce qui allait s’y passer, la bonne apprit à Francine que le premier jour des vacances était aussi le jour de la distribution des prix en présence des parents, tuteurs et amis des élèves. L’agrément y avait sa part sous la forme de cette terrible épreuve de la patience humaine qu’on appelle récitation des poésies ; on avait soin d’ailleurs de couper le supplice par des rafraîchissements et des morceaux de musique, afin de soutenir le courage d’un auditoire exaspéré. Le journal de la localité envoyait un reporter à cette représentation, et quelques-unes des élèves de miss Ladd se délectaient d’avance du bonheur enivrant de voir leurs noms imprimés.
« Cela commence à trois heures, poursuivait la servante, et, avec la musique, les répétitions, la décoration de la salle, il y a de quoi perdre la tête ! Sans compter, ajouta-t-elle en baissant la voix et se rapprochant de Francine, sans compter que nous avons eu une surprise. Miss Jethro est partie ce matin, sans dire adieu à personne !
– Qu’est-ce que c’est que miss Jethro ?
– La nouvelle maîtresse, miss. Aucune de nous ne l’aimait et tout le monde croit qu’il y a quelque chose de louche là-dessous. Miss Ladd et le clergyman ont eu hier une grande conversation et ils ont fait venir miss Jethro ; ça n’a guère bonne apparence, n’est-ce pas ? Y a-t-il encore quelque chose pour votre service, miss ? Il fait une journée superbe après la pluie de cette nuit ; si j’étais que de vous, j’en profiterais pour aller me promener dans le jardin. »
Ayant fini de déjeuner, Francine s’apprêta à suivre ce sage conseil.
La domestique indiqua à Francine la direction du jardin et se retira, n’emportant point, de la nouvelle élève, une impression très favorable. Pendant qu’elle lui parlait, l’amertume se lisait trop clairement sur le visage de Francine : pour une jeune fille qui a d’elle-même une assez bonne opinion, il est peu flatteur de se voir exclue des préoccupations de ses camarades à cause de son incontestable infériorité.
Y aura-t-il jamais un jour, se demandait-elle douloureusement, où je pourrai, moi aussi, recevoir des prix, chanter et jouer devant une assemblée ? Quel plaisir ce serait de les voir toutes sécher de jalousie !
Une vaste pelouse, ombragée par de beaux arbres, des parterres et des bosquets, avec des sentiers sinueux gracieusement dessinés, faisait du jardin un délicieux refuge pendant cette belle matinée d’été. Le paysage, tout nouveau pour une originaire des Indes occidentales, et la fraîcheur de la brise exercèrent leur influence calmante même sur la nature maussade de Francine. Elle souriait involontairement en écoutant les oiseaux chanter à plein gosier au-dessus de sa tête.
En errant sous les arbres, qui occupaient un espace de terrain assez considérable, elle découvrit un ancien vivier presque entièrement recouvert de plantes aquatiques. Quelques filets d’eau coulaient encore de la fontaine délabrée qui en occupait le centre. De l’autre côté de la pièce d’eau, le sol descendait en pente vers le sud, découvrant la vue d’un village qui, avec son église, se détachait sur un fond de collines couvertes de bruyères et de sapins. Une petite construction de fantaisie, ayant la forme d’un chalet suisse, avait été placée de façon à dominer la perspective. Tout près de ce kiosque et à son ombre se trouvaient une table et une chaise, portant l’une un portefeuille, l’autre une boîte à couleurs. Sur le gazon, à la merci des caprices de la brise, gisait un morceau de papier à dessin. Francine fit en courant le tour de la mare et ramassa le papier au moment où le vent allait l’emporter dans l’eau. C’était une esquisse à l’aquarelle du village et du bois. Francine, qui avait regardé le paysage même avec une parfaite indifférence, fut intéressée par la copie. Les visiteurs des galeries de tableaux manifestent ce même goût pervers : l’œuvre du copiste accapare si bien leur attention qu’il ne leur en reste plus pour l’original.
Francine, en levant les yeux de dessus l’esquisse, eut un tressaillement. Elle venait de s’apercevoir qu’un homme l’examinait d’une des fenêtres du chalet suisse.
« Quand vous aurez fini avec ce dessin, lui dit-il tranquillement, vous voudrez bien me le rendre. »
Il était grand, mince et très brun. Sa figure, aux traits réguliers, à demi dissimulés sous une barbe noire et bouclée, aurait paru parfaitement belle, même aux yeux d’une pensionnaire, sans les rides profondes qui lui sillonnaient le front entre les yeux et lui creusaient les coins de la bouche. De plus, une sorte d’ironie perpétuelle altérait le charme de manières naturellement douces. Seuls, dans tout ce qui l’entourait, les chiens et les enfants savaient apprécier pleinement ses mérites. Il s’habillait avec une irréprochable propreté ; mais la coupe de son veston du matin manquait d’élégance et son chapeau de feutre avait atteint un âge avancé. Bref, pas une de ses qualités qui ne fût accompagnée d’un défaut. C’était un de ces hommes inoffensifs, malchanceux, auxquels le succès et l’art de plaire semblent à jamais refusés.
Francine lui tendit son dessin, sans savoir s’il avait voulu plaisanter ou parler sérieusement.
« Je ne me suis permis d’y toucher, dit-elle, que parce que je le voyais en danger.
– Quel danger ? »
Le doigt de Francine désignait la mare.
« Si je n’étais pas arrivée à temps, il serait tombé dans l’eau.
– Croyez-vous donc qu’il vaille la peine que vous avez prise ? »
Tout en parlant, ses yeux allaient de l’esquisse au paysage qu’elle représentait, et les coins de sa bouche se relevaient avec une expression moqueuse.
« Madame la Nature, dit-il, je vous demande pardon ! »
Après quoi, il déchira « l’œuvre d’art » en menus morceaux, qu’il lança par la fenêtre.
« C’est dommage ! » dit Francine.
Il vint la rejoindre sur la pelouse qui faisait face au cottage.
« Qu’est-ce qui est dommage ?
– D’avoir déchiré ce joli dessin.
– Ce n’était pas du tout un joli dessin.
– Vous n’êtes guère poli, monsieur. »
Il la regarda avec une sorte de compassion, comme s’il se fût attristé qu’une créature aussi jeune fût si prompte au dépit. Quant à lui, même dans ses accès d’humeur contredisante, il conservait toujours l’accent d’une calme politesse.
« Parlez franchement, miss, reprit-il, je viens d’offenser votre sentiment dominant, l’amour-propre. Vous n’aimez pas qu’on vous dise, même indirectement, que vous n’entendez rien à l’art. Maintenant tout le monde se connaît à tout. La grande passion du monde civilisé, c’est la vanité. Vous pouvez offenser votre meilleur ami sur bien des points de sentiment, et obtenir pourtant votre pardon ; mais si par malheur, il vous arrive de froisser son amour-propre, la brouille amenée entre vous par cette inadvertance durera jusqu’à la fin de vos jours. Excusez-moi de vous faire partager le bénéfice de mon expérience. C’est la forme de vanité qui m’est personnelle. Puis-je d’ailleurs vous être utile en quelque façon ? Cherchez-vous l’une de ces demoiselles ? »
Quand il parla de « ces demoiselles », Francine sentit s’éveiller en elle une sorte d’intérêt, elle s’informa s’il faisait partie de la pension.
Ses lèvres se relevèrent de nouveau avec leur pli ironique.
« Je suis un des maîtres, dit-il. Allez-vous également appartenir à la pension ? »
Francine inclina la tête avec un mélange de gravité et de condescendance destiné à le retenir à sa place.
Loin d’accepter cette leçon tacite, il se permit de nouvelles libertés.
« Aurez-vous le malheur de devenir une de mes élèves ? demanda-t-il.
– Je ne sais pas qui vous êtes.
– Vous ne serez guère plus avancée quand vous le saurez. Je m’appelle Alban Morris.
– Je veux dire, reprit Francine, que je ne sais pas ce que vous enseignez. »
Alban Morris indiqua du geste les fragments épars de son croquis d’après nature.
« Je suis un méchant artiste, répliqua-t-il. Quelques méchants artistes deviennent membres de l’Académie royale. D’autres se mettent à boire. D’autres attrapent une pension. D’autres enfin – je suis de ceux-là – trouvent un refuge dans l’enseignement. Ici le dessin est un extra. Voulez-vous un bon conseil ? Ménagez la bourse de votre excellent père. Dites que vous n’avez pas envie d’apprendre à dessiner. »
Il paraissait si convaincu que Francine éclata de rire.
« Vous êtes un original, dit-elle.
– Vous vous trompez encore, miss, je suis un homme malheureux. »
Les rides du visage d’Alban se creusèrent, la flamme ironique de son regard s’éteignit. Il se retourna du côté de la maison pour y prendre une pipe et une blague à tabac sur le rebord de la fenêtre.
« J’ai perdu mon seul ami l’année dernière, dit-il. Depuis la mort de mon chien, la pipe est la seule compagnie qui me reste. Naturellement, il ne m’est pas permis de jouir de la société de cet excellent camarade en présence des dames. Elles ont leurs goûts particuliers en fait de parfums. Leurs vêtements sont imprégnés de l’odeur fétide du musc. Celle du tabac leur semble intolérable. Permettez-moi de me retirer, en vous remerciant des peines que vous vous êtes données pour sauver mon croquis. »
L’accent avec lequel il exprima sa gratitude piqua Francine.
« J’ai eu tort d’admirer votre dessin, dit-elle, j’ai eu tort de vous croire un original ; ai-je tort une troisième fois en supposant que vous n’aimez pas les femmes ?
– Je regrette d’avoir à reconnaître que vous êtes dans le vrai, répondit gravement Alban Morris.
– N’y a-t-il pas d’exception ? pas une seule exception ? »
Ces mots avaient à peine dépassé ses lèvres qu’elle s’aperçut, à l’expression du visage de son interlocuteur, qu’elle venait de rouvrir une plaie secrète. Ses sourcils noirs se contractèrent et ses yeux perçants lui lancèrent un regard de colère. Cela ne dura qu’une seconde. Levant son chapeau de feutre, il lui fit un profond salut.
« J’ai gardé un point vulnérable, et vous venez de le toucher, dit-il. Bonsoir ! »
Avant qu’elle pût lui répondre, il avait tourné le coin de la maison et disparu dans un bosquet, à l’autre extrémité de la pelouse.
CHAPITRE V DÉCOUVERTES DANS LE JARDIN
Laissée à elle-même, miss de Sor revint sous les arbres.
Son entretien avec le maître de dessin avait eu cela de bon qu’il l’avait aidée à tuer le temps. Quelques jeunes filles auraient trouvé fort ardue la tâche de porter un jugement précis sur le caractère d’Alban Morris. Francine, observatrice fort superficielle, le déclara « un peu timbré » et s’en tint là, à son entière satisfaction.
Revenue à son point de départ, elle aperçut Émily, qui allait et venait, la tête baissée, l’air absorbé. Pleine d’elle-même et de sa propre importance comme l’était Francine, elle eût passé indifférente auprès de toute autre jeune fille, à moins d’en avoir reçu des avances particulières. Mais elle s’arrêta pour examiner Émily.
C’est, généralement, la cruelle destinée des petites femmes de devenir trop grosses et de naître avec des jambes trop courtes. La taille svelte d’Émily semblait défier le premier de ces désastres, et il lui suffisait de traverser une chambre pour prouver que le second ne l’avait pas atteinte. La nature l’avait construite, de la tête aux pieds, sur un modèle de proportions irréprochables. La dimension importe peu, quant au résultat, pour les femmes qui ont la bonne fortune de posséder une structure régulière. Lorsqu’elles atteignent la vieillesse, il leur arrive souvent d’étonner les hommes qui marchent derrière elles dans la rue. « Ma parole ! elle avait la tournure aussi souple que celle d’une jeune fille ; il me tardait de voir sa figure : soixante-dix ans pour le moins ! et des cheveux tout blancs ! »
Francine, poussée par une impulsion amicale des plus rares chez elle, aborda Émily.
« Vous paraissez triste, dit-elle ; sûrement ce ne peut être le regret de quitter la pension ? »
Disposée comme elle l’était en ce moment, Émily saisit avec empressement cette occasion de rembarrer Francine.
« Vous êtes dans l’erreur, répondit-elle. J’ai justement trouvé à la pension la meilleure des amies, Cécilia. En outre, la vie de pension et le changement qu’elle entraînait dans mes habitudes m’ont aidée à supporter le chagrin de la perte de mon père. J’ai l’air troublée, s’il vous plaît de le savoir, parce que je pensais à ma tante. Elle n’a pas répondu à ma dernière lettre, et je commence à craindre qu’elle ne soit malade.
– J’en suis fâchée, dit Francine.
– Pourquoi ? Vous ne connaissez pas ma tante, et moi vous ne me connaissez que d’hier. Pourquoi donc seriez-vous fâchée ? »
Francine resta muette. Sans bien s’en rendre compte, elle commençait à subir l’influence exercée par Émily sur toutes les natures mises en contact avec elle. Se sentir attirée vers une étrangère, une pauvre créature forcée de gagner sa vie, était pour miss de Sor une énigme qui la remplissait de perplexité. Ayant vainement attendu une réponse, Émily reprit sa marche et les réflexions que sa camarade avait interrompues.
Par un enchaînement d’idées bizarre, elle passa du souvenir de sa tante à celui de miss Jethro. L’entrevue de la nuit précédente lui revenait sans cesse à l’esprit.
Par instinct plutôt que par raisonnement, elle avait tenu secret cet étrange incident. Aucun soupçon au sujet de miss Jethro n’avait transpiré dans la pension. Miss Ladd, entourée de son état-major de professeurs et de sous-maîtresses, n’avait fait allusion à l’affaire que dans les termes les plus mesurés : « Des circonstances d’une nature toute privée ont obligé miss Jethro à quitter mon institution. Quand nous nous retrouverons à la fin des vacances, une autre personne l’aura remplacée. »
C’est à cela que s’étaient bornées les explications de miss Ladd. Les questions adressées aux domestiques n’avaient pas abouti à un résultat plus satisfaisant. Les bagages de miss Jethro devaient être expédiés à une des gares de Londres, et miss Jethro elle-même avait dérouté toutes les investigations en s’éloignant à pied.
Pour Émily, l’intérêt que lui inspirait l’institutrice n’était pas de pure curiosité ; elle désirait sincèrement revoir la mystérieuse amie de son père. Elle se disait que sa tante pourrait peut-être la mettre sur ses traces. Les détours du sentier ramenèrent Émily en face de Francine.
Celle-ci, qui méditait encore sur la réception peu encourageante qui avait accueilli ses premiers essais de conversation et qui, cependant, se sentait dominée par un invincible attrait, interpréta le retour d’Émily comme une sorte d’excuse. S’approchant avec un sourire contraint, elle lui adressa de nouveau la parole.
« Que font donc toutes ces demoiselles dans la salle d’études ? »
La figure d’Émily prit cet air étonné qui dit si clairement aux importuns : Ne comprenez-vous pas que je désire être tranquille ?
Mais Francine était absolument insensible aux rebuffades de ce genre ; l’épaisseur de son épidémie la mettait à l’abri.
« Pourquoi n’allez-vous pas les aider ? poursuivit-elle, vous la meilleure tête de toutes, la plus lucide, celle à qui chacun s’empresse d’obéir ? »
C’est peut-être une chose humiliante à confesser, mais il est certain que tous nous sommes accessibles à la flatterie. Les goûts étant divers, il est diverses façons de brûler l’encens, mais le parfum est toujours agréable à toutes les variétés de nez. La façon de Francine produisit un effet calmant sur Émily. Elle répondit plus doucement :
« Miss de Sor, je n’ai rien à faire dans tout cela.
– Rien à faire ! Vous n’avez rien à recevoir ?
– J’ai reçu tous les prix depuis des années.
– Mais il y a des récitations. Sûrement vous récitez aussi ? »
Paroles inoffensives en elles-mêmes, mais Francine n’avait pas de chance : après avoir irrité Alban Morris, voilà qu’elle offensait Émily !
« Qui vous a dit cela ? s’écria la jeune fille ; j’insiste pour le savoir !
– Personne ne m’a rien dit, répliqua Francine.
– Personne ne vous a dit l’injure qui m’a été faite ?
– Non, vraiment. Oh ! miss Brown, qui pourrait jamais se permettre de vous faire injure ?
– Le croiriez-vous ? On m’a interdit de prendre part à la récitation, à moi la première de la classe ! C’est arrivé il y a un mois, quand on préparait le programme. Miss Ladd me demanda si j’avais choisi la poésie que je devais dire. Je répondis : « Non seulement le morceau est choisi, mais je le sais déjà par cœur. – Qu’est-ce donc ? – La scène du poignard dans Macbeth. » Là-dessus, il y a eu un véritable hurlement, je n’ai pas d’autre mot, un véritable hurlement d’indignation. Était-ce possible ! le monologue d’un homme, et d’un homme qui est un assassin, récité par une élève de miss Ladd, devant une assemblée de parents et de tuteurs ! – Mais je n’ai pas démordu, je suis restée ferme comme un roc. – Je dirai la scène du poignard ou je ne dirai rien. C’est la deuxième alternative qui a été acceptée. L’insulte est pour Shakespeare aussi bien que pour moi. Ah ! j’étais si remplie de mon sujet ! J’aurais été un Macbeth effrayant ! Je commençais, avec des yeux égarés et une voix sourde : « Est-ce un poignard que je vois ?… »
Émily, qui, en récitant, regardait vaguement du côté des arbres, tressaillit tout à coup et, quittant brusquement le rôle de Macbeth, elle redevint elle-même, avec des joues très rouges et une flamme de courroux dans les yeux.
« Pardon, dit-elle, je ne saurais me fier à ma mémoire, il faut que j’aille chercher la pièce. »
Sans plus rien ajouter, elle s’éloigna du côté de la maison.
Quelque peu surprise, Francine jeta les yeux autour d’elle et aperçut sous les arbres, lui aussi en pleine retraite, l’excentrique professeur de dessin, Alban Morris.
Admirait-il également la scène du poignard, mais par une réserve discrète, désirait-il l’entendre sans se montrer ? En ce cas, pourquoi Émily, qui ne péchait certes pas par un excès de défiance d’elle-même, avait-elle déserté le jardin dès qu’elle avait découvert sa présence ? Pourquoi ?… Un sourire malicieux se dessina sur les traits de Francine.
Au même instant, la douce Cécilia arrivait à son tour près de la pelouse. Charmante apparition, avec son chapeau de paille, sa robe blanche et son bouquet de fleurs au corsage.
« Il fait si chaud dans la salle d’études, dit-elle, et quelques-unes des pensionnaires – les pauvres petites ! – sont tellement maussades, après la répétition, que je me suis échappée. J’espère qu’on vous a donné à déjeuner, miss de Sor ? À quoi vous êtes-vous amusée ici, toute seule ?
– J’ai fait une fort intéressante découverte, répliqua Francine.
– Une découverte fort intéressante dans notre jardin ! Qu’est-ce que ça peut bien être ?
– Le maître de dessin, ma chère, est amoureux d’Émily. Peut-être qu’elle ne se soucie pas de lui. Peut-être aussi que j’ai été l’innocent obstacle qui a troublé leur rendez-vous. »
Cécilia avait largement déjeuné de son plat favori, des œufs sur le plat ; elle était de charmante humeur.
« Chut ! fit-elle, en cachant à demi sa délicieuse figure derrière son éventail ; chut ! il nous est interdit de parler d’amour ou d’amoureux ! si pareil bruit venait aux oreilles de miss Ladd, le pauvre M. Morris pourrait perdre sa place.
– Mais est-ce que ce n’est pas vrai ? demanda Francine.
– Il se peut que ce soit vrai, ma chère, seulement personne n’en sait rien. Émily ne nous en a jamais soufflé mot, et je ne sache pas que M. Morris ait fait part à un confident de son secret. De temps en temps, nous le surprenons à la contempler, voilà tout.
– Avez-vous rencontré Émily en descendant au jardin ?
– Oui, et elle a passé près de moi sans me dire un mot.
– Elle était sans doute absorbée par la pensée de M. Morris. »
Cécilia secoua la tête.
« Je crois bien, Francine, qu’elle pensait surtout à l’avenir qui s’ouvre devant elle. Vous a-t-elle dit, la nuit dernière, quels sont ses projets en quittant la pension ?
– Elle m’a dit que vous aviez été très bonne pour elle. J’en aurais appris davantage, je crois, si je ne m’étais pas endormie. Que va-t-elle faire ? »
Cécilia répondit :
« Pauvre Émily ! elle va vivre dans une maison triste et maussade ! Il lui faudra écrire et traduire pour un savant qui étudie des inscriptions hiéroglyphiques – c’est, je crois, ainsi qu’on les appelle – découvertes dans les ruines de l’Amérique centrale. C’est une perspective qui n’a rien de gai. Émily, cependant, ne fait qu’en rire. « Je prendrai tout plutôt qu’une place de gouvernante, répète-t-elle. Les enfants qui recevraient de moi leur enseignement seraient vraiment trop à plaindre ! » Elle m’a suppliée de l’aider à gagner sa vie. J’ai donc écrit à papa. Il est membre du parlement, et tous ceux qui ont besoin d’une place sont convaincus qu’il est de son devoir de la leur procurer. Il se trouva qu’un de ses anciens amis, un certain sir Jervis Redwood, était à la recherche d’un secrétaire. Comme il favorise l’effort tenté par les femmes pour occuper des emplois d’homme, sir Jervis n’avait pas de répugnance à essayer d’une « femelle », selon sa gracieuse expression. C’est là, n’est-ce pas, une jolie manière de parler de nous ? Miss Ladd assure d’ailleurs que c’est incorrect. Papa avait déjà répondu qu’il ne connaissait personne qui pût convenir. Après avoir reçu ma lettre où je lui recommandais Émily, il écrivit de nouveau. Dans l’intervalle, sir Jervis s’était vu adresser deux offres de services ; toutes deux venaient de vieilles dames, toutes deux avaient été refusées…
– Parce que les postulantes étaient vieilles ? demanda Francine.
– Vous allez l’entendre lui-même donner ses raisons ; papa m’a envoyé un extrait de sa lettre, qui m’a mise dans une colère bleue. C’est justement à cause de cela qu’il me sera facile de vous répéter ses paroles textuelles : « Nous sommes quatre vieilles gens dans la maison et nous n’avons pas besoin d’une cinquième. Une jeunesse ? à la bonne heure ! elle nous égayera. Si l’amie de votre fille accepte mes conditions et si elle n’est pas encombrée d’un amoureux, je l’enverrai chercher au commencement des vacances. » Quel langage égoïste et grossier, n’est-ce pas ? Mais Émily n’a pas été de mon opinion quand je lui ai montré la lettre, et elle a pris la place proposée, au grand chagrin de sa tante. Maintenant que le moment de partir est arrivé, quoique la pauvre chère ne veuille pas en convenir, je pressens qu’un tel avenir l’effraye.
– Très probablement, dit Francine, qui jugea superflu de manifester la moindre sympathie. Mais, dites-moi, quelles sont donc les quatre vieilles gens dont parle la lettre ?
– D’abord sir Jervis, soixante-dix ans à son dernier anniversaire ; ensuite sa sœur, non mariée, qui en a près de quatre-vingts. Ensuite son domestique, M. Rook, qui a passé la soixantaine. Puis enfin la femme de ce domestique, laquelle se considère comme une jeune ingénue, attendu qu’elle n’a que quarante ans. Voilà la maisonnée. Mistress Rook doit venir aujourd’hui même prendre Émily pour l’emmener dans le Nord, et je ne suis pas du tout sûre que cette compagne de voyage soit du goût de mon amie.
– C’est donc une femme désagréable ?
– Non, pas exactement. Plutôt bizarre et fantasque. Le fait est que mistress Rook a eu ses peines et qu’elles l’ont un peu détraquée. Elle et son mari tenaient l’auberge du village tout près de notre parc ; nous les connaissions très bien. Certainement je les plains, ces pauvres gens… Que regardez-vous, Francine ? »
Ne prenant pas le moindre intérêt aux affaires de M. et Mme Rook, Francine étudiait la charmante figure de sa camarade dans l’espoir d’y trouver des défauts. Elle venait de constater que Cécilia avait les yeux placés trop loin l’un de l’autre, et que son menton manquait de force et de caractère.
« J’admirais votre fraîcheur, ma chère, reprit-elle froidement ; mais pourquoi donc plaignez-vous les Rook ?
– Ils ont été obligés, déjà vieux, de se mettre en service, à la suite d’un malheur dont ils n’étaient nullement responsables. Les chalands désertèrent tout à coup l’auberge, et M. Rook fit faillite. Cette auberge était perdue de réputation, à cause d’un meurtre qui s’y était commis.
– Un meurtre !… Ah ! voilà qui devient intéressant ! s’écria Francine ; pourquoi ne me le disiez-vous pas plus tôt ?
– Je n’y pensais pas, dit Cécilia.
– Continuez ! Étiez-vous chez vos parents quand c’est arrivé ?
– Non, j’étais ici.
– Vous l’avez lu dans les journaux, alors ?
– Miss Ladd ne nous permet pas de lire les journaux, ce sont les lettres de la maison qui m’ont mise au courant. Non pas qu’on m’en ait parlé longuement ; on me disait que c’était trop affreux pour être décrit. Le pauvre gentleman… »
Francine parut réellement émue.
« Un gentleman ! s’écria-t-elle, c’est horrible !
– Le pauvre homme était étranger au pays, reprit Cécilia, et la police était embarrassée pour déterminer le motif du crime. C’est vrai que son portefeuille avait disparu ; mais la montre et ses bijoux furent retrouvés sur le corps. Je me rappelle les initiales de son linge, parce qu’elles étaient les mêmes que celles de ma mère avant son mariage : J. B. Réellement, Francine, voilà tout ce que je sais.
– Mais vous savez pourtant si on a découvert l’assassin ?
– Oui, je sais cela. Le gouvernement offrit une récompense ; des détectives très habiles furent envoyés de Londres pour venir en aide à la police locale. Tout cela n’aboutit à rien. Le meurtrier est toujours resté inconnu.
– À quelle époque a eu lieu l’événement ?
– En automne.
– L’automne de l’année dernière ?
– Non, non ! il y aura bientôt quatre ans. »
CHAPITRE VI SUR LA ROUTE DU VILLAGE
Alban Morris, aperçu par Émily se dissimulant derrière les arbres, ne s’était pas contenté de se retirer dans une autre partie du jardin. Il avait poussé sa fuite, sans se soucier de la direction qu’il prenait, jusqu’à un sentier qui, coupant à travers champs, le menait à la grande route et de là à la station du chemin de fer.
Le professeur de dessin de miss Ladd était dans cet état d’irritabilité nerveuse qui cherche dans la rapidité de la marche un soulagement à sa souffrance. L’opinion publique du voisinage, surtout l’opinion publique représentée par les femmes, avait décidé depuis longtemps que ses manières étaient défectueuses et son caractère d’une incurable maussaderie. Les hommes qu’il croisait dans le sentier ne lui accordaient qu’un « bonjour » prononcé de fort mauvaise grâce. Les femmes ne paraissaient pas même le voir. Il y en eut une cependant, celle-là jeune et d’humeur folâtre, qui, le voyant marcher à toutes jambes dans la direction de la gare, lui cria de loin :
« Ne vous pressez pas si fort, monsieur, vous avez tout le temps d’arriver pour le train de Londres. »
Elle fut très surprise de le voir s’arrêter. Sa réputation d’impolitesse était si bien établie, qu’elle se hâta de mettre entre eux une grande distance avant d’oser le regarder. Il ne faisait pas attention à elle, il semblait discuter avec lui-même. La jeune étourdie venait de lui rendre un service, elle lui avait suggéré une idée.
« Si j’allais à Londres ? pensait-il. Pourquoi pas ? Le pensionnat se disperse pour les vacances, et elle s’en va comme les autres. »
Il se détourna pour regarder du côté de l’établissement de miss Ladd.
« Si je retourne là-bas pour lui dire adieu, elle se tiendra à l’écart jusqu’à la dernière minute et à peine si j’obtiendrai un salut. Après mon expérience des femmes, redevenir amoureux, amoureux d’une jeune fille dont je pourrais être le père ! Quelle honteuse folie ! »
Des larmes brûlantes montaient aux yeux d’Alban. Il les essuya d’un geste farouche et se remit en marche, bien décidé à retourner faire ses paquets pour partir ensuite par le premier train.
À l’extrémité du sentier, il s’arrêta de nouveau.
Ce qui causait cette halte, c’était encore une personne de ce sexe dont la vue réveillait en son âme le souvenir de si cruelles injures. Mais c’était une toute petite personne, misérablement vêtue, et sanglotant amèrement sur les débris d’une cruche cassée.
Alban Morris la contemplait avec son sourire sardonique.
« Vous avez donc cassé votre cruche ? dit-il.
– Et renversé toute la bière du père ! » répondit l’enfant.
Son pauvre petit corps tremblait d’épouvante.
« La mère va me battre quand je rentrerai chez nous, ajouta-t-elle.
– Et que fait votre mère quand vous rapportez la cruche en bon état ?
– Elle me donne une tartine de beurre.
– Très bien. Maintenant, écoutez : la mère vous donnera une tartine de beurre. »
La fillette le regardait avec des yeux ronds tout pleins de larmes. Alban poursuivit, sans se départir de sa gravité :
« Vous comprenez ce que je vous dis ?
– Pas très bien, monsieur.
– Avez-vous un mouchoir de poche ?
– Non, monsieur.
– Alors séchez vos yeux avec le mien. »
Il lui jeta son mouchoir d’une main, tandis qu’il ramassait de l’autre un fragment de poterie. « Cela nous servira de modèle, » marmottait-il.
L’enfant, après avoir examiné tour à tour Alban et son mouchoir, prit courage et frotta vigoureusement ses paupières humides. L’instinct, qui vaut toute la raison qu’ait jamais prétendu posséder l’humanité, cet instinct infaillible, disait à la petite créature ignorante qu’elle avait trouvé un ami. Elle rendit gravement son mouchoir à Alban, qui la prit dans ses bras.
« Là, maintenant, vos yeux sont secs et votre figure est présentable, dit-il. Voulez-vous m’embrasser ? »
L’enfant lui mit sur la joue un baiser sonore.
« Très bien ! allons chercher une autre cruche, » ajouta-t-il en la laissant glisser à terre.
La petite secoua la tête d’un air inquiet.
« Est-ce que vous avez assez d’argent ? » demanda-t-elle.
Alban tapa sur sa poche.
« Et de reste ! fit-il.
– Oh ! alors, je suis bien contente, reprit la petite ; venez ! »
Et, la main dans la main, tous deux s’en allèrent au village, et achetèrent une cruche, qu’ils firent remplir au cabaret.
Le père altéré travaillait aux champs où l’on établissait des tuyaux de drainage, et Alban porta la cruche jusqu’à ce que l’on fût en vue du journalier.
« Faites bien attention à présent de ne plus la laisser tomber, dit-il ; mais qu’est-ce que vous avez ?
– J’ai peur.
– Pourquoi ?
– Oh ! donnez-moi la cruche ! »
Elle la lui arracha presque des mains. Il n’y avait plus une minute à perdre, ou une autre réserve de coups l’attendait dans le champ : le père n’était pas tendre pour sa progéniture quand cette progéniture tardait à lui apporter ses rafraîchissements. Pourtant, la fillette, au moment de s’échapper, se rappela les lois de la politesse enseignées à l’école et fit une petite révérence écourtée, en disant : « Merci, monsieur. » Le souvenir amer de l’injure subie revint assaillir Alban tandis qu’il la regardait s’éloigner. « Quel dommage qu’elle grandisse pour devenir une femme ! » pensait-il.
L’aventure de la cruche cassée avait retardé d’une demi-heure son retour au logis. Quand il revint à la grand’route, le train du Nord venait d’entrer en gare et, au bout d’une minute, la cloche annonçait qu’il était reparti vers Londres.
Une des voyageuses qui venait d’en descendre ne devait pas, s’il fallait en juger par le sac de voyage qu’elle tenait à la main, demeurer longtemps dans le village.
Comme elle s’avançait de son côté, il remarqua que c’était une petite femme maigre et leste, vêtue de couleurs criardes assemblées par un goût déplorable. À mesure qu’Alban se rapprochait d’elle, il distinguait mieux son visage, dont un nez aquilin était le trait le plus frappant. Peut-être aussi ce nez avait-il été en proportion avec le reste de la figure au temps de sa jeunesse, alors que les joues possédaient des contours potelés et arrondis. Probablement myope, la femme clignait légèrement ses yeux cerclés de fines petites rides. Mais ces rides, à coup sûr, elle ne voulait pas les voir. Ses cheveux étaient évidemment teints, et elle portait coquettement, sur l’oreille, son chapeau orné d’une plume. Elle marchait d’un pas vif, en balançant son sac et en redressant la tête. Sa tournure comme sa toilette disaient aussi clairement que l’eût pu faire sa voix : « Peu importe combien d’années j’ai vécu ! j’entends rester jeune et charmante jusqu’à la fin de mes jours. »
À la grande surprise d’Alban, elle l’interpella au passage.
« Pardon, pourriez-vous m’indiquer le chemin de la pension de miss Ladd ? »
Elle parlait avec une rapidité nerveuse et un sourire singulièrement déplaisant. Ce sourire divisait ses lèvres minces juste assez pour laisser voir de trop belles dents, d’un éclat suspect. Elle ouvrait les yeux de la façon la plus étrange ; sa paupière supérieure s’élevait, découvrant toute la prunelle, et lui donnait ainsi non pas l’air d’une femme qui cherche à se rendre agréable, mais tout au contraire la physionomie d’une femme saisie de terreur.
Alban, peu soucieux de dissimuler l’impression défavorable que la femme avait produite sur lui, répondit d’un ton bref : « Tout droit ! » et voulut passer.
Elle l’arrêta d’un geste péremptoire.
« Je vous ai parlé poliment, dit-elle, et comment me répondez-vous ? Ça ne m’étonne pas d’ailleurs. Les hommes sont tous plus ou moins brutes de leur naturel, et vous êtes un homme. « Tout droit ! » répétait-elle d’un ton méprisant. Je voudrais savoir comment ce beau conseil pourrait servir dans un endroit qu’on n’a jamais vu. Peut-être que vous ne connaissez pas plus que moi la maison de miss Ladd, ou que vous ne voulez pas vous donner la peine de me répondre. C’est ce que j’aurais dû attendre d’un individu de votre sexe. Bonjour. »
Alban fut sensible au reproche. La femme avait fait appel à une faculté qui ne s’engourdissait guère chez lui : le sens humoristique ; cela l’amusait de voir sa propre aversion contre les femmes reflétée dans l’hostilité de l’étrangère contre les hommes. En guise d’excuses, il s’empressa de lui fournir toutes les indications désirables, puis voulut de nouveau s’éloigner, mais en vain. Il avait regagné l’estime de son interlocutrice, et elle n’en avait pas fini avec lui.
« Vous connaissez très bien le pays, dit-elle ; je me demande si vous savez aussi quelque chose de la pension. »
Aucune intonation dans le son de sa voix, aucun changement dans ses manières ne trahissait une arrière-pensée chez la questionneuse. Alban était sur le point de l’engager à se rendre directement à la pension où elle pourrait faire elle-même son enquête, lorsqu’il remarqua ses yeux. Jusqu’alors elle l’avait regardé bien en face ; maintenant elle examinait la poussière du sol. Ce pouvait être un pur hasard ; selon toutes probabilités cela ne signifiait absolument rien, et cependant cela éveilla sa curiosité.
« Je dois en effet connaître quelque chose de la pension, répondit-il, j’y suis professeur.
– Alors vous êtes l’homme qu’il me faut. Puis-je vous demander votre nom ?
– Alban Morris.
– Merci. Moi, je suis mistress Rook. Je suppose que vous avez entendu parler de sir Jervis Redwood ?
– Non.