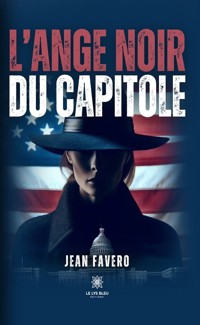Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’épouse du plus grand promoteur de la côte est des États-Unis est assassinée. Sur son corps est posée une image de la Vierge Marie, signature du « tueur à la Vierge » qui a sévi quatre ans auparavant. Ce nouveau meurtre fait resurgir, chez le lieutenant Mike Perugiano, tous ses démons, ses doutes, et l’échec de n’avoir pu arrêter l’assassin. Y a-t-il dans ce crime de nouveaux indices pour le confondre ? C’est alors que, dans un message macabre, le serial killer propose à Mike un marché impossible…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Favero a toujours été passionné par le roman noir et l’intrigue policière. Bien qu’ayant été bercé dans sa jeunesse par les grands auteurs comme Chase, Chandler et autres, il est friand des plus récents tels que Coben, Chattam, Elroy… À la suite d’une carrière de chercheur au CNRS et comme conseiller scientifique dans les Ambassades de France à Varsovie, Rome et Washington, il se lance dans l’aventure littéraire et signe avec
Je vous salue Marie… son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Favero
Je vous salue Marie…
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean Favero
ISBN : 979-10-377-6585-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
Sénèque
Chapitre 1
Il était tard, je finissais une journée harassante à écrire des rapports sur des affaires mineures et sans intérêt. Pour couronner le tout, en fermant la porte de mon bureau je me suis fait agresser par un travesti qui venait de se faire embarquer pour prostitution et scandale sur la voie publique. Il était complètement shooté et il avait besoin de passer ses nerfs sur quelque chose ou sur quelqu’un. Après avoir démoli le tiroir d’un bureau resté ouvert, il a dû trouver que je représentais une cible idéale à son défoulement et son pied armé d’un talon aiguille a fusé en direction des parties les plus fragiles de mon anatomie. Heureusement que dans un réflexe j’ai pu éviter le pire et que l’énorme paluche de mon collègue a définitivement calmé ses ardeurs. Vu l’état de sa joue qui semblait vouloir faire la nique à celles de Dizzi Gillespie en pleine action, je crains qu’il soit obligé de se mettre, pour quelque temps, au chômage technique de racoleur de charme. Comme un automate bien réglé, je suis allé récupérer ma voiture au deuxième sous-sol. Ma seule envie, rentrer chez moi, me mettre à l’aise, décompresser en dégustant un bon whisky, avant d’avaler un repas imposé par les quelques restes dispersés dans mon réfrigérateur. Je suis sorti du parking souterrain du bâtiment abritant le poste de police, et me suis engagé dans l’avenue déjà encombrée de voitures des employés quittant leur boulot. J’étais resté enfermé toute la journée dans mon bureau, frigorifié par une clim fonctionnant à plein régime sans aucune possibilité de la couper. On était équipé de vieux appareils qui faisaient un bruit infernal et le mien, placé à hauteur de mon bureau, juste en face de moi, m’envoyait son air vicié en pleine figure, me desséchant les yeux, ce qui n’arrangeait pas le port de mes lentilles de contact. Avec ces vieux engins, il y avait des chances que je me chope la légionellose ! Je détestais la clim ! Comme pour me venger de ces engins malfaisants, je roulais lentement avec les vitres ouvertes pour respirer l’air pur dont j’avais été privé pendant une grande partie de ma journée et pour mieux apprécier la tiédeur de ces jours de la fin avril. J’aimais cette période de l’année où la chaleur, sans être étouffante, s’imposait peu à peu et où les journées commençaient à s’étirer doucement sur des soirées agréables. La ville avait définitivement pris ses couleurs de printemps, et les nombreux espaces verts s’étaient remplis d’azalées multicolores. Les gens qui avaient abandonné leurs manteaux dans lesquels ils étaient engoncés une semaine auparavant, musardaient devant les vitrines des magasins ou prenaient le temps de s’arrêter pour déguster un café sur les terrasses des coffee shops ou des restaurants qui égayaient les trottoirs du centre-ville. Tout le monde semblait plus gai, plus décontracté, plus heureux. J’avais mis un CD de jazz soft et je me laissais tranquillement aller aux accents des improvisations du saxophoniste. Je commençais à bien m’imprégner de ce moment de douce tranquillité, quand ma radio de police s’est mise à grésiller, comme pour me rappeler à l’ordre. Je ne sais pas si c’était l’équipement de ma voiture qui commençait à se faire vieux, mais j’avais toujours l’impression qu’entre deux mots, parfois inintelligibles, le haut-parleur me crachotait les postillons de l’opératrice en plein visage. Je me suis dit que c’était soit l’équipement qui datait soit, ce qui était moins drôle, que mon audition commençait à prendre l’eau. Mon esprit rebelle s’était vite empressé de bannir la deuxième hypothèse, mais il ne fallait pas se leurrer, on n’arrive pas à un an et demi de la retraite sans commencer à sentir que des trucs se déglinguent. Un « code 54d » – personne décédée – était diffusé, et un responsable d’enquête était demandé sur place. Une patrouille venait de repérer près de l’ancien canal à hauteur de la cabane de l’éclusier, une voiture, avec au volant une femme vraisemblablement tuée par balle. C’était sur ma route, et de toute façon à part mon whisky, et ma petite chatte, plus personne ne m’attendait chez moi. De plus, il n’y avait que l’action qui me maintenait en forme. La paperasserie, ventilée par la clim mal réglée, ce n’était pas du tout mon truc. Après avoir donné mon code de référence et mon nom en signalant que je me chargeais de l’enquête, j’ai accéléré à fond. Pour réponse, j’ai eu un « 10-4 » exaspérant et déshumanisé, alors qu’il était aussi simple de me dire « OK, bien compris » ! Avec mon gyrophare amovible collé sur le toit de ma voiture, les lumières rouges et bleues clignotantes de la calandre et la sirène à fond, les véhicules, très nombreux à cette heure de la soirée, s’écartaient comme par enchantement pour me laisser le passage. Je pouvais imaginer les conducteurs entendant la sirène impérative et apercevant dans leur rétroviseur le gyrophare aveuglant s’approcher d’eux à vive allure, sans faire mine de ralentir, avoir une brusque montée d’adrénaline, se demandant un peu affolés, comment ils allaient pouvoir, au milieu de toutes ces voitures, se mettre rapidement sur le côté.
Je savais exactement où était l’endroit signalé par la radio crachotante et de toute façon, vu le nombre de bagnoles de flic arrêtées sur le côté que j’apercevais au loin, je n’aurais pas pu le louper. Dans la nuit qui commençait à tomber, entre chien et loup, plus loup que chien d’ailleurs, les couleurs rouges et bleues tournoyantes des rampes lumineuses des voitures de police éclairaient toute la zone comme de multiples kaléidoscopes. Cela donnait une ambiance théâtrale, celle du moment où le rideau se lève et où le spectateur surpris découvre le décor. Ici, le décor était simple, minimaliste : une voiture arrêtée et à l’intérieur le corps sans vie d’une femme tuée d’une balle dans la tête.
Je me suis garé pendant que des flics en uniforme essayaient de canaliser le flot important de voitures à cette heure de la journée. D’autres policiers étaient en train d’installer la rubalise jaune interdisant l’accès de ce qui pouvait être une scène de crime. La voiture de la victime était légèrement en contrebas sur un petit terre-plein, près de l’ancienne maisonnette de l’éclusier à l’abri des regards et ne pouvait que difficilement être vue de la route. Le sentier en terre battue qui longeait le canal offrait une piste agréable aux promeneurs et aux joggeurs. Je ne pensais pas me retrouver un jour dans cet endroit pour le boulot. Je venais y courir quelques fois le dimanche quand il faisait beau, si je n’avais pas envie de flemmarder à la maison, si mon survêtement était propre, si j’estimais que je devais perdre des kilos, si je me disais qu’il fallait que je me remue les fesses, si… enfin… pas très souvent. L’endroit était agréable, malheureusement, à cette époque de l’année, l’eau stagnante du canal laissait s’étendre des mousses vertes qui favorisaient la prolifération d’insectes pas toujours très sympathiques. Il faut dire que j’avais une répulsion physique pour ce genre de bestioles ! Il ne fallait pas chercher plus loin pourquoi, en ce moment, alors que la chaleur commençait à s’installer, la région était infestée de moustiques ! Légèrement en contrebas de la route, protégé des bruits de la circulation, cet endroit demeurait tranquille et paisible et seuls quelques cris d’oiseaux déchiraient le silence. Rien n’aurait pu faire penser qu’il pouvait abriter une scène horrible. La voiture était garée normalement, pas de trace de dérapage sur l’herbe humide, pas de portière ouverte, rien qui puisse attirer l’attention. Cela aurait très bien pu être la voiture de deux amoureux à la recherche d’un peu d’intimité. Le patrouilleur à moto, arrivé le premier sur les lieux, m’a indiqué qu’un gars qui promenait son chien avait fait la macabre découverte et avait aussitôt averti la police. Il était d’ailleurs toujours là, un peu à l’écart, et attendait, quelque peu impressionné par le dispositif policier, qu’on prenne sa déposition. Précautionneux de l’environnement, sa main gantée tenait un ramasse-crottes qui semblait avoir récemment servi. L’individu aux cheveux grisonnants d’environ 65-70 ans était accompagné d’un gros chien, style berger allemand, qu’il retenait fermement par le collier pour l’empêcher de gambader autour de la voiture. C’est d’ailleurs en essayant de rattraper son chien qui s’était échappé qu’il avait vu le véhicule. Intrigué, il s’en était approché et avait compris que quelque chose de dramatique s’était passé ; il avait alors averti la police. Le flic avait pris une rapide déposition et lui avait demandé de se tenir à l’écart pour que son animal ne perturbe pas la recherche d’indices éventuels. Les collègues allaient l’interroger dans le détail, mais je savais d’avance qu’il n’y aurait rien à en tirer. Dans ses premières déclarations au patrouilleur, il avait dit n’avoir rien vu de suspect ni rien entendu, pas même une détonation, ce qui indiquait qu’il était arrivé sur les lieux pas mal de temps après les faits. Plus haut sur la route, des voitures attirées par la concentration inhabituelle de bagnoles de police s’étaient arrêtées un peu plus loin, provoquant un embouteillage monstre. Mais on n’y peut rien, c’est comme ça, les gens sont toujours attirés par le macabre, friands de sensations fortes surtout quand ils savent qu’eux même ne risquent rien. C’est quoi ? Un accident ? Un meurtre ? Peut-être plusieurs morts complètement écrabouillés ? C’est dégueulasse, mais on veut voir, ne rien louper et pouvoir raconter tout ça le soir au moment du repas… « Tu sais chérie, en rentrant du boulot ce soir… c’était horrible. »
La plupart des agents en uniforme me connaissaient et je n’ai pas eu à montrer ma plaque pour passer la frontière virtuelle qui me séparait du sordide. C’est vrai que j’étais assez facilement reconnaissable avec mon mètre quatre-vingt-huit et mes quatre-vingt-quinze kilos dont au moins deux ou trois auraient pu se « dissoudre » le dimanche matin sur le sentier le long du canal, si ma séance de jogging n’avait pas été aussi dépendante de mes nombreux « si » ! Je n’avais aucune idée de ce que j’allais voir exactement, mais je devais me préparer au pire. J’en avais vu des cadavres, des morts violentes, dans ma longue carrière de policier, mais je ne pouvais m’y habituer. Des hommes, des femmes, et même, l’horreur suprême, des enfants, souvent dans des positions bizarres, de celles qu’on ne prend jamais dans la vie, comme des pantins de chiffon qu’on laisserait choir avec indifférence ; mais tous, dans leur regard figé, semblaient envoyer le même message « Qu’est-ce que je fous là, c’était pas mon heure… ». Après avoir mis des recouvre-chaussures pour ne pas polluer les abords immédiats de la voiture, je me suis approché de la Chrysler Conquest rouge de 1988. C’était un modèle ancien, mais encore très prisé des amateurs de belles voitures. Celle-ci était rutilante et semblait neuve. La vitre du côté conducteur par laquelle j’essayais de voir à l’intérieur était couverte de sang et d’un liquide blanchâtre assez repoussant. Je suis passé de l’autre côté et, après avoir enfilé une paire de gants en latex, j’ai ouvert la portière, ce qui m’a permis de mesurer l’horreur de la scène. Une femme était au volant, le haut du corps penché en avant, le visage tourné vers la gauche. Le siège baquet en cuir noir légèrement enveloppant avait maintenu le corps, l’empêchant de basculer sur le côté. La ceinture de sécurité était défaite. Vêtue d’un jean et d’un T-shirt blanc, la victime paraissait d’âge moyen, la quarantaine environ, des cheveux blonds que le sang avait rendus poisseux. Sa boîte crânienne était à moitié arrachée. Était-ce un suicide, un meurtre ? Bien qu’il n’y ait aucune règle, j’imaginais mal une personne mettant fin à ses jours dans un pareil cadre. Mais après tout, cette femme avait très bien pu vouloir se donner la mort à cet endroit précis, qui avait peut-être pour elle une signification particulière ; elle n’en avait plus rien à faire à présent, mais pour l’enquête il allait falloir creuser, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans l’esprit de quelqu’un qui en arrive à cette extrémité. La personne n’a-t-elle en tête que la volonté farouche de sa propre destruction, ou a-t-elle, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, un réflexe de survie qui l’empêcherait d’aller au bout de sa folie ? Le nombre important de suicides ratés me faisait penser qu’heureusement cela devait être souvent le cas. Cependant, sans toutefois écarter cette hypothèse du suicide, ma longue expérience de scènes de crimes me disait que cette femme avait été victime d’une agression brutale qui s’était terminée par un meurtre.
La police scientifique allait débarquer rapidement et photographier la scène sous tous ses angles, avant d’entrer en jeu avec leurs espèces de cotons tiges à prélèvement d’ADN et autres pinceaux et poudre magnétique pour les relevés d’empreintes. C’était eux qui allaient, de toute façon, nous donner les premiers éléments pour orienter notre enquête. Ils allaient pouvoir conclure rapidement s’il s’agissait d’un suicide ou d’un meurtre. Mais avant qu’ils n’entrent en action, je voulais fixer la scène dans mon esprit, avant que la moindre chose ne soit bougée. Je me reculais légèrement pour avoir une vue d’ensemble. S’il s’agissait bien d’un meurtre comme je le pensais, ce que je voyais était exactement la dernière vision de la scène de crime que le tueur avait eue en partant. Je l’imaginais jetant un dernier coup d’œil pour s’assurer que rien ne serait susceptible de nous mettre sur sa piste. À première vue, il n’y avait rien pour attirer le regard d’un passant. Le hasard a voulu qu’un promeneur cherchant à rattraper son chien s’approche de la voiture et se rende compte de l’horreur de la scène. Cela donnait l’impression d’un assassin, très maître de lui, prenant son temps pour s’assurer que tout paraisse « normal ».
Il n’y avait pas d’arme sur la banquette ni sur le plancher de la voiture, et au vu de la blessure occasionnée, l’arme ne devait pas être un petit calibre qui aurait pu filer entre les sièges ! Ceci évidemment confirmait mon impression première, me faisant éliminer la thèse du suicide en accréditant en revanche celle d’un meurtre.
L’habitacle était maculé de taches de sang. La vitre du côté conducteur et le bord gauche du pare-brise, étoilés par l’impact de la balle qui avait continué sa course après avoir traversé la tête de la victime, avaient recueilli la quasi-totalité de la matière cervicale. Le sol de la voiture n’était qu’une flaque immonde de sang qui commençait à coaguler. J’essayais d’imaginer l’agression ; la position du cadavre et la blessure béante semblaient indiquer que l’assassin devait se trouver assis sur le siège avant, l’arrière étant de toute façon trop étroit et très difficile d’accès sur ce genre de véhicule. À en juger par la partie arrachée du crâne, le meurtrier avait dû tirer juste derrière l’oreille certainement au moment où la victime lui tournait la tête peut-être quand la malheureuse essayait de s’enfuir, ce qui pouvait expliquer que sa ceinture de sécurité ne soit pas bouclée. Une véritable exécution. C’est à ce moment-là que j’ai aperçu son sac à main fermé, intact, dépassant de dessous le siège du côté passager. L’examen d’un sac de femme est en général très révélateur de la personnalité de sa propriétaire. C’est certainement pour cette raison qu’ouvrir le sac d’une dame m’a toujours semblé une immixtion dans sa vie privée, voire intime. Il ne me serait jamais venu à l’idée de regarder dans celui de mon épouse. À côté des objets classiques, mouchoirs jetables, brosse à cheveux, tampons hygiéniques, téléphone portable, le sac à main contenait des produits de beauté coûteux, un rouge à lèvres de grande marque, un magnifique poudrier laqué et un parfum haut de gamme, suggérant le niveau social élevé de la victime. Tous ces objets, accessoires de beauté, paraissaient presque anachroniques et même tristes auprès de cette femme sans visage. L’analyse de son téléphone portable devrait pouvoir nous dire si elle n’avait pas reçu un appel pouvant expliquer sa présence dans ce lieu insolite. Par ailleurs, le portefeuille renfermait une coquette somme en billets, ce qui semblait indiquer que le vol n’était pas le motif du crime. Elle portait des bijoux de valeur, un collier, un bracelet et des bagues, ce qui confirmait cette hypothèse. Dans son portefeuille, il y avait également, au milieu de nombreuses cartes de crédit et de cartes de magasins, son permis de conduire. Il était établi au nom de Joan McCall, 41 ans. Ce nom m’était familier, je savais que c’était celui d’une personne connue. La Joan McCall, à laquelle je pensais, avait souvent fait la couverture de plusieurs magazines, ce qui d’ailleurs m’a permis de l’identifier immédiatement en voyant la photo sur son permis de conduire. Il s’agissait bien de l’épouse de Peter McCall, un des plus gros promoteurs-entrepreneurs de la côte Est des États-Unis. J’ai tout de suite compris qu’en raison de l’identité de la victime, cette enquête allait être délicate. J’entendais déjà le capitaine me demander d’agir vite, mais également de veiller à ne pas trop exposer cette famille connue à l’appétit rapace des journalistes. Enquêter avec « circonspection », sans faire trop de vagues…
L’équipe de la police scientifique est arrivée rapidement sur les lieux. Je les connaissais pour la plupart, mais je me suis présenté à celui qui semblait diriger et que je voyais pour la première fois.
— Lieutenant Mike Perugiano, police criminelle, section homicide. Je viens d’arriver et c’est moi qui vais mener cette enquête.
— Docteur O’Callaghan. Bonsoir lieutenant.
La poignée de main était ferme, le regard franc, ce gars m’a plu immédiatement. C’était un homme dans la force de l’âge, avec les cheveux aussi roux que pouvait le laisser prédire son nom irlandais. Je savais que j’étais destiné à le revoir et qu’une bonne partie de mon boulot, du moins au début, se ferait en collaboration étroite avec lui.
— Vous avez déjà pu faire quelques constations lieutenant ?
— Il semble que le suicide soit à écarter. Il s’agit sans aucun doute d’un meurtre. Il n’y a aucune arme dans la voiture.
Le légiste s’est penché, a observé le cadavre et a immédiatement confirmé ma conclusion.
— De toute façon, le point d’impact du coup de feu, légèrement à la droite de l’occiput, nous fait à coup sûr écarter la thèse du suicide ou alors la dame travaillait dans un cirque comme contorsionniste ! Il est probable que la victime a vu son meurtrier sortir son arme et a essayé de s’enfuir, ce qui expliquerait que la blessure se situe à cet endroit du crâne.
Selon ses premières constatations, température apparente du corps, état de coagulation du sang et début de rigidité cadavérique au niveau de la nuque et de l’articulation mandibulaire, l’heure de la mort ne devait pas remonter à plus de quatre ou cinq heures.
— On va prendre toutes les photos lieutenant, et on pourra ensuite examiner le corps de plus près.
La séance photo dura environ une vingtaine de minutes pendant que le reste de l’équipe essayait de récolter, dans la terre humide, un maximum d’indices autour de la voiture. Ils avaient moulé dans du plâtre une trace de pas et une trace de pneu qui semblaient fraîches.
Une bâche blanche avait été déroulée tout autour de la scène de crime pour la protéger de la vue et de toute intrusion intempestive. La nuit était complètement tombée, et une équipe avait installé toute une série de lampes halogènes qui éclairait la scène à giorno. C’était dantesque de voir cette tête à moitié arrachée sous cette lumière crue. Cela me donnait envie de vomir.
Deux autres collègues arrivés sur les lieux n’en menaient pas large non plus.
— Ma parole, on lui a tiré dessus avec un bazooka ! a remarqué l’un d’eux avec un haut-le-cœur et détournant la tête.
Personne n’a relevé sa boutade qui devait plus l’aider à se donner une contenance qu’à essayer de faire sourire son entourage.
Le responsable scientifique s’est avancé vers moi pour me dire que la séance photo était terminée et qu’on pouvait maintenant examiner le cadavre avant de le faire transférer au centre médico-légal du comté. Le mélange de sang et de matière cervicale avait formé une colle infâme qui retenait le reste de la tête au volant. Le légiste qui avait repéré l’endroit de l’impact de la balle sur la boîte crânienne, confirma mon hypothèse que le tireur devait être assis à côté d’elle et lui avait tiré dessus au moment où elle tournait la tête, la balle l’atteignant à la base droite du crâne. Selon lui, le meurtrier n’avait pas tiré à bout touchant, mais devait avoir son arme à environ quinze ou vingt centimètres de sa tête. Il m’a fait remarquer des traces très larges de brûlure juste sous le point d’impact, ce qui l’a quelque peu intrigué. Il y avait toujours des traces quand un coup de feu était tiré de près, mais dans ce cas précis, la brûlure était beaucoup plus importante qu’à l’accoutumée. Il allait analyser tout cela en détail. Il m’a expliqué que la balle, après avoir fait éclater la boîte crânienne à l’impact, avait provoqué, de façon classique, une projection de fragments osseux vers l’intérieur du crâne, se comportant comme des projectiles secondaires, entraînant littéralement l’explosion de toute une partie de la tête. La balle elle-même, ralentie après avoir brisé l’os et arraché les chairs, avait été déviée et était ressortie pour aller étoiler le pare-brise sur la gauche. Il a fallu tirer assez fort pour relever ce qui restait du crâne collé au volant par les cheveux blonds ensanglantés de cette pauvre femme. Le léger bruit sourd de succion a failli me faire gerber. C’est au moment où le corps a été basculé en arrière sur le dossier du fauteuil que je l’ai vue, délicatement posée sur la cuisse droite de la victime. Je suis resté sans dire un mot comme tétanisé. Elle était là, immaculée, sans une seule tache de sang au milieu de ce carnage, bien en vue sous la lumière crue des projecteurs. Non, ça n’allait pas recommencer… elle semblait me narguer. Je ne pouvais la quitter des yeux. Je l’avais vue à quatre reprises sur des scènes de crimes violents. C’était sa signature, celle du tueur en série que j’avais poursuivi quatre ans auparavant sans jamais parvenir à l’identifier et bien sûr encore moins à l’arrêter. J’avais devant moi cette image de la Vierge Marie qui avait bouleversé ma vie. Depuis quatre ans, la police vivait dans la crainte que le tueur récidive, mais les meurtres avaient cessé et depuis je n’avais plus revu cette image. Et aujourd’hui, elle était là… « Il » était de retour. Bien que l’enquête fût toujours ouverte, je pensais, j’espérais que je n’allais plus en entendre parler, mais le cauchemar allait reprendre. Ce moment me semblait irréel, totalement anachronique, avec l’image de cette Vierge au regard si doux, dans un environnement apaisé, au centre de cette scène horrible, d’une femme à moitié décapitée baignant dans son sang. Et là, tous mes démons, toutes mes craintes, tous mes doutes, tous mes échecs sont remontés à la surface.
Chapitre 2
J’étais en plein délire ; je savais que le cauchemar allait reprendre et que Joan McCall risquait d’être la première d’une nouvelle liste de meurtres en série. La sonnerie de mon téléphone me ramena à la réalité, à l’horreur de la scène de crime. C’était le bureau qui me faisait part de plusieurs appels d’un certain Peter McCall qui s’inquiétait que son épouse ne soit pas rentrée, et qui voulait avertir la police de sa disparition. L’agent de faction au poste sachant qu’une femme venait d’être découverte assassinée avait jugé opportun de me prévenir, pensant qu’il pourrait peut-être y avoir une relation. Et comment qu’il y en avait une ! C’était bien l’épouse de Peter McCall, qui était là, tel un pantin désarticulé, la tête à moitié arrachée.
Il était un peu plus de vingt-trois heures et j’aurais préféré ne pas savoir que le mari avait déjà signalé la disparition de sa femme à la police. Tout cela aurait pu être réglé le lendemain matin à la première heure, après que la police scientifique avait relevé tous les détails de la scène de crime, que le corps ait été transporté à la morgue et la voiture amenée dans les locaux de la police pour y être analysée en détail c’est-à-dire dans au moins deux bonnes heures. J’aurais pu alors rentrer chez moi, essayer d’imaginer le déroulement du meurtre, et me concentrer sur cette vision de l’image pieuse qui, quatre ans auparavant, avait hanté chaque jour de ma vie. Mais je ne pouvais me dérober. Il me fallait absolument aller chez les McCall. De toute façon, le mari attendait une réponse de la police ; sa femme avait disparu et il voulait savoir ce qui avait pu lui arriver. J’avais repéré, sur le permis de conduire de la victime, leur adresse dans un quartier ultra résidentiel. J’allais devoir lui apprendre que son épouse avait été retrouvée assassinée sans décemment pouvoir lui dire « ne vous en faites pas monsieur McCall, on verra tout ça tranquillement demain » ! Ça allait être un coup d’une heure ou une heure et demie du matin, si toutefois j’arrivais à le raisonner. J’avais malheureusement dû faire ce genre de démarche à de nombreuses reprises dans ma carrière et à chaque fois c’était le même scénario accompagné des mêmes sentiments, qui me tordaient les tripes. C’était toujours la même scène qui se répétait, je frappais à la porte, la personne était surprise de voir un inconnu se présenter chez elle, puis se rassurait quand je présentais ma plaque, puis s’inquiétait à nouveau de la raison qui pouvait m’emmener, puis me permettait d’entrer, et enfin, m’écoutait lui annoncer la nouvelle qui allait soudain changer sa vie. L’atmosphère se figeait, le visage de la personne semblant réagir à chaque mot prononcé pour finalement devenir totalement livide. On a coutume de dire que le déni est la première étape du deuil, mais je peux assurer, pour l’avoir ressenti et constaté à chaque fois, que le déni est éphémère et que c’est un véritable coup de poing d’une rare violence qu’on encaisse en plein visage, et c’est l’anéantissement, le KO debout.
Bien qu’il n’y ait plus beaucoup de voitures à cette heure avancée de la nuit j’ai dû mettre environ quarante-cinq-minutes pour arriver chez les McCall ce qui m’a permis de peaufiner mon laïus pour lui annoncer la nouvelle. Il n’était évidemment pas question d’évoquer la présence de l’image pieuse près du corps de son épouse, ce n’était pas le bon moment. Si j’en parlais, il voudrait en savoir plus et je n’avais ni l’envie ni les éléments suffisants pour évoquer des pistes possibles de l’enquête. J’allais probablement me contenter des formules laconiques qui enfoncent des portes ouvertes du style « une enquête est en cours et tout sera mis en œuvre pour retrouver le ou les assassins. Nous vous tiendrons informé évidemment du déroulement de nos investigations ».
Le quartier était splendide et respirait la richesse et le confort, sous la lumière douce des lampadaires. La maison des McCall construite sur un talus était une impressionnante bâtisse avec des colonnades entourant le porche. Elle était d’un luxe peu commun ; une large allée montait en pente douce vers la porte d’entrée, au milieu d’une pelouse à faire pâlir d’envie les joueurs de boulingrin les plus exigeants. Contre la maison et dans le jardin, des éclairages feutrés adoucissaient l’ambiance. Je n’ai pu m’empêcher de penser à madame McCall qui avait toujours vécu dans cet environnement luxueux et protecteur ; elle n’aurait jamais imaginé mourir abandonnée dans une voiture, près d’une maison modeste et d’un canal à l’eau croupissante. Arrivé sous le porche d’entrée, je n’ai même pas eu le temps de sonner. Malgré l’heure tardive, McCall, qui avait dû m’entendre arriver, m’a ouvert la lourde porte en bois précieux. Visiblement, il m’attendait. C’était un homme grand d’une stature imposante, aux cheveux châtain clair, et aux yeux verts un peu délavés ; une mâchoire marquée et un menton légèrement saillant laissaient entrevoir un caractère déterminé. Habillé de façon élégante et décontractée, il dégageait une impression de force tranquille. Je l’ai immédiatement reconnu pour avoir vu plusieurs de ses photos dans le magazine Forbes. Une célébrité dans le domaine industriel et économique.
C’est certainement parce que je savais qu’il faisait partie de notre communauté, que je m’étais intéressé à cet article sur lui. Je me souvenais assez bien du portrait qui en était fait dans le magazine. Peter McCall, 53 ans, d’origine irlandaise, n’avait pas voulu suivre les traces de son père, un chirurgien réputé et extrêmement apprécié. Il s’était dirigé vers l’architecture et avait été brillamment diplômé du MIT. Il était passionné par la conception de nouvelles structures dans le bâtiment et vouait une admiration passionnelle pour les grands maîtres, Nouvel, Ghery, Johnson ou Ma Yansong. Il s’était taillé une bonne réputation dans un cabinet new-yorkais puis s’était lancé dans la promotion et la construction d’immeubles dont il concevait les plans et le design. C’était un domaine difficile, semé d’embûches, avec une concurrence féroce, pourtant McCall avait su s’implanter dans ce milieu et avait su imposer la « touche McCall ». L’homme était apprécié et faisait autorité dans son domaine. À de nombreuses reprises, il avait été sollicité par la télévision pour expliquer, du point de vue technique, comment la structure des tours du World Trade Center avait pu s’écrouler lors de l’attentat du 11 septembre 2001. Sa renommée d’architecte avait bien sûr contribué à sa réussite, mais la fortune de sa femme l’avait beaucoup aidé à devenir un des promoteurs immobiliers les plus importants, sinon le plus important de la côte Est.
— Monsieur McCall ? Je suis le lieutenant Mike Perugiano de la police criminelle. En disant cela, je lui présentai ma plaque. En général, ça rassure et en même temps ça impressionne. Ça n’a pas du tout été le cas pour lui. C’était certainement quelqu’un qui avait l’habitude de côtoyer des gens haut placés, des personnalités politiques ou du spectacle, alors un petit lieutenant de police ne devait pas peser beaucoup pour lui.
— Oui, entrez, je suppose que vous venez au sujet de ma déclaration de disparition de mon épouse Joan. Mais je ne pensais pas avoir la visite d’un lieutenant de la criminelle.
Était-il impressionné par ma fonction ?
Passé le hall d’entrée, j’ai eu l’impression de me retrouver dans une salle de bal tellement le séjour était spacieux. Devant mon étonnement, il s’est empressé de me dire que cette maison avait appartenu à une star de cinéma des années soixante-dix, un peu mégalo, dont il ne m’a pas donné le nom. Je me suis dit que, bizarrement, au lieu de se faire construire une maison totalement à son goût, lui l’architecte de renom, il avait préféré acheter celle d’une star de cinéma. Était-ce parce qu’il appréciait le décor hollywoodien de ces années un peu folles ? Pour son côté un peu kitch ? Ou plus simplement parce qu’elle lui avait plu ! Il l’avait quand même fait restructurer pour lui donner un aspect un peu plus intime. Comment cela devait-il être avant la restructuration ! Il faut dire que c’était meublé et décoré avec un goût exquis. Pour casser l’impression d’immensité, un luxueux escalier design mêlant harmonieusement la chaleur et la douceur du bois avec la force de l’acier complétait harmonieusement la pièce. Le mélange subtil et recherché de meubles anciens et de meubles ultramodernes disposés autour de tapis épais arrivait à donner à la pièce un charme d’une extraordinaire finesse d’où se dégageait une impression de bien-être. Beaucoup de cadres disposés çà et là montraient Peter et Joan épanouis en différents endroits tous aussi paradisiaques les uns que les autres. Ils semblaient former un couple vraiment uni et heureux. Près de la cheminée, j’ai immédiatement flashé sur un tableau aux couleurs vives et aux lignes géométriques qui m’a fait penser à un Kandinsky. Voyant mon intérêt pour cette peinture, Peter me confirma, avec une pointe de fierté dans la voix, que c’était bien une œuvre du célèbre peintre russe qu’il avait acquise à une vente aux enchères chez Christie’s à Londres. C’était un de mes peintres préférés. J’étais subjugué, moi qui m’essayais, dans mes moments de détente, à faire quelques tableaux qu’en général je badigeonnais aussitôt après, tant j’étais satisfait de mon « œuvre » !
J’ai réalisé tout à coup que nous étions en conversation presque mondaine et qu’il semblait avoir oublié le but supposé de ma visite. Pourtant ce que je devais lui annoncer était une chose terrible dont il n’avait pas la moindre idée. J’étais assez mal à l’aise et je voulais en finir vite. Quand il s’est tourné vers moi j’ai préféré aller droit au but.
— Monsieur McCall, votre épouse, Joan McCall, possède bien une Chrysler Conquest de 1988 de couleur rouge ?
— Oui, c’est un vieux modèle, mais de toutes ses voitures c’est sa préférée. Elle a eu un accident, c’est ça ? Je m’inquiétais qu’elle ne soit pas rentrée. J’espère qu’elle n’est pas blessée.
— Je suis désolé, monsieur McCall, nous avons retrouvé sa voiture, et votre femme a été retrouvée sans vie dans son véhicule. Je suis désolé.
Le déni, le KO debout… rien de tout ça. Peter McCall est resté imperturbable, juste peut-être quelques mouvements imperceptibles de son visage qui pouvaient faire penser qu’il encaissait le coup.
— Qu’est-il arrivé ? Un malaise, une attaque cardiaque ? Ou était-ce un accident ? Elle a heurté une autre voiture ? Elle est rentrée dans un arbre, dans un mur ?
J’étais surpris qu’il s’attache aux détails techniques de l’éventuel accident.
— Rien de tout cela monsieur McCall ; je suis désolé, mais il s’agit en fait d’un meurtre. Elle a été tuée par une arme à feu.
Je ne voulais pas évoquer l’horreur de la scène, mais j’ai senti que le gars était ébranlé, même s’il voulait donner le change en essayant de ne pas réagir et rester digne. Une telle maîtrise de soi était rare. En général, la personne est anéantie devant ce genre de nouvelle avec les jambes qui flageolent et le besoin de s’asseoir. McCall est resté debout sans bouger pendant quelques secondes qui ont paru interminables. Son visage avait juste un peu pâli. Il restait immobile, le regard fixe semblant s’imprégner de l’horreur de cette nouvelle. Ce peu de réaction, ce détachement apparent, me mettait mal à l’aise au point que je me demandais s’il n’y avait pas un problème sérieux dans le couple.
— Mais je ne comprends pas, c’était quoi ? Un vol ? Une agression sexuelle ?
— Les premières constatations sembleraient indiquer que le vol ne soit pas le motif de l’agression. Votre épouse avait sur elle un collier, un bracelet et des bagues qui devaient représenter beaucoup d’argent, et son portefeuille contenait une coquette somme en liquide. Par ailleurs, rien n’indique a priori qu’elle ait été victime d’une tentative de viol.
— Je ne comprends pas. C’est impossible ! Mais alors quoi ? Où cela s’est-il produit ?
— Votre épouse était encore au volant de sa voiture au bord du canal près de l’ancienne demeure de l’éclusier.
— Oui, je vois très bien où c’est. Nous allions parfois nous balader ensemble de ce côté. Mais comment est-ce arrivé ? Qui l’a trouvée ?
— C’est une personne qui promenait son chien qui a vu la voiture stationnée en contrebas de la route et qui en s’approchant a vu la scène de crime. Je suis vraiment désolé. Monsieur McCall, savez-vous si elle avait rendez-vous avec quelqu’un à cet endroit en cette fin d’après-midi ?
— Non, pas du tout. Je suis rentré en début d’après-midi d’un chantier et je ne me suis pas préoccupé de son absence me doutant qu’elle avait dû aller faire quelques courses ou voir des amies comme elle en avait l’habitude. Mais le soir, j’ai commencé à m’inquiéter. Ce n’est pas son habitude de rentrer tard, ou si quelque chose la retient, elle prend toujours la peine de me prévenir. J’ai essayé de lui téléphoner, mais je suis tombé sur son répondeur. J’ai appelé ma fille qui ne savait pas non plus où elle pouvait être. Sa meilleure amie que j’ai également appelée m’a dit en revanche qu’elles s’étaient retrouvées au supermarché, et que ma femme lui avait déclaré vouloir rentrer rapidement pour préparer un dîner qui devait être une surprise pour moi. Tout ceci commençait à devenir inquiétant d’autant qu’elle avait déclaré à son amie ne pas vouloir s’attarder et rentrer rapidement. À vingt-deux heures, ne la voyant toujours pas arriver, je me suis décidé à appeler le poste de police, craignant qu’elle ait eu un accident. C’est horrible, un meurtre ! Mais que dois-je faire ? Puis je la voir ?
— Elle a été transférée à l’institut médico-légal du comté, mais je pense que vous n’aurez pas à vous y rendre pour l’identification, à moins que vous n’y teniez absolument. Son permis de conduire retrouvé sur la scène de crime, ses affaires personnelles et ses empreintes suffiront à l’identifier formellement. Avait-elle, en dehors de vous et votre fille, de la famille, des parents, des frères, des sœurs ?
— Non, elle était seule, elle n’avait plus ses parents. Mais c’est incompréhensible. Si ce n’est pas une mauvaise rencontre avec quelqu’un qui en voulait à son argent ou qui voulait l’agresser sexuellement qui cela pourrait-il être ? Elle n’avait aucun ennemi, au contraire elle était appréciée de tous.
— C’est ce que l’enquête devra déterminer, et votre aide nous sera très précieuse. Ce qui m’interpelle c’est l’endroit où a eu lieu le meurtre. Ce n’est pas un endroit où on s’arrête, surtout quand, comme vous me l’expliquiez, on est pressé de rentrer chez soi pour préparer un repas. Ça a plus l’air d’un lieu de rendez-vous et dans ce cas il faudra déterminer qui elle avait l’intention de voir. Vous avez dit que c’est un endroit où vous aviez coutume de vous rendre en compagnie de votre épouse. Il est donc possible qu’elle ait choisi ce lieu familier pour y rencontrer quelqu’un. L’autre possibilité, c’est qu’elle ait été agressée au moment où elle montait dans sa voiture, et forcée de s’arrêter à cet endroit précis.
— Je n’ai aucune explication. Je ne comprends pas, c’est irréel. Que dois-je faire ? J’avoue que je suis totalement désemparé. Je n’arrive pas à y croire.
— Pour l’instant du côté de l’enquête il n’y a rien d’autre à faire ce soir. La police scientifique est encore sur les lieux pour récolter un maximum d’indices et va ensuite emporter la voiture dans nos locaux pour une analyse approfondie. Le mieux c’est que nous revoyions tout cela ensemble dès demain matin.
— Je vais me rendre sur les lieux du meurtre, je veux voir de mes yeux ce qui a pu se passer.
— Je ne vous le conseille pas. Cela risque d’être très traumatisant et vous risquez de perturber le travail des experts médico-légaux. Monsieur McCall, en fonction de mon expérience, permettez-moi de vous dire que vous ne devriez pas rester seul ce soir. Appelez votre fille ou des amis, cela vous aidera.
— Oui, vous avez raison, je vous remercie lieutenant de votre sollicitude.
— Je vous demande simplement de rester à la disposition de la police pour la suite de l’enquête.
J’étais arrivé à placer la phrase qui allait me libérer. Heureusement pour moi, c’était certainement un homme très pragmatique et il s’était rendu à l’évidence qu’il n’y avait plus rien à faire ce soir. J’étais arrivé à le persuader de ne pas se rendre sur place même si je savais qu’à cette heure le corps de son épouse avait déjà été transporté à la morgue. Cela m’a permis de prendre congé en plaçant ma deuxième phrase enfonceuse de portes ouvertes, « croyez que nous allons tout faire pour retrouver le meurtrier de votre épouse et bien sûr, nous vous tiendrons informé des avancées de l’enquête ». Cela pouvait le rassurer et me permettait de mettre un terme à cette conversation. En partant, je lui ai laissé ma carte en lui faisant remarquer qu’il y avait mon numéro de portable et qu’il pouvait me contacter à n’importe quel moment s’il le souhaitait ou si un détail lui revenait en mémoire. Il était plus d’une heure du matin quand je l’ai quitté.
La nuit était fraîche et contrastait avec la douce chaleur qui avait régné toute la journée. J’ai rejoint ma voiture et ai conduit lentement jusque chez moi dans les rues presque désertes à cette heure tardive. J’adorais ce moment où la ville endormie semblait offrir ses rues au plaisir de la conduite. J’ai mis en sourdine un CD de Miles Davis qui m’a accompagné jusqu’au bout de l’agglomération. Les lumières des vitrines des supermarchés ouverts 24 h sur 24 et les enseignes lumineuses avaient laissé place au calme des sous-bois où se cachaient des maisons cossues, au porche délicatement éclairé, comme pour inviter le passant à entrer. Parfois dans l’obscurité je voyais briller sur le bas-côté, les yeux d’une biche égarée qui me regardait passer imperturbable. C’était vraiment un beau quartier et mon épouse adorait cette maison devenue maintenant trop grande pour moi seul. J’étais content de rentrer. Je savais que Cookie, ma petite chatte Korat, devait commencer à s’impatienter. Heureusement qu’elle pouvait entrer et sortir par la chatière que j’avais aménagée sur la porte donnant sur l’arrière de la maison vers le jardin. C’était ma seule compagne ; elle remplissait avec la plus grande affection la solitude qui parfois me pesait. Ce petit animal me rappelait mon épouse. C’était elle qui l’avait baptisé ainsi parce qu’elle était en train de cuisiner des petits biscuits le jour où elle l’avait découvert dans notre jardin. Mon whisky, lui, m’aura-t-il attendu ? Je crois que j’allais l’oublier pour ce soir, et passer directement à mon repas qui allait se résumer à un bol de pâtes chinoises qui traînaient dans le placard de ma cuisine. Comme à mon habitude je me suis encore obstiné avec les baguettes, pour capituler une fois de plus et finir avec la fourchette, puis suis allé me coucher gardant toujours dans la tête, cette image de la Vierge qui semblait me sourire.