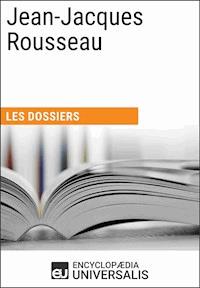
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Un dossier de référence sur Jean-Jacques Rousseau
Les idées que Jean-Jacques Rousseau a exprimées dans les domaines multiples qu'il a abordés (psychologie, morale, politique, éducation…) ont eu une influence décisive au-delà de son temps, à tel point que les grands débats d’aujourd’hui sur ces mêmes thèmes continuent de s’en inspirer. Ce dossier, composé d’une vingtaine d’articles empruntés à l’Encyclopædia Universalis, présente tour à tour l’auteur, ses œuvres principales et l’environnement dans lequel elles sont nées. Il rend présents, sous la conduite des meilleurs spécialistes, un des plus grands écrivains de la littérature française et une pensée toujours féconde.
Un ouvrage conçu par des spécialistes du domaine pour tout savoir sur le sujet !
A PROPOS DES DOSSIERS D’UNIVERSALIS
L’Encyclopaedia Universalis propose des dossiers complets sur des thématiques spécifiques pour développer et approfondir ses connaissances. Grâce à un index détaillé qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités, le lecteur peut effectuer aisément une recherche ciblée et naviguer à travers ces dossiers de référence.
A PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341003438
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce dossier, consacré à Jean-Jacques Rousseau, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles de ce dossier à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
ROUSSEAU JEAN-JACQUES (1712-1778)
En plein siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau élève une véhémente protestation contre le progrès des sciences et l’accumulation des richesses, contre une société oppressive et des institutions arbitraires. Il stigmatise la dénaturation croissante de l’homme et prévient ses contemporains que, faute de retourner à la simplicité naturelle, ils courront inévitablement à leur ruine. Il propose tour à tour de réformer l’éducation, les mœurs, les institutions politiques et sociales, le droit et même la religion. Si l’homme occupe aujourd’hui une place centrale dans notre conception du monde, c’est en grande partie à Rousseau qu’on le doit. Ainsi que l’a dit Kant : « Rousseau est le Newton du monde moral. »
1. « Une misérable question d’Académie »
En réponse à Mgr de Beaumont, archevêque de Paris qui avait condamné l’Émile, Rousseau écrit :
Émile, J.-J. Rousseau. Émile, de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), in œuvres, Thomine et Fortic, 1823-1824, Paris. «Chacun respecte le travail des autres afin que le sien soit en sûreté.» Gravure sur cuivre de Dupreel d'après Jean Michel Moreau (1741-1814). (AKG)
« J’étais né avec quelque talent, cependant j’ai passé ma jeunesse dans une heureuse obscurité, dont je ne cherchais point à sortir [...]. J’approchais de ma quarantième année, et j’avais, au lieu d’une fortune que j’ai toujours méprisée, et d’un nom qu’on m’a fait payer si cher, le repos et des amis, les deux seuls biens dont mon cœur soit avide. Une misérable question d’Académie m’agitant l’esprit malgré moi me jeta dans un métier pour lequel je n’étais point fait ; un succès inattendu m’y montra des attraits qui me séduisirent. Des foules d’adversaires m’attaquèrent sans m’entendre, avec une étourderie qui me donna de l’humeur, et avec un orgueil qui m’en inspira peut-être. Je me défendis, et de dispute en dispute je me sentis engagé dans la carrière, presque sans y avoir pensé. Je me trouvai devenu, pour ainsi dire, auteur à l’âge où l’on cesse de l’être, et homme de lettres par mon mépris même pour cet état. Dès-là je fus dans le public quelque chose : mais aussi le repos et les amis disparurent. Quels maux ne souffris-je point ? »
Rousseau a répété plusieurs fois que sa vocation littéraire était née sur la route de Vincennes, où, dans une sorte d’illumination, il avait découvert la voie à suivre pour réformer une société injuste et oppressive. Jusqu’alors il avait songé à faire une carrière de musicien, jouant du violon, de l’orgue et du clavecin, dirigeant de petits concerts et donnant des leçons de musique. À trente ans il imagina un nouveau système de notation musicale qu’il présenta à l’Académie des sciences de Paris avant de le publier (Dissertation sur la musique moderne), puis il se mit à composer un opéra, Les Muses galantes, qui ne remporta pas le succès attendu, et il écrivit plusieurs pièces de circonstances.
Un jour d’octobre 1749 – il était dans sa trente-huitième année – Rousseau prit la route de Vincennes pour rendre visite à Diderot qui était incarcéré au Donjon, pour avoir écrit la Lettre sur les aveugles. Tout en marchant, Rousseau parcourut Le Mercure de France qu’il avait emporté et tomba sur la question proposée par l’académie de Dijon pour le prix de l’année suivante : Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs.
« À l’instant de cette lecture, nous dit-il dans ses Confessions, je vis un autre univers et je devins un autre homme. » Il fut comme ébloui de mille lumières, des foules d’idées se pressèrent dans son esprit, il sentit « sa tête prise par un étourdissement semblable à l’ivresse ». Rousseau était si bouleversé qu’il dut se reposer sous un des chênes de l’avenue de Vincennes, et c’est là qu’il rédigea ce que l’on appelle la « prosopopée de Fabricius », où il engage les Romains – c’est-à-dire ses contemporains – « à renverser les amphithéâtres, à briser les marbres, à chasser les esclaves qui les subjuguent, et dont les funestes arts les corrompent ».
Rousseau a déclaré douze ans plus tard : « Si j’avais pu écrire le quart de ce que j’ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j’aurais fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j’aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j’aurais démontré que l’homme est bon naturellement et que c’est par les institutions seules que les hommes deviennent méchants. »
Cette illumination, véritable crise métaphysique, venait de libérer d’un seul coup une âme longtemps opprimée : Rousseau découvrait subitement non seulement les causes de corruption de l’homme, mais encore les moyens d’arrêter sa marche vers l’abîme.
De retour à Paris, le philosophe composa pendant ses insomnies son premier Discours ; une fois achevé, et après l’avoir montré à Diderot qui y apporta quelques corrections, il l’envoya à l’académie de Dijon. Près d’une année plus tard (juill. 1750), alors qu’il n’y songeait plus du tout, il apprit que son Discours avait remporté le prix de l’Académie. Ce premier ouvrage parut en janvier 1751 et provoqua immédiatement des remous. Les thèses que Rousseau défendait étaient si originales, si surprenantes, elles étaient tellement contraires à l’opinion générale – il ne faut pas oublier qu’en plein siècle des Lumières l’idée de progrès était ancrée dans tous les esprits – que les contradicteurs se multiplièrent. On ne compte plus les réfutations du premier Discours. Rousseau s’efforça d’y répondre par une série de lettres ouvertes à l’abbé Raynal, à Grimm, à Bordes, à Lecat et même au roi Stanislas Leczinsky. Au fur et à mesure qu’il réplique à ses adversaires, on voit sa pensée se préciser, se compléter, s’affermir toujours davantage dans ce qu’il appellera plus tard son « grand et triste système ».
En six mois, Rousseau était devenu célèbre. Lui qui, depuis vingt ans, cherchait à acquérir quelque notoriété comme musicien se trouvait d’un jour à l’autre le point de mire de tous les cercles de Paris. D’ailleurs cette célébrité allait s’enrichir l’année suivante d’une renommée musicale : Rousseau faisait représenter à Fontainebleau devant le roi et la reine de France son opéra-ballet Le Devin du village et y remportait un succès éclatant. Il avait quarante ans. Une extraordinaire carrière littéraire s’ouvrait devant lui. Carrière fulgurante puisque, à l’exception de ses œuvres autobiographiques (Confessions, Dialogues, Rêveries du promeneur solitaire) qui sont toutes posthumes, tous ses grands livres ont paru en l’espace de seize années : le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité (1755), la Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758), La Nouvelle Héloïse (1761), Émile (1762), Du contrat social (1762), la Lettre à Christophe de Beaumont (1763), les Lettres écrites de la montagne (1764), auxquels il faut ajouter l’achèvement du Dictionnaire de musique (1767). Entre-temps, Rousseau s’est réfugié en Suisse, il a été lapidé à Môtiers, expulsé de l’île de Saint-Pierre puis est parti pour l’Angleterre. Désormais, Rousseau est un proscrit, un être traqué, soupçonneux, malade, en proie à la folie de la persécution, qui s’engage même à plusieurs reprises à ne plus rien publier de son vivant.
Le Discours sur les sciences et les arts est inséparable du Discours sur l’origine de l’inégalité. Leur thèse peut se résumer ainsi : l’homme est né bon ; c’est la société – les institutions sociales – qui l’a corrompu. Les sciences et les arts (dans le premier Discours), l’inégalité sociale (dans le second) ont dénaturé l’homme. Né pour le bonheur et la vertu, celui-ci s’est laissé détourner de son chemin par le développement des connaissances et par les séductions du luxe et de la puissance.
L’état primitif de l’homme, cet état de nature où l’être humain connaissait l’innocence et la bonté, n’est peut-être qu’une vue de l’esprit, mais c’est une hypothèse qui doit nous faire regretter un passé qui n’est plus et qui ne reviendra jamais, car l’histoire ne rétrograde pas.
Les deux premiers ouvrages de Rousseau décrivent le processus par lequel le mal s’est introduit dans le monde et la manière dont la nature humaine a été corrompue, encore que le premier mette l’accent sur les vertus des cités antiques et le second sur l’âge d’or de l’humanité. Le Discours sur l’économie politique tente pour la première fois de concilier les devoirs de l’homme et ceux du citoyen. C’est dans ce texte que Rousseau énonce sa théorie de la volonté générale, source des lois positives et du gouvernement, règle du juste et de l’injuste, volonté qui émane du corps politique tout entier et lui donne sa cohésion.
2. Les grandes œuvres
Dans chacun de ses ouvrages, Rousseau va proposer un remède à la corruption des sociétés. Il imagine trois voies susceptibles de mener à une nouvelle synthèse de la nature et de la culture qui ne trahirait pas l’essence de l’homme.
Dans l’Émile, Rousseau repense l’éducation d’un enfant destiné à devenir citoyen ; dans La Nouvelle Héloïse, il imagine la vie idéale d’une microsociété ; dans le Contrat social, il pose les fondements d’un État juste et légitime, où chacun écoute la voix de sa conscience.
• L’« Émile » : de l’enfant au citoyen
Rousseau se montre original et même révolutionnaire dès les premières pages de l’Émile. Récit didactique, l’Émile repose sur l’intuition fondamentale, peut-être héritée de Condillac, mais pour la première fois appliquée et fondée en droit, de la perfectibilité humaine. À sa naissance, l’homme n’est rien, il devient tout. C’est cette genèse de la raison considérée au niveau de l’individu que Rousseau envisage dans l’Émile après l’avoir étudiée au plan de l’humanité dans le deuxième Discours. Car qu’est-ce que l’histoire de la corruption de l’humanité sinon l’histoire même de l’homme ? L’histoire de ses facultés ? L’ontogenèse reflète donc la phylogenèse ; avec, néanmoins, cette différence : tout enfant a devant lui la possibilité de son devenir, alors que l’humanité s’est embarquée dans une histoire mal commencée et qu’elle ne peut, hélas, rétrograder. Différence capitale, on le voit. Ainsi, pour Rousseau, l’enfant n’est d’abord que sensations, puis « raison sensitive », de là il devient « raison intellectuelle », et enfin conscience morale. Croissance du corps et croissance de la raison vont de pair. Comment aider l’enfant à ne pas gaspiller la chance de développer ses facultés conformément à la nature, chance que l’humanité a laissé échapper ? Comment pousser l’enfant à se cultiver, c’est-à-dire à passer d’un état d’innocence à un état de culture, sans pour autant que cette culture soit artificielle et contre-nature ? Comment, en un mot, actualiser sans les dénaturer les virtualités – raison, sociabilité, conscience morale et civique – de l’enfant ? Tel est le propos de Rousseau dans l’Émile.
Il forge une méthode éducative fondée sur l’idée de la prédominance de l’influence du milieu naturel sur celle des hommes. Autrement dit, il prône une éducation dépourvue de médiations. L’enfant découvrira tout par lui-même et en lui-même. C’est dire que le pédagogue sera moins un précepteur qu’un observateur. Il aura pour tâche non d’instruire l’enfant, mais de le diriger selon la voix de sa nature propre. Il ne donnera pas de préceptes, mais les fera découvrir par l’enfant lui-même. Deux tâches incombent donc au pédagogue : laisser faire la nature, d’une part, et préserver le cœur de l’enfant du vice et son esprit des préjugés, d’autre part. Telle est la fameuse éducation négative ou inactive élaborée par l’écrivain.
Toutefois, cette pédagogie « naturelle » n’est pas sans entraîner des difficultés, dont la principale est, paradoxalement, son artificialité. Certes, l’éducateur laissera faire la nature ; il faut pourtant que l’enfant soit confronté avec certains obstacles pour que sa nature s’accomplisse. Dès lors, bien qu’apparemment absent, le pédagogue sera partout présent. Il suscitera les rencontres de l’enfant avec la nature, favorisera les chocs affectifs ou intellectuels. Voilée mais extrêmement agissante, la main du maître sera derrière toute chose. C’est dans un monde « truqué », mené au gré des ruses de son pédagogue, que l’enfant évoluera et s’accomplira. Est-ce donc par l’artifice que Rousseau croit atteindre l’homme de la nature ? La contradiction, en fait, n’est qu’apparente, car la nature ne peut se conquérir que par l’apprentissage fondamental de la nécessité. Ce n’est qu’après avoir pris l’habitude de se plier exclusivement aux choses et non de s’assujettir à la volonté capricieuse des hommes que l’enfant sera vraiment libre. Or, pour cela, la présence discrète, mais effective, du pédagogue est requise.
Le respect de la liberté intérieure de l’enfant ou, si l’on préfère, de sa dignité humaine gouverne ainsi toute la pédagogie rousseauiste. Non moins importante et originale est la place qu’occupe l’idée de bonheur dans ce traité. Pour Rousseau, en effet, l’éducation de l’enfant doit être joyeuse, le passage de la nature brute à une culture en harmonie avec l’essence de l’individu se veut heureux. Seule une éducation qui considère l’enfant dans l’enfant et non l’adulte en puissance peut répondre à cette exigence de bonheur. C’est pourquoi Rousseau privilégie le développement physique de l’adolescent, les jeux. Loin de considérer l’éducation comme un dressage douloureux, Rousseau n’y voit qu’épanouissement libre et joyeux. Deux pôles gouvernent et articulent le projet rousseauiste : liberté d’une part, bonheur de l’autre, qui se retrouvent dans La Nouvelle Héloïse et dans le Contrat social.
• Vertu et bonheur
Dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau imagine sur le mode romanesque l’organisation d’une famille – au sens patriarcal, incluant la domesticité, les familiers de la maison, les cousins, les amis... – qui vivrait selon les enseignements de la nature, une nature non pas brutale et sauvage mais fécondée par la culture, par la raison. Masque, hypocrisie, orgueil, jalousie, artifice s’y trouvent bannis au profit de la transparence, de la communion des cœurs, de l’innocence, de la pureté. Comment s’opère ce prodige ? Quel principe gouverne cette « société des cœurs » ? L’Élysée, verger mystérieux, s’offre comme symbole de cette harmonie. À qui le regarde, ce jardin semble agreste et abandonné. Or tout y est d’un art consommé : « Il est vrai que la nature a tout fait, mais sous ma direction, et il n’y a rien là que je n’aie ordonné », déclare Julie. À force d’art, Julie a rejoint la nature, non pas la nature désordonnée et chaotique, mais une nature spiritualisée. Les passions, les élans du cœur doivent être équilibrés, purifiés par la raison ; tel est le message de l’Élysée. Or, La Nouvelle Héloïse trace le devenir moral de deux amants. Julie et Saint-Preux doivent, pour des raisons sociales, renoncer à leur ardente passion. Les deux amants, fous de douleur, parviennent néanmoins à dominer leur cœur. Libérés de l’appel impétueux des sens, en paix avec leur conscience mais fidèles à leur passion épurée, ils vivront réunis sous l’œil protecteur du mari de Julie. Saint-Preux placé en face de Mme de Wolmar conservera son amour pour Julie d’Étange et Julie continuera d’aimer Saint-Preux, seulement elle ne sera que « l’amante de son âme ». Vertu et bonheur se retrouvent à différents niveaux dans ce roman aux multiples facettes. Ces mêmes principes gouvernent en effet et l’économie domestique et l’éducation des enfants. Aussi bien la vie ordonnée, joyeusement paisible de Clarens est bien souvent opposée à celle qui est faite de perversion, d’esclavage et de malheur des grandes villes. Mais la vie citadine est-elle irrémédiablement vouée au malheur ? « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers [...] Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. » Dans ce préambule au Contrat social, l’auteur livre d’emblée son programme et sa méthode.
• Loi et contrat
Fonder le droit politique, telle est l’ambition de Rousseau. C’est pourquoi, loin de décrire le droit tel qu’il est, Rousseau se propose de rechercher ce qu’il devrait être ; autrement dit, il décide d’établir des conditions de possibilités d’une société – et par conséquent d’une autorité – légitime. À ses yeux, le fait ne fait pas droit. C’est donc en tant que philosophe et non en tant qu’ethnologue ou historien qu’il parlera. À la méthode génétique ou historique Rousseau oppose ainsi la méthode hypothético-déductive. Son problème s’énonce de la façon suivante : trouver un type d’association qui assurerait à chaque individu la sécurité – forme que revêt dans la vie sociale la notion particulière de bonheur, qui est le mobile du passage de l’état de nature à l’état civilisé – tout en lui permettant de conserver sa liberté, c’est-à-dire de ne pas trahir son essence. Chez lui se rencontrent concurremment la préoccupation dominante de la philosophie de Hobbes et celle de la philosophie de Locke. Sécurité et liberté sont les deux pôles organisateurs de sa Cité.
Rousseau rejette toute autorité reposant sur les privilèges de nature ou sur le droit du plus fort. Pour lui la seule autorité légitime naît d’un accord réciproque des parties contractantes, d’une convention. Pacte d’association donc, qui n’est suivi d’aucun pacte de sujétion. Non seulement le peuple est la source de la souveraineté, mais encore, il apparaît comme celui qui exerce cette souveraineté. Celle-ci demeure – pour reprendre les expressions percutantes de Rousseau – « inaliénable » et « indivisible ». Ainsi, le souverain et le peuple appartiennent à la même humanité considérée sous différents rapports. C’est dire, en quelque sorte, que tout individu pactise avec lui-même comme membre du corps social. « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté », affirme Rousseau : tout individu est aussi citoyen, ce que l’on exprime encore en disant qu’à tout droit correspond un devoir. « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. » Pierre angulaire de toute démocratie, la célèbre formule rousseauiste fait surgir la notion capitale et souvent mal comprise : celle de volonté générale. Loin d’être un hyperorganisme, cette volonté qui tend toujours à l’utilité publique se révèle, bien au contraire, intérieure à tout individu. Elle correspond ainsi à la conscience dont la voix se fait entendre en chacun. De sorte qu’on ne peut, ainsi que beaucoup l’ont voulu, considérer que la théorie rousseauiste de l’État conduit au « totalitarisme ».
Deux phares ne cessent de guider sa quête et d’illuminer sa doctrine : liberté d’une part, sécurité (« ordre social », « bonheur public ») de l’autre ; deux impératifs dont l’existence simultanée n’est rendue possible que par l’introduction d’un concept clé : celui d’égalité. La démocratie est là, tout entière.
• Rousseau législateur
La publication de la Profession de foi du vicaire savoyard, qui forme une importante partie du livre IV d’Émile, devait valoir à Rousseau la persécution et l’exil. L’auteur y faisait l’éloge de la religion naturelle et de la tolérance universelle. Il réduisait les dogmes à quelques principes très simples et fondait sa religion sur la conscience, instinct divin, juge du bien et du mal. « Le culte essentiel, disait-il, est celui du cœur. » Aussi ne faut-il pas s’étonner si le Parlement, la Sorbonne et l’Église, pour une fois d’accord, condamnèrent l’Émile et si Rousseau fut décrété « de prise de corps ». Quelques jours plus tard, le Petit Conseil de Genève englobait l’Émile et le Contrat social dans le même opprobre et ordonnait que ces deux livres fussent lacérés et brûlés devant la porte de l’Hôtel de Ville « comme téméraires, scandaleux, impies, tendant à détruire la religion chrétienne et tous les gouvernements ».
Averti de la menace qui pesait sur lui, Rousseau s’enfuit à Yverdon, d’où il fut chassé par le gouvernement de Berne, puis à Môtiers, dans la principauté de Neuchâtel, où il vécut pendant deux ans sous la protection du roi de Prusse. C’est là qu’il répondit à ses accusateurs, l’archevêque de Paris et le gouvernement de Genève, dans sa Lettre à Christophe de Beaumont et dans ses Lettres écrites de la montagne, deux ouvrages dont le style est particulièrement incisif.
Dans le Contrat social, Rousseau avait montré que le sort de l’humanité dépend de la nature des institutions politiques et que seuls quelques peuples qui n’ont point encore « porté le vrai joug des lois », qui vivent en paix et se suffisent à eux-mêmes, peuvent échapper à la dégénérescence et à la ruine. Il désignait l’île de Corse comme un de ces rares pays propre à la législation. Aussi accepta-t-il, à la demande d’un des partis corses, de préparer un Projet de Constitution inspiré des principes qu’il avait définis dans le Contrat social, mais adapté à la situation physique, politique, géographique, économique de l’île. Quelques années plus tard, il devait répondre affirmativement aux Confédérés de Bar venus lui demander son avis sur la manière de réformer la Constitution polonaise. Ni le Projet de Constitution pour la Corse, ni les Considérations sur le gouvernement de Pologne n’empêchèrent ces États d’être occupés ou même dépecés ! Rousseau avait vu les dangers qui pèsent sur les petites communautés, c’est pourquoi il avait engagé celles-ci à fortifier leur âme par la pratique de la vertu, de la liberté et de la tolérance, et surtout à se préoccuper de créer un véritable esprit public qui les préserverait de toute atteinte. Comme le pédagogue doit développer l’esprit libre et heureux de son élève, le législateur doit donner au peuple des institutions qui lui assurent la liberté et le conduisent à la vertu.
3. L’épreuve de la connaissance de soi
Victime de l’incompréhension et de la persécution, Rousseau se mit à rédiger ses Confessions





























