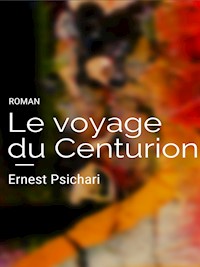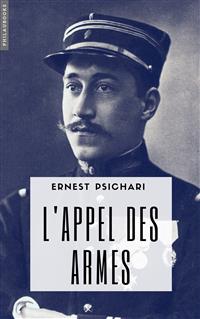
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Sprache: Französisch
Lorsque l’auteur de ce récit fit ses premières armes au service de la France, il lui sembla, qu’il commençait une vie nouvelle. Il eut vraiment le sentiment de quitter la laideur du monde et d’accomplir comme la première étape d’une route qui devait le conduire vers de plus pures grandeurs. Dès lors, il s’attacha à reconnaître patiemment la région dans laquelle il venait de pénétrer et à s’assurer des règles à l’aide desquelles il lui faudrait s’y diriger. De ces méditations juvéniles, sortit ce livre commencé dans l’ardeur de la vingt-sixième année, et achevé sous la tente saharienne, pendant les longues heures d’un magnifique exil. Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
L'appel des armes
Ernest Psichari
philaubooks
Table des matières
Sans titre
Préface
Partie I
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Partie II
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Partie III
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
A CELUI DONT L’ESPRIT M’ACCOMPAGNAIT DANS LES SOLITUDES DE L’AFRIQUE, A CET AUTRE SOLITAIRE EN QUI VIT AUJOURD’HUI L’AME DE LA FRANGE, ET DONT L’ŒUVRE A COURBÉ D’AMOUR NOTRE JEUNESSE, A NOTRE MAITRE
CHARLES PÉGUY
CE LIVRE DE NOTRE GRANDEUR ET DE NOTRE MISÈRE.
E.P.
Lorsque l’auteur de ce récit fit ses premières armes au service de la France, il lui sembla, qu’il commençait une vie nouvelle. Il eut vraiment le sentiment de quitter la laideur du monde et d’accomplir comme la première étape d’une route qui devait le conduire vers de plus pures grandeurs.
Dès lors, il s’attacha à reconnaître patiemment la région dans laquelle il venait de pénétrer et à s’assurer des règles à l’aide desquelles il lui faudrait s’y diriger.
De ces méditations juvéniles, sortit ce livre commencé dans l’ardeur de la vingt-sixième année, et achevé sous la tente saharienne, pendant les longues heures d’un magnifique exil.
Préface
Une nouvelle édition du célèbre livre d’Ernest Psichari « l’Appel des Armes » vient s’ajouter à tant d’autres, et l’on me fait l’honneur de me demander une courte préface pour l’annoncer. J’éprouve quelque confusion à l’écrire et cependant je me reprocherais de ne pas répondre à une aussi flatteuse sollicitation. Si mes quelques pages sont, – et je n’en doute pas, – parfaitement inutiles, que le lecteur veuille bien les pardonner au sentiment d’admiration et de reconnaissance qui les dicte !
Pourquoi le succès continu de cet ouvrage qui, si intéressant et si fort soit-il par certains côtés, n’est pas non plus sans défaut et trahit çà et là, non seulement les incertitudes d’un esprit qui ne fait encore que s’approcher du vrai, mais les inexpériences d’un écrivain débutant dans le métier ?
La destinée glorieuse et tragique de celui qui a scellé de son sang les idées dont il s’était fait l’apôtre suffit-elle à expliquer la faveur dont il jouit près des générations les plus récentes, lui l’aîné, lui le penseur d’avant-guerre ? Pas absolument.
Ernest Psichari est l’un des héros de la génération qui s’est si justement appelée « la génération sacrifiée », mais il est aussi, – et à ce point de vue ses écrits ont une valeur documentaire qui durera autant que notre histoire, – l’un des plus véridiques et des plus magnifiques témoins de l’évolution de la conscience française dans les années qui ont immédiatement précédé la redoutable tourmente. Car, – je ne suis pas le premier à en faire la remarque, – avant d’ avoir donné sur le champ de bataille le témoignage de son sacrifice héroïque, la France avait donné celui de son renouvellement intérieur. Pauvres psychologues, historiographes ignorants, ceux qui, en France et à l’étranger, neutres ou ennemis, expliquent par la violence de la commotion et par la peur de la mort, le changement moral et religieux qu’ont manifesté à tous les yeux les années 1914 et 1915 ! Dès 1911, pour qui savait voir, il était évident ; Albert de Mun en avait tressailli de joie ; un peu plus tard, M. Paul Bourget, recevant M. Boutroux à l’académie française, l’avait défini avec la précision du philosophe et du savant. Et, s’il m’est permis de rapprocher mon nom de noms aussi éclatants, n’avais-je pas, moi aussi, parcourant nos collèges dans les quinze premiers jours de juillet 1914, annoncé que la génération nouvelle nous donnerait deux grandes leçons, celle du soldat, investi de la mission de rendre à la patrie sa grandeur perdue, celle du chrétien qui, rompant avec un intellectualisme décevant, irait droit à la religion comme à la source de la force morale ?
Un instinct merveilleux, ne craignons pas de dire providentiellement suscité, avait averti la jeunesse française du danger que la France allait courir et de la tâche qui lui incomberait à elle-même. De cette tâche, Péguy a donné la formule : « Il faut que France, il faut que Chrétienté continue ».
France et Chrétienté, les deux mots se rapprochent et s’unissent étroitement. L’idéal national, l’idéal religieux se mêlent au point que, dans l’esprit de ces jeunes hommes, ils semblent n’en plus faire qu’un. Ils retrouvent d’un coup toute la tradition ; il s’agit de continuer ; il faut que France et Chrétienté continuent. Retour à l’esprit de tradition et à tout ce qu’elle contient, y compris la mystique chrétienne et le dogme catholique, telle leur apparaît la condition première du salut ; telle sera donc la première note de la génération qui veut le salut de la France.
La seconde sera la note militaire ; car, sans la force, point de salut pour une nation menacée ; c’est précisément d’avoir, le premier et plus haut que qui que ce soit donné cette note qui constitue l’originalité d’Ernest Psichari et de son livrée « l’Appel des Armes ».
A la face des hommes qui venaient de traîner dans la boue l’armée française et ses chefs, qui, au nom d’un faux humanitarisme, s’étaient déclarés, en dépit de tous les risques, pacifistes et prêts à désarmer la France, il sut découvrir et il osa célébrer « la mystique du métier militaire ». Si l’expression ne lui appartient pas en propre, – d’autres, à commencer par Péguy, l’ont employée aussi ; du moins fut-il, de cette mystique, le théoricien puissant et vivant. Au rebours des écrivains allemands qui la proclamaient eux aussi, il n’y mêla nul élément d’inhumaine violence, ni de farouche barbarie. Sa mystique de l’armée demeure humaine et chrétienne. Il comprit et il fit comprendre la grandeur de la servitude militaire. Il osa comparer le soldat au prêtre et proclamer les affinités profondes de ces deux épouvantails « le sabre et le goupillon ». Il saisit le rôle moral et civilisateur de l’armée ; il en devina l’efficacité rédemptrice dans les plus redoutables des crises nationales. Il vit Paris et la France s’unir autour de cette armée, retrouver à son égard l’enthousiasme que les passions révolutionnaires n’éteignent jamais chez nous que pour bien peu de temps, et se préparer à porter d’un cœur unanime la grande épreuve, dès qu’il plairait à Dieu d’en laisser sonner l’heure. Même sous la fureur des luttes religieuses, il sut reconnaître la persistance du fond chrétien et catholique de notre pays que tant d’entre nous, découragés ou irrités, se sentaient disposés à nier. En un mot, il retrouva tous les traits de la France éternelle, ceux-là même que Barrès, le maître de qui ces jeunes relevaient pour une si grande part, devait décrire en des pages qui resteront un des plus beaux monuments de notre langue.
Semblable au héros de « l’Appel des Armes », le jeune Français de 1914 « prenait contre son père le parti de ses pères ». Sa protestation se dressait véhémente contre les leçons dont avaient retenti les chaires les plus célèbres et qui avaient séduit leurs aînés.
De cette réaction, la génération nouvelle avait non seulement la conscience, mais l’orgueil. Quelques-uns le lui reprochèrent, non sans dureté, et c’étaient précisément ceux qui, moins que tous, en avaient le droit, car ils portaient la responsabilité d’un état d’esprit qui avait failli conduire la France à sa perte.
D’autres auraient pu se plaindre d’être englobés injustement dans l’anathème général porté contre les pères et les maîtres. Catholiques, depuis 1871, nous n’avions jamais, pas même une heure, laissé fléchir en nous l’idéal patriotique – pas plus que l’idéal religieux : nous avions toujours estimé qu’une défaite demeure et ne s’efface pas tant qu’elle n’a pas été effectivement réparée ; tous nos éducateurs, tous nos professeurs, tous nos prêtres, à l’exception de quelques malheureux modernistes un instant entraînés dans la crise intellectuelle qui emportait à fond l’autre jeunesse, avaient imperturbablement suivi la ligne droite ; pour bien servir la France au moment du danger, nos disciples n’avaient besoin de renier ni leurs maîtres, ni leurs principes.
Mais, depuis Jésus-Christ, les catholiques n’oublient pas « qu’il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de pénitence ». Les convertis leur sont chers ; ils les accueillent à bras ouverts.
Trop ouverts, murmurent aujourd’hui certains critiques, qu’agace un engouement parfois excessif pour ces nouveaux venus, chez qui ils relèvent, sans bienveillance, telles attitudes, expressions, qui leur paraissent malencontreuses.
Eh mon Dieu ! que des hommes dont la formation première n’a pas été chrétienne, ne sont pas, dès leur prime jeunesse, entrés dans les cadres catholiques, marchent d’abord un peu à tâtons, qu’ils procèdent par approximations successives ; que, malgré leur ferme volonté d’incliner totalement leur intelligence devant la doctrine de l’Eglise, volonté qu’ils ont souvent affirmée, ils n’atteignent pas la précision du langage théologique, quoi détonnant ? Mais faut-il leur en faire un grief ? Non. L’erreur consisterait à les transformer en guides de la pensée catholique. Ils n’y prétendent généralement pas.
Ernest Psichari notamment, parvenu au terme de son évolution intérieure et déjà résolu à s’inscrire dans la milice sacrée, reconnaissait les lacunes de son savoir et aspirait aux études qui devaient les combler. Il eût, tout le premier, souri des naïfs et des imprudents amis qui l’eussent traité de docteur et de père de l’Eglise. Quelle injustice pourtant de méconnaître l’heureux changement qu’il a provoqué en beaucoup de ses contemporains ! Combien ont appris de Maxence qu’ils avaient une âme faite à l’image de Dieu, qu’ils étaient nés pour croire, pour espérer et pour aimer !
Ce qui a été, ce qui demeure, dans cet ordre d’idées, l’œuvre propre, l’œuvre de bon aloi d’Ernest Psichari et de ses émules, c’est l’orientation nouvelle, l’orientation chrétienne et catholique qu’ils ont donnée à l’esprit d’une grande partie de la jeunesse intellectuelle. N’en est-ce point assez pour justifier de notre part les mots de reconnaissance et d’admiration que, pour mon compte, je n’ai pas craint d employer ?
Si l’on songe que ces mêmes hommes ont amené par milliers à l’amour de leur mère, la France, des fils qu’une éducation malfaisante en détournait ; que cet amour a été générateur du plus splendide héroïsme, des plus mystiques sacrifices pour le salut commun ; que de la direction qu’ils ont si largement contribué à donner à l’âme française est moralement sortie la victoire ; que cette victoire enfin ils l’ont payée de leur vie ; aux mêmes mots de reconnaissance et d’admiration qui remonteront à nos lèvres s’ajoutera celui de respect.
Alfred BAUDRILLART
de l’Académie Française.
Partie I
1
Bien qu’il eût dans sa vie contemplé beaucoup de paysages admirables, le capitaine Nangès aimait par-dessus tout ce petit coin de la Brie où le Grand Morin sinue à travers de pâles prairies, parmi des saules et des gaulis, en amont et en aval de la paisible petite ville de Crécy. C’est là qu’il avait pris coutume de venir oublier les fatigues de ses campagnes et de réapprendre la douceur des paysages de France. Nulle part, à son gré, il ne pouvait mieux achever la rêverie commencée dans le tumulte de l’Afrique ou la langueur de l’Asie, ni donner à cette rêverie une forme plus sincère et plus grave.
Dans ce canton de l’Ile-de-France, c’est une pensée qui vient du cœur, une pensée de dévotion et d’amitié qui vous envahit. Le soir, quand le soleil barre d’une raie d’intense violet les glèbes pesantes de l’horizon, par-dessus le frisson délicat et nocturne des hêtres, on se sent inondé d’amour, de volupté paisible, comme celle qu’évoque un foyer heureux. Dans les chemins creux où un pommier se penche de loin en loin, on rencontre des hommes et des enfants, et l’on entend de larges tintements d’angélus. Des parfums mouillés montent des vallées. Les coteaux gracieux sentent la nuit, le lourd repos...
Diocèse de Meaux, cryptes de Jouarre, cloches des petites communes, cloches des paroisses, Crécy, Villiers, Voulangis !... Les heures passent, claires et légères, point voluptueuses, si l’on veut, mais tendres surtout.
On a dit la grâce parfaite, l’harmonie délicate, le bon goût de ces paysages modérés. Ce n’est pas cela que venait y chercher un homme comme Timothée Nangès quand, dans les arrêts d’une vie désordonnée, il voulait se reposer dans de la certitude et de la logique. Ce qui lui plaisait dans cette terre, c’était au contraire il ne savait quoi de grand, de tendu, de sérieux, que pourtant il comprenait sans fatigue.
Ici la race est d’accord avec le paysage, sérieuse comme lui, ardente sans frivolité, sans élégances inutiles. Beauté tout intérieure, toute spirituelle. Certains soirs, on pense à Pascal, si français, quand il écrivait : « Certitude... Pleurs de joie. » Mais il y a plus de jeunesse ici, plus de verdeur.
Au fait, dans ces contrées, Timothée pouvait se dispenser d’admirer. Il était dans sa maison, chez lui. Là, son cœur parlait seul et les images ne comptaient plus. Son plaisir, c’était justement de ne pas admirer, et il comprenait alors la douceur de vivre. Partout ailleurs, il admirera ou il critiquera. Ici, point. Il respirait dans de la belle matière terrestre, dans une belle matière solide, confortable, où il était bien, il était à l’aise, il se sentait naturel et candide, parfaitement adapté.
Comme on approchait de la mi-octobre, Nangès avait quitté sa garnison de Cherbourg pour venir à Crécy tirer quelques perdrix et y mieux goûter ainsi les charmes d’un automne finissant. Il chassait en brave homme, en paysan, de gros souliers aux pieds, la pipe à la bouche. Il aimait les joies saines de la vie, les beaux chevaux, la chasse, le mouvement. A quarante ans, il n’avait d’autre ambition que de conserver son étonnante vigueur physique et que ses jours fussent beaux et unis comme le vol tendu des grands oiseaux de mer. Non que, habitué à la solitude, il n’eût connu les troubles d’une conscience ardente et inquiète, d’une sensibilité délicate toujours abandonnée à l’impression du moment, toujours attentive à la minute qui passait. Mais, peut-être pour ces raisons mêmes, avait-il éprouvé le besoin d’organiser son existence sur quelques réalités simples, que la jeunesse qu’il avait conservée à son cœur ne servait qu’à fortifier et à mieux asseoir. Il s’était installé dans une sorte de félicité intérieure, austère et sérieuse.
Elle lui venait surtout de l’exercice passionné de son métier, où il apportait une sorte de mysticisme singulier, et autant peut-être de l’ardeur qu’il mettait à saisir les faces changeantes et diverses de la vie. Ainsi, en même temps, c’était un soldat d’autrefois, un homme que toute idée moderne blessait et en même temps un homme profondément attaché à son siècle, en ce sens qu’il en avait toutes les inquiétudes, tout le trouble, le sombre tourment... M. Nangès avait d’ailleurs quelques biens, mais, trop replié sur lui-même, trop intérieur, il ne savait pas en tirer de grandes joies. Il avait eu un beau passé au Soudan, mais n’en avait jamais attendu de récompenses dans le monde. Il existe encore aujourd’hui de tels hommes.
Timothée avait d’ordinaire comme compagnon de chasse un jeune garçon dont le visage lui plaisait extrêmement. Il se nommait Maurice Vincent. Il était le fils de l’instituteur du village. Le capitaine Nangès aimait son regard qui s’essayait sur la vie, son impatience ; il trouvait du bonheur à être près de lui, dans la campagne familière.
Ils enfonçaient dans la terre chaude et marneuse. Le silence était adorable, mystérieux, comme s’il était fait de bruits lointains qu’on n’entendait pas. Alternativement, ils sifflaient le chien, le vieux setter Briquet...
Le dernier jour, celui du départ de Nangès pour sa garnison de Cherbourg, ils sortirent de bonne heure. Il tombait une bruine fine. Tous deux ne parlaient guère. Le capitaine n’était pas bavard. Comme ils marchaient depuis une heure, il dit seulement :
– Voici un temps qui n’est pas défavorable. Les longues nuits et les pluies vont aider la terre à retenir le fumet du gibier. Les courants vont pouvoir travailler.
– Eh oui, Monsieur Timothée, répondit le jeune homme, vous partez au mauvais moment. Et voici le temps encore où les bécasses vont arriver...
Tous deux aimaient la terre et la connaissaient, non point en artistes ni en poètes, mais dans le détail ; non dans son lyrisme, mais dans sa vie journalière ; non poétiquement, mais humblement, fraternellement. Tous deux, à des degrés divers, avaient reçu une forte nourriture intellectuelle. Le père de Maurice, esprit fumeux, théoricien diffus, et non dépourvu d’ambition, avait de bonne heure envoyé son fils au lycée de Meaux. Dépassant de beaucoup la culture assez simple de M. Vincent, l’enfant s’y était pris d’amour pour les beaux livres, la belle prose, la belle langue, pour les idées. Mais il avait gardé le goût enfantin de la campagne. Il sentait qu’il valait mieux dans une prairie mouillée d’automne que dans une salle d’étude. L’odeur sordide des classes le poursuivait. C’était un avertissement confus qu’il serait plus en sûreté dans le vallon natal que dans les mornes académies de nos pédagogues d’aujourd’hui. Ainsi il rejoignait le capitaine Nangès qui avait pris les mêmes chemins, mais plus consciemment, en haine de ce qu’on nomme de nos jours l’intellectualisme, par opposition sans doute avec l’intelligence.
Les deux chasseurs passèrent sur un grand plateau qu’un vent humide emplissait de détresse. Le capitaine tua quatre pluviers qui s’étaient égarés sur une éteule, et comme il était tard, ils allèrent déjeuner dans une auberge campagnarde qu’ils connaissaient.
Dans une sorte de fièvre qui se contenait, travaillait à se modérer, ivre d’odeurs et de brises, le capitaine, pendant le repas, conta d’autres chasses au Soudan, puis une guerre africaine, de grandes misères d’autrefois. Et l’enfant voyait des plaines mornes, du soleil, des gens qui marchent accablés. Mais il était le fils de l’instituteur Vincent, et il n’avait jamais entendu ce langage-là. Parmi ces échos nouveaux, l’on devine quel pouvait être le trouble de ses pensées.
Il faut qu’un Français raisonne et cherche partout des preuves. L’émoi que Maurice ressentait, en écoutant ces récits, il voulait le mesurer, savoir ce qu’en valait l’aune. Les imaginations guerrières qu’il se faisait, toutes ces agréables résonances lointaines, il ne les acceptait que sous bénéfice d’inventaire. Il n’était pas de ceux qui consentent bénévolement à cette dualité : que le cœur soit touché sans que la raison le soit. Or, quelle était la situation de Maurice Vincent devant le capitaine Nangès ?
D’abord il s’exaltait. Il retrouvait en lui des ardeurs qu’il croyait éteintes, car ses maîtres lui avaient appris les douces romances de l’humanitarisme. Il frémissait aux grands battements d’ailes de la Gloire ; n’entendait-il pas parler d’une épopée ? Mais aussitôt il se reprenait, s’indignait de ce mouvement du cœur et, en bon élève, maudissait la guerre.
Pour mieux s’expliquer ce petit combat intérieur, il faut rappeler que l’on était au temps du plus grand triomphe des pacifistes. On réprouvait tout emploi de la violence, toute action de la force. Il fallait — dans le monde de Maurice, c’était une obligation — rabaisser l’armée tout entière, et surtout quand elle fait œuvre d’armée, aux colonies. Il fallait détester les fusils, et surtout quand ils servent à tirer. C’était là en quelque sorte le thème de l’époque, le motif principal, et comme une de ses nécessités sociales. Il y avait des variantes. Les uns — et le père de Maurice était du nombre — maudissaient les soldats et leur drapeau. Les autres rêvaient d’une sorte d’armée qui fût comme un prolongement de l’école laïque, obligatoire et primaire, une œuvre postscolaire, selon le mot en faveur ; enfin, par une contradiction singulière, un instrument même de pacifisme. Mais, très généralement, dans le peuple comme dans la bourgeoisie, on s’accordait à trouver désuètes, indignes de notre temps, les vieilles vertus conquérantes de la race et à désirer un repos qui était celui des consciences honnêtes et apeurées. Quel moyen pour un jeune garçon d’échapper à son siècle et de ne pas professer des sentiments aussi bien portés ? Mais qu’un passant survienne, évoque une campagne lointaine, des herbes où des soldats rampent, le fusil au poing, les cris d’un assaut dans la lumière tremblante d’un beau jour, le vieux fonds reparaît. Ce qui dormait s’éveille, et si le jeune homme a quelque sincérité, tout est remis en question.
Ainsi, c’est une sorte de drame minuscule qui se jouait dans cette auberge de la Brie, pendant que deux chasseurs se délassaient en buvant du vin d’Avallon, neuf et léger.
Dans son trouble, voici, si l’on veut, ce que pensait le jeune homme et ce qu’il n’osait exprimer :
– L’armée est une bien belle chose, et c’est trop, je le sens bien, que d’en médire, comme fait mon père. Cependant, pourquoi ces conquêtes, ces abus de la force inique, dont je vois bien que le capitaine Nangès a goûté l’ivresse malsaine ? Je ne veux pas me laisser toucher par ces actions glorieuses qui me donnent assurément une grande idée de leur auteur, mais qui sentent un peu le moyen âge. Peut-être l’armée atteindrait-elle à une beauté plus sobre et plus moderne, si elle voulait se faire la modeste éducatrice de la nation et renoncer aux jeux coûteux et peu honorables de la guerre. Car si...
C’était un compromis. Mais le débat n’était-il pas passionnant qui mettait aux prises tant de forces contraires et égales, dont l’accord insensé constituait précisément la maladie de notre siècle ? Au vrai, Maurice Vincent ne foulait pas de cet accord. « Il faut parier, dit Pascal. Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué. » Maurice était honnête. Il ne voulait pas retirer des récits de Nangès d’agréables émotions et en même temps refuser de le suivre jusqu’où il voulait l’entraîner, prendre tout et ne rien donner. Dans une semblable dispute, il comprenait qu’il ne s’agissait pas d’être pour jusqu’à un certain point, ou contre jusqu’à un certain point. Il était parfaitement intolérable que le cœur assignât une limite et la raison une autre limite, que l’imagination trouvât son compte, mais que la pure doctrine trouvât le sien aussi. Entre ces deux points extrêmes, la place était intenable. Il fallait aviser.
Et c’est ce qu’exprima justement le capitaine Nangès, lorsqu’il eût payé l’hôtelière et que, sur la route départementale de Melun, il eût retrouvé son ami :
– Toutes ces agitations — c’était d’une campagne saharienne qu’il parlait — toutes ces agitations ne sont rien sans l’idée qui leur donne un sens. Ce n’est pas un grand honneur, mon cher Maurice, que de mourir de soit dans un désert. Mais c’en est un que d’avoir une idée, ou, si tu veux, bien que le mot soit condamné, une foi. On nous accuse d’être une force du passé. C’est vrai. Il n’y a point d’accommodements possibles avec nous, point d’adaptations ni de transactions d’aucune sorte. Un soldat est un homme d’une simplicité merveilleuse. Notre livre ne se compose que de quelques théorèmes qui suffisent à nos besoins. Mais là, par exemple, rien à retrancher ni à ajouter. Si l’on retranche ou si l’on ajoute, si peu que ce soit, on détruit tout. La moindre adjonction, la moindre suppression, amènent une déviation infinie. Je ne demande pas...
Ah ! combien cette première position était habile dans sa candeur, et justement par cette candeur même ! Le capitaine ne parlait pas souvent ainsi. Seulement, il faut le dire, pendant les longues promenades des derniers jours, le jeune Maurice Vincent l’avait prodigieusement intéressé. Non pas, nous l’avons dit, qu’ils eussent échangé beaucoup de mots. Mais Maurice lui semblait un type essentiel, ou, comme dit Emerson, « un homme représentatif ».
Il avait manifestement les vertus de la race, l’esprit orné et latin, mais attaché à la terre, tout près du sol. Il excellait à la chasse et s’y montrait tout entier, hardi, décidé, plein de bon sens et de finesse, ingénieux. La chasse est moins en France le sport du grand seigneur que celui des gens de la classe même de Vincent : paysans riches, petits bourgeois, demi-bourgeois, petits fonctionnaires, humbles hobereaux campagnards. Maurice Vincent, en pantalon de velours, en jambières de toile grise, la veste ouverte sur un tricot de grosse laine, avec son air réfléchi, son parler lent, un peu traînant, est typique. Il est, en effet, une représentation éminente, et qui peut prendre, dans ce décor de l’Ile de-France, toute sa valeur. Et ce que Nangès a cru remarquer chez lui dans ses promenades, c’est une sorte de gravité, un certain ton élevé, le besoin d’un système, joint à une spontanéité naïve, mais le besoin, tout de même, d’un système d’idées, d’une logique idéale.
C’est une chose merveilleuse en France que l’on puisse toucher le plus humble jeune homme par de la foi, et pourvu que des raisons supérieures soient mises en jeu.
– Je ne demande pas, continuait Nangès, que tu entendes tout ce que je dis. Beaucoup de soldats, hélas ! ne l’entendent pas. On se révolte contre certaines mesquineries. Ceux même qui ne blâment pas l’ensemble blâment le détail, la rudesse des caporaux, l’inutilité de certaines « vexations » ou de certaines fatigues imposées sans qu’on en voie bien la raison, le mépris que l’on a souvent à la caserne pour le « bachelier » ou l’« intellectuel », telle dureté qui broie trop l’individu. À un degré supérieur, d’autres qui ne blâment pas le principe, blâment l’application du principe, son utilisation éventuelle, et c’est alors l’armée conquérante que l’on vise. Tous ont tort. Il faut choisir. C’est un tout immuable : chaque chose y a sa place, ou il n’est rien. « Celui qui n’est pas pour moi est contre moi. » Tu as beaucoup lu, mon cher enfant, et les propos de tes aînés ont mis en toi le trouble de la conscience moderne. Mais dans ce qui m’occupe maintenant, les lectures sont peu de chose. L’armée est un article de foi. Je ne te requiers pas, si encore tu me suis jusqu’ici, de rester toute ta vie dans l’armée. Mais j’aimerais qu’en allant au service, tu eusses l’idée préconçue de trouver tout bien. Je te citerai encore ce grand Pascal. Il voulait que l’on fit les gestes de la religion avant même que l’on crût, et il écrit la phrase célèbre : « Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira. – Mais c’est ce que je crains. – Et pourquoi ? Qu’avez-vous à perdre ? » Pour ma part, je ne redoute pas de telles extrémités.
Peut-être ce coup-là, M. Nangès allait-il un peu loin. Mais il se trouva justement qu’il disait ce qu’il fallait dire. C’était une utile réponse aux tièdes leçons de M. Vincent.
Tiraillé entre ces deux partis, Maurice devait écouter son cœur. Il avait la conscience du danger. Suivre l’instituteur, c’était tout perdre, et la vraie conscience de lui-même, et l’utilisation de ses facultés normales. Ses vertus naturelles ne trouvaient plus leur emploi.
Nangès se flatte d’avoir porté un coup qui peut perdre ou sauver le jeune homme. Ou Maurice se retrouvera, et retrouvera du même coup sa vraie route, – ou, au contraire, il sera effrayé des forces du passé, et, comme tant d’autres, acceptera l’hypocrisie, consentira au double jeu qui le révoltait tout à l’heure. Or justement, lorsqu’il s’était aperçu qu’il se plaisait aux récits passionnés du capitaine Nangès, n’avait-il pas déjà rejeté cette hypocrisie ? Tout cela est si impliqué qu’il n’ose aller plus avant. Il demande seulement la confiance en la vie.
Un dernier trait montrera comme il entendait cette confiance, et sa candeur délicate.
Comme ils arrivaient, le capitaine et lui, à hauteur des premières maisons de Voulangis et qu’ils semblaient, après être allés si loin en eux-mêmes, se recueillir, ils virent venir d’un sentier à travers champs une assez jolie jeune, fille, presque une enfant, et fraîche, et que suivait une chèvre enrubannée.
– Ah ! Monsieur Timothée, dit gaiement le jeune homme, vous n’avez pas encore vu ma petite amie. Elle s’appelle Claire Monestier. Elle est jolie, n’est-ce pas ?
Il s’approcha de la jeune fille, lui prit la main et lui dit, avec un peu d’orgueil enfantin, qu’elle faisait la connaissance du capitaine Nangès, de l’artillerie coloniale.
Le ton sur lequel il fit cette présentation n’échappa nullement à Timothée. Ce lui fut une nouvelle indication. Et plus loin, comme ils allaient vers la diligence de Crécy :
– Nous ne sommes pas encore fiancés. Mais nous nous marierons un jour.
Cette simplicité amoureuse charma le capitaine. Il apercevait là, plutôt qu’une grande passion, un sentiment fin, aimable, de bonne et durable qualité, Point de curiosité d’amour ni d’impatience. Rien qu’un regard ferme et clair, où brillait une sorte de volonté