
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait : "La Lune était en son plein, le ciel était découvert, et neuf heures du soir étaient sonnées lorsque nous revenions d'une maison proche de Paris, quatre de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016895
©Ligaran 2015
La Lune était en son plein, le ciel était découvert, et neuf heures du soir étaient sonnées lorsque nous revenions d’une maison proche de Paris, quatre de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l’un le prenait pour une lucarne du ciel par où l’on entrevoyait la gloire des bienheureux ; tantôt l’autre protestait que c’était la platine où Diane dresse les rabats d’Apollon ; tantôt un autre s’écriait que ce pourrait bien être le soleil lui-même, qui s’étant au soir dépouillé de ses rayons regardait par un trou ce qu’on faisait au monde quand il n’y était plus.
« Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m’amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la Lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. »
La compagnie me régala d’un grand éclat de rire.
« Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la Lune, de quelque autre, qui soutient que ce globe-ci est un monde. » Mais j’eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge, Copernic et Kepler, avaient été de cette opinion, je ne les obligeai qu’à s’égosiller de plus belle.
Cette pensée, dont la hardiesse biaisait en mon humeur, affermie par la contradiction, se plongea si profondément chez moi que, pendant tout le reste du chemin, je demeurai gros de mille définitions de Lune, dont je ne pouvais accoucher ; et à force d’appuyer cette créance burlesque par des raisonnements sérieux, je me le persuadai aussi, mais, écoute, lecteur, le miracle ou l’accident dont la Providence ou la fortune se servirent pour me le confirmer.
J’étais de retour à mon logis et, pour me délasser de la promenade, j’étais à peine entré dans ma chambre quand sur ma table je trouvai un livre ouvert que je n’y avais point mis. C’était les œuvres de Cardan ; et quoique je n’eusse pas dessein d’y lire, je tombai de la vue, comme par force, justement dans une histoire que raconte ce philosophe : il écrit qu’étudiant un soir à la chandelle, il aperçut entrer, à travers les portes fermées de sa chambre, deux grands vieillards, lesquels, après beaucoup d’interrogations qu’il leur fit, répondirent qu’ils étaient habitants de la Lune, et cela dit, ils disparurent.
Je demeurai si surpris, tant de voir un livre qui s’était apporté là tout seul, que du temps et de la feuille où il s’était rencontré ouvert, que je pris toute cette enchaînure d’incidents pour une inspiration de Dieu qui me poussait à faire connaître aux hommes que la Lune est un monde.
« Quoi ! disais-je en moi-même, après avoir tout aujourd’hui parlé d’une chose, un livre qui peut-être est le seul au monde où cette matière se traite voler de ma bibliothèque sur ma table, devenir capable de raison, pour s’ouvrir justement à l’endroit d’une aventure si merveilleuse et fournir ensuite à ma fantaisie les réflexions et à ma volonté les desseins que je fais !… Sans doute, continuais-je, les deux vieillards qui apparurent à ce grand homme sont ceux-là mêmes qui ont dérangé mon livre, et qui l’ont ouvert sur cette page, pour s’épargner la peine de me faire cette harangue qu’ils ont faite à Cardan.
« Mais, ajoutais-je, je ne saurais m’éclaircir de ce doute, si je ne monte jusque-là ?
– Et pourquoi non ? me répondais-je aussitôt.
Prométhée fut bien autrefois au ciel dérober du feu. À ces boutades de fièvres chaudes, succéda l’espérance de faire réussir un si beau voyage. Je m’enfermai, pour en venir à bout, dans une maison de campagne assez écartée, ou après avoir flatté mes rêveries de quelques moyens capables de m’y porter, voici comme je me donnai au ciel.
Je m’étais attaché autour de moi quantité de fioles pleines de rosée, et la chaleur du soleil qui les attirait m’éleva si haut, qu’à la fin je me trouvai au-dessus des plus hautes nuées. Mais comme cette attraction me faisait monter avec trop de rapidité, et qu’au lieu de m’approcher de la Lune, comme je prétendais, elle me paraissait plus éloignée qu’à mon partement, je cassai plusieurs de mes fioles, jusqu’à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait l’attraction et que je descendais vers la Terre.
Mon opinion ne fut point fausse, car j’y retombai quelque temps après, et à compter l’heure que j’en étais parti, il devait être minuit. Cependant je reconnus que le soleil était alors au plus haut de l’horizon, et qu’il était midi. Je vous laisse à penser combien je fus étonné : certes je le fus de si bonne sorte que, ne sachant à quoi attribuer ce miracle, j’eus l’insolence de m’imaginer qu’en faveur de ma hardiesse, Dieu avait encore une fois recloué le soleil aux cieux, afin d’éclairer une si généreuse entreprise.
Ce qui accrut mon ébahissement, ce fut de ne point connaître le pays où j’étais, vu qu’il me semblait qu’étant monté droit, je devais être descendu au même lieu d’où j’étais parti. Équipé comme j’étais, je m’acheminai vers une chaumière, où j’aperçus de la fumée ; et j’en étais à peine à une portée de pistolet, que je me vis entouré d’un grand nombre de sauvages. Ils parurent fort surpris de ma rencontre ; car j’étais le premier, à ce que je pense, qu’ils eussent jamais vu habillé de bouteilles. Et pour renverser encore toutes les interprétations qu’ils auraient pu donner à cet équipage, ils voyaient qu’en marchant je ne touchais presque point à la Terre : aussi ne savaient-ils pas qu’au premier branle que je donnais à mon corps, l’ardeur des rayons de midi me soulevait avec ma rosée, et sans que mes fioles ne fussent plus en assez grand nombre, j’eusse été, possible, à leur vue enlevé dans les airs.
Je les voulus aborder ; mais comme si la frayeur les eût changés en oiseaux, un moment les vit perdre dans la forêt prochaine. J’en attrapai toutefois un, dont les jambes sans doute avaient trahi le cœur. Je lui demandai avec bien de la peine (car j’étais essoufflé), combien on comptait de là à Paris, depuis quand en France le monde allait tout nu, et pourquoi ils me fuyaient avec tant d’épouvante. Cet homme à qui je parlais était un vieillard olivâtre, qui d’abord se jeta à mes genoux ; et joignant les mains en haut derrière la tête, ouvrit la bouche et ferma les yeux. Il marmotta longtemps, mais je ne discernai point qu’il articulât rien ; de façon que je pris son langage pour le gazouillement enroué d’un muet.
À quelque temps de là, je vis arriver une compagnie de soldats tambour battant, et j’en remarquai deux se séparer du gros pour me reconnaître. Quand ils furent assez proches pour être entendus, je leur demandai où j’étais.
« Vous êtes en France, me répondirent-ils ; mais qui diable vous a mis dans cet état ? et d’où vient que nous ne vous connaissons point ? Est-ce que les vaisseaux sont arrivés ? En allez-vous donner avis à M. le Gouverneur ? Et pourquoi avez-vous divisé votre eau-de-vie en tant de bouteilles ?” À tout cela, je leur repartis que le diable ne m’avait point mis en cet état ; qu’ils ne me connaissaient pas, à cause qu’ils ne pouvaient pas connaître tous les hommes ; que je ne savais point que la Seine portât des navires ; que je n’avais point d’avis à donner à M. de Montbazon ; et que je n’étais point chargé d’eau-de-vie.
« Ho, ho, me dirent-ils, me prenant par le bras, vous faites le gaillard ? M. le Gouverneur vous connaîtra bien, lui !” Ils me menèrent vers leur gros, me disant ces paroles, et j’appris d’eux que j’étais en France et n’étais point en Europe, car j’étais en la Nouvelle France. Je fus présenté à M. de Montmagny, qui en est le vice-roi. Il me demanda mon pays, mon nom et ma qualité ; et après que je l’eus satisfait, en lui racontant l’agréable succès de mon voyage, soit qu’il le crût, soit qu’il feignît de le croire, il eut la bonté de me faire donner une chambre dans son appartement. Mon bonheur fut grand de rencontrer un homme capable de hautes opinions, et qui ne s’étonna point quand je lui dis qu’il fallait que la Terre eût tourné pendant mon élévation ; puisque ayant commencé de monter à deux lieues de Paris, j’étais tombé par une ligne quasi perpendiculaire en Canada.
Le soir, comme je m’allais coucher, je le vis entrer dans ma chambre :
« Je ne serais pas venu, me dit-il, interrompre votre repos, si je n’avais cru qu’une personne qui a pu faire neuf cents lieues en demi-journée les a pu faire sans se lasser. Mais vous ne savez pas, ajouta-t-il, la plaisante querelle que je viens d’avoir pour vous avec nos pères jésuites ? Ils veulent absolument que vous soyez magicien ; et la plus grande grâce que vous puissiez obtenir d’eux, c’est de ne passer que pour imposteur. Et en vérité, ce mouvement que vous attribuez à la Terre n’est-ce point un beau paradoxe ; ce qui fait que je ne suis pas bien fort de votre opinion, c’est qu’encore qu’hier vous fussiez parti de Paris, vous pouvez être arrivé aujourd’hui en cette contrée, sans que la Terre ait tourné ; car le soleil vous ayant enlevé par le moyen de vos bouteilles, ne doit-il pas vous avoir amené ici, puisque, selon Ptolémée, Tyco-Brahé, et les philosophes modernes, il chemine du biais que vous faites marcher la Terre ? Et puis quelles grandes vraisemblances avez-vous pour vous figurer que le soleil soit immobile, quand nous le voyons marcher ? et que la Terre tourne autour de son centre avec tant de rapidité, quand nous la sentons ferme dessous nous ?
– Monsieur, lui répliquai-je, voici les raisons qui nous obligent à le préjuger. Premièrement, il est du sens commun de croire que le soleil a pris place au centre de l’univers, puisque tous les corps qui sont dans la nature ont besoin de ce feu radical qui habite au cœur du royaume pour être en état de satisfaire promptement à leurs nécessités et que la cause des générations soit placée également entre les corps, où elle agit, de même que la sage nature a placé les parties génitales dans l’homme, les pépins dans le centre des pommes, les noyaux au milieu de leur fruit ; et de même que l’oignon conserve à l’abri de cent écorces qui l’environnent le précieux germe où dix millions d’autres ont à puiser leur essence. Car cette pomme est un petit univers à soi-même, dont le pépin plus chaud que les autres parties est le soleil, qui répand autour de soi la chaleur, conservatrice de son globe ; et ce germe, dans cet oignon, est le petit soleil de ce petit monde qui réchauffe et nourrit le sel végétatif de cette masse.
Cela donc supposé, je vis que la Terre ayant besoin de la lumière, de la chaleur, et de l’influence de ce grand feu, elle se tourne autour de lui pour recevoir également en toutes ses parties cette vertu qui la conserve. Car il serait aussi ridicule de croire que ce grand corps lumineux tournât autour d’un point dont il n’a que faire, que de s’imaginer quand nous voyons une alouette rôtie, qu’on a, pour la cuire, tourné la cheminée à l’entour. Autrement si c’était au soleil à faire cette corvée, il semblerait que la médecine eût besoin du malade ; que le fort dût plier sous le faible, le grand servir au petit ; et qu’au lieu qu’un vaisseau cingle le long des côtes d’une province, on dût faire promener la province autour du vaisseau.
Que si vous avez de la peine à comprendre comme une masse si lourde se peut mouvoir, dites-moi, je vous prie, les astres et les cieux que vous faites si solides, sont-ils plus légers ? Encore nous, qui sommes assurés de la rondeur de la Terre, il nous est aisé de conclure son mouvement par sa figure. Mais pourquoi supposer le ciel rond, puisque vous ne le sauriez savoir, et que de toutes les figures, s’il n’a pas celle-ci, il est certain qu’il ne se peut pas mouvoir ? Je ne vous reproche point vos excentriques, vos concentriques ni vos épicycles ; tous lesquels vous ne sauriez expliquer que très confusément, et dont je sauve mon système. Parlons seulement des causes naturelles de ce mouvement.
Vous êtes contraints vous autres de recourir aux intelligences qui remuent et gouvernent vos globes.
Mais moi, sans interrompre le repos du Souverain Être, qui sans doute a créé la nature toute parfaite, et de la sagesse duquel il est de l’avoir achevée, de telle sorte que, l’ayant accomplie pour une chose, il ne l’ait pas rendue défectueuse pour une autre ; moi, dis-je, je trouve dans la Terre les vertus qui la font mouvoir. Je dis donc que les rayons du soleil, avec ses influences, venant à frapper dessus par leur circulation, la font tourner comme nous faisons tourner un globe en le frappant de la main ; ou que les fumées qui s’évaporent continuellement de son sein du côté que le soleil la regarde, répercutées par le froid de la moyenne région, rejaillissent dessus, et de nécessité ne la pouvant frapper que de biais, la font ainsi pirouetter.
L’explication des deux autres mouvements est encore moins embrouillée, considérez, je vous prie… À ces mots, M. de Montmagny m’interrompit et :
J’aime mieux, dit-il, vous dispenser de cette peine ; aussi bien ai-je lu sur ce sujet quelques livres de Gassendi, à la charge que vous écouterez ce que me répondit un jour l’un de nos Pères qui soutenait votre opinion :
« En effet, disait-il, je m’imagine que la Terre tourne, non point pour les raisons qu’allègue Copernic, mais pour ce que le feu d’enfer, ainsi que nous apprend la Sainte Écriture, étant enclos au centre de la Terre, les damnés qui veulent fuir l’ardeur de la flamme, gravissent pour s’en éloigner contre la voûte, et font ainsi tourner la Terre, comme un chien fait tourner une roue, lorsqu’il court enfermé dedans. » Nous louâmes quelque temps le zèle du bon Père ; et son panégyrique étant achevé, M. de Montmagny me dit qu’il s’étonnait fort, vu que le système de Ptolémée était si peu probable, qu’il eût été si généralement reçu.
« Monsieur, lui répondis-je, la plupart des hommes, qui ne jugent que par les sens, se sont laissé persuader à leurs yeux ; et de même que celui dont le vaisseau navigue terre à terre croit demeurer immobile, et que le rivage chemine, ainsi les hommes tournant avec la Terre autour du ciel, ont cru que c’était le ciel lui-même qui tournait autour d’eux. Ajoutez à cela l’orgueil insupportable des humains, qui leur persuade que la nature n’a été faite que pour eux ; comme s’il était vraisemblable que le soleil, un grand corps, quatre cent trente-quatre fois plus vaste que la terre, n’eût été allumé que pour mûrir ses nèfles, et pommer ses choux.
Quant à moi, bien loin de consentir à l’insolence de ces brutaux, je crois que les planètes sont des mondes autour du soleil, et que les étoiles fixes sont aussi des soleils qui ont des planètes autour d’eux, c’est-à-dire des mondes que nous ne voyons pas d’ici à cause de leur petitesse, et parce que leur lumière empruntée ne saurait venir jusqu’à nous.
Car comment, en bonne foi, s’imaginer que ces globes si spacieux ne soient que de grandes campagnes désertes, et que le nôtre, à cause que nous y rampons, une douzaine de glorieux coquins, ait été bâti pour commander à tous ? Quoi ! parce que le soleil compasse nos jours et nos années, est-ce à dire pour cela qu’il n’ait été construit qu’afin que nous ne cognions pas de la tête contre les murs ?
Non, non, si ce Dieu visible éclaire l’homme, c’est par accident, comme le flambeau du roi éclaire par accident au crocheteur qui passe par la rue.
– Mais, me dit-il, si comme vous assurez, les étoiles fixes sont autant de soleils, on pourrait conclure de là que le monde serait infini, puisqu’il est vraisemblable que les peuples de ces mondes qui sont autour d’une étoile fixe que vous prenez pour un soleil découvrent encore au-dessus d’eux d’autres étoiles fixes que nous ne saurions apercevoir d’ici, et qu’il en va éternellement de cette sorte.
– N’en doutez point, lui répliquai-je ; comme Dieu a pu faire l’âme immortelle, il a pu faire le monde infini, s’il est vrai que l’éternité n’est rien autre chose qu’une durée sans bornes, et l’infini une étendue sans limites. Et puis Dieu serait fini lui-même, supposé que le monde ne fût pas infini, puisqu’il ne pourrait pas être où il n’y aurait rien, et qu’il ne pourrait accroître la grandeur du monde, qu’il n’ajoutât quelque chose à sa propre étendue, commençant d’être où il n’était pas auparavant. Il faut donc croire que comme nous voyons d’ici Saturne et Jupiter, si nous étions dans l’un ou dans l’autre, nous découvririons beaucoup de mondes que nous n’apercevons pas d’ici, et que l’univers est éternellement construit de cette sorte.
– Ma foi ! me répliqua-t-il, vous avez beau dire, je ne saurais du tout comprendre cet infini.
– Eh ! dites-moi, lui dis-je, comprenez-vous mieux le rien qui est au-delà ? Point du tout.
Quand vous songez à ce néant, vous vous l’imaginez tout au moins comme du vent, comme de l’air, et cela est quelque chose ; mais l’infini, si vous ne le comprenez en général, vous le concevez au moins par parties, car il n’est pas difficile de se figurer de la Terre, du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux. Or, l’infini n’est rien qu’une tissure sans bornes de tout cela. Que si vous me demandez de quelle façon ces mondes ont été faits, vu que la Sainte Écriture parle seulement d’un que Dieu créa, je réponds qu’elle ne parle que du nôtre à cause qu’il est le seul que Dieu ait voulu prendre la peine de faire de sa propre main, mais tous les autres qu’on voit ou qu’on ne voit pas, suspendus parmi l’azur de l’univers, ne sont rien que l’écume des soleils qui se purgent. Car comment ces grands feux pourraient-ils subsister, s’ils n’étaient attachés à quelque matière qui les nourrit ?
Or comme le feu pousse loin de chez soi la cendre dont il est étouffé ; de même que l’or dans le creuset, se détache en s’affinant du marcassite qui affaiblit son carat, et de même que notre cœur se dégage par le vomissement des humeurs indigestes qui l’attaquent ; ainsi le soleil dégorge tous les jours et se purge des restes de la matière qui nourrit son feu. Mais lorsqu’il aura tout à fait consommé cette matière qui l’entretient, vous ne devez point douter qu’il ne se répande de tous côtés pour chercher une autre pâture, et qu’il ne s’attache à tous les mondes qu’il aura construits autrefois, à ceux particulièrement qu’il rencontrera les plus proches ; alors ce grand feu, rebrouillant tous les corps, les rechassera pêle-mêle de toutes parts comme auparavant, et s’étant peu à peu purifié, il commencera de servir de soleil à ces petits mondes qu’il engendrera en les poussant hors de sa sphère.
C’est ce qui a fait sans doute prédire aux pythagoriciens l’embrasement universel.
Ceci n’est pas une imagination ridicule ; la Nouvelle-France, où nous sommes, en produit un exemple bien convaincant. Ce vaste continent de l’Amérique est une moitié de la Terre, laquelle en dépit de nos prédécesseurs qui avaient mille fois cinglé l’Océan, n’avait point encore été découverte ; aussi n’y était-elle pas encore non plus que beaucoup d’îles, de péninsules, et de montagnes, qui se sont soulevées sur notre globe, quand les rouillures du soleil qui se nettoie ont été poussées assez loin, et condensées en pelotons assez pesants pour être attirées par le centre de notre monde, possible peu à peu en particules menues, peut-être aussi tout à coup en une masse. Cela n’est pas si déraisonnable, que saint Augustin n’y eût applaudi, si la découverte de ce pays eût été faite de son âge ; puisque ce grand personnage, dont le génie était éclairé du Saint-Esprit, assure que de son temps la Terre était plate comme un four, et qu’elle nageait sur l’eau comme la moitié d’une orange coupée. Mais si j’ai jamais l’honneur de vous voir en France, je vous ferai observer par le moyen d’une lunette fort excellente que j’ai que certaines obscurités qui d’ici paraissent des taches sont des mondes qui se construisent. » Mes yeux qui se fermaient en achevant ce discours obligèrent M. de Montmagny à me souhaiter le bonsoir. Nous eûmes, le lendemain et les jours suivants, des entretiens de pareille nature. Mais comme quelque temps après l’embarras des affaires de la province accrocha notre philosophie, je retombai de plus belle au dessein de monter à la Lune.
Je m’en allais dès qu’elle était levée, [rêvant] parmi les bois, à la conduite et au réussit de mon entreprise. Enfin, un jour, la veille de Saint-Jean, qu’on tenait conseil dans le fort pour déterminer si on donnerait secours aux sauvages du pays contre les Iroquois, je m’en fus tout seul derrière notre habitation au coupeau d’une petite montagne, où voici ce que j’exécutai :
Avec une machine que je construisis et que je m’imaginais être capable de m’élever autant que je voudrais, je me précipitai en l’air du faîte d’une roche. Mais parce que je n’avais pas bien pris mes mesures, je culbutai rudement dans la vallée.
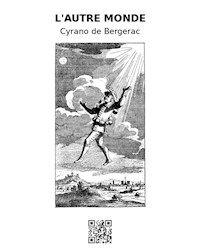
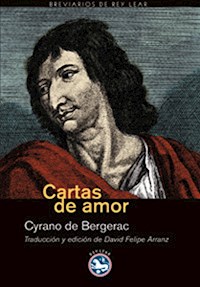

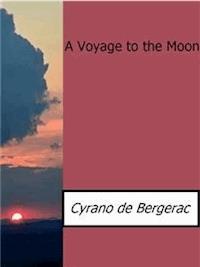














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










