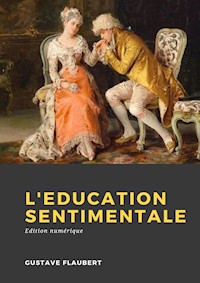
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’éducation sentimentale est un roman de Gustave Flaubert, inspiré de ses expériences amoureuses. Il retrace la vie de Frédéric Moreau, jeune étudiant qui veut intégrer la haute société. Frédéric quitte Paris pour Nogent-sur-Seine à bord d’un bateau. Il y rencontre le couple Arnoux, et tombe éperdument amoureux de Madame Arnoux. Une fois arrivé, il retrouve Charles Deslauriers, son meilleur ami et lui raconte son coup de foudre avec elle. Charles lui suggère de se rapprocher de Monsieur Arnoux, pour avoir une excuse de les voir souvent. Pour ses ambitions de se frayer un chemin dans la haute sphère, Charles lui conseille également de se lier d’amitié avec son voisin le père Roque, ami du riche Monsieur Dambreuse, banquier renommé. Frédéric retourne à Paris pour ses études de droit à la faculté. Mais malgré des lettres de recommandation du Père Roque, il n’est pas accueilli convenablement par Monsieur Dambreuse. Ce dernier lui conseille alors de se lier d’amitié avec son mari, Jacques Arnoux, pour se rapprocher d’elle. Il lui conseille aussi de profiter de son voisin, le père Roque, qui a des liens étroits avec un riche banquier, monsieur Dambreuse.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gustave Flaubert est né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à 59 ans à Croisset, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai 1880. Avec Victor Hugo, Stendhal, Balzac et Zola, il est considéré comme l'un des plus grands romanciers français du XIXe siècle. Flaubert se différencie par sa conception du métier d’écrivain et la modernité de sa poétique romanesque. Prosateur de premier plan de la seconde moitié du XIXe siècle, Gustave Flaubert a marqué la littérature universelle par la profondeur de ses analyses psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements des individus et de la société. La force de son style se révèle dans de grands romans comme
Madame Bovary (1857),
Salammbô (1862),
L'Éducation sentimentale (1869) ou le recueil de nouvelles
Trois Contes (1877).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustave Flaubert
L’ÉDUCATION SENTIMENTALE.
– 1845–
I
Le héros de ce livre, un matin d’octobre, arriva a Paris avec un cœur de dix-huit ans et un diplôme de bachelier ès lettres.
Il fit son entrée dans cette capitale du monde civilisé par la porte Saint-Denis, dont il put admirer la belle architecture ; il vit dans les rues des voitures de fumier traînées par un cheval et un âne, des charrettes de boulanger tirées à bras d’homme, des laitières qui vendaient leur lait, des portières qui balayaient le ruisseau. Cela faisait beaucoup de bruit. Notre homme, la tête à la portière de la diligence, regardait les passants et lisait les enseignes.
Quand, après être descendu de voiture, avoir payé sa place, avoir fait visiter ses paquets par l’employé des contributions indirectes, s’être choisi un commissionnaire et décidé enfin pour un hôtel, il se trouva tout à coup dans une chambre vide et inconnue, il s’assit dans un fauteuil et se prit à réfléchir au lieu de déboucler ses malles et de se laver la figure.
Les poignets sur les cuisses, les yeux tout grands ouverts, il contemplait d’un air stupide les quatre pieds de cuivre d’une vieille commode en acajou plaqué qui se trouvait là.
Quoi de plus triste qu’une chambre d’hôtel, avec ses meubles jadis neufs et usés par tout le monde, son demi-jour faux, ses murs froids qui ne vous ont jamais renfermé, et la vue dont on jouit sur des arrière-cours de dix pieds carrés, ornées aux angles les de gouttières crasseuses avec des cuvettes de plomb a chaque étage. Vive plutôt une chambre d’auberge, parquetée en bois blanc, ayant pour tous meubles deux chaises d’église, un grand lit recouvert d’une serge verte, et, sur la cheminée de plâtre, un pauvre bénitier en or avec une branche de buis bénit ! Il y a une seule fenêtre donnant sur la grande route, on est a la hauteur du bouchon suspendu au-dessus de la porte, on peut le prendre avec la main ; la vigne qui tapisse toute la maison grimpe jusqu’à vous, et ses feuilles, quand vous vous penchez pour voir, vous caressent la joue. On entend de là les moissonneurs qui fanent dans les champs, et, le soir, le bruit ferré des grands chariots qui rentrent.
Sa mére lui dit :
— Eh bien, a quoi rêves-tu donc ?
Et comme il ne bougea nullement, elle le secoua par le bras en réitérant la même question.
— Ce que j’ai ? ce que j’ai ? dit-il, se redressant en sursaut, — mais je n’ai rien du tout.
Il avait pourtant quelque chose.
II
Mais il eût été bien embarrassé de le dire, car il n’en savait rien lui-même.
Quand sa mère fut restée huit jours avec lui, qu’elle l’eut installé, nippé et emménagé, quand ils furent allés ensemble deux fois au musée de Versailles, une fois à Saint-Cloud, trois fois à l’Opéra-Comique, une fois aux Gobelins, une fois au puits de Grenelle, une trentaine de fois dans divers passages pour acheter divers objets, la bonne femme songea à se séparer de son fils ; elle lui fit d’abord mille recommandations sur beaucoup de choses qu’elle ne connaissait pas, puis l’engagea au travail, à la bonne conduite, à l’économie.
Le jour du départ arrivé, ils dînèrent en tête à tête dans un restaurant, près la cour des Messageries, mais ils n’avaient faim ni l’un ni l’autre et se parlèrent peu. Au moment de se séparer et dès avant qu’on fît l’appel, elle s’attendrit, et quand il fallut se quitter, ce fut en pleurant qu’elle baisa son pauvre Henry sur les deux joues. Henry alluma de suite un cigare et prit une tenue impassible ; mais à peine la voiture s’était-elle ébranlée que le cigare l’étouffait, il le jeta avec colère : « Adieu, pauvre mère, se dit-il, adieu, adieu », et dans son cœur il la couvrit de bénédictions et de caresses. Il aurait voulu l’embrasser tout à son soûl, l’empêcher de pleurer, lui essuyer les yeux, la consoler, la faire sourire, la rendre heureuse ; il se trouva lâche et s’en voulut d’avoir été presque humilié de sa tendresse tout à l’heure, devant trois bourgeois qui composaient le public ; il enfonça ses mains dans ses poches, son chapeau sur ses yeux, et continua à marcher sur le trottoir, d’un air brutal.
Ne sachant que faire les premiers jours, il rôdait dans les rues, sur les places, dans les jardins ; il allait aux Tuileries, au Luxembourg ; il s’asseyait sur un banc et regardait les enfants jouer ou bien les cygnes glisser sur l’eau. Il visita le Jardin des Plantes et donna à manger à l’ours Martin, il se promena dans le Palais Royal et entendit le coup de pistolet qui part à midi, il regardait les devantures des boutiques e nouveautés et des marchands d’estampes, il admirait le gaz et les affiches.
Le soir, il allait sur les boulevards pour voir les catins, ce qui l’amusa beaucoup les premiers jours, car il n’y avait rien de pareil dans sa province.
Tout en flânant le long des quais, il lisait le titre des bouquins étalés sur le parapet ; il s’arrêtait, aux Champs-Elysées, devant les faiseurs de tours ct les arracheurs de dents ; sur la place du Louvre, il passa un jour beaucoup de temps à contempler les oiseaux étrangers que l’on y voit, dans des cages, caqueter et battre des ailes quand il fait le moindre rayon de soleil. Les pauvres bêtes gémissent, regardent les nuages, se balancent sur leurs anneaux comme elles se balançaient sur les branches de leurs grands arbres situés au delà des mers, dans des pays plus chauds ; il manqua même de se faire enlever un doigt par une perruche rouge à bec recourbé, qu’il trouvait plus jolie que les autres.
Il montait sur les tours des églises et restait longtemps appuyé sur les balustrades de pierre qui les couronnent, contemplant les toits des maisons, la fumée des cheminées, et, en bas, les hommes tout petits qui rampent comme des mouches sur le pavé. Il se faisait transporter en omnibus d’un quartier de Paris à l’autre, et il regardait toutes les figures que l’on prenait et qu’on laissait en route, établissant entre elles des rapprochements et des antithèses.
Il entrait dans un café et restait une heure entière à lire la même ligne d’un journal.
Il allait au bois de Boulogne, il regardait les jolis chevaux et les beaux messieurs, les carrosses vernis et les chasseurs panachés, et les grandes dames à figure pâle, dont le voile remué par le vent et s’échappant de la portière lui passait sous le nez, avec le bruît des gourmettes d’argent. Il aimait leur maintien dédaigneux et leurs blasons bariolés ; il rêvait, en les contemplant, à quelque existence grasse, pleine de loisirs heureux, passée derrière de triples rideaux roses, sur des meubles de velours ; il se figurait les salons où elles allaient, le soir, décolletées, en diamants, avec des fleurs, les oreillers garnis de dentelles où elles posaient leur tête, les grands parcs qu’elles avaient l’été, et les allées sablées où marchaient leurs pieds.
Mais à chaque joie qu’il rêvait, une douleur nouvelle s’ouvrait dans son âme, comme pour expier de suite les plaisirs fugitifs de son imagination.
Etourdi du bruit des rues et de toute cette cohue d’hommes qui s’agitait autour de lui sans qu’il participât à ces actions et à ces mouvements passionnes, il s’éprenait tout à coup de désirs paisibles, souhaitait vivre loin de tout cela, à cent lieues d’une ville, dans quelque petit village ignoré, assis au revers d’un coteau, à l’ombre des chênes, pour y exister et y mourir plus inconnu que le plus humble des mortels.
Rentré chez lui, il n’allumait pas sa bougie, mais il faisait un grand feu et s’asseyait devant à regarder le bois brûler. C’était un grand feu clair, qui éclairait le plafond et se mirait dans les glaces ; la flamme bourdonnait, une rougeur moirée ondulait sur les charbons, parfois des étincelles s’élançaient en spirales en éclatant comme des fusées, et Henry alors pensait à des choses si douces, si anciennes, si profondément tendres, qu’il en venait à sourire.
Grace au charbon de terre, aux cheminées à la prussienne, aux bûches économiques et aux calorifères de toutes sortes, ils n’existent plus ces vénérables foyers antiques, où l’on entrait tout debout, quand, après une longue chasse d’hiver, on venait s’asseoir dans une des niches pratiquées aux côtés, attendant que les oies et les quartiers de mouton qui tournaient à la broche fussent cuits pour le souper, pendant que, de temps à autre, un valet cassait de la bourrée sur son genou et la jetait au feu qui la tordait et la dévorait, et qu’assis sur leur train de derrière, les lévriers mouillés se chauffaient le dos en bâillant.
À quoi pensait-il ?
À son enfance, à son pays, au jardin de son père. Il revoyait toutes les plates-bandes, tous les arbres et le vieux cerisier où il avait établi une balançoire, et le grand rond de gazon où il s’était si souvent roulé, à l’époque surtout où on le tondait, ou bien au mois d’avril, quand il était couvert de marguerites.
Il pensait aussi à ces trois jeunes gens, ses plus vieux camarades, ceux avec qui autrefois il avait joué au gendarme et au voleur : l’un s’était fait marin, le second était mort en Afrique, le troisième s’était déjà marié ; tous trois étaient morts pour lui.
Il pensa aussi à une tante défunte depuis longtemps et qu’il n’aimait pas quand elle vivait. Il songea à son bon temps de collège, à son pupitre tout abîmé de coups de canif et noirci d’encre, aux marronniers de la cour, et aux greniers de l’église où l’on allait dénicher des hirondelles. Il songea encore à ces après-midi du jeudi, si pleins de joie et de tumulte ; il revit un petit café où ifs se réunissaient pour fumer et pour causer politique, il revit les tables ébréchées et la vieille femme qui les servait.
Il songea aussi à la petite fille qu’il avait aimée à sept ans, à la demoiselle qui l’avait ému à douze, à la dame qui l’avait tourmenté plus tard ; il se rappela successivement tous les lieux où il les avait vues, il tâcha même de se reconstruire tous les mots oubliés qu’elles avaient pu lui dire, mais sa mémoire avait perdu quelques-uns de leurs traits ; il se rappelait seulement les yeux de l’une, la voix de l’autre, ou bien rien qu’un certain geste, au souvenir duquel son cœur tressaillait tout entier.
Il voulut faire des vers appropriés à son état d’esprit, mais, comme il fut longtemps à attraper la rime du second, il s’arrêta tout court. Il voulut ensuite écrire des pensées détachées, mais il n’en trouva aucune.
III
JULES À HENRY
« Depuis que tu m’as quitté, mon cher Henry, il me semble que tout est parti avec toi, ton absence m’a laissé un vide affreux. Je t’envie autant que je te regrette. Comme je voudrais être avec toi à Paris ! comme la vie doit y être belle et chaude ! Réponds-moi de suite et donne-moi des détails sur tout ce que tu fais, sur tes nouvelles connaissances, sur les sociétés où tu te trouves, etc. As-tu vu Morel ? t’a-t-il mené chez des actrices ? vois-tu des artistes ? vas-tu souvent au spectacle ? dis-moi un peu ce que tu as trouvé de l’opéra, etc., etc., je brûle d’avoir une lettre.
Comme tu es heureux, toi ! ton père a bien voulu te laisser aller à Paris ; tu es libre, tu as de l’argent, des maîtresses, tu vas dans le monde, mais moi !… Je vais te raconter ce qui s’est passé depuis ton départ.
Tu sais que ma mère voulait que je fusse notaire ; je le voulais aussi pour aller faire mon droit là.bas, pour t’aller rejoindre, mais mon père s’y est opposé, disant qu’il n’aurait jamais le moyen de m’acheter une étude, que les notaires d’ailleurs étaient tous des filous et des Robert Macaire, qu’il avait eu souvent des procès et qu’ils l’avaient toujours volé, qu’enfin c’était un métier d’imbécile et qu’il ne consentirait jamais à ce que son fils l’apprit. Son idée fixe est de me garder ici, avec lui et de me faire entrer dans une administration quelconque ; il dit que c’est une belle carrière et qu’avec de l’assiduité et de l’intelligence on peut y faire son chemin. Je ne sais pas encore si ce sera dans les contributions indirectes ou dans les finances ; il est sorti ce matin de bonne heure en me disant qu’il allait s’occuper de moi. Puisse-toi ! être repoussé dans toutes ses demandes et voir tous ses absurdes projets avorter dès le premier jour !
Comprends-tu cela, Henry, le comprends-tu ? moi, dans un bureau ! moi commis, moi écrivant des chiffres, copiant des rôles, maniant des registres ou des livres, comme ils appellent ça, des livres en peau verte, à tranches jaunes, et garnis de coins en cuivre ! être là du matin au soir, côte à côte avec des garçons de bureau, des domestiques à cent francs par mois ! venir tous les jours à 9 heures du matin, s’en aller à 4 heures du soir, et revenir le lendemain et le surlendemain, et ainsi pendant toute la vie, ou plutôt jusqu’à ce que j’en meure, car j’en mourrai de rage et d’humiliation ! Donc j’aurai un maître, un supérieur, un chef à qui il faudra obéir, à qui j’irai porter la besogne, l’ouvrage, et qui sera là, assis dans son fauteuil, à examiner tout, à compter les virgules passées, les lignes de travers, les mots oubliés, et qui me grondera sur ma mauvaise écriture, et me bousculera comme un valet !… Patience ! patience ! je suis bien décidé à ne pas me laisser mener par eux et à tous les envoyer promener de manière à ce qu’ils ne s’y refrottent plus ; je veux d’abord me faire renvoyer dès la première semaine, c’est un parti pris, et puis après, nous verrons. A moins qu’on ne me fasse bottier, sans doute, ou garçon épicier, il ne manquerait plus que ça !
Ô mon pauvre Henry. est-ce là ce que nous avions rêvé ensemble ? Te rappelles-tu la belle vie que nous nous étions arrangée autrefois, et comme nous en causions en promenade ? Nous devions demeurer dans la même maison, tous les matins jusqu’à midi nous aurions travaillé, chacun à notre table ; à cette heure-là on se serait lu ce qu’on aurait fait. Alors nous serions sortis, nous aurions été aux bibliothèques, aux musées, le soir dans les théâtres ; rentrés chez nous et avant de nous coucher, nous aurions encore analysé ce que nous avions vu dans la journée et préparé notre travail du lendemain.
Comme nous aurions été heureux ainsi, vivant, pensant en commun, nous occupant d’art, d’histoire, de littérature ! Avec quelques bonnes connaissances, quelques articles un peu forts mis dans les journaux, nous serions vite arrivés à nous faire un nom. Ma première pièce, c’est toi qui J’aurais lue au comité, car tu lis mieux que moi, et puis j’aurais trop tremblé. Et la première représentation, mon Dieu ! la première représentation, y as-tu pensé quelquefois ? Le théâtre est tout plein de monde, les femmes sont en toilette et ont des bouquets ; nous autres nous sommes dans les coulisses, nous allons, nous venons, nous parlons à nos actrices dans les costumes de nos rôles ; on hisse les décors, on lève la rampe, les musiciens entrent à l’orchestre, on frappe les trois coups, et tout le bourdonnement de la salle s’apaise. On lève le rideau, tout le monde écoute, la pièce commence, les scènes vont, le drame se déroule, des bravos partent ; et puis on se tait de plus belle, on entendrait une mouche voler, chaque mot de l’acteur, tombant goutte à goutte, est recueilli avec une avidité muette… de tous les gradins bravo ! bravo ! les mains battent, les pieds remuent, bravo ! Bravo ! l’auteur ! l’auteur ! l’auteur !… Ah ! Henry, qu’elle est belle la vie d’artiste, cette vie toute passionnée et idéale, où l’amour et la poésie se confondent, s’exaltent et se ravivent l’une de l’autre, où l’on existe tout le jour avec de la musique, avec des statues, avec des tableaux, avec des vers, pour se retrouver le soir, à la clarté flamboyante des lustres, sur les planches élastiques du théâtre, au milieu de tout ce monde poétique qui rayonne d’illusion, ayant des comédiennes pour maîtresses, contemplant sa pensée vivre sur la scène, étourdi de l’enthousiasme qui monte jusqu’à vous, et goûtant à la fois la joie de l’orgueil, de la volupté et du génie ! P.-S. — Mon père vient de rentrer, il m’a fait demander dans sa chambre ; c’est fini, je suis douanier. Dans huit jours j’entre comme surnuméraire, il faut, ce soir, que j’aille faire ma visite au Directeur pour le remercier… il me faudra me contenir. Je n’en puis plus, plains-moi. Adieu !
Ton ami jusqu’à la mort.
JULES. Je t’enverrai plus tard la liste d’ouvrages que j’ai envie que tu m’apportes aux vacances. N’est-ce pas bientôt la saison des bals masqués ? Dis-moi le costume que tu prendras. M. A., le receveur, qui vient de se marier, donnera le 25 une grande soirée, il veut que ce soit tout à fait comme à Paris.
J’irai. »
IV
Henry était encore dans son lit quand il lut cette lettre ; les illusions qu’elle retraçait lui parurent déjà si vieilles qu’elles ne le touchèrent point, et les misères dont son ami se lamentait si puériles qu’il ne le plaignit pas. Il sourit même un peu de pitié, en voyant son admiration pour Paris et sa frénésie littéraire, qu’il regarda, du haut de sa sagesse de débarqué de huit jours, comme deux maladies de province ; après quoi il replia la lettre dans ses mêmes plis, la mit sur sa table de nuit, et continua, couché sur le dos et les yeux levés au plafond, à réfléchir sur ses illusions propres et ses misères personnelles.
On verra dans la suite comment les premières changèrent de nature et pourquoi les secondes ne diminuèrent pas.
La sagesse des grands-parents avait cependant prévenu pour lui toute espèce de malheur. Après beaucoup de délibérations, où l’on était remonté à l’origine des sociétés humaines, et où tous les systèmes d’éducation avaient été discutés ; après beaucoup d’hésitations, de renseignements, de contremarches et de démarches, on avait enfin mis le jeune homme dans une pension spéciale ad hoc et sui generis : ad hoc, en ce sens qu’il n’y avait dans cette maison que des fils de famille, comme lui élevés dans la pureté du foyer domestique, ayant tous des mœurs honnêtes, placés là par leurs parents afin qu’ils les gardent, et tous désirant également les perdre au plus vite ; sui generis, car cette pension était une honnête pension, où il y avait autre chose que des prospectus, des haricots et de la morale ; on y était nourri et chauffé.
L’établissement avait bonne apparence. C’était une grande maison, dans une rue déserte dont je tairai le nom, comme dit Cervantès ; elle avait une grande porte cochère peinte en vert, plusieurs larges fenêtres donnant sur la rue, et l’été, quand elles étaient ouvertes, on voyait en passant les meubles du salon garnis de leur housse en calicot blanc. Sur le derrière se trouvait une manière de jardin anglais, avec des montagnes et des vallées, des sentiers qui tournaient entre des rosiers et des acacias boules, un beau sorbier qui s’élevait par-dessus le mur et laissait retomber gracieusement ses panaches de baies rouges ; de plus, au fond — c’était ce qu’on apercevait en entrant chez M. Renaud — une tonnelle de jasmins et de clématites, faîte en treillage blanc et garnie d’un banc rustique. J’oubliais une pièce d’eau, large comme une tonne de Basse-Normandie, et où il y avait trois poissons rouges presque continuellement immobiles. Quand les parents avaient vu cela, ils étaient ravis, leur enfant respirerait un bon air, ils passaient dès lors par toutes les conditions ; elles étaient fort dures.
Car si M. Renaud prenait peu d’élèves, c’étaient des élèves choisis ; il n’en avait pas plus de cinq ou six, auxquels il consacrait tout son temps et toute sa science. On y préparait les jeunes gens à l’Ecole polytechnique, à l’Ecole normale et aux baccalauréats de toute nature ; il recevait aussi des étudiants en médecine et en droit, se contentant pour ces derniers de leur recommander de ne pas perdre de temps, c’était tout ce qu’il leur enseignait. Du reste ils l’aimaient tous, non point qu’il eût cette raison ardente qui séduit la jeunesse et qui l’attire vers les vieillards, mais c’était un bonhomme facile, leur rendant la vie douce et tranquille, passablement jovial, assez bien bouffon et amateur de calembours.
Il paraissait malin à la première entrevue et bête à la seconde, il souriait souvent d’une manière ironique aux choses les plus insignifiantes, et, quand on lui parlait sérieusement, il vous regardait sous ses lunettes d’or avec une intensité si profonde qu’elle pouvait passer pour de la finesse ; sa tête, dégarnie sur le devant et couverte seulement sur la nuque de cheveux blonds, grisonnants et frisés, qu’il laissait pousser assez longs et qu’il ramenait soigneusement sur les tempes, ne manquait pas d’intelligence ni de candeur ; toutes les lignes saillantes de sa stature, qui était petite et ramassée sur elle-même, se perdaient dans une chair flasque et blanchâtre ; il avait le ventre gros, les mains faibles et potelées comme celles des vieilles femmes de cinquante ans, ses genoux étaient cagneux, et il se crottait horriblement dans les rues.
Si les chaussons de Strasbourg n’avaient pas existé de son temps, il les aurait inventés ; il en portait continuellement, hiver comme été, au grand désespoir de sa femme, et gémissait pendant une heure quand il fallait sortir et passer des bottes. Mme Renaud lui avait brodé une calotte grecque, fond de velours brun avec des fleurs bleues, dont Il se couvrait le chef dans son cabinet, où il restait toute la journée à travailler et à donner ses leçons ; il avait toujours le corps enveloppé d’une robe de chambre en tartan vert à raies noires, c’était l’ennemi le plus déclaré des habits et des dessous de pieds.
Quand les jeunes gens descendaient de leurs chambres, ils laissaient leurs casquettes dans l’antichambre, où il y avait deux paillassons et six chaises ; ensuite ils s’allaient mettre auprès de leur maître, sur des chaises ou des fauteuils, comme bon leur semblait, dormaient ou écoutaient, ou bien regardaient les éternels bustes de Voltaire et de Rousseau qui décoraient les deux coins de la cheminée, feuilletaient des livres dans la bibliothèque, ou dessinaient sur leur carton des têtes de Turcs et des chevelures de femme. Les habitudes de la maison étaient patriarcales et débonnaires : tous les dimanches, après dîner, on prenait le café ; le soir on jouait aux cartes dans le salon de Mme Renaud ; quelquefois on allait au théâtre tous ensemble, ou bien, l’été, on s’allait promener à la campagne, à Meudon, à Saint-Cloud.
Mme Renaud, du reste, était une excellente femme, une femme charmante, dont les manières maternelles avaient quelque chose de caressant et d’amoureux. On la voyait toute la matinée avec un bonnet de nuit coquettement garni de dentelles, mais qui lui cachait ses bandeaux ; sa robe sans ceinture, et dont les plis larges tombaient dès le collet, ne laissait rien à saisir et elle prenait dedans des attitudes molles et fatiguées ; elle parlait souvent du malheur de cette vie, des chagrins qui l’avaient usée, de sa jeunesse qui était déjà loin, mais elle avait de si beaux yeux noirs et de si beaux sourcils, sa lèvre était encore si rose, si humide, sa main se remuait avec une agilité si gracieuse dans tous les actes où elle s’en servait, qu’il fallait bien qu’elle mentît. Quand elle s’habillait et qu’elle mettait son grand chapeau de paille d’Italie à plume blanche, c’était une beauté royale, pleine de fraîcheur et d’éclat ; dans sa marche rapide sa bottine craquait avec mille séductions, elle avait une allure un peu cavalière et virile, mais toujours mitigée cependant par l’expression de sa figure, qui était ordinairement d’une tendresse mélancolique.
Quoique, dans certains moments, elle se fit un peu la mère de famille et la femme mûre, personne ne savait son âge, et j’aurais bien défié de me le dire le plus fameux marchand d’esclaves qu’il y ait depuis Bassora jusqu’à Constantinople. Si sa gorge, qu’elle laissait volontiers voir, était peut-être un peu trop pleine, en revanche elle envoyait une si douce odeur quand on s’approchait d’elle ! Elle cachait bien, il est vrai, le bas de sa jambe, mais elle montrait le bout de son pied, et il était très mignon ; derrière l’oreille on apercevait bien sur sa tête une imperceptible ligne blanche, qui voulait dire que les cheveux commençaient à tomber à cette place, mais pourquoi donc y avait-il sur son front quelque chose qui appelait le baiser ? pourquoi ces deux bandeaux noirs, qui lui descendaient sur les joues, donnaient-ils envie d’y porter la main, de les lisser encore, de les respirer de plus près, d’y poser les lèvres ?
L’hiver, elle se tenait dans sa chambre, assise entre la fenêtre et la cheminée, occupée à coudre ou à lire devant une petite table à ouvrage qui lui avait appartenu étant jeune fille. Pendant les longues heures qu’elle passait seule, que de fois ne regardait-elle pas la fleur jaune, en bois d’oranger incrusté sur le palissandre, en pensant très tristement à mille choses que j’ignore ! puis elle relevait la tête et se remettait à faire aller son aiguille, poussant un soupir ou se serrant les lèvres ; mais dès que le printemps était revenu et que les premiers bourgeons de lilas étaient éclos, elle allait avec son ouvrage se placer dans la tonnelle, et elle restait là jusqu’au soleil couchant. Aussi, tout en travaillant dans leurs chambres, les jeunes gens qui regardaient dans le jardin voyaient son sarrau blanc passer çà et là derrière les arbres ; elle se promenait dans la grande allée du rond, le long du mur, regardait les espaliers, regardait un brin d’herbe, ne regardait rien, se baissait pour cueillir de la violette, cassait avec ses doigts les boutons morts des églantiers, allait et venait. Le matin, encore en papillotes, elle arrosait ses fleurs elle-même, elle les aimait à l’adoration, disait-elle, le chèvrefeuille et les roses surtout ; elle en respirait le parfum d’une manière toute sensuelle.
Aux heures des repas elle descendait dans la salle à manger, où elle était gracieuse comme une maîtresse de maison qui fait les honneurs de chez elle.
Elle n’avait pas le bonheur d’une mère, mais elle adorait les enfants ; s’il en venait quelquefois chez elle, c’étaient des caresses, des chatteries et des bonbons à n’en plus finir. Mariée fort jeune à M. Renaud, sans doute qu’elle l’avait aimé, ne fut-ce qu’un jour, ne fut-ce qu’une nuit ; mais, à l’époque où commence cette histoire, il y avait déjà longtemps qu’elle ne regardait plus l’amour que par derrière l’épaule, en souriant un peu, il est vrai, et en lui envoyant de tristes adieux. Belle comme elle l’était encore, avec un cœur aussi sensible et une organisation aussi parfaite, elle l’avait reçu avidement, sans doute, dans la candeur de son désir, sans trop s’inquiéter d’où il lui venait ; puis, bien vite, elle en avait eu assez, et le regrettait maintenant, et le souhaitait peut-être, comme ces affamés qui, à peine à table, se sont emplis de potage et de bouilli. Sans songer qu’il va venir tout à l’heure de la dinde truffée et des sorbets.
Ils vivaient, mari et femme, en bonne intelligence, ce qui tenait à la bonassité du mari et à la douceur de la femme ; on eût dit à les voir le meilleur ménage du monde, et après déjeuner ils faisaient même un tour de jardin ensemble bras dessus, bras dessous.
Madame avait sa bourse particulière et son tiroir secret ; Monsieur grondait rarement et depuis bien longtemps déjà ne faisait plus couche commune avec Madame. Madame lisait très tard le soir dans son lit ; Monsieur s’endormait de suite et ne rêvait presque jamais, si ce n’est quand il s’était un peu grisé, ce qui lui arrivait quelquefois.
VI
Il y avait dans cette maison, quant aux personnes, différents individus dont nous ferons peut-être plus tard la connaissance, mais entre autres, un Allemand qui se livrait aux mathématiques et deux Portugais de famille très riche, d’esprit très lourd, de mine très laide et de peau fort jaune, qui achevaient leurs études afin de retourner savants dans leur pays.
Henry se lia peu avec ses nouveaux camarades, il restait le plus souvent dans sa chambre, sortait rarement, et quand cela lui arrivait, rentrait de bonne heure. Il avait apporté beaucoup de choses de son pays : un petit portrait de sa sœur, qu’il accrocha de suite à la tête de son lit, des pantoufles brodées par sa mère, son fusil, sa carnassière, le plus de livres qu’il avait pu en fourrer dans sa malle, une petite boîte ou il serrait ses lettres, un buvard en maroquin rouge sur lequel il écrivait, et puis son couteau, un presse-papier, un canif, plusieurs canifs même, cadeaux de Jour de l’an qui lui rappelaient de vieilles connaissances et des jours écoulés.
Il passa les premiers jours à arranger tout cela, ce qu’il fit le plus lentement possible, le fusil et la carnassière suspendus à la muraille, vis-à-vis des deux fleurets passés dans la garde l’un de l’autre, le buvard posé sur la table et la petite boîte aux lettres sur la cheminée, entre les deux flambeaux de cuivre.
La chambre qu’on lui avait donnée était grande, toute pareille, du reste, à celle de Mme Renaud qui occupait le premier, l’étage inférieur, avec nombre égal de fenêtres, c’est-à-dire deux, ayant vue sur le jardin et garnies comme les siennes d’une balustrade en fer recourbé, avec boutons fleuris et des arabesques dans le goût de Louis XV ; une grande commode, placée entre les deux fenêtres, faisait face à un canapé de velours d’Utrecht vert, à clous de bronze ; sur l’autre panneau le lit se mirait dans la glace de la cheminée, montrant naïvement ses rideaux blancs passés dans un anneau doré suspendu au plafond.
Quand il eut enfin accordé les meubles de cet appartement avec les siens propres, quand il se fut bien habitué à s’asseoir dans ce fauteuil et à s’accouder sur cette table, ne sachant alors que faire, il se mit à travailler ; les dimanches même il restait chez lui. Mme Renaud aussi ne sortait guère ce jour-là, mais M. Renaud en profitait pour aller faire ses courses, et ses élèves pour s’en aller se divertir dans Paris.
Comme le quartier était désert et que, le soir surtout, il y passait peu de voitures, Henry entendait Mme Renaud ouvrir sa fenêtre et fermer la jalousie, ensuite il l’entendait encore marcher quelque temps, puis tout rentrait dans le silence ; il écoutait attentivement ses pas, quand ils avaient cessé il y songeait encore. L’idée qu’il l’aimait ne lui était seulement pas venue dans la tête, mais le retour habituel de cette fenêtre qui se fermait et s’ouvrait, et ce bruit calme de pas féminins revenant ainsi chaque soir, avant de s’endormir, tenait son esprit dans une espèce de suspension rêveuse ; c’était pour lui, comme pour d’autres, le chant du coq ou l’angélus.
Un jour, c’était, je crois, au mois de janvier, elle entra dans sa chambre, il était seul ; elle montait au grenier, où elle avait à faire, et entrait là en passant, elle ouvrit la porte tout doucement, en souriant ; Henry, accoudé sur sa table, la tête dans ses mains, se détourna au bruit qu’elle fit en marchant sur le parquet.
— C’est moi, dit-elle, je vous dérange ?
— Oh ! non, entrez.
— Ce n’est pas la peine… merci… je n’ai pas le temps.
Et elle s’appuya du coude sur le coin de la cheminée, comme pour se soutenir.
Henry s’était levé.
— Ne vous dérangez donc pas, continuez ce que vous faisiez, je vous en prie, restez à votre place.
Il obéit, et ne sachant quoi trouver à lui dire il resta la bouche fermée. Mme Renaud, debout, regardait ses cheveux et le haut de son front.
— Vous travaillez donc toujours ? continua-t-elle, jamais vous ne sortez ; vous avez vraiment une conduite… exemplaire pour un jeune homme.
— Vous croyez ? fit Henry d’un air qu’il aurait voulu rendre fin.
— On le dirait du moins, reprit-elle en clignant les yeux et en lui envoyant un étrange regard à travers ses longs cils rapprochés, geste charmant dans sa figure et qu’elle faisait toujours en penchant un peu la tête sur l’épaule et en relevant le coin des lèvres. Vous ne vous amusez donc jamais ? vous vous fatiguerez.
— Mais à quoi m’amuser ? à quoi m’amuser ? répéta Henry, qui s’apitoyait sur lui-même et pensait bien plus à la demande qu’à la réponse.
— Ainsi il n’y a que les livres qui vous plaisent ?
Pas plus ça qu’autre chose.
— Ah ! vous faites le blasé. dit-elle en riant, est-ce que vous êtes déjà dégoûté de la vie par hasard ? pourtant vous êtes si jeune !… A la bonne heure, moi ! j’ai le droit de me plaindre, je suis plus vieille et j’ai plus souffert que vous, allez, croyez-moi.
— Non.
— Oh ! oui, fit-elle en soupirant et en levant les yeux au ciel, j’ai bien souffert dans la vie — et elle frissonna comme si elle eût ressenti la douleur de souvenirs amers — un homme est toujours moins malheureux qu’une femme, une femme… une pauvre femme.
A ces derniers mots, une clef qu’elle avait dans les mains et qu’elle n’avait cessé de faire tourner sur son index s’arrêta tout à coup dans sa rotation, serrée convulsivement par les cinq jolis doigts de Mme Renaud.
C’était une main un peu grasse peut-être, et trop courte aussi, mais lente dans ses mouvements, garnie de fossettes au bas des doigts, chaude et potelée, rose, molle, onctueuse et douce, aristocratique, une main sensuelle ; les yeux d’Henry y étaient singulièrement attirés ; il descendait, de l’une à l’autre, les deux lignes qui, partant de son poignet, remontaient alternativement entre chaque doigt, il regardait curieusement la couleur un peu fauve de cette peau fine, bleuie à certaines places par le cours de petites veines minces entrecroisées.
Mme Renaud, de son côté, considérait ses grands cheveux châtains épanchés en larges masses sur ses épaules, avec son attitude entière toute naïve et pensive.
A quoi pensent-ils donc l’un et l’autre ? à peine s’ils se sont parlé qu’ils se taisent déjà, voilà le dialogue interrompu.
Mme Renaud est au coin de la cheminée, le coude droit appuyé sur le chambranle, tout le corps un peu de côté ; les pattes de son bonnet sont dénouées et laissent le dessous de son menton à nu, sa main gauche est dans la poche de son tablier de soie, elle ferme les yeux à demi et sourit un peu du coin des lèvres, un peu moins que tout à l’heure, mais plus intérieurement, si bien que personne ne pourrait s’en apercevoir. Le jour blafard qui passe à travers les vitres éclaire la figure d’Henry, fait blanchir son front et met en saillie le galbe de son visage ; ses deux jambes sont croisées sous la table, il ouvre de grands yeux, on dirait qu’il songe à ce qu’il ne voit pas.
— Qu’avez-vous donc ? fit-elle à la fin.
— Moi ! reprit Henry comme se réveillant, rien… rien du tout, je vous assure.
— A quoi pensiez-vous ?
— Je l’ignore.
— Vous êtes distrait à ce que je vois. C’est comme moi, cent fois par jour je me surprends rêvassant à une foule de choses insignifiantes ou indifférentes, je perds tous les jours à cela un temps considérable.
— Ce sont de bonnes heures, ne trouvez-vous pas, Madame, que ces heures-là, que ces moments qui s’écoulent vaguement, doucement, sans laisser dans l’esprit aucun souvenir de joie ni de douleur.
— Vous croyez ? dit-elle.
Il poursuivit, sans prendre garde à l’expression sympathique qui avait animé ces deux mots, il était de ces gens qui aiment à finir leurs phrases.
— L’esprit en conserve à peine une ressouvenance tendre et indéterminée, que l’on aime à retrouver quand on est triste.
— Comme vous avez raison ! dit-elle encore.
— Chez mon père il y avait, dans le jardin, un grand cerisier à fleurs doubles. Si vous saviez comme j’y ai dormi à l’ombre ! tout le monde me traitait de Turc et de paresseux.
Avec un petit rire d’indulgence, comme pour un enfant :
— On n’avait peut-être pas tort, lui dit-elle.
— Mais l’hiver, surtout…
— Oh ! l’hiver, n’est-ce pas ? pour cela je suis bien comme vous, vive le coin du feu ! on y est si bien pour causer !
— J’y restais seul, assis dans un fauteuil, à passer toutes mes soirées ; j’y brûlais un bois considérable.
— Ah ! nous serions bien ensemble. Moi aussi, M. Renaud me gronde souvent pour cela, mais c’est mon bonheur à moi, je ne sors pas, je ne vais pas dans le monde, je suis une pauvre femme bien ignorée, qui vit chez elle retirée.
— Pourquoi cela ? dit Henry, qui, comme vous le voyez, lecteur, se permettait déjà de lui adresser des questions, car ils étaient déjà un peu amis, non pas par ce qu’ils s’étaient dit, mais par le ton dont ils se l’étaient dit.
— Pourquoi ? répondit-elle, mais n’ai-je pas mon mari ? ma maison ? et puis d’ailleurs je n’aime pas le monde, il est si méchant, si bas, si faux !
— Jamais je ne vais au bal non plus, ça m’ennuie, je n’ai jamais dansé de ma vie.
— Ah ! pour cela vous avez tort, il faut savoir danser au moins ! Vous êtes donc un vrai ours ?
Et elle se mit à rire en montrant ses belles dents.
— C’est singulier ! un jeune homme !
Elle acheva avec un ton de voix plus sérieux :
— Ah ! vous changerez plus tard.
— Qui vous l’a dit ?
— Ça viendra, croyez-moi.
— Quand ?
— Si vous vouliez plaire à un… à quelqu’un.
Elle s’arrêta, Henry rougit :
— Vous croyez ? dit-il.
Elle fit deux pas pour s’avancer vers le milieu de la cheminée, elle étendit un pied, puis le second, et y chauffa tout debout la semelle de ses bottines noires, tout en se regardant dans la glace et rajustant ses bandeaux, qu’elle lissait avec la paume des mains.
— Quelle jolie boite vous avez là ! dit-elle en prenant le petit coffre d’acajou garni de clous d’acier qui était sur la cheminée entre les deux flambeaux de cuivre, qu’est-ce qu’il y a dedans ?
— J’y mets mes lettres.
— C’est votre correspondance ? Oh ! vous la fermez à clef.
Et passant encore à un autre sujet de discours :
— Etes-vous bien dans votre chambre ?
— Vous voyez, répondit Henry, j’y reste toujours.
— Elle est bien, cette chambre-là, tout à fait comme la mienne en bas ; vous ne la connaissez pas, je crois ? vous n’y êtes jamais entré ?
— Jamais,
— J’aime mieux celle-ci, elle est plus grande ; d’ailleurs je l’ai longtemps habitée, avant que vous ne veniez j’y demeurais.
— Ah ! vous l’avez habitée ? dit Henry.
— Il va falloir que je vous quitte, dit-elle tout à coup, j’ai ce soir du monde à dîner, vous descendrez de bonne heure, n’est-ce pas ?
Elle s’écarta de la table d’Henry, elle s’en allait. En passant près du lit elle s’arrêta, et voyant le portrait à l’aquarelle qui était croché au delà sur la muraille :
— C’est votre sœur, je crois ? vous ne m’aviez pas dit que vous eussiez une sœur ; comment l’appelez-vous ?
— Louise.
— Louise ! j’aime ce nom-là… Mais je ne peux la voir d’ici, il fait déjà sombre et le rideau me la cache.
Elle écarta le rideau qui couvrait le pied de la couche et le repoussa contre la muraille, puis elle revint vers le milieu du lit et se pencha dessus pour mieux examiner le portrait, le matelas céda légèrement et s’affaissa sous le poids de son corps.
— Trouvez-vous qu’elle vous ressemble ? dit-elle tout à coup en détournant la tête.
Henry était derrière elle et regardait la torsade de ses cheveux noirs, le peigne qui les retenait, le dos brun qui venait après ; sa figure était charmante quand il la vit se retourner ainsi par-dessus son épaule et lui demander encore une fois, presque couchée sur son lit :
— Dites, trouvez-vous qu’elle vous ressemble ?
— On le dit.
— Les yeux particulièrement, n’est-ce pas ? bleus comme les vôtres — elle regardait alternativement le portrait et le visage d’Henry — avec les sourcils noirs, c’est là ce qu’il y a de rare… la coupe du visage aussi est la même… mais elle est un peu plus blonde que vous il me semble.
Elle se tenait sur le lit, appuyée sur les deux poings, son tablier de soie s’accrochait à la couverture de laine, ses jarrets tendus chassaient le tapis en arrière, qui glissait sur le plancher ; sa figure, alors animée, était toute souriante et inquisitive ; ses yeux aux paupières closes étaient bien ouverts cette fois et regardaient ceux d’Henry gui se tenaient fixes sur les siens.
Elle avait les cils longs et relevés, la prunelle noire, sillonnée de filets jaunes qui faisaient des petits rayons d’or dans cette ébène unie ; toute la peau des yeux était d’une teinte un peu rousse, qui les agrandissait et leur donnait une manière fatiguée et amoureuse. J’aime beaucoup ces grands yeux des femmes de trente ans, ces yeux longs, fermés, à grands sourcils noirs, à la peau fauve fortement ombrée sous la paupière inférieure, regards langoureux, andalous, maternels et lascifs, ardents comme des flambeaux, doux comme du velours ; ils s’ouvrent tout à coup, lancent un éclair et se referment dans leur langueur.
— Votre bouche, par exemple, continua-t-elle, est plus petite, plus dessinée, plus moqueuse… L’aimez-vous bien, votre sœur ?… Elle vous aime bien aussi, n’est-ce pas ?… Et votre mère ? vous étiez l’enfant gâté, je suis sûre ; on vous cédait tout, j’imagine.
Elle ne regardait plus le portrait, elle s’acheminait vers la porte, elle tenait la clef. Henry ne répondait rien.
— Ma femme ! ma femme ! cria une voix dans l’escalier.
— Allons, adieu, je vous quitte, il est 4 heures, je cours m’habiller… Oh ! comme nous avons bavardé ! bonsoir, à tout à l’heure.
Elle ouvrit la porte prestement, la robe siffla dans le courant d’air, Henry l’entendit descendre en courant et quelque temps après marcher dans sa chambre.
Il retourna à sa place, on n’y voyait plus, ce n’était pas la peine de se remettre au travail. Il se promena donc de long en large et regarda dans le jardin la nuit qui commençait à venir ; il pensa à toutes les choses qui lui vinrent dans la tête, mais surtout au bruit que font les jupons des femmes quand elles marchent et au craquement de leur chaussure sur le parquet.
VII
Enfin il s’habilla et descendit au salon.
Personne n’était encore arrivé. Mme Renaud, toute seule, assise dans un fauteuil, près du feu, un écran dans les doigts, attendait les convives. Quoique en décembre, elle avait mis une robe blanche, tenue invariable des Anglaises et des femmes de notaires de petite ville ; une grande pèlerine de dentelles, les bouts croisés par devant lui couvrait les épaules, plus larges que jamais à cause de sa taille qui était plus mince que de coutume. Elle était en cheveux, mais, pour varier un peu, elle avait passé dans les dents du peigne une petite chaîne d’or, qui se cachait dans sa chevelure comme un serpent et dont le gland, qui en terminait un des bouts, lui retombait sur l’oreille.
— Vous êtes aimable, lui dit-elle en entrant, de venir me tenir compagnie.
— Je croyais qu’il y avait déjà du monde, répondit-il sottement.
— Sans cela vous ne seriez pas descendu, repartit Mme Renaud en riant.
— Oh ! ce n’est pas cela que je voulais dire, mais je ne voulais pas arriver le dernier.
— Cela vous intimiderait pour entrer, peut-être ? Est-ce que vous êtes si enfant ?
— Moi, timide ! répondit Henry outragé dans sa dignité d’homme de dix-huit ans, moi, timide ? au contraire, au contraire.
— Cela ne serait pas étonnant, à votre âge.
Et dans ces trois mots « à votre âge » il y avait je ne sais quoi de caressant et d’affectueux.
— Plaignez-moi plutôt, continua-t-elle, plaignez-moi, je vais bien m’ennuyer ce soir. M. Renaud veut recevoir, ça l’amuse. Oh ! nous aurons des gens… insupportables, vous verrez… On est si contraint devant le monde, si peu libre, obligé de surveiller chaque mouvement que l’on fait, de s’observer à chaque mot que l’on dit. Oh ! quel supplice !
Puis continuant, comme se parlant à elle-même :
— Oh ! que j’aime bien mieux la société intime de vrais amis, où l’on peut tout dire, tout penser… Mais il est si rare de rencontrer des personnes dont le cœur réponde au vôtre et qui vous puissent comprendre !
Elle disait cela lentement, étendue sur un gros coussin de velours rouge, les pieds posés sur les chenets, d’un ton ennuyé et avec une figure mélancolique.
MM. Sébastien Alvarès et Emmanuel Mendés entrèrent de front en se cognant à la porte, luisants et pommadés tous deux, en redingote marron à collet de velours, avec des cravates de satin très longues et des gilets très ouverts ; ils firent tous deux un salut assez gauche et restèrent debout dans un coin, à causer ensemble dans la langue de leur pays.
Six heures sonnaient à la pendule quand le père Renaud ouvrit la porte du salon à deux battants et introduisit le gros de la compagnie, qui arrivait à l’heure juste. Elle se composait de M. et Mme Lenoir, marchands de bois à Paris et compatriotes de M. Renaud, et de leurs deux enfants, Adolphe et Clara, vrais enfants de Paris, blancs et pâles, lymphatiques et bouffis ; la petite fille surtout était fort laide, elle avait les yeux rouges et toussait souvent ; son frère était un gros blond frisé, assez tranquille, il mangeait prodigieusement, surtout de la crème, ses parents lui trouvaient beaucoup de moyens, on l’avait habillé en artilleur.
Mlle Aglaé arriva toute seule, sans son frère. Mlle Aglaé était une vieille fille de vingt-cinq ans, professeur de piano dans les boarding schools for young ladies, une femme très gracieuse et très maigre, ayant de superbes papillotes à l’anglaise qui lui caressaient les clavicules et les omoplates, qu’elle découvrait volontiers, en toute saison, sans jamais attraper de rhume ni de fluxion de poitrine, quoiqu’elle semblât d’abord d’une délicate et tendre constitution. Ses pieds n’étaient guère beaux, quoique le lacet de ses bottines de peau verdâtre fût si serré que les œillets manquaient de s’en rompre. Chose déplorable, surtout pour une femme sentimentale, ses mains étaient rouges et, l’hiver, abîmées d’engelures ; mais vous ne remarquez pas ces dents éclatantes et polies, que ses lèvres minces découvrent quand elle sourit ; ni cette peau d’un blanc si irréprochable que son boa de cygne et son cou sont presque de la même couleur. C’était la vieille camarade de Mme Renaud, son amie de dortoir, sa confidente intime ; elles se voyaient presque tous les jours, restaient longtemps ensemble, et se reconduisaient régulièrement jusqu’à la porte de la rue, où la conversation se prolongeait bien encore un bon quart d’heure.
A peine entrée dans le salon, elle se défit familièrement de son châle et de son chapeau, qu’elle alla porter dans la chambre de Mme Renaud. Mme Renaud lui prit tout cela des mains et elles sortirent ensemble, aussi vives et aussi gaies que des jeunes filles.
— Eh ! bonjour, mon cher Ternande, dit l’amphitryon en serrant les mains à un grand luron à chevelure fougueuse, qui portait dans le monde un aplomb imperturbable, un habit vert à boutons brillants, boutonné du haut en bas. Comment vont les arts ?
— Mais pas mal, mon cher maître, pas mal.
— Notre coloris se chauffe-t-il ?
— A mort, répondit l’artiste.
— Et le torse ? continua M. Renaud en ricanant d’une manière fine, le torse, comme vous le dites, l’étudions-nous toujours ? J’aime beaucoup le torse, moi… Toujours ferme, l’antique, j’espère ? il ne faut pas sortir de là, voyez-vous, l’antique, l’antique !
— Vous y voilà encore ! répondit Ternande impatienté, mais, mon cher monsieur, comprenez donc…
Il l’entraina dans l’embrasure d’une fenêtre et lui exposa pour la centième fois ses idées sur l’art, qui ne furent pas plus comprises que fa première, malgré ses rapprochements ingénieux, ses décisions tranchées et sa gesticulation expressive.
— Mais à quoi penses-tu donc, mon ami ? dit Mme Renaud en venant prendre son mari par le bras et le tirer de sa discussion esthétique, à quoi penses-tu ? voici la famille Dubois, salue-la donc.
M. Renaud obéit à sa femme, if fit la révérence à tout le monde, s’inquiéta de la santé de chacun, offrit des sièges à la société, donna des tabourets aux dames, des tapis aux messieurs ; il fut obséquieux et léger, il glissait, il volait.
Au dîner, il plaça à ses côtés Mme Dubois et Mme Lenoir ; l’humeur de la première lui allait beaucoup. C’était une grosse commère — il l’appelait sa commère, ayant été parrain avec elle de l’enfant du beau-frère de son mari — d’environ quarante-sept ans, assez fraîche encore, bien nippée et bien nourrie, un peu haute en couleur, l’œil vif et le caquet prompt, très fournie de gorge, puisqu’on entend par là ce qui s’étend depuis le menton jusqu’au nombril ; elle était enrichie de camées et de broches sur la poitrine et de bagues à tous les doigts, mais en revanche peu fournie en cheveux.
M. Dubois avait une redingote bleue, c’est tout ce que je peux en dire, ne l’ayant jamais vu que par derrière le dos. Ils avaient amené avec eux leur fille unique, Mlle Hortense, et une cousine de la province, qui leur était confiée.
On avait habilement alterné les messieurs et les dames mariés, les jeunes personnes et les jeunes gens. Ainsi Henry était à côté de Mlle Aglaé, Alvarès à côté de la cousine de Mme Dubois, et Mendès de l’autre côté de Mme Dubois, dont l’embonpoint impressionnait son cœur portugais et adolescent ; les deux autres jeunes gens, qui attendaient sur le palier, s’étaient placés les derniers, à côté des enfants.
Le couvercle de la soupière était retiré et fumait près du bouilli, la grande cuiller était plongée dans le vermicelle ; M. Renaud détourna la tête, une personne manquait, il restait une chaise inoccupée, il y avait une serviette en cœur encore non dépliée ; c’était M. Shahutsnischbach qui se faisait attendre. On l’appela, on le cria, on monta à sa chambre, il descendit. Dans quelle tenue, mon Dieu ! dans son costume de tous les jours, les doigts barbouillés par le blanc du tableau, avec un gros foulard rouge autour du cou et des chaussons de lisière aux pieds, et étonné, confus, ébahi, ne sachant s’il devait s’en aller ou rester, s’enfuir ou s’asseoir, les bras ballants, le nez au vent, ahuri, stupide.
— Mais vous saviez qu’il y avait du monde, vous saviez qu’il y avait du monde, répétait M. Renaud, attristé et vexé. Toujours le même ! Singulier être ! Original d’Allemand !
A quoi le pauvre garçon se contentait de répondre qu’il n’en savait rien, qu’il n’en savait rien du tout, tout en cherchant une issue pour gagner sa place, en se levant sur la pointe des pieds afin de passer sans encombre derrière le dossier de toutes les chaises.
Après que Mme Renaud, toujours bonne et douce, eut réclamé pour lui l’indulgence de la compagnie et apaisé le courroux formaliste de son mari, qui grommelait piano : « C’est ridicule, c’est ridicule, c’est d’un ridicule outré ! », le repas commença de la manière la plus calme du monde. Le jeune Shahutsnischbach, délivré du regard de la foule, mangeait très placidement, assis entre les enfants chéris de M. et Mme Lenoir, auxquels il donnait à manger, versait à boire, nouait et dénouait les serviettes ; les autres convives coupaient, découpaient, vidaient leur assiette, et les plats s’en allaient et se remplaçaient.
On causa politique, on maudit l’Angleterre, on plaignit l’Espagne déchirée par les factions, on déplora l’Italie dégénérée et la Pologne vaincue.
Les dames ne disaient rien ou causaient littérature, ce qui est la même chose. Ternande était engagé avec M. Lenoir, qui voulait se faire faire son portrait et discutait avec lui le choix du peintre ; il lui indiquait naturellement son maître. Henry s’extasiait sur Beethoven, qu’il n’avait jamais entendu, avec Mlle Aglaé qui ne le comprenait pas. Mme Renaud ne disait rien, Mendès regardait Mme Dubois. Les deux lampes à la Carcel filaient.
Au dessert la conversation devint générale, elle roula sur la littérature. Il fut question de l’immoralité du drame et de l’influence incontestable qu’il a exercé sur tous les criminels modernes ; on blâma beaucoup Antony, à la mode dans ce temps-là ; on cita pour rire quelques vers d’Hernani ; on fit quelques pointes, on vanta Boileau, le législateur du Parnasse. M. Renaud en récita même par cœur quelques apophtegmes, tels que : « Rien n’est beau que le vrai, le vrai seul est aimable » ou : « Cent fois sur le métier… » ou : « Sans le style en un mot… » et autres raretés poétiques. Vint ensuite le parallèle obligé du doux Racine et du grand Corneille, suivi de celui de Voltaire et de Rousseau. Après quoi la littérature de l’empire fut mise en pièces par Ternande et par Henry, qui réclamaient pour l’art, tandis que les hommes graves, les hommes de quarante à cinquante ans, protestaient pour le goût et pour la langue. On parla encore de V. Hugo, de Mlle Mars, de l’Opéra Comique, de Robert le Diable, de l’Opéra, du cirque, et de la vertu des actrices, et des prix Montyon qu’elles obtiennent. Ternande était très exalté, il était rouge, il parlait beaucoup, il vantait la Tour de Nesle ; M. Lenoir, M. Dubois, M. Renaud le plaignaient et ricanaient ; Henry était grave, et s’entretenait de Jocelyn tout bas avec Mlle Aglaé ; Mme Dubois regrettait le bon temps de la Comédie et Talma dans Manlius ; Mendès regardait Mme Dubois. Le vulgaire champagne arriva, ce vin essentiellement français, qui a eu le malheur de faire naître tant de couplets, français comme lui et ennuyeux comme lui. Le maître de la maison, avec le pouce, ébranla le bouchon gonflé dans le goulot de la bouteille. Il partit — toutes les dames crièrent de surprise — s’élança au plafond, et retomba sur une cloche à fromage, qui se mit à vibrer du coup. On se passa les verres de main en main, vivement, pêle-mêle ; la mousse tombait sur la nappe et sur les doigts, les dames riaient ; il y a ainsi des bonheurs infaillibles.
Après le dîner, dans le salon, Mme Renaud prit Henry à part et le complimenta sur la manière dont il avait soutenu ses idées.
— Oh ! je vous écoutais parler, dit-elle ; tout ce que je pensais, vous le disiez. Comme vous les avez tous vaincus ! Je suis bien de votre avis, allez, vous aviez raison, mille fois raison.
— J’ai eu tort, répondit-il lentement et en faisant dans sa phrase de longs points d’arrêt ; à quoi bon exprimer quelque chose du sentiment qui vous anime à des gens que rien n’anime, et vouloir faire passer un peu de la poésie qui vous gonfle le cœur dans des cœurs fermés pour elle ? c’est peine perdue et sottise, c’est une folie, une maladie que j’avais beaucoup naguère, mais dont je me guéris chaque jour.
— Est-ce que vous seriez poète par hasard ?
— Qui vous l’a dit ?
— Je devine.
— Mais j’aime à lire les poètes, continua Henry sans avoir l’air d’y prendre garde. Et vous ? n’aimez-vous pas aussi à vous bercer mollement dans leur rythme, à vous laisser emporter par le rêve d’un génie sur quelque nuage d’or, au delà des mondes connus ?
Mme Renaud le regardait parler.
— Ce sont de grands bonheurs, n’est-ce pas, dit-elle avec une expression d’ignorance avide.
Et tout en causant ainsi ils parlèrent ensemble des histoires d’amour fameuses au théâtre, des élégies les plus tendres ; ils aspirèrent en pensée la douceur des nuits étoilées, le parfum des fleurs d’été ; ils se dirent les livres qui les avaient fait pleurer, ceux qui les avaient fait rêver, que sais-je encore ? ils devisèrent sur le malheur de la vie et sur les soleils couchants. Leur entretien ne dura pas longtemps, mais il fut plein, le regard accompagnait chaque mot, le battement de cœur précédait chaque parole. Mme Renaud admira l’imagination d’Henry, qui fut séduit par son âme.
Mme Aglaé fut priée de chanter, elle se mit au piano, enfila des gammes, hennit, piaffa, pompa et brossa le clavier. Personne ne comprit un mot de l’air d’italien qu’elle fit sortir de son larynx ; comme il était long, tout le monde applaudit à la fin. L’Allemand, à qui on demanda son avis, répondit qu’il ne se connaissait pas en musique, ce qui sembla drille, les Allemands devant être musiciens.
Alvarès, qui était resté au coin du piano pendant tout le temps gue Mlle Aglaé avait chanté, et qui lui avait ramassé une fois sa bague et l’autre fois un cahier de musique, dit le soir, en se couchant, à son camarade Mendès :
— Tu n’étais pas, comme moi, près d’elle, tu n’as pas vu ses yeux. Quand elle a dit : Amor ! vieni ! oh ! je sentais ses longues papillotes chasser l’air autour d’elle, un air chaud, embaumé. Comme cette femme là vous aimerait ! comme elle chante bien !
Mendès lui répondit :
— Oh ! que Mme Dubois a une belle poitrine ! Quelle poitrine ! tu n’as pas remarqué, au dessert, quand elle parlait, comme sa gorge montait et s’abaissait. Pour aller à la table de jeu elle a passé devant moi, si près de moi qu’une chaleur douce m’en est venue sur la joue… Etre l’amant de cette femme là, ô, mon Dieu !
Et Henry ? Rentré dans sa chambre, il s’y déshabilla lentement, rêveur sans savoir pourquoi, et avec un sourire dans l’âme. Sur la cheminée il trouva une clef, c’était celle de Mme Renaud, qu’elle tenait à ses doigts tantôt et qu’elle avait oubliée là par hasard, et il se rappela la nonchalance de sa posture et toute la grâce de son visage. Prêt à se coucher, il s’arrêta au bord du lit, on eût dit que quelqu’un s’y était déjà étendu. C’était elle qui s’était appuyée dessus, pour regarder le portrait de Louise ; les draps étaient un peu tirés d’un côté, le couvre-pied était dérangé… Il entra dedans avec précaution, avec crainte, en tressaillant, obéissant machinalement au singulier instinct de ne pas défaire ce désordre.
Mille choses douces le bercèrent, à demi endormi, et, la nuit, il rêva qu’il se promenait avec elle sous une grande avenue de tilleuls, qu’ils se tenaient les bras entrelacés et que sa poitrine se rompait. Alvarès rêva de longues chevelures de femmes pâles qui lui effleuraient tout le corps. Mendès aussi rêva… il rêva qu’il se mourait sur les seins nus d’une Chinoise.
VIII
JULES A HENRY.





























