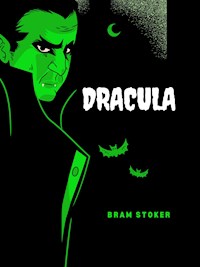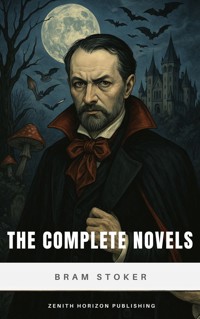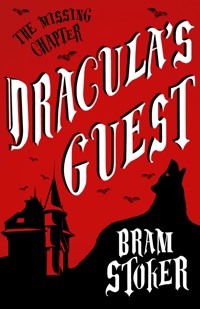4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un jeune anglais de passage à Paris, décide d'explorer le monde des chiffonniers pour sortir des sentiers touristiques habituels. Il se rend donc à Montrouge et entre dans un quartier de dépôt d'ordures. Il entreprend de converser avec les habitants des lieux, mais bien mal lui en prend... - Rien de va plus entre Magareth et Geoffrey: altercations, menaces se succèdent. Et... Geoffrey finit par enterrer Magaret dans l'âtre du grand hall. Mais... l'histoire ne fait que commencer...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
L'Enterrement des rats et autres nouvelles
L'Enterrement des rats et autres nouvellesL’ENTERREMENT DES RATSUNE PROPHÉTIE DE BOHÉMIENNELES SABLES DE CROOKENLE SECRET DE L’OR QUI CROÎTPage de copyrightL'Enterrement des rats et autres nouvelles
Bram Stoker
L’ENTERREMENT DES RATS
Si vous quittez Paris par la route d’Orléans, après avoir tra-versé les fortifications et tourné à droite, vous vous trouverez dans un endroit un peu sauvage et pas du tout agréable. À droite, à gauche, devant, derrière vous s’élèvent de grands tas d’ordures et de détritus que le temps a fini par accumuler. Paris a une vie nocturne aussi bien que diurne, et un voya-geur de passage qui rentre à son hôtel, rue de Rivoli ou rue Saint-Honoré, tard dans la nuit, ou qui le quitte tôt le matin, peut devi-ner, en approchant de Montrouge – s’il ne l’a déjà fait –, à quoi servent ces grands chariots qui ressemblent à des chaudières sur roues qu’il trouve arrêtés un peu partout quand il passe par là. Chaque ville possède ses institutions propres, créées à partir de ses propres besoins. Ainsi, l’une des institutions les plus no-tables de Paris est sa population de chiffonniers. Tôt le matin – et la vie parisienne commence très tôt –, on peut voir dans la plu-part des rues, placées sur le trottoir en face de chaque cour et de chaque allée, et dans l’intervalle de deux ou trois maisons, comme cela existe encore dans certaines villes américaines, et même dans certains quartiers de New York, des grandes boîtes de bois où les domestiques, ou les habitants, vident les ordures accumulées pendant la journée. Autour de ces boîtes se réunis-sent, puis s’en vont, lorsque le travail est terminé, vers d’autres champs de labeur et vers d’autres pâturages nouveaux, des hommes et des femmes misérables, crasseux et l’air affamé, dont les outils de travail consistent en un sac ou un panier grossier porté sur l’épaule, et en un petit râteau avec lequel ils retournent, sondent, examinent dans le plus grand détail les boîtes à ordures. À l’aide de leur râteau, ils ramassent et déposent dans leur panier ce qu’ils trouvent avec la même facilité qu’un Chinois utilise ses baguettes. Paris est une ville centralisée, et centralisation et classifica-tion sont étroitement liées. Dans un premier temps, alors que la centralisation est en train de devenir effective, ce qui la précède, c’est la classification. Tout est groupé, par similarité ou par ana-logie, et de ce groupement de groupes surgit une unité entière ou centrale. On voit rayonner une multitude de longs bras aux in-nombrables tentacules, tandis qu’au centre se dresse une tête gigantesque ayant un cerveau qui a le pouvoir de comprendre, des yeux perçants qui peuvent regarder de tous côtés, et des oreilles sensibles pour écouter – et une bouche vorace pour ava-ler. D’autres villes ressemblent à tous les oiseaux, bêtes et pois-sons dont l’appétit et le système digestif sont normaux. Paris, seule, est l’apothéose analogique de la pieuvre. Produit de la cen-tralisation portée à l’absurde, la ville représente bien la pieuvre ; et il n’est aucun aspect où cette ressemblance est plus curieuse que dans la similarité avec l’appareil digestif. Ces touristes intelligents, qui, ayant abandonné toute indivi-dualité entre les mains de MM. Cook ou Gaze, « font » Paris en trois jours, sont souvent intrigués par le fait qu’un dîner, qui, à Londres, aurait coûté à peu près six shillings, peut ne pas dépas-ser trois francs dans un café du Palais-Royal. Leur surprise n’aurait plus de raison d’être s’ils voulaient bien considérer la classification comme une spécialité théorique de la vie pari-sienne, et s’adapter à tout ce qui entoure cette donnée à partir de laquelle le chiffonnier a sa genèse. Le Paris de 1850 ne ressemble pas au Paris d’aujourd’hui, et qui voit le Paris de Napoléon et du baron Haussmann peut à peine se rendre compte de l’existence de l’état des choses il y a quarante-cinq ans. Néanmoins, on peut compter au nombre des choses qui n’ont pas changé les quartiers où les détritus sont rassemblés. L’ordure est partout la même dans le monde, à toutes les époques, et la ressemblance de famille entre des tas d’ordures est parfaite. Ainsi, le voyageur qui visite les environs de Montrouge peut, sans difficulté, remonter dans son imagination jusqu’à l’année 1850. Cette année-là, je faisais un séjour prolongé à Paris. J’étais très amoureux d’une jeune demoiselle qui, bien qu’elle partageât ma passion, avait si totalement cédé à la volonté de ses parents qu’elle leur avait promis de ne pas me voir ou de ne pas m’écrire pendant une année. Moi aussi, j’avais été obligé d’accepter ces conditions, avec le vague espoir de l’approbation parentale. Du-rant cette période de probation, j’avais promis de rester hors du pays et de ne pas écrire à ma bien-aimée jusqu’à l’expiration de l’année. Naturellement, le temps me pesait beaucoup. Il n’y avait personne dans ma propre famille ou dans le cercle de mes amis qui pût me donner des nouvelles d’Alice, et aucun membre de sa famille à elle n’avait, je regrette de le dire, assez de magnanimité pour m’envoyer ne fût-ce qu’un mot occasionnel de réconfort touchant sa santé ou son bien-être. Je passai six mois à errer à travers l’Europe ; mais comme je ne pus trouver de distractions satisfaisantes dans ces voyages, je décidai de venir à Paris où, au moins, je ne serais pas loin de Londres, au cas où quelque bonne nouvelle pourrait m’appeler là-bas avant le moment indiqué. Que « l’espoir différé rend le cœur malade » ne fut jamais aussi vrai que dans mon cas, parce que, à mon désir perpétuel de voir le visage que j’aimais, s’ajoutait en moi une anxiété qui me torturait parce que j’avais peur à l’idée que quelque accident pourrait m’empêcher de prouver à Alice, le moment venu, que pendant toute cette longue période probatoire j’avais été digne de sa con-fiance et fidèle à mon amour pour elle. Ainsi, chaque voyage nou-veau que j’entreprenais me donnait une sorte de plaisir cruel, parce qu’il impliquait des conséquences possibles plus graves que celles qu’il aurait comportées en temps ordinaire. Comme tous les voyageurs, j’épuisai vite les endroits les plus intéressants, et je fus obligé, le second mois de mon séjour, de chercher des distractions là où je le pouvais. Après divers déplacements dans les banlieues les plus con-nues, je commençai à deviner qu’il existait une terra incognita, inconnue des guides touristiques, située dans le désert social entre ces lieux séduisants. En conséquence, je commençai à faire des recherches systématiques, et chaque jour je reprenais le fil de mon exploration à l’endroit où je l’avais laissé le jour précédent. Avec le temps, mes explorations me conduisirent près de Montrouge, et je me rendis compte que dans ces parages se si-tuait l’Ultima Thulé de l’exploration sociale – un pays aussi peu connu que celui qui entoure la source du Nil Blanc. Et, ainsi, je décidai d’investir philosophiquement le monde des chiffonniers, son habitat, sa vie, ses moyens d’existence. La tâche était repoussante, difficile à accomplir, et offrait peu d’espoir d’une récompense adéquate. Néanmoins, en dépit du bon sens, mon obstination prévalant, j’entrepris ma nouvelle investigation avec une énergie plus grande que celle que j’aurais pu avoir dans des recherches dirigées dans un quelconque but, d’intérêt ou de mérite supérieurs. Un jour, à la fin d’un bel après-midi dans les derniers jours du mois de septembre, j’entrai dans le saint des saints de la ville des ordures. L’endroit était évidemment le lieu de résidence de nombreux chiffonniers, parce qu’une sorte d’arrangement était manifeste dans la façon dont les tas d’ordures étaient formés près de la route. Je passai parmi ces tas qui se dressaient debout comme des sentinelles bien alignées, décidé à m’aventurer plus avant, et à traquer l’ordure jusqu’à son ultime emplacement. Tandis que j’avançais, je vis derrière les tas d’ordures quelques silhouettes passer ici et là, de toute évidence regardant avec intérêt l’arrivée d’un étranger dans un tel endroit. Leur quartier était comme une petite Suisse, et, avançant en zigza-guant, je perdis de vue le sentier derrière moi. Finalement, j’entrai dans ce qui semblait être une petite ville ou une communauté de chiffonniers. Il y avait un certain nombre de cabanes ou de huttes, comme on peut en trouver dans les par-ties les plus reculées des marais d’Allan, sortes d’abris rudimen-taires composés de murs d’osier et de terre, et recouverts de chaume grossier fait avec des détritus d’étable – abris tels qu’on ne voudrait pour rien au monde y pénétrer, et qui, même peints, n’ont rien de pittoresque à moins d’être judicieusement traités. Au milieu de ces huttes se trouvait l’un des plus étranges brico-lages – je ne peux pas dire habitations – que j’aie jamais vus. Une immense et antique armoire, vestige colossal de quelque boudoir Charles VII ou Henri II, avait été convertie en habitation. Les deux portes étaient ouvertes, si bien que l’intérieur entier s’offrait à la vue du public. Dans la moitié vide de l’armoire, il y avait un salon d’environ quatre pieds sur six, où s’étaient réunis, fumant la pipe autour d’un brasier de charbon, pas moins de six vieux soldats de la Ière République, portant des uniformes déchirés et usés jusqu’à la corde. De toute évidence, ils appartenaient à la catégorie des mauvais sujets ; leurs yeux glauques et leurs mâ-choires pendantes témoignaient clairement d’un amour commun pour l’absinthe ; et leurs yeux avaient ce regard hagard et usé, plein de la férocité somnolente que fait naître aussitôt, dans son sillage, la boisson. L’autre côté de l’armoire demeurait comme dans le passé, avec ses rayonnages intacts, si ce n’est qu’ils avaient tous été coupés sur la moitié de leur profondeur, et sur chacune de ces six planches se trouvait un lit fait de chiffons et de paille. La demi-douzaine de notables qui habitaient cette cons-truction me regardaient avec curiosité ; et quand je me retournai, après avoir fait quelques pas, je vis leurs têtes rassemblées pour une conversation à voix basse. Je n’aimais pas du tout l’aspect que prenait tout cela parce que l’endroit était très solitaire, et les hommes avaient l’air très, très méchants. Toutefois, je ne vis au-cune raison d’avoir peur et continuai, pénétrant plus avant en-core dans le Sahara. Le chemin était assez tortueux ; et, parcou-rant une série de demi-cercles comme le font les patineurs qui exécutent la figure dite hollandaise, je devins assez conscient que j’étais en train de m’égarer. Quand j’eus avancé un peu plus avant, je vis, contournant l’angle d’un tas d’ordures à moitié achevé, assis sur un tas de paille, un vieux soldat au manteau râpé. « Hé ! me dis-je. La Ière République est bien représentée ici, avec ce militaire. » Quand je passai devant le vieil homme, il ne me regarda même pas, mais il contempla le sol avec une insistance appuyée. De nouveau, je me dis à moi-même : « Tu vois le résultat d’une vie de guerre difficile. La curiosité de ce vieil homme appartient au passé. » Néanmoins, quand j’eus fait quelques pas de plus, je me re-tournai soudainement, et je vis que sa curiosité ne s’était pas éteinte parce que le vétéran avait levé la tête et me regardait avec une expression bizarre. J’eus l’impression que c’était l’un des six notables de l’armoire. Quand il me vit le regarder, il laissa tom-ber sa tête ; et, sans plus songer à lui, je continuai mon chemin, content qu’il existât une étrange similitude entre ces vieux sol-dats. Un peu plus tard, d’une façon semblable, je rencontrai un autre vieux soldat. Lui non plus ne fit pas attention à moi quand je passai. Le temps aidant, il commençait à se faire tard dans l’après-midi, et je commençai à songer à revenir sur mes pas. Aussi je fis demi-tour pour rentrer, mais je pus voir qu’un certain nombre de sentiers passaient entre les différents tas, et je ne sus avec certi-tude lequel prendre. Dans ma perplexité, je voulus m’adresser à quelqu’un pour lui demander mon chemin, mais je ne vis per-sonne. Je décidai de continuer quelques pas plus avant et essayai de voir si l’on pouvait me renseigner – mais pas un vétéran ! J’atteignis mon but, parce que, après environ deux cents mètres, je vis devant moi une sorte de simple cabane semblable à celles que j’avais déjà vues, avec cependant pour différence que celle-ci n’était pas destinée à être habitée, car elle était faite sim-plement d’un toit et de trois murs, et elle était ouverte sur le de-vant. À l’évidence, tout me permettait de croire qu’il s’agissait d’un endroit où s’opérait le triage des ordures. À l’intérieur de la cabane se trouvait une vieille femme ridée et recroquevillée par l’âge ; je m’approchai d’elle pour lui demander mon chemin. Elle se leva quand je fus près d’elle, et je lui demandai mon chemin. Elle engagea immédiatement la conversation et il me vint à l’esprit qu’ici, au centre même du Royaume des Ordures, je pouvais recueillir des détails sur l’histoire du métier de chiffon-nier, surtout puisque je pouvais le faire de la bouche même d’une personne qui semblait en être l’habitant le plus ancien. Je commençai mon enquête, et la vieille femme me donna des réponses fort intéressantes – elle avait été l’une des céteuses qui étaient restées assises tous les jours devant la guillotine, et qui avaient eu un rôle actif parmi les femmes qui s’étaient singulari-sées par leur violence pendant la Révolution. Au cours de notre conversation, elle dit tout à coup : – Mais M’sieur doit en avoir assez de rester debout ? Et elle épousseta un vieux tabouret branlant pour que je puisse m’asseoir. Cette idée ne me plaisait pas beaucoup pour plusieurs raisons ; mais la pauvre vieille femme était tellement civile que je ne voulais pas risquer de la blesser en refusant, et, de plus, la conversation d’une personne qui avait assisté à la prise de la Bastille pouvait être intéressante. Aussi je m’assis et notre en-tretien continua. Tandis que nous parlions, un vieillard plus âgé, et même plus recroquevillé et plus ridé que la femme, apparut de derrière la cabane. « Voici Pierre, dit-elle. M’sieur peut entendre des his-toires, maintenant, s’il le veut, parce que Pierre était partout, de la Bastille jusqu’à Waterloo. » Le vieil homme prit un autre ta-bouret à ma demande, et nous plongeâmes dans un océan de souvenirs sur la Révolution. Ce vieil homme, bien qu’habillé comme un épouvantail, res-semblait à n’importe lequel des six autres vétérans. À ce moment, j’étais assis au centre de la cabane, basse de plafond, avec la vieille femme à ma gauche et l’homme à ma droite ; tous deux étaient assis à un pas devant moi, la pièce était remplie de toutes sortes d’objets curieux en bois et de beaucoup de choses dont j’aurais voulu être éloigné. Dans un coin se dres-sait un amas de chiffons que semblait vouloir abandonner l’abondante vermine qui s’y trouvait, et dans un autre un tas d’os dont l’odeur était quelque peu repoussante. De temps à autre, jetant un coup d’œil à ces amas, je pouvais voir les yeux luisants de quelques-uns des rats qui infestaient l’endroit. Tout cela était déjà désagréable, mais ce qui me semblait pire encore était une vieille hache de boucher, au manche en fer recouvert de taches de sang, et qui était appuyée contre le mur, à droite. Tout cela ne m’inquiétait pas cependant outre mesure. La conversation des deux vieillards était tellement fascinante que je demeurai en leur compagnie tandis que la nuit tombait et que les tas d’ordures je-taient des ombres profondes dans les espaces qui les séparaient. Après un certain temps, je commençai à me sentir mal à l’aise. Je ne pouvais savoir ni comment ni pourquoi, mais quoi qu’il en soit, je ne me sentais pas en paix. Un malaise est instinc-tif et a valeur d’avertissement. Les facultés psychiques sont sou-vent les sentinelles de l’intellect, et lorsqu’elles donnent l’alarme, la raison commence à agir, bien que, peut-être, pas consciem-ment. C’est ce qui se passa en moi. Je commençai à réfléchir à l’endroit où je me trouvais et à ce qui m’entourait, et à me de-mander comment je pourrais m’en sortir au cas où je serais atta-qué ; et puis la pensée me vint tout à coup à l’esprit, bien que sans cause évidente, que j’étais en danger. La prudence me souffla : « Reste tranquille et ne fais aucun geste. » Aussi je restai tran-quille et ne fis aucun geste parce que je savais que quatre yeux rusés me regardaient. « Quatre yeux, sinon plus. » Mon Dieu, quelle horrible pensée ! La cabane pouvait être entourée sur trois côtés par des ruffians. Je pouvais être au centre d’une horde de desperados tels que seul un demi-siècle de révolutions pério-diques peut en produire. Avec le sentiment du danger, mon intellect et ma faculté d’observation s’aiguisèrent, et je devins plus attentif que d’ordinaire. Je remarquai que les yeux de la vieille femme se tournaient constamment vers mes mains. Je les regardai à mon tour et vis la cause de son regard : mes bagues. À mon petit doigt gauche, je portais une lourde chevalière, et à celui de droite un diamant de valeur. Je pensai que, s’il existait un danger, mon premier souci de-vait être d’écarter tout soupçon. Aussi je commençai à diriger la conversation sur le milieu des chiffonniers – vers les égouts et les choses qu’on y trouvait ; et ainsi, peu à peu, vers les bijoux. Puis, saisissant une occasion favorable, je demandai à la vieille femme si elle avait des connaissances sur de telles choses. Elle me ré-pondit qu’elle en avait un peu. J’étendis ma main droite et, lui montrant le diamant, lui demandai ce qu’elle en pensait. Elle ré-pondit que ses yeux étaient mauvais et se pencha sur ma main. Je dis, aussi nonchalamment que je pus : – Excusez-moi ! Vous verrez mieux comme ça ! Et, enlevant le diamant, je le lui tendis. Une lueur qui n’avait rien d’une auréole irradia de son visage flétri de vieillarde quand elle toucha la pierre. Elle me jeta un coup d’œil aussi rapide et perçant que l’éclair.





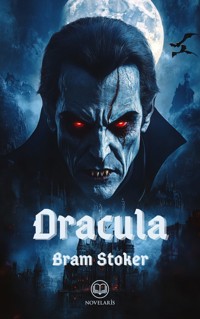

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)