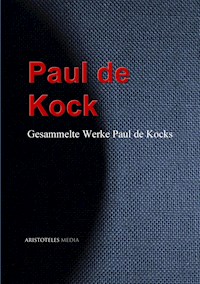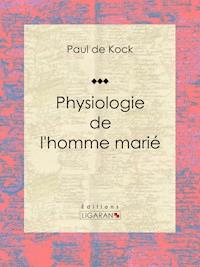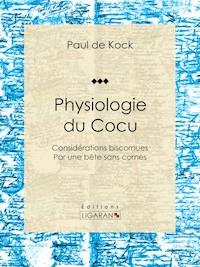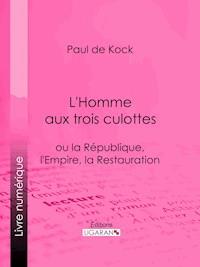
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "On était au mois de ventôse, c'était la seconde année de la république française, ce qui pour beaucoup de personnes se comprenait mieux par le mois de mars de l'an mil sept cent quatre-vingt-quatorze.
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On était au mois de ventôse, c’était la seconde année de la république française, ce qui pour beaucoup de personnes se comprenait mieux par le mois de mars de l’an mil sept cent quatre-vingt-quatorze.
Le temps était sombre, pluvieux et triste ; il venait de sonner quatre heures à une horloge de bois placée dans une petite chambre d’un rez-de-chaussée donnant sur la cour d’une maison de la rue Poissonnière, et à peine si l’on voyait encore assez clair dans cette pièce pour distinguer les objets à quelques pas de soi.
Près d’une cheminée, dans laquelle brûlait un feu modeste, une femme d’une cinquantaine d’années était assise et s’occupait à raccommoder une veste d’homme. Le costume de cette femme était simple et presque pauvre, mais son extrême propreté le relevait un peu. C’était un déshabillé d’indienne de couleur sombre, un tablier à raies rouges et noires, puis, pour coiffure, le grand bonnet à barbes tombantes que portaient presque toutes les femmes à l’époque de la république.
La figure pâle et amaigrie de cette femme semblait annoncer qu’elle venait de faire une forte maladie, la tristesse de son regard dénotait aussi que chez elle les peines du cœur s’étaient réunies à celles du corps. Cependant, de temps à autre, elle s’efforçait de sourire, et sa figure reprenait quelque sérénité lorsque ses regards s’attachaient sur un jeune homme assis de l’autre côté de la cheminée.
C’était un garçon de vingt et un ans, grand, maigre, mais bien bâti, et dont toute la personne annonçait plus que son âge ; son teint assez brun, ses cheveux et ses yeux très noirs donnaient au premier abord quelque chose de sévère, de dur même à sa physionomie : mais, en considérant son profil dessiné à l’antique et tous ses traits dont l’expression mâle n’excluait pas l’élégance, on ne pouvait nier que ce jeune homme n’eût en lui quelque ressemblance avec les portraits que l’on nous fait des héros de Rome et d’Athènes.
Le beau garçon tenait un livre et lisait : il avait pour vêtement un large pantalon de drap gris, puis un gilet à grands revers. Il portait des bas bleus et de gros souliers ; enfin pour qu’il fût complètement habillé il ne lui manquait que la veste, ou plutôt la carmagnole, que près de lui on était en train de rapiécer.
Le jeune homme venait de poser son livre sur le chambranle de la cheminée, il regarda la bonne dame assise auprès de lui et lui dit :
– Vous n’y voyez plus, ma mère, vous vous abîmez les yeux.
– Oh ! j’y vois encore assez, mon cher Maxime ; je voudrais achever sur-le-champ de raccommoder ta veste, car tu n’en as pas d’autre et tu ne dois pas avoir chaud en manches de chemise.
– Donnez-vous le temps, je n’ai pas froid ici… ; il est vrai que je voudrais sortir ce soir…, mais j’ai encore une autre carmagnole… du reste, je crois qu’elle est plus mauvaise que celle-ci.
– Comment ! Maxime, tu veux sortir ce soir ?… j’espérais que tu resterais à me tenir compagnie.
– Cela ne se peut pas, ma mère, j’ai affaire à l’imprimerie, et le citoyen Hébert me gronderait demain si je n’y allais pas… ; il ne se repose que sur moi pour la correction des épreuves de son journal.
– Ah ! oui, son journal, le Père Duchesne ! répond la mère du jeune homme en haussant les épaules ; voilà encore un beau journal ! qui ne prêche que le meurtre, le sang, le carnage !…
– De grâce, taisez-vous ! si l’on vous entendait…, vous seriez perdue !…
En disant ces mots, le jeune homme s’était levé, puis après avoir regardé autour de lui, avait doucement entrouvert une des fenêtres qui donnaient sur la cour, afin de s’assurer si personne ne s’y promenait, car de la cour il eût été facile d’entendre ce qui se disait dans l’appartement du rez-de-chaussée.
Mais il tombait trop d’eau, il faisait trop mauvais temps pour que personne fût tenté de se tenir dehors. Maxime rassuré referme la fenêtre, et revient s’asseoir près de sa mère, à laquelle il dit d’un ton plus doux :
– D’ailleurs, ma mère, vous savez bien que vous n’entendez rien à la politique et vous m’aviez promis de ne plus vous occuper de tout cela…
– Non sans doute, mon ami, je n’ai pas la prétention de m’entendre à ce qui concerne les grands intérêts de l’État… ; mais il y a de ces choses où il ne faut, pour bien juger, que consulter son cœur et sa conscience ! Dans le temps où nous vivons, comment veux-tu qu’on ne s’occupe pas de politique… quand tout le monde en parle… quand chacun autour de nous fait, arrange à sa guise un gouvernement, quand chaque minute apporte la nouvelle d’une arrestation, ou d’une condamnation à mort, quand on tremble pour soi et pour tous ceux que l’on aime, quand on n’ose pas sortir de sa demeure de crainte de rencontrer quelque charrette sanglante, quelques hommes sanguinaires portant sur des piques les têtes de leurs victimes…
– Ma mère… ma mère… vous exagérez…
– Hélas ! non, mon ami : je ne dis que ce qui est… ce que nous avons tous vu… Oh ! je sais bien que tu es républicain, toi, Maxime, je sais bien que tu donnerais ton sang pour ta patrie, pour voir la France libre, fière, indépendante ;… je sais bien que tu as pleuré de joie en quatre-vingt-neuf… et pourtant tu n’avais que seize ans alors ; mais c’est égal, tu as pleuré de joie en apprenant la belle réponse de Mirabeau lorsque l’on voulait dissoudre l’Assemblée des états généraux. Ah ! si tous les républicains te ressemblaient !… personne ne tremblerait que les coupables, et la terreur ne régnerait pas dans Paris et dans la France entière !… Oh ! tu le sais bien aussi, car depuis quelque temps tu es triste, mécontent, parce que tu vois que cela ne marche pas comme toi et tant d’autres l’aviez espéré.
– Sans doute, ma mère, j’ai vu avec peine les excès auxquels on s’est livré… des idées de vengeance, des calculs sordides, remplacer le cours de la justice… des hommes féroces, ou des têtes folles s’emparer du pouvoir ; mais que voulez-vous ! une révolution ne s’accomplit pas sans qu’il se commette des abus ! cela fut ainsi de tout temps !…
– L’exemple des autres devrait vous servir et vous corriger… Les Anglais ont rougi d’avoir fait périr leur roi… et vous avez fait mourir le vôtre, comme si vous aviez à cœur de prendre la moitié de leur honte !
– Chut ! chut !… oh ! taisez-vous, je vous en prie… et donnez-moi ma carmagnole… que j’aille corriger les épreuves du Père Duchesne ! Ah ! ma mère… si ce n’eût pas été pour rester près de vous, je sens que j’aurais eu plus de plaisir à aller combattre les étrangers qui menacent nos frontières, que d’être prote dans une imprimerie !… Tous les hommes de mon âge sont partis pour la réquisition… et moi… je suis resté… par la protection du citoyen Hébert… Ah ! j’en suis honteux quelquefois !…
– Qu’est-ce que tu dis là !… tu es honteux d’être resté près de ta mère pour la soutenir par ton travail !… car sans toi je ne mangerais que du pain… et encore pas tous les jours. Ton père, ce bon Bertholin, avait une place dans le ministère de la marine, cela suffisait pour nous faire vivre et t’élever… car, grâce au ciel, tu as reçu une bonne éducation !… Mais ton père est mort il y a six ans, et la pension que l’on me payait comme sa veuve a été supprimée depuis la révolution… Mais tu es savant ! tu sais le grec, le latin, l’histoire, et tu as trouvé facilement une place dans l’imprimerie… où tu es aimé, considéré même… car on connaît la pureté de tes principes… On sait que tu es un républicain, toi, mais non pas un terroriste. Oh ! quant à cela, il n’y a pas à mordre sur ta conduite ! Et tu voudrais me quitter… abandonner ta place… ta pauvre mère, pour aller à la guerre te faire tuer… Ah ! Maxime !… c’est bien mal… et je ne comprends pas que l’on puisse être honteux de servir d’appui, de protecteur à sa mère.
En achevant ces mots, madame Bertholin avait détourné la tête pour cacher quelques larmes qui tombaient de ses yeux ; mais déjà Maxime s’est levé et il a couru embrasser sa mère en lui disant :
– Allons… j’ai eu tort… pardon… pardon… oubliez cela…
– Tu ne me parleras plus de me quitter… de te faire soldat ?…
– Non… non… je resterai près de vous… mais donnez-moi ma carmagnole, que j’aille à l’imprimerie.
Maxime vient d’endosser la veste et il se dispose à sortir, lorsqu’on frappe plusieurs coups à la porte, et au même instant une voix de femme fait entendre ces mots :
– Citoyenne Bertholin… c’est moi, Euphrasie Picotin-Horatius.
– La citoyenne Picotin ne sort donc plus d’ici ! dit Maxime en hochant légèrement la tête. Il me semble qu’elle vient tous les jours.
– Elle aime à causer… il paraît qu’elle n’a rien à faire chez elle… et puis elle…
La maman Bertholin n’achève pas sa phrase, mais elle regarde son fils en souriant. Celui-ci est allé ouvrir la porte du carré, et une femme de dix-neuf ans, gentille, grasse, rose, l’œil très vif, la mine fort éveillée, entre aussitôt dans la chambre. Sa toilette était aussi élégante que la mode le comportait alors ; mais elle était de mauvais goût, c’était une exagération de tout ce que les femmes mettaient pour être à la fois en patriotes et en muscadines. Ainsi avec un bonnet à barbe cette femme avait de gros nœuds de dentelles, puis une énorme cocarde placée assez coquettement sur le côté ; la jupe était fort courte et laissait voir une jambe bien faite et un pied très cambré, enfin sa robe fort décolletée par-devant et par-derrière permettait d’admirer un dos et des épaules rondelettes, et de plonger les yeux entre deux globes d’albâtre qui ne craignaient pas de se montrer au grand jour.
La jeune femme est entrée lestement dans la chambre, en s’écriant :
– Bonjour, citoyenne ; tu te portes mieux ? Bonjour, citoyen Maxime ; il y a bien longtemps que je n’ai eu le plaisir de te rencontrer.
Ces mots sont accompagnés d’un sourire très gracieux adressé au jeune homme : celui-ci ne semble pas y faire attention et se contente de répondre :
– Mais il me semble que tu m’as vu ici avant-hier, citoyenne…
– Avant-hier ?… tu crois ?… c’était nonidi ou octidi… non, je crois que c’était décadi… est-ce décadi que je suis venue, citoyenne ?
– Je ne m’en souviens plus… D’ailleurs je m’embrouille avec tous ces noms-là… je ne m’y retrouve jamais
– Eh bien, citoyenne, tu es comme mon mari, ce pauvre Picotin-Horatius, il s’embrouille dans tout… Heureusement que je suis là pour le remettre au courant… j’ai de la tête pour nous deux ; c’est heureux ! Ah ! il n’était pas né pour le commerce, Picotin… je suis encore à chercher pourquoi il était né…
– Tu lui diras bien des choses de ma part, citoyenne, dit Maxime en se disposant à partir.
– Comment, citoyen Maxime, tu t’en vas ! dit la jeune femme d’un ton où perçait un peu de dépit : mais est-ce moi qui te fais fuir si vite ?…
– Non, certes… mais le travail de l’imprimerie…
– C’est que mon mari voulait te voir… il avait quelque chose à te demander relativement à son enseigne, qu’il veut changer, il désirerait ton avis… Il sait que tu ne peux donner que de bons conseils. Et puis j’ai rencontré ton ami Roger ; il part demain pour l’armée, et avant de s’éloigner il doit venir te dire adieu.
– Je vais me hâter alors, afin de revenir de bonne heure… Ma mère, si Roger vient, dites-lui d’attendre ; je serais bien fâché s’il partait sans que je l’eusse embrassé. Au revoir, citoyenne !
En disant ces mots, Maxime prend un chapeau rond sur lequel est attaché la cocarde nationale et s’éloigne en faisant encore un sourire d’adieu à sa mère.
Pendant que la bonne dame Bertholin ouvre la fenêtre d’une pièce voisine qui a vue sur la rue, afin de regarder son fils s’éloigner, madame Picotin est allée se mirer devant une petite glace placée sur la cheminée, et tout en chiffonnant son bonnet, elle dit :
– Sais-tu, citoyenne Bertholin, que ton fils est fort beau garçon ?… bel homme, bien bâti ? c’est dommage qu’il ait toujours un air si grave, si sévère… Il ne rit jamais… Pour un jeune homme, c’est étonnant.
– Nous ne vivons pas dans un temps qui prête à rire, répond la mère de Maxime, en retournant s’asseoir à sa place.
– Ah bien !… s’il fallait toujours s’affliger, on maigrirait, on perdrait sa fraîcheur… Je tiens beaucoup à mes couleurs, moi, d’autant plus que j’espère faire la déesse de la Liberté à la première fête nationale qui aura lieu en l’honneur de l’Être suprême. Picotin-Horatius doit en faire la demande pour moi dans notre section.
– Comment !… tu veux faire la Liberté ! dit madame Bertholin, en regardant la jeune femme d’un air surpris.
– Pourquoi pas ?… Je suis assez bien faite pour cela… ce ne sera déjà pas une Liberté si déchirée !
– Et le costume qu’il faut mettre ne t’effarouche pas ?
– Le costume ? au contraire, c’est ce qui me tente… C’est un costume grec, une légère tunique, puis un manteau jeté dessus… Ah ! je sais bien qu’on fait voir ses formes ; mais fallût-il se mettre nue, du moment que c’est pour la nation, je m’y mettrais… Oh ! je suis une vraie sans-culotte, moi !
– Je m’en aperçois ! et ton mari !… il trouve bon que tu veuilles représenter la Liberté ?
– Je voudrais bien voir qu’il ne le trouvât pas bon !… N’est-ce pas un honneur ? Oh ! d’ailleurs, ce pauvre Picotin, est-ce qu’il a d’autres volontés que les miennes ! il sera enchanté de voir sa femme coiffée du bonnet phrygien et traînée dans un char ! Oh ! je voudrais déjà y être.
Et la jeune femme se met à sautiller dans la chambre en chantant :
Pendant que madame Picotin dansait, une voix se faisait entendre dans la rue : c’était celle du crieur public qui annonçait les nouvelles condamnations à mort prononcées la veille par le tribunal révolutionnaire, et dont l’exécution avait lieu dans la journée.
La mère de Maxime est retournée dans la chambre dont la fenêtre donne sur la rue, elle écoute avec anxiété, puis bientôt, en entendant prononcer le nom de François Brémont, elle se laisse tomber sur une chaise, en murmurant :
– François Brémont ! pauvre homme ! et lui aussi… Eh ! mon Dieu à soixante-seize ans, de quoi donc a-t-on pu le trouver coupable ?
Euphrasie Picotin est restée sur une jambe, elle regarde la mère de Maxime, et s’apercevant qu’elle pleure, court à elle, en lui disant d’un air assez ému :
– Est-ce qu’il y a quelqu’un de votre connaissance ?
– Oui, un vieillard, un si brave homme : il avait été l’ami, le protecteur de mon mari, et on l’a condamné…
– Oh ! certainement, on fait des choses… des… Mais que voulez-vous ?… il ne faut pas même avoir l’air de plaindre ceux qui sont condamnés, car alors on passera soi-même pour suspect ! et de suspect à guillotiné il n’y a pas bien loin… Aussi, c’est pour cela que Picotin affecte tant de zèle pour la république, qu’il met un bonnet rouge, qu’il porte une carmagnole, qu’il a ajouté à son nom celui d’Horatius, qu’il crie contre les aristocrates… Il a si peur, le pauvre homme !
– Ah ! à la bonne heure ! dit la mère Bertholin, en pressant la main de la jeune femme dans la sienne, avouez-moi que vous faites tout cela par peur, et au moins je ne vous détesterai pas.
En ce moment, un murmure confus se fait entendre dans la rue ; ce sont des cris, des chants, des vociférations ; bientôt les voix se rapprochent, et une centaine de personnes arrivent en hurlant, en poussant des exclamations de joie qui ressemblent à des cris de fureur. Ceux qui font ce tumulte sont, pour la plupart, des hommes débraillés, déguenillés, coiffés de bonnets rouges, et armés les uns de sabres, les autres de piques, de fusils ou de pistolets ; mais parmi tout ce monde on voit des femmes, à l’œil hagard, au teint livide ou aviné ; ces femmes, dont les cheveux flottent au hasard sur leurs épaules, ce qui achève de leur donner l’aspect de furies, brandissent aussi des sabres nus, et crient plus fort encore que les hommes :
– À la lanterne l’aristocrate ! à la lanterne !…
Puis au milieu de ce groupe effrayant est un petit vieillard en habit bleu, les cheveux poudrés, attachés avec un cadogan, qui est pâle, tremblant et s’efforce de faire entendre à ceux qui l’ont arrêté qu’il n’est pas un aristocrate, quoiqu’il porte de la poudre et qu’il ait un collet de velours à son habit, et qu’on ne doit pas pendre un homme parce qu’il est suspecté d’être suspect.
Sur le passage de ces furieux, les gens de boutique se sont hâtés de rentrer chez eux, la plupart des fenêtres qui étaient ouvertes se sont fermées ; mais Euphrasie Picotin est restée à la croisée, et, tandis que la mère de Maxime fuit dans la première pièce, pour ne pas entendre des cris qui lui font mal, la jeune femme se penche en dehors de la fenêtre et applaudit avec ses mains, en criant :
– Oui, à bas les aristocrates ! à la lanterne tout le monde !
Cette exclamation, qui aurait pu être prise en mauvaise part, enchante au contraire un de ces messieurs portant des piques, et comme le rez-de-chaussée où se trouvait Euphrasie n’était qu’à un pied au-dessus du niveau de la rue, le sans-culotte s’approche de la croisée et dit à la jeune femme :
– Tu es une bonne b… toi ! À bonne heure ! tu comprends la chose publique… Veux-tu m’embrasser ?
– Avec plaisir, citoyen, répond Euphrasie en se penchant en dehors de la fenêtre, tandis que de son côté le sans-culotte monte sur ses pointes, afin d’atteindre aux joues fraîches et roses qui lui sont présentées.
Alors un baiser bien retentissant est pris sur le visage de la jeune femme, ensuite son embrasseur lui donne une poignée de mains et court rejoindre ses compagnons. Lorsqu’il est loin la citoyenne Picotin referme la fenêtre et va, en essuyant ses joues, se rasseoir près de la mère de Maxime, d’un air qui n’annonçait pas qu’elle fût bien satisfaite de l’accolade qu’elle venait de recevoir.
Une demi-heure s’était écoulée depuis l’évènement de la croisée ; madame Bertholin s’était remise à travailler ; Euphrasie ne dansait plus, mais de temps à autre elle essuyait encore ses joues, en murmurant :
– Picotin ne revient pas de la section… Je lui avais donné rendez-vous ici. Ton fils ne rentre guère vite… Et ce Roger qui devait venir lui dire adieu… Pauvre Roger !… il dit qu’il est content de partir… dame ! il était très amoureux de moi… et, il y a deux ans, lorsque j’ai épousé Picotin, il a eu bien du chagrin, quoiqu’il ait feint de prendre son parti. Moi, j’aimais assez Roger ; certainement il me plaisait plus qu’Anacharsis Picotin… D’abord, il est mieux de figure ; non pas que mon mari soit laid, mais il a l’air bête !… et ces airs-là ne font qu’augmenter avec les années ! Ma tante a voulu que je devinsse l’épouse de Picotin ; elle m’a dit : Il a quelque chose, c’est un homme établi, tandis que ton petit Roger n’a rien. J’ai obéi à ma tante. D’ailleurs je me disais : Quand je serai mariée, Roger viendra nous voir… je l’engagerai très souvent à venir dîner avec nous. Mais ce monsieur m’a gardé rancune ; il m’a boudée pendant dix-huit mois, en voilà seulement six qu’il revient chez nous ; et à présent il part pour l’armée ! C’est fort contrariant, ça me fera un vide et à mon mari aussi, qui aimait beaucoup Roger et qui faisait tous les soirs avec lui sa partie de dominos !
La mère de Maxime prêtait fort peu d’attention aux discours que lui tenait la jeune femme ; elle semblait livrée tout entière à ses réflexions ; mais, de temps à autre, elle poussait un gros soupir, murmurait le nom de François Brémont, puis essuyait les larmes qui tombaient de ses yeux.
Tout à coup le bruit d’une voiture se fit entendre : bientôt il cessa devant la maison, et on entendit la voix du cocher demander qu’on ouvrît les deux battants de la porte-cochère.
– C’est la voiture de monsieur… du citoyen Derbrouck, dit madame Bertholin ; il revient sans doute de Passy avec sa femme.
– Qu’est-ce que c’est que le citoyen Derbrouck ? demande Euphrasie, après avoir été regardé la jolie voiture bourgeoise arrêtée devant la porte.
– C’est un banquier hollandais établi en France depuis quelques années : ah ! c’est un bien brave homme, et aussi bon, aussi obligeant qu’il est honnête.
– Comment ose-t-il encore avoir équipage dans un temps où tout le monde craint de paraître riche, de peur de passer pour un aristocrate ?
– Il paraît que monsieur… que le citoyen Derbrouck n’a pas peur. C’est un homme qui est pour les idées libérales, qui aime le peuple, qui déteste l’oppression. Il est lié avec plusieurs membres du Comité de salut public : il reçoit chez lui Hébert, le général Ronsin, et beaucoup d’autres personnages marquants de l’époque. J’avoue que cela me surprend ! M. Derbrouck a l’air si doux, si aimable !… Comment peut-il faire sa société d’hommes dont les opinions sont si exaltées !… mais, comme dit mon fils, je n’entends rien à la politique.
– Quel âge a ce banquier ?
– Trente et quelques années : c’est un homme superbe, et une figure si remarquablement belle, que, dans le quartier, presque toutes les femmes et beaucoup d’hommes l’ont surnommé le bel Hollandais.
– Ah ! je suis curieuse de le voir… Est-il marié ?
– Oui ; sa femme est jeune, jolie et très bienfaisante, jamais elle n’a repoussé la prière d’un malheureux ; et maintenant que le pain est si cher et si rare, sans elle, j’en connais plus d’un qui en aurait manqué. Ce qu’il y a d’affreux, d’indigne, c’est que ce sont ceux qu’ils obligent qui sont les premiers à dire du mal de ce brave M. Derbrouck !… Ah ! cependant, il faut excepter Prosper. Oh ! pour celui-là, c’est un bon garçon, et malgré sa légèreté, son étourderie habituelle, je suis bien sûre qu’il irait… je ne sais où pour être utile à la famille Derbrouck…
– Qu’est-ce que c’est que ça, Prosper ?
– Un tout jeune homme… un garçon de dix-huit ans à peu près… Prosper Bressange est fils d’un marchand de soierie ; malheureusement, il est resté orphelin de bonne heure : son père avait amassé quelque argent, le jeune Prosper a eu bientôt dissipé tout cela ! À seize ans, ce monsieur donnait des dîners, traitait ses amis chez les meilleurs restaurateurs, puis faisait le diable, cassait les carreaux des maisons, insultait les passants, et quelquefois ne craignait pas d’aller au comité de la section pour rire et se moquer tout haut des orateurs lorsqu’il échappait quelque balourdise à ceux-ci, ce qui leur arrive assez souvent.
– Ah ! oui… oui… Prosper Bressange… je m’en souviens… je l’ai vu ici… C’est un ami de ton fils ; il a même de fort beaux yeux… l’air un peu mauvais sujet… mais j’aime ça dans un homme ; au moins on s’attend à quelque chose. Comment ! il n’a que dix-huit ans ce garçon-là !… il en parait vingt-quatre ! Il est tout à fait formé… Et que fait-il à présent ?
– Après avoir mangé ce que lui avait laissé son père, il a été bien heureux d’obtenir de l’ouvrage dans l’imprimerie où travaille Maxime ; mais encore ne travaille-t-il pas souvent !… Dès qu’il a un assignat, il court le dépenser… et puis, toujours des aventures, des disputes, des querelles… des gens battus, des carreaux cassés, et, sans M. Derbrouck, qui bien souvent l’a tiré de là, en payant pour lui, il y a longtemps que Prosper aurait été arrêté !…
– Comment le banquier hollandais peut-il connaître ce garçon ?
– Prosper demeure dans la maison… tout là-haut… une petite chambre dans les mansardes, et lorsque madame Derbrouck est accouchée, il y a six mois, Prosper ne s’est-il pas avisé de vouloir tirer un feu d’artifice dans la cour ? C’est ce jour-là qu’il s’est battu avec Goulard le portier, celui-ci a prétendu qu’il avait reçu une fusée dans l’œil ; je ne sais pas si c’est vrai, mais j’avoue que, depuis ce jour, son regard déjà faux et louche est encore plus hideux.
– Madame Derbrouck a plusieurs enfants ?
– Non, elle n’a que sa petite fille qui a dix mois et qu’elle nourrit. Oh ! elle est belle comme un ange… Mais pendant que nous jasons, il me semble que le portier n’ouvre guère sa porte-cochère.
– Non, car la voiture est toujours dans la rue…
– Je vais l’ouvrir alors, Goulard est peut-être absent. Il ne se gêne pas ! au lieu de garder sa porte, il va pérorer à la section… Il doit dire de jolies choses ! un homme si méchant !
En achevant ces mots, la bonne dame s’est levée, et ouvrant la porte de son appartement qui donne sur un petit palier, puis sur la cour, elle se hâte d’aller lever la barre de fer qui ferme les deux battants de la porte-cochère, et la voiture du banquier hollandais entre dans la maison.
Un homme de trente et quelques années en descend ; la mère de Maxime n’avait point flatté le portrait qu’elle avait fait à Euphrasie ; il était difficile de rencontrer une plus belle figure unie à une taille plus élégante et aussi bien proportionnée ; un air à la fois noble, doux et affable ajoutait encore au charme répandu sur toute la personne du banquier hollandais.
M. Derbrouck était habillé de noir et coiffé avec de la poudre ; cette toilette, bien que simple, était de trop bon goût pour l’époque, et formait un contraste remarquable avec toutes les carmagnoles que l’on rencontrait.
Le Hollandais s’est empressé de donner la main à une femme de vingt-six à vingt-sept ans qui descend de la voiture, suivie d’une femme de chambre, qui porte sur ses bras un enfant en bas âge. Madame Derbrouck est mise avec goût, mais fort simplement. On voit qu’elle ne désire pas être remarquée pour sa toilette. C’est une femme plus jolie que belle, plus agréable que régulière ; elle est petite, blanche et mignonne : on s’étonne qu’elle ait la force de nourrir. Cependant à peine a-t-elle mis pied à terre qu’elle se hâte de reprendre dans ses bras l’enfant que portait la femme de chambre.
Euphrasie s’était placée contre la fenêtre donnant sur la cour, et, quoiqu’il fit sombre, cherchait à voir les personnes qui venaient de descendre de voiture ; mais bientôt sa curiosité fut pleinement satisfaite, car, au lieu de monter sur-le-champ à leur appartement au premier, M. et madame Derbrouck se dirigèrent vers le rez-de-chaussée habité par la veuve Bertholin, et y entrèrent au moment où celle-ci posait sur la cheminée une chandelle qu’elle venait d’allumer.
– Reçois mes remerciements, citoyenne Bertholin, dit le banquier en entrant dans la chambre. C’est toi qui as eu la complaisance de nous ouvrir la porte-cochère, car il me paraît que le portier est absent.
– Oui, citoyen ; mais, mon Dieu ! cela ne valait pas la peine de t’arrêter pour me remercier et de faire entrer ici mada… la citoyenne qui va peut-être prendre du froid… et c’est dangereux quand on nourrit.
– Oh ! il n’y a pas de danger ! répond en souriant l’épouse du Hollandais. Je suis trop couverte pour craindre le froid… Je suis très aise de profiter de cette occasion, citoyenne, pour te faire voir ma fille, ma petite Pauline… Tiens, comment la trouves-tu ?
– Charmante ! oh ! quel joli petit cœur ! dit la veuve en considérant l’enfant qu’on lui présentait.
Euphrasie s’est approchée alors, et, poussant un cri d’admiration, elle embrasse la petite fille en disant :
– Oh ! oui. C’est un ange. Tu permets, citoyenne ?… J’aime beaucoup les enfants ! voilà comme j’en voudrais un ! Je ne cesse de dire cela à mon mari, depuis deux ans que je suis sa conjointe… mais, bah ! Picotin est si bête ! c’est comme si je chantais ! Enfin, ça viendra peut-être… avec le temps ! Ce n’est pas moi qui y mets opposition, toujours !
Madame Derbrouck souriait du bavardage d’Euphrasie, qui, tout en s’extasiant sur l’enfant, reportait à chaque minute ses yeux sur le père.
– Et ton fils, citoyenne, travaille-t-il toujours à son imprimerie ? dit le Hollandais, lorsque madame Picotin eut cessé de parler.
– Oui, citoyen, toujours. Oh ! Maxime n’est point un paresseux ; il est même allé ce soir à son ouvrage.
– C’est un brave et digne garçon que ton fils, citoyenne, il est rempli d’instruction, de moyens, de capacité ! S’il voulait se pousser, je suis certain qu’il ne tarderait pas à avoir un emploi honorable, et cela serait à désirer pour la république : ce sont des hommes comme ton fils qu’il faudrait voir à la tribune, à la Convention… Ah ! tout n’en irait que mieux !
– Citoyen, je te remercie pour Maxime : mais mon fils n’est point ambitieux… pas assez peut-être… Depuis quelque temps, comme il trouve que cela ne va pas comme il l’espérait, il est triste, il fuit le monde, et, son travail achevé, revient près de moi, me lit l’Histoire romaine, l’Histoire grecque, et s’enflamme, s’anime, en s’identifiant avec les grands hommes de l’antiquité.
– Eh bien, c’est comme mon mari, s’écrie Euphrasie : il a une fureur pour me lire ou pour me parler des Romains. Moi, ça ne m’amuse pas beaucoup, je l’avoue ; j’aimerais mieux des historiettes drôlettes… les Contes de la Fontaine, par exemple ; et je dis à Picotin : Lis-moi le Villageois qui cherche son veau, ça te sera bien plus avantageux, mais il me répond : Il faut connaître l’histoire romaine, puisque nous portons à présent des surnoms romains ; je dois connaître les aventures de mon patron Horatius Coque… Coque… Ah ! mon Dieu ! comment donc l’a-t-il appelé l’autre jour : Horatius Coculès ! Je lui ai même dit : Mon ami, tu as pris là un singulier parrain ; mais il ne faut pas disputer des goûts.
– C’est très juste, répond M. Derbrouck en souriant.
Puis, tirant une bourse de sa poche, il y prend plusieurs écus de six livres et les présente à la mère de Maxime, en lui disant :
– Citoyenne Bertholin, tu as déjà eu la bonté de me faire connaître les pauvres honteux les plus nécessiteux de ce quartier ; mais depuis quelques jours je suis resté à Passy, et il doit y avoir de nouvelles infortunes par ici… le mal arrive si vite dans ces temps de troubles… La république veut le bonheur du peuple, mais il y a mille souffrances particulières qu’elle ne peut connaître, ou dont elle n’a pas la faculté de s’occuper. Tiens, veux-tu bien, citoyenne, te charger encore de distribuer cela de ma part à ceux dont les besoins sont les plus pressants ?
– Ah ! citoyen Derbrouck que tu es bon ! répond la pauvre veuve, en prenant l’argent qu’on lui présente. Oui, sans doute, je me charge avec orgueil de ta commission, je serai heureuse de la remplir avec zèle et fidélité. Ah ! tout le monde devrait te bénir, et pourtant…
La bonne femme a dit bien bas ces derniers mots, mais d’ailleurs Euphrasie se charge de couvrir sa voix en s’écriant :
– Du numéraire ! Peste ! ça devient rare. Picotin prétend que les assignats valent mieux, autre boulette de mon mari ! Il voulait convertir en assignats tout ce que nous avions : bijoux, argenterie, meubles. Je crois, si je l’avais laissé faire, qu’il m’aurait fait coucher sur des assignats. Je m’y suis opposée ; je lui ai dit : Horatius Cocu… Coques… enfin n’importe, le nom n’y fait rien ; je lui ai dit : Cher époux, de bons matelas me semblent de première nécessité dans un ménage bien uni ! tes assignats, c’est superbe, mais on en dépense trop à la fois. Quand je vais acheter pour mon dîner un pot-au-feu de soixante livres, ou un poulet de quatre-vingts, je m’aperçois que l’on aimerait beaucoup mieux recevoir une pièce de vingt-quatre sous.
M. Derbrouck et sa femme disaient adieu à la veuve Bertholin et se disposaient à monter à leur appartement, lorsque tout à coup la porte du carré est ouverte brusquement et un nouveau personnage entre dans la chambre.
C’est un homme de trente et quelques années, petit, trapu, dont les jambes arquées et cagneuses supportent un corps presque aussi large que haut. La figure de ce personnage est d’une laideur repoussante, car, outre un nez plat et rentré, des cheveux roux et une bouche énorme, dans les deux petits yeux verts pâles, qu’il roule constamment autour de lui, se peint une expression de férocité qui se cache parfois sous un sourire faux et satanique.
Cet homme a le costume des gens qui poursuivaient le petit vieillard suspecté d’être suspect ; un pantalon court et large, une carmagnole déboutonnée, une grosse chemise tout ouverte par-devant et laissant voir à nu une poitrine surchargée de longs poils roux ; enfin, pour coiffure, un immense bonnet en loutre avec une longue queue-de-renard retombant par-derrière et flottant sur ses épaules. Une grosse cocarde au bonnet, une pipe à la bouche, et les manches de la veste retroussées jusqu’au coude : tel était en ce moment Goulard Leonidas, le portier de la maison.
– Qui est-ce qui s’est permis d’ouvrir ma porte-cochère ? s’écrie le portier d’une voix de Stentor, en entrant chez la veuve Bertholin sans saluer personne, et sans même porter la main à son bonnet.
À l’aspect de Goulard, madame Derbrouck ne peut maîtriser un mouvement d’effroi et de dégoût, puis ses yeux se portent sur son mari, comme pour le supplier de se modérer et de ne point traiter cet homme comme il le mérite. Un regard du banquier rassure sa femme, tandis que la veuve Bertholin répond d’un air fort calme :
– C’est moi qui ai ouvert la porte ; il le fallait bien, puisque tu n’y étais pas.
– Non, il ne le fallait pas… Ma porte est mon département, je ne veux pas qu’on y touche !… Je suis à cheval sur mes droits, comme sur les droits de l’homme.
– Diable ! citoyen Goulard, mais tu es bien despote pour un républicain, dit M. Derbrouck en tâchant de prendre un air riant.
– D’abord, je ne suis plus Goulard ! je ne m’appelle plus Goulard ; mon nom est Léonidas ! On m’appellera comme ça quand on voudra que je réponde.
– Léonidas, soit ! Eh bien, si tu avais été à ton poste, un autre n’aurait pas été obligé de se déranger pour m’ouvrir ta porte-cochère… Tu ne voulais pas sans doute que je restasse dans la rue avec ma voiture ?
– Est-ce qu’on a besoin des voitures, des carrosses ? est-ce que sous la république une et indivisible, les bons patriotes n’ont pas des jambes pour marcher ?
– Je crois que sous toutes les époques les hommes ont eu des jambes pour marcher ; mais lorsqu’on a un long chemin à faire, lorsqu’on ne veut pas se fatiguer, je ne vois pas pourquoi on ne se servirait pas d’une voiture quand on en a une… Il n’y a pas de loi qui défende cela. Au surplus, je suis trop bon de te donner toutes ces raisons, car je n’ai aucun compte à te rendre. C’est toi qui devrais t’excuser de ne pas avoir été à ta porte.
On entendait au son de la voix de M. Derbrouck que la patience commençait à lui échapper et que ce n’était plus qu’avec peine qu’il retenait sa colère. Mais sa femme le regardait toujours d’un air suppliant ; et, tandis que la veuve Bertholin jetait sur le portier un regard de mépris, Euphrasie, pâle et tremblante, avait entièrement perdu l’usage de la parole.
– M’excuser de ne pas avoir t’été à ma porte ! répond le portier en faisant un mouvement d’épaules. Ah ! ben !… le plus souvent que je vais m’excuser ! Est-ce que je ne dois pas t’être au comité de ma section quand j’ai des rapports à faire… ou des motions à proposer pour la fraternité et l’égalité… de l’indivisibilité ! Et d’ailleurs, je n’aime pas les voitures, moi, je ne veux pas me gêner pour les aristocrates.
– Qui vous a autorisé à m’appeler ainsi ? s’écrie M. Derbrouck.
Le portier allait répondre, lorsque la veuve Bertholin se place entre lui et le Hollandais, et dit à Goulard :
– En vérité, citoyen Léo… Léonidas, je ne comprends rien à ta conduite… Comment, tu sembles vouloir provoquer le citoyen Derbrouck !… Mais tu oublies donc que ce brave homme a été aussi ton bienfaiteur à toi et aux tiens ?… Quand tu étais malade, il y a trois mois, qui t’envoyait des bouillons, de la viande !… c’était cette bonne dame… Puis, quand tu te plaignais de n’avoir pas de vêtements assez chauds à mettre, qui te donna de l’argent pour en acheter… et pour avoir du bois, du vin ? C’est le citoyen Derbrouck… C’est toujours lui qui est venu à ton aide.
– Eh bien ! que ça prouve ?… S’il m’en a donné, c’est qu’il en a de trop, v’là tout !… Et s’il en a de trop, faut lui en ôter.
Le portier a dit ces mots entre ces dents, tandis que la mère de Maxime lève les yeux au ciel, en murmurant :
– Faites donc du bien pour être récompensés ainsi !
– Il n’est pas question de ce que j’ai fait ! reprend le banquier, et je ne demande aucun remerciement ; obliger ceux qui ont besoin est un devoir dont on ne doit pas tirer vanité. Mais aujourd’hui, lorsque je te fais remarquer que c’est toi qui avais tort de ne pas être là pour ouvrir ta porte, il me semble, Goulard, que tu dois répondre honnêtement.
– Et moi, je n’entends pas qu’on me donne des leçons, ni qu’on rabaisse ma qualité sociale et mes droits d’homme égal devant un chacun ! Entends-tu, toi-même, citoyen Derbrouck, et ne parle pas si haut, et ne fais pas tant d’embarras, parce qu’on pourrait rabattre ton caquet… et fièrement !
– Qu’est-ce à dire, misérable ? tu oses me menacer, je crois ?…
– Suffit… suffit !… on sait ce qu’on sait… on connaît les intelligences des aristocrates avec les étrangers. On ouvrira les yeux à la nation sur les individus qui ont voiture…
– Ah ! c’en est trop ; il faut que je châtie ce drôle !
En disant ces mots, le banquier a levé le bras sur le portier ; mais aussitôt madame Derbrouck jette un cri, et se précipite pour retenir son époux, la mère Bertholin en fait autant, Euphrasie elle-même oublie sa terreur, et de ses bras court enlacer et retenir le beau Hollandais. Pendant ce temps, Goulard, reculant une jambe en arrière, écartant ses deux bras et ouvrant ses mains, se met dans la position d’un homme qui va tirer la savate.
Mais quelqu’un qui se précipite alors dans la chambre donne une autre tournure à cette scène.
Le nouveau venu est un jeune homme grand, svelte, élancé ; il a un mauvais pantalon avec une veste de chasse assez élégante, et porte sur la tête une espèce de bonnet fait en papier, qui est posé assez coquettement sur l’oreille ; ses traits sont fins et spirituels, ses grands yeux bleus ont une expression hardie, quelquefois railleuse mais toujours gaie, et son front large et haut annonce une tête capable de concevoir et d’exécuter de grandes pensées.
En apercevant le mouvement de Goulard qui semble vouloir défier M. Derbrouck, Prosper Bressange, car c’est lui qui vient d’entrer, se place devant le portier, et lui empoignant avec vigueur les deux bras, lui fait faire plusieurs pirouettes dans la chambre, en disant :
– Qu’est-ce que c’est ?… Léonidas veut faire de la gymnastique : il veut qu’on admire sa belle taille…, ses formes de chien basset. Eh bien, voyons… : tournons, dansons, dessinons-nous devant la société…, montrons comme nous sommes gentils !
Et le jeune homme continue de faire tourner le portier, qui se débat et cherche à se dégager, en s’écriant avec colère :
– Veux-tu me lâcher… petit garnement ! il n’est pas question de danser ni de plaisanter…, z’entends-tu ? et un morveux ne doit pas venir se mêler dans les affaires qui regardent le salut de la république !
– Un morveux ! répond Prosper, en continuant de serrer les poignets au portier, de manière à l’empêcher de remuer. Oh ! tu dois sentir en ce moment que ce morveux-là serait ton maître, et qu’il te peloterait d’importance, si tu t’avisais devant lui de te permettre la moindre impertinence avec des personnes que tu dois honorer, respecter et bénir !… Me traiter d’enfant ! mais tu oublies, Léonidas, qu’il n’y a plus d’enfants dans ce temps-ci… ; et puis, si tu avais été au théâtre de la Nation, tu aurais retenu ces vers :
C’est Voltaire qui a dit ça et il n’était pas manchot, Voltaire… Ah ! cré coquin ! mon pauvre Léonidas, s’il t’avait vu tout à l’heure dans ta belle position, je suis sûr qu’il t’aurait engagé à te faire acteur… tu aurais été superbe avec un casque et une tunique ; n’est-il pas vrai, citoyen Derbrouck ?
Pendant cette conversation entre le portier et le jeune homme, le banquier avait eu le temps de se calmer et d’entendre les prières de son épouse ; reprenant l’air affable qui lui était naturel, il frappe sur l’épaule de Prosper, en lui disant :
– Bonsoir, Prosper ; bonsoir, mon garçon ; tu as bien fait d’arriver…, tu m’as rendu à moi-même…, et je sens maintenant combien j’étais déraisonnable de m’être laissé emporter. Mais il est temps de monter chez nous, ma chère amie, tu dois être fatiguée… Je te salue, citoyenne, bonsoir.
M. Derbrouck a pris le bras de sa femme, en faisant un salut amical à la dame Bertholin. L’épouse du Hollandais, enchantée de voir se terminer ainsi une scène dont elle avait redouté les suites, se hâte de sortir avec son mari ; mais, en s’éloignant, elle serre la main de la bonne veuve, et jette un regard de reconnaissance à Prosper, en lui disant à demi-voix :
– Merci…, mon ami…, merci !
Euphrasie fait une gracieuse révérence au bel Hollandais, en le suivant des yeux jusqu’à la porte, tandis que le portier fronce les sourcils et détourne la tête, en murmurant :
– Va ! aristocrate, tu me le payeras.
– Et maintenant, dit Prosper, en allant s’asseoir devant le feu, lorsque la famille hollandaise est partie, maintenant, mon petit Goulard, dis-moi donc ce que tu avais tout à l’heure contre ce bon citoyen Derbrouck… Est-ce qu’il t’avait entendu pérorer à la section, et te faisait compliment des idées nouvelles que tu avais émises ?… Ah ! ah ! maman Bertholin, et vous, jolie citoyenne ! quel dommage que vous ne vous soyez pas trouvées là quand Léonidas a parlé…, vous auriez entendu de belles choses !…
– Vous venez donc du comité ? dit Euphrasie en s’asseyant près de Prosper.
– Oui, j’en viens… ; j’aime assez aller flâner par là : on entend quelquefois de drôles de motions…, comme aujourd’hui, par exemple…
– Il aime mieux cela que de travailler, dit la maman Bertholin, d’un air mécontent.
– Il faut bien se tenir au courant des orateurs de son quartier. Figurez-vous, citoyenne, que Léonidas Goulard… ou Goulard Léonidas, qui se promène là devant vous en faisant des yeux de chat-tigre, a d’abord proposé de faire transférer le port du Havre au Gros-Caillou, afin que l’on eût des huîtres plus facilement à Paris. Ensuite, voulant probablement rendre sa position plus lucrative, il a proposé de forcer tous les locataires d’une maison de donner le quart de leur revenu à leur portier, et la moitié, dans le cas où la maison n’aurait que deux locataires ; vous voyez que ce gaillard-là ne s’oublie pas, et que, dans son amour pour la patrie et son zèle pour l’égalité, il veut d’abord faire les portiers plus riches que tout le monde. Enfin et pour dernière motion, il a prétendu que le changement de femme n’étant pas rendu encore assez facile par le divorce, il fallait faire une loi qui permît aux hommes de se marier pour un mois, quinze jours ou huit jours, à volonté !… J’ai le regret de vous annoncer que les trois propositions du citoyen Léonidas ont eu peu de succès.
– Se marier pour huit jours ! dit Euphrasie en souriant, ce serait un peu turc… mais ce ne serait peut-être pas trop désagréable !
– Moi, dit Prosper, il me semble qu’il vaut autant ne pas se marier du tout.
– Tu te moques de mes motions ! dit Goulard, en continuant de se promener au fond de la chambre ; mais je te dis encore une fois que tu n’entends rien aux choses de la politique… Vois-tu, on ne nous mènera plus comme des bêtes d’assomme, à présent, nous autres… À l’heure d’aujourd’hui, tout le monde est instruit !
– Écris-moi donc ce que tu viens de me dire là…
– Gnia pas besoin de savoir écrire pour avoir des idées !…
– C’est juste ; mais il faut en avoir de bonnes, ou ne pas se mêler de choses auxquelles on ne comprend rien… Toi et tes pareils, vous nuisez plus à la république que vous ne la servez… ; en parlant en public à tort et à travers, en faisant des propositions absurdes, vous nous déconsidérez près de l’étranger !…
– Voyez-donc ce blanc-bec qui vient faire son savant !
– Prends-garde, Goulard, le blanc-bec t’a fait voir qu’il avait la poigne forte !
– Quant à ce Hollandais…, qu’il prenne garde… ; c’est un aristocrate. D’ailleurs, il était l’ami de Dumouriez, ami intime même !… puisqu’il a voyagé avec le général en Belgique…, qu’il s’est trouvé à la prise de Gertrudenberg ; Dumouriez avait élevé ce Hollandais au rang de colonel de dragons dans son armée… À propos de quoi faire colonel un banquier ?…
– Parce que probablement le banquier prêtait de l’argent au général, dit la mère de Maxime. D’ailleurs, qu’est-ce que tout cela prouve ? Dumouriez a, dit-on, passé du côté des ennemis. D’abord, ça n’est pas prouvé ça ; d’autres disent qu’il s’est tout bonnement retiré en Angleterre, parce qu’il n’approuvait plus la tournure que prenait la révolution, et ne voulait pas servir le parti de la Montagne. Au reste, le citoyen Derbrouck ne l’a pas suivi ; au contraire, il est revenu à Paris… S’il s’était senti coupable, serait-il rentré en France, dans un temps où la faute la plus légère suffit pour être puni de mort ?
– Ta, ta, ta !… on sait ce qu’on sait, reprend Goulard, en secouant la tête. Et les soupers que le banquier donne dans sa maison, à Passy, la république sait que ce sont des réunions de factieux…, des soupers liberticides !
– Liberticide ! s’écrie Prosper ; oh ! fichtre, Léonidas, voilà un mot que tu dois être bien content d’avoir retenu ! Je suis sûr que tu le placeras souvent dans tes discours !…
– Mais il faut être aussi méchant que tu l’es, Goulard, reprend la veuve, pour oser suspecter des réunions dans lesquelles se trouvent les plus chauds patriotes, les plus zélés républicains…
– Oh ! c’est qu’il y en a qui font semblant… ; mais on ne s’en laisse pas t’imposer.
– Bravo ! Léonidas : tu parles comme à la tribune ! s’écrie Prosper en riant.
– Mon Dieu ! dit tout bas Euphrasie, est-ce que ce vilain portier ne s’en ira pas !… Depuis qu’il est entré, je n’ai pas pu placer quatre mots ! il est insupportable…, et si laid…, si sale… Il devrait bien fermer sa chemise au moins, nous n’avons pas besoin de savoir qu’il est velu comme un ours !
– Ce n’est pas moi qui le retiendrai, répond Prosper ; et si vous voulez même, je vais le mettre à la porte…
– Oh ! non, non ! murmure la vieille dame ; il est si méchant !… il faut prendre garde…
Goulard continuait de se promener en long et en large, regardant de côté et tâchant d’entendre quand on parlait bas. Au bout d’un moment, comme chacun gardait le silence, il reprend :
– Il y a encore dans le quartier une jeune aristocrate sur laquelle que j’ai l’œil ouvert… Son père a émigré, donc la fille devrait être incarcérée ; si elle ne l’est pas encore, c’est qu’on l’a oubliée… j’y ferai penser.
– Et de qui donc parles-tu ? s’écrie Prosper, qui, depuis quelques instants, est devenu sérieux et attentif, en écoutant le portier.
– De qui que je parle ?… parbleu !… de la fille du comte de Trévilliers…, de la petite Camille.
– De cette jeune fille qui n’a pas encore seize ans… et qui est si jolie…, si bien faite…, qui a de si beaux yeux noirs…, avec de longs cils et des sourcils formant l’arc…, et des dents si blanches…, et une bouche si gracieuse ?…
– Peste ! mon gaillard ! il paraît que tu l’as bien regardée la jeune Camille ! mais tout cela n’empêche pas que ce ne soit la fille d’un émigré, et par conséquent une petite aristocrate que l’on doit arrêter…
– Tu veux faire arrêter la fille du comte de Trévilliers !… s’écrie Prosper en se levant, mais, avant cela, je t’aurai brisé…, mis en morceaux !…
Et sautant aussitôt sur le portier, le jeune homme le saisit à la gorge, le renverse, et a déjà posé un genou sur sa poitrine avant que celui-ci ait eu le temps de se reconnaître. Cependant les deux femmes suppliaient Prosper de lâcher Goulard, qui commençait à jeter de grands cris, lorsque plusieurs coups sont frappes à la porte : des voix bien connues se font entendre. Lejeune homme se décide alors à quitter le portier, qui, se relevant précipitamment, se sauve en se jetant le nez contre les personnes qui viennent d’entrer.
C’était d’abord un homme de vingt-quatre ans au plus, mais qui semblait par sa mise, sa coiffure et ses manières, vouloir se donner l’air posé d’un homme mûr. Sa figure presque toujours riante, sa bouche entrouverte, son nez au vent, annonçaient plus de bonhomie et de curiosité que d’esprit et de moyens. Sa tenue rigoureusement républicaine, mais propre et soignée, dénotait un homme à son aise qui prenait par goût le costume populaire ; enfin son geste habituel, en parlant, était un mouvement de tête qui avait la prétention de vouloir dire bien des choses ; ensuite il se frottait les deux mains, comme quelqu’un qui est content de lui.
Ce personnage s’appelait Poupardot ; fils de marchands riches, il avait trouvé sa fortune suffisante, et, ne jugeant pas nécessaire de chercher à l’augmenter, s’était marié fort jeune, pour jouir tranquillement de son revenu, sans avoir d’autre tracas que de soigner ses terres et ses maisons.
Car Poupardot possédait, outre ses rentes, une maison à Paris, une ferme aux environs de Montereau, une maison de campagne à Clichy, et une maisonnette à la barrière d’Enfer.
Madame Poupardot était une petite femme gentille, douce, bonne ménagère, qui avait beaucoup plus d’esprit que son mari, dont, à cause de cela, elle faisait presque toujours les volontés ; car les gens d’esprit aiment mieux céder que se disputer. Cependant elle envisageait rarement les évènements comme son mari ; mais elle ne voulait pas tourmenter Poupardot, qui était doué d’un caractère heureux, voyait tout en beau, approuvait tout ce qu’on faisait, et ne prévoyait jamais le mal.
Avec les deux époux était arrivée une troisième personne : c’était un jeune homme d’une figure douce ; ses traits sans être réguliers, avaient une expression agréable, et ses yeux, quoique bruns devenaient fort tendres quand il les fixait sur une jeune et jolie femme. C’était Roger, celui que la réquisition venait d’atteindre ; et qui, à en croire la sémillante Euphrasie, avait eu un vif chagrin lorsqu’elle avait épousé Anacharsis Picotin.
Maxime, Roger et Poupardot avaient été camarades de pension, et jusqu’alors leur amitié ne s’était pas refroidie, quoiqu’ils fussent chacun dans une position différente, et que leurs opinions en politique différassent aussi. Il est vrai que jamais ils ne s’étaient rien demandé l’un à l’autre, et vous savez que le meilleur moyen de conserver ses amis est de ne rien leur devoir et de ne jamais leur prêter.
– Qu’est-ce qu’il a donc celui-là ? dit Poupardot, contre lequel Goulard s’était jeté en sortant. Il est diablement pressé… ; il a manqué de me casser une dent… C’est égal, cela ne m’empêchera pas de souhaiter le bonsoir à la compagnie… Comment va cette santé, citoyenne Bertholin ?
– Très bien, citoyen Poupardot ; je te remercie.
– Moi, je me porte comme un charme…, à part un gros rhume qui me contrarie pour respirer… Et voilà ma femme qui devient grasse comme une caille… C’est gentil la graisse…, à part que ça gêne pour marcher !
– Dieu merci ! je n’en suis pas encore là, répond la jeune femme, en allant embrasser la maman Bertholin.
– C’est bien aimable à vous d’être venus me voir, dit la mère de Maxime.
– Oui, reprend Poupardot, c’était depuis longtemps notre intention… à part que je n’y songeais pas du tout ce soir… Je comptais même mener ma femme au spectacle… au théâtre Feydeau, voir l’Enlèvement des Sabines, du citoyen Picard… On dit que c’est bien… ; il a de l’esprit, le citoyen Picard !… c’est un auteur qui se poussera… Mais, comme nous étions en route pour le spectacle, nous avons rencontré Roger. Il nous a dit : Je vais chez Maxime lui faire mes adieux, ainsi qu’à sa respectable mère. Alors, ma femme m’a dit : Au lieu d’aller à Feydeau, nous devrions accompagner Roger chez ton ami. Moi, je suis toujours de l’avis de ma femme…, parce qu’elle ne me contrarie jamais…, et nous sommes venus avec Roger… Où donc est Maxime ?
– À son imprimerie ; mais il ne va pas tarder à rentrer, car il sait par la citoyenne Picotin que Roger devait venir, et il m’a chargée de lui dire de l’attendre.
En entendant nommer Euphrasie qu’il ne connaissait pas, Poupardot lui fait un profond salut, et son épouse l’examine avec cette curiosité minutieuse que les femmes apportent à se regarder entre elles, et qui leur fait d’un premier coup d’œil apercevoir la partie faible de la figure, de la toilette et de la tournure.
Quant à Euphrasie, depuis que Roger est arrivé, elle lui lance de fréquentes œillades, que de mauvaises langues pourraient interpréter d’une façon peu rassurante pour le front d’Horatius-Coclès Picotin.
Prosper est allé s’asseoir dans un coin ; depuis sa dispute avec Goulard, il est devenu rêveur et semble ne plus porter attention à ce qu’on dit autour de lui.
– Eh bien, mon pauvre Roger, tu vas donc aller à l’armée ? dit madame Bertholin en regardant le jeune soldat avec intérêt.
– Oui, ma bonne mère, je vais aller combattre les ennemis de la France, et, ma foi, j’en suis bien content !
– C’est aimable, ce que tu dis-là, citoyen ! murmure Euphrasie, d’un air piqué. Il paraît que tu ne regrettes personne à Paris ?
– Si fait, citoyenne, j’y laisse des amis…, des personnes que j’aime ; mais d’un autre côté, je suis las de voir des exécutions, des échafauds. À l’armée, du moins, je n’aurai pas ces affreux spectacles à supporter : si l’on y reçoit la mort, c’est en se défendant, c’est en la donnant à l’ennemi ; il y a de la gloire à acquérir, et sacrebleu ! voilà ce qui convient à un Français.
– Oh ! je parierai que tu reviendras général, citoyen, répond Euphrasie, en attachant ses regards sur Roger.
– Je ne sais pas ce que je deviendrai ni si je reviendrai ; mais, à coup sûr, je me ferai tuer ou je ne resterai pas soldat… Eh bien Prosper n’es-tu pas de mon avis ?… À quoi rêves-tu donc là-bas, tout seul ? N’as-tu pas envie de servir aussi ?
Prosper lève les yeux sur Roger, passe la main sur son front, comme pour rappeler ses idées, puis répond :
– Oui…, j’irai à l’armée… ; mais pas encore… : on peut avoir besoin de moi ici…, et si je n’étais là…, qui veillerait sur… ?
– Sur qui ? demanda Roger en souriant : mais Prosper détourne la tête en murmurant : C’est mon affaire.
– Oh ! on devine bien, dit Euphrasie, et tout à l’heure tu t’es trahi en voulant rosser le portier.
– Citoyens, dit Poupardot, en tirant de sa poche une tabatière et offrant à priser à la compagnie, citoyens, je m’étonne de vous entendre murmurer contre la marche du gouvernement. Il me semble que cela va bien, à moi…, très bien, même… Je suis pour les idées nouvelles ! à part que je voudrais que tout cela pût s’accomplir sans qu’on tuât personne !
– Moi, je n’aime pas les révolutions, murmure sa femme, en hochant la tête.
– Oh ! toi, Élisa, tu es une trembleuse… ; la république ne veut que notre bien !
– C’est possible ! mais nous avions une si jolie maison rue des Petites-Écuries, reprend la femme de Poupardot en soupirant : ne se sont-ils pas avisés de venir la visiter, de gratter les murs, de les goûter, pour savoir s’ils contenaient du salpêtre ? et le résultat est qu’on va démolir notre maison.
– Oui, dit Poupardot parce que je la leur ai vendue, mais on me la paye trois fois sa valeur !…
– Ah ! c’est vrai, on te la paye… en assignats.
– Eh bien, qu’est-ce que cela fait ? Les assignats sont un peu tombés en discrédit, mais ils reprendront… ; oh ! ils remonteront, et ce sera pour moi une très bonne opération.
– J’aimais bien mieux notre maison !…
– Je suis de l’avis de la citoyenne, dit Euphrasie ; le numéraire me parait, à moi, plus solide que vos chiffons de papier…, et comme je suis la maîtresse au logis, j’ai empêché Picotin de fondre notre mobilier en assignats… Mais à propos de mon mari… que peut-il être devenu ? je commence à en être inquiète, quoique je sache que ce soit un gaillard incapable de se compromettre et de se mêler dans une dispute…
– J’entends chanter dans la cour, dit Roger, je reconnais la voix de Picotin.