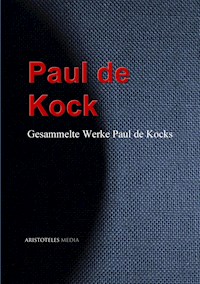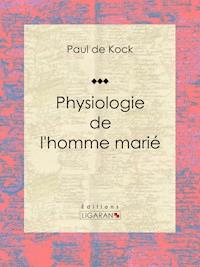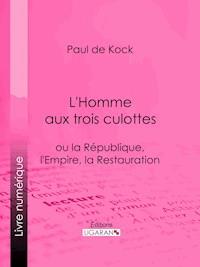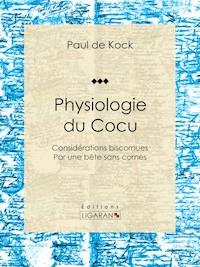Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "– Mesdames, serrez-vous un peu sur la gauche... Et vous, messieurs, appuyez sur les dames... Il y a encore une place... On doit tenir dix, et vous n'êtes que neuf... Il faut que le compte y soit. – Le compte ! Est-ce que l'on vient au spectacle pour être encaissés comme des sardines ?... Vous voyez bien que nous sommes déjà gênés ; où diable voulez-vous placer encore quelqu'un ? D'abord moi, je ne me dérange pas."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
– Mesdames, serrez-vous un peu sur la gauche… Et vous, messieurs, appuyez sur les dames… Il y a encore une place… On doit tenir dix, et vous n’êtes que neuf… Il faut que le compte y soit.
– Le compte ! Est-ce que l’on vient au spectacle pour être encaissé comme des sardines ?… Vous voyez bien que nous sommes déjà gênés ; où diable voulez-vous placer encore quelqu’un ? D’abord moi, je ne me dérange pas.
– Allons, l’ouvreuse, laissez-nous en repos. Il n’y a plus de place…
– Je vous dis, monsieur, qu’on doit tenir dix…
– Ne voyez-vous pas que ce monsieur et ces deux dames qui tiennent le coin peuvent compter pour quatre au moins ?
– Ça ne me regarda pas, monsieur…
– Madame, entrez ; donc… Il y a une place. Si ces messieurs ne veulent passe déranger, je ferai venir l’inspecteur… Passez donc, madame ; si vous ne la prenez pas, j’y mettrai une autre personne…
En disant ces mots, une vieille femme maigre, à la voix nasillarde, et que l’on a déjà reconnue pour une ouvreuse de loges, sans s’inquiéter des murmures que faisaient entendre les personnes placées sur la première banquette du balcon, poussait vers nous une jeune femme qui semblait hésiter pour prendre la place que l’ouvreuse lui indiquait.
Moi, j’étais assis sur le second banc ; aimant mieux être là que sur le devant, je n’avais pas demandé la place que l’ouvreuse offrait à la dernière personne arrivée ; mais je tournai la tête pour voir cette dame, car on va souvent au spectacle autant pour voir le monde qui est dans la salle que pour écouter la pièce ; je me retournai donc, et je vis une fort jolie figure, ce qui n’est pas rare à Paris, mais une figure qui me plaisait beaucoup, ce qui est bien différent, car tes goûts sont très variés, et tout en rendant justice à la beauté, on lui préfère quelquefois une physionomie dont les traits n’ont aucune régularité, mais dont l’expression a pour nous plus de charme.
Cette dame, ou cette demoiselle, car il me serait encore difficile de décider cette question, paraît âgée de vingt-quatre ans environ ; elle n’est ni grande ni petite, ni brune ni blonde ; quant à ses yeux… ma foi, je ne puis pas encore affirmer s’ils sont noirs ou bleus ; elle a un grand chapeau, et je n’ai pas pour habitude de regarder une dame de manière à voir sur-le-champ dans le blanc de ses yeux ; ce qu’il y a de certain cependant, c’est qu’elle est fort bien.
J’ai offert ma main pour que l’on puisse passer par-dessus la seconde banquette, la dame s’appuie légèrement sur moi ; je puis voir maintenant qu’elle a un petit pied, un bas de jambe parfaitement pris et, de plus, elle est chaussée avec beaucoup de soin : je tiens infiniment à ce que l’on soit chaussé proprement ; je n’augure pas bien de ces dames qui ont un beau châle et des bas sales.
Mais ce monsieur qui a déclaré à l’ouvreuse qu’il n’entendait pas être traite comme nue sardine, quoique à la maigreur de son corps et à la longueur tranchante de son profil on puisse croire qu’il a été longtemps pressé dans une bourriche, le monsieur, sans se retourner, a mis son chapeau entre ses jambes ; il paraît décidé à ne pas céder un pouce de terrain. Son voisin, jeune homme dont la figure est plus aimable, s’est retourné, comme moi, pour voir la personne qu’on veut placer à côté de lui ; probablement que, comme moi aussi il trouve cette dame à son goût, car il se range de côté, fait une petite place, et la jeune dame, longtemps indécise, arrive enfin sur le devant et s’assied, d’un air timide, entre ces deux messieurs.
Le personnage à figure de couperet continue de murmurer, de se plaindre, de maudire les premières représentations. L’égoïste !… Se plaindre parce que cette jeune dame est tout contre lui, parce que ses bras et peut-être ses pieds touchent les siens… Ah ! je voudrais bien être à sa place !… Mais je n’ai pas trente ans, et ce monsieur en a près de soixante. Il me semble cependant que même lorsque je serai vieux j’éprouverai encore la douce influence de la beauté… peut-être n’en sera-t-il rien… mais il faut toujours espérer.
Cette dame a murmuré quelques phrases :
– Messieurs… je suis bien fâchée… si je vous gêne trop, je ne resterai pas…
Le grand homme sec n’ose cependant pas la renvoyer, c’est bien heureux ! Le jeune homme se serre encore pour lui faire de la place, et lui jure qu’il est fort à son aise… J’étais sûr qu’il la trouverait aussi de son goût.
Il paraît que cette dame est seule, car je ne vois venir personne avec elle. Seule au spectacle et au balcon… hum ! Cependant ne préjugeons rien ; elle peut avoir un mari, un parent ou un ami au parterre ; on peut venir l’attendre à la porte.
La salle s’emplit. Nous sommes au théâtre de la Gaité. On va jouer la première représentation d’un mélodrame ; c’est une grande affaire pour tous les habitués, pour les amateurs du boulevard du Temple, et même des autres quartiers ; en effet, pourquoi ne viendrait-on pas aussi bien aux mélodrames des petits théâtres qu’à ceux des grands ; depuis quelque temps ne donne-t-on pas des mélodrames partout ? L’année mil huit cent vingt-neuf fera époque pour-cela… et nous sommes dans cette année-là.
Il reste encore deux places près de moi, mais la porte du balcon s’ouvre ; deux dames entrent, où plutôt se précipitent : celles-ci n’attendent pas que l’ouvreuse leur dise s’il y a encore de la place ; elles n’enjambent point, elles sautent, elles se jettent spontanément sur la banquette ; celle qui est près de moi manque de s’asseoir sur mes genoux, et avec son coude jette à terre mon chapeau ; elle ne fait pas attention à tout cela, elle ne semble nullement s’inquiéter de gêner ses voisins, pour elle la grande affaire est d’être placée ; en s’asseyant elle pousse un ouf capable d’éteindre un quinquet, puis s’écrie ;
– Nous v’là dedans enfin… Ah bien, ça n’est pas sans peine. Dis donc, Marie, comme on se bouscule à la porte… c’est une tuerie !… J’ai manqué d’avoir le sein pris dans une balustrade… c’est qu’il y avait des sournois qui poussaient… et puis en poussant, ils vous pincent. As-tu vu comme j’ai parlé à ce vilain rouget qui était derrière moi ? Il avait toujours sa main sur ma hanche ; il disait que c’était pour me protéger !… Je lui ai dit : Si vous ne voulez pas finir vos protections, je vous fais empoigner par le gendarme !… Recule-toi donc un peu, Marie… que nous soyons à notre aise…
Je prévois que nous aurons pendant les entractes, et peut-être pendant les actes, le plaisir d’entendre la conversation de ces deux dames, qui ne veulent pas être poussées, mais ne se gênent nullement pour pousser les autres. Ce sont pourtant deux femmes jeunes, dont les traits sont assez agréables, mais quelle différence avec cette dame qui est venue auparavant ! des joues bien rouges, des yeux bien brillants, des bouches bien fraîches, mais une expression commune, rien de spirituel, rien de délicat, dans tout cela.
J’avance un peu ta tête : je voudrais bien apercevoir de temps à autre la figure de cette jolie dame que je n’ai fait qu’entrevoir ; mais je suis placé précisément derrière elle, et elle a un de ces chapeaux, désespoir des habitués de spectacles. Je maudis le chapeau, non parce qu’il me cache une grande partie de la scène, mais parce qu’il m’empêche de voir cette figure dont l’expression m’a plu sur-le-champ. Je voudrais revoir si en l’examinant à loisir le charme sera toujours le même… Il y a tant de choses qui pour plaire ne demandent pas à être examinées longtemps !
On ne se retourne pas, on reste bien tranquille ; je crois m’apercevoir qu’on ne répond que par monosyllabes au jeune voisin de gauche qui cherche à entamer la conversation, et qui, piqué de ce qu’on ne lui montre pas plus de reconnaissante pour la place qu’il a bien voulu faire, finit par tourner le dos et lorgner ailleurs.
Je commence aussi à m’ennuyer de ne regarder que le derrière d’une capote pensée ; portons nos regards sur ce qui nous entoure : à côté du grand monsieur sec est une jeune femme coiffée d’un petit bonnet à la bergère, une figure lutine, de petits yeux noirs bien éveillés, un nez retroussé, toujours un demi-sourire sur les lèvres, un certain air moqueur en regardant les autres femmes. Cela m’a bien l’air d’une jeune ouvrière ; elle est avec une petite fille du quinze à seize ans, mise dans le même goût, qui n’est pas jolie, mais qui parle très haut et rit toujours avec sa compagne.
Après le jeune homme qui est à gauche, est un petit-maître de quarante ans au moins, une recherche affectée dans la mise, les boutons en opale, le lorgnon, des gants serin, des cheveux très noirs bien bouclés, – on voit que le coiffeur a passé par là, – des favoris bien taillés, et plus noirs encore que les cheveux, des sourcils de jais ; tout cela pourrait bien être peint ; je ne serais même pas surpris qu’il eût un faux toupet ; on les adapte si bien maintenant ! avec cela de belles couleurs, ce serait un fort joli garçon si son nez, extrêmement aquilin, n’était pas d’une petitesse ridicule : au total, un air aussi bête que suffisant.
Après ce mirliflore, un monsieur et une dame… de ces figures ordinaires, de bons bourgeois, qui aimeraient mieux ne point dîner que manquer la première représentation d’un mélodrame ; le chapeau de l’épouse a l’air d’un colimaçon ; il est probable qu’il aura reçu quelques bourrades à la queue, c’est ce qui l’aura déformé, et ou aime trop à se moquer des autres pour que personne ait eu la charité de dire à cette dame que sa capote fait la gouttière par le haut. Quant au mari, il ne voit pas cela ; il ne regarde jamais sa femme.
Dans la loge derrière moi, un monsieur avec une dame, dont la mise est trop recherchée pour venir à un théâtre des boulevards ; cela jure avec ces individus qui, à deux étages plus haut, sont sans vestes, et ont retroussé leurs chemises jusqu’au coude, allongeant leur tête couverte de la casquette de loutre, pour échanger avec des amis, placés aux autres extrémités de la salle, des plaisanteries qui sont plus que grivoises. Mais ces messieurs sont au paradis, et il paraît qu’on s’y permet tout.
Je connais déjà les deux femmes assises à côté de moi ; je sais que l’une s’appelle Marie, et que l’autre met à chaque instant son bras sur mon épaule et ses cuisses sur les miennes, c’est toujours très agréable. Derrière nous enfin sont deux hommes, l’un, qui est fort jeune, a la bouche béante, l’air étonné, les yeux aussi ouverts qu’il soit possible, et semble encore neuf aux plaisirs du spectacle et aux habitudes de Paris ; l’autre, à moitié chauve, a ramené avec peine sur le devant de sa tête le peu de cheveux qui en couvre encore le derrière ; il fait le gentil, sourit et fredonne sans cesse, regarde les dames en dessous, et fait en sorte d’avoir ses genoux tout contre le dos de ma grosse voisine.
– Dis donc, Marie, vois-tu nos hommes ?… ils doivent être au parterre… ils sont partis une heure avant nous, ils se seront bien placés…
– Je ne les vois pas plus que notre chat !…
– C’est drôle, ça… est-ce qu’ils se sont perdus dans la queue, ou ben qu’ils n’auront pas pu percer dans ce fouillis-là !…
– Oh ! je suis bien tranquille pour Gérard, il sait se faire faire place… Quand on est de sa force et nerveux comme lui, est-ce qu’on n’entre pus partout ?
– Mon mari est nerveux aussi, ce pauvre Bribri !… Mais comme il n’est pas grand, j’ai toujours peur qu’en ne l’étouffe… Ah ! attends, je crois que je les vois sous le lustre…
– Prenez dont garde, madame, vous vous couchez sur moi, dit le vieux monsieur de devant, sur lequel ma voisine se penchait pour mieux voir dans le parterre.
– Dame, il faut bien que je cherche mon homme… Oui, c’est lui, c’est Bribri… il a mis son bonnet de soie noire…
– Gérard est à côté de lui…
– Mais, madame, vous nous étouffez…
– Ah ! mon Dieu ! est-ce qu’en n’ose pas remuer ici ?…
La voisine se jette alors sur moi et met sa main sur mon épaule pour se pencher vers le parterre, tandis que le vieux monsieur se retourne et lance à ces dames des regards courrouces, auxquels elles ne font aucune attention, continuant de parler comme si elles étaient chez elles.
– Je voudrais bien que Gérard nous visse…
– Sont-ils bêtes de ne pas regarder de notre côté !… Attends, je vas lever la main. Hum ! hum !…
Fort heureusement pour moi que messieurs Gérard et Bribri aperçurent les signaux de leurs épouses, sans quoi ces dames ne cessaient point leurs évolutions ; mais aux sourires qu’on leur rendit, elles se calmèrent, se remirent à leur place, et je pus respirer et voir devant moi.
La capote pensée conserve toujours sa même tranquillité, ne se retournant pas, ne regardant ni à droite ni à gauche, ne causant point avec ses voisins. Pour une dame qui est venue seule, cette conduite est assez surprenante. Je suis précisément derrière elle, je pourrais appuyer mes genoux contre elle, et glisser ma main le long de sa robe, ainsi que le font tant de ces amateurs qui ne vont au spectacle que pour se procurer ce petit plaisir. Mais que le ciel me préserve de me conduire jamais ainsi ! N’est-ce pas une manière bien délicate de faire connaître à une dame qu’elle nous plaît, que de lui enfoncer nos genoux dans le dos, ou de lui pincer le bas des reins ! conduite que l’on ne pourrait se permettre qu’avec des filles publiques, et auxquelles, par conséquent, on semble assimiler les femmes à qui on fait de telles offenses. Quand donc les hommes sauront-il se respecter ?… Ah, mon Dieu ! je crois que je fais de la morale !… Non, je dis ce que je pense, et voilà tout.
Le public s’impatiente de ce qu’on ne commence pas ; et le public du boulevard du Temple exprime bruyamment son ennui. Au parterre, on bat la semelle ; aux galeries, on siffle ; au paradis, on crie : « La toile ! » avec accompagnement de jurons. Pendant tout ce tapage, je m’aperçois que le monsieur chauve, assis derrière ma grosse voisine, a tiré un petit peigne d’écaille de sa poche, et qu’il s’occupe à ramener sur son front une trentaine de cheveu, qui s’obstinent à vouloir retomber en arrière d’où ils se développent en Longues mèches, ce qui donne à la tête de ce monsieur la tournure de ces plumeaux que vendaient les Alsaciennes.
Mes deux voisines, qui ont juré de ne pas rester deux minutes tranquilles, se sont levées de nouveau, et regardant dans le parterre :
– Ah ! Marie, voilà ton époux qui fait la conversation avec ses voisins…
– Il n’est pas bête, Gérard ; il cause très longtemps quand il veut…
– Tiens, voilà Bribri qui jacasse aussi !… As-tu remarqué comme il fuit des yeux fixes en parlant ? C’est un genre pour se donner de l’expression. Ils rient, ces messieurs… Ah ! les espiègles !… Dieu ! que je voudrais savoir ce qui les fait rire… Hum !… hum !…
Et ma voisine se penche tout à fait sur moi, et avance son bras en faisant aller son mouchoir ; mais le mouchoir va sur la figure du petit-maître, qui repousse le bras de la dame en s’écriant :
– Faites donc attention, madame… vous m’éborgnez… Voilà une heure que vous gênez tout le monde… Vous n’êtes pas ici dans votre chambre.
– Tiens ! cette nouvelle ! Si j’étais dans ma chambre, je sais bien ce que je ferais… Est-ce qu’il n’est pas permis de parler à son époux ?…
– On ne se parle pas de la galerie au parterre…
– Est-ce qu’il y a une ordonnance de police qui le défend ?
– Si vous voulez parler à votre mari, descendez auprès de lui.
– J’ai payé comme vous, et peut-être mieux que vous… le parlerai quand cela me fera plaisir… Vous faites le méchant parce que vous parlez à des femmes, si Bribri était avec moi, vous fileriez doux comme un mérinos ! On connaît ça !
Le monsieur bouclé lève les épaules et se retourne d’un autre côté en murmurant :
– Comme ces théâtres-ci sont composés !… Je ne sais pas comment on peut y venir… S’il y avait eu de la place dans une loge, certainement je ne serais pas ici… Mais, tout est loué ! tout est retenu d’avance !…
– On dit beaucoup de bien dû la pièce nouvelle, répond le mari de la dame au colimaçon, auquel s’était adressé le mirliflore.
– Ah ! beaucoup de bien !… Parbleu ! ces mélodrames, c’est toujours la même chose… Un tyran, un niais et une orpheline persécutée. J’en ai vu soixante !… c’est toujours la même intrigue.
– Monsieur est donc un habitué de ces théâtres ?
– Un habitué ? non ; main j’y viens… parce qu’il faut bien faire quelque chose.
– La pièce qu’on va donner est en six tableaux. – Incessamment, ils les feront en trente-six… Ça sera comme une véritable lanterne magique. Parais ! disparais !
– Moi, j’aime beaucoup les pièces en tableaux, c’est amusant ; c’est un genre plus varié.
– C’est un genre qui ruinera plus d’un directeur… Mais, comme vous dites, c’est assez divertissant… On voit un salon, puis une forêt, puis une caverne… Des jours, des années se passent dans un même acte. À la vérité, ça vous embrouille un peu ; on ne sait pas trop où on en est, ni ce que cela signifie ; mais c’est à la manière de Shakespeare, de Schiller ; on n’a pas besoin de comprendre.
– Mesdemoiselles, vous me poussez sans cesse… c’est insupportable. Vous mettez vos pieds dans mes jambes ; bientôt je ne pourrai plus remuer le bras pour prendre ma tabatière. C’est le grand monsieur sec qui s’adresse aux deux grisettes qui sont à sa droite, et dont l’aînée lui répond en lui riant au nez : « Nous, monsieur, nous ne remuons pas !… » Puis les jeunes filles se retournent, recommencent à chuchoter en poussant des éclats de rire, regardent le jeune homme à l’air étonné et à la bouche ouverte, qui est place derrière elles, lui font des mines, lui tirent la langue, puis se montrent du doigt la capote en colimaçon.
On frappe les trois coups. Mes voisines se rasseyent ; la petite pièce commence. Les deux ouvrières qui ont probablement une passion parmi les acteurs du théâtre, et qui se sont placées au balcon afin de voir leur objet de plus près, avancent la tête et se penchent sur l’avant-scène en disant :
– Ah ! qu’il est beau là-dedans !… Comme ce costume-là lui sied bien !… Il a l’épingle que je lui ai donnée avant-hier… Ah ! il nous voit… il nous regarde… J’en suis folle, ma petite…
– Mesdemoiselles, vous m’empêchez de voir, dit le grand monsieur ; vous avez la moitié du corps en dehors de la balustrade !…
– Monsieur, nous ne verrions pas sans cela… Vous êtes bien heureux encore que nous n’ayons pas de chapeaux…
– Silence donc ! dit madame Gérard, est-ce qu’on parle comme ça quand la toile est levée !
– À la porte ! crie-t-on du parterre.
– Voulez-vous vous taire, filons ! dit une voix du paradis.
Le calme se rétablit, la petite pièce s’achève, et dès que le rideau est baissé, mes voisines se mettent de nouveau en mouvement, et font des signes à leurs maris.
Le mirliflore sort en laissant un gant à si place ; les deux grisettes sortent en marchant sur les banquettes ; le jeune homme placé près de la jolie dame sort aussi, j’espérais que mesdames Bribri et Gérard en feraient autant, mais elles restent pour mon malheur.
Comme cette dame placée sur le devant se trouve pour l’instant plus à son aise, elle regarde dans la salle, et je puis apercevoir ses traits. Je ne m’étais pas trompé, elle est charmante !… plus on la regarde, plus sa figure plaît… à moi, du moins. De beaux yeux, fendus en amande, et d’une expression si douce, quoique noirs… les cheveux châtains… un nez moyen, mais d’une forme gracieuse. Une bouche… ni grande ni petite… et des dents… impossible de les voir, elle tient sa bouche fermée, mais elle doit avoir de belles dents, je le gagerais ; d’ailleurs il faut toujours juger joli ce qu’on ne voit pas ; il n’en coûte pas plus et cela contente : pour le teint, je dois avouer qu’elle en a bien peu, elle est plutôt pâle, et son air est sérieux ; mais j’aime beaucoup les femmes pâles, et une bouche sérieuse devient si séduisante lorsqu’elle sourit !… tandis qu’une bouche qui rit toujours c’est constamment la même chose !
Je crois que cette dame s’est aperçue de mon attention à te regarder. Elle se tourne de manière que je ne puis plus la voir. Diable ! c’est bien contrariant…
Je n’ose lui parler… Elle n’a pas de ces airs qui permettent d’entamer la conversation… Après tout, à quoi bon causer avec cette dame ?… Quelle nécessité de chercher à faire sa connaissance ? Tenons-nous tranquille, cela vaudra beaucoup mieux. Ne me suis-je pas promis d’être sage ; de ne plus courir les bals, de ne plus fréquenter les grisettes, de dîner moins souvent chez le traiteur avec des amis qui aiment autant le champagne que moi, de ne plus monter à cheval, de ne plus jouer à l’écarté ?
Il est cependant cruel de penser qu’on ne reverra peut-être plus une personne qui nous plaît, que l’on se sent disposé à aimer, vers laquelle il semble qu’une secrète sympathie nous entraîne. Il est vrai que cette sympathie-là s’établit bien souvent entre une belle Femme et un joli garçon… ne l’ai-je pas cent fois ressentie !… Je ne prétends pas dire par là que je sois beau, mais je suis essentiellement sensible.
– Ah ! mille pardons monsieur !… C’est l’élégante placée dans la loge derrière moi qui avec sa main avait légèrement touché ma tête. Je lève les yeux et je m’incline. Elle est très bien aussi cette dame-là ; beaucoup de personnes la trouveront peut-être plus jolie que la dame pâle et sérieuse, cependant je n’éprouve pas pour elle les mêmes désirs que pour la capote pensée. C’est peut-être parce que celle-ci ne me regarde jamais, tandis que je puis voir l’autre tout à mon aise ; les hommes sont si bizarres ! ou plutôt la nature leur a donné un cœur si bizarre, car certainement ce n’est pas par notre volonté que nous sommes comme cela, et que nous aimons de préférence ce que nous ne pouvons pas avoir. Si nous nous étions faits nous-mêmes, nous n’aurions probablement pris tous ces petits désagréments-là.
– Ah !… Pif !… paf !… Via qu’on se bat au parterre… Ah ! mon Dieu, Marie, c’est sous le lustre… c’est auprès de nos hommes… pourvu qu’ils ne se fourrent pas là-dedans… Ne t’en mêle pas, Bribri… ne t’en mêle pas, entends-tu ? Tu vas perdre ton bonnet de soie noire !…
Ma voisine s’était couchée sur la balustrade et m’étouffait par le poids de son corps ; je la repoussai doucement en lui disant ;
– Calmez-vous, madame, vous voyez bien que M. Bribri est fort tranquille, et que la dispute ne le regarde pas.
– Ah ! monsieur, c’est que je connais mon mari, il ne faudrait qu’un mot pour qu’il s’exposât… il est petit, mais c’est égal, il est rageur comme un griffon !…
La dame à la capote pensée se retourne un peu ; elle souriait légèrement, je souriais aussi, nos regards se rencontrèrent, et il me sembla qu’il s’établissait dès lors une secrète intelligence entre nous ; du moins je me plu à le croire parce que j’en avais le désir.
Mais les personnes qui étaient sorties reviennent prendre leurs places. Les deux jeunes filles tiennent dans leurs mains des oranges et de la galette, elles se bourrent de gâteaux et épluchent leurs oranges du côté de leur voisin, qui est au supplice et ne cosse de répéter : – Mesdemoiselles, vous allez me tacher… prenez garde, l’orange emporte la couleur…
– Une demi-heure d’entracte, et ils ne commencent pas encore ! dit le petit-maître en lorgnant dans les loges. C’est indécent !… Nous faire attendre ainsi pour une pièce qui ne vaudra peut-être rien.
– Dis donc, Marie, ce beau petit camus à favoris cirés qui dit que la pièce qu’on va donner est indécente…
– Bah ! on a dit à Gérard que c’était superbe… Le premier ouvrier de notre voisin le lampiste a vu la répétition, il assure que c’est magnifique… Plus fort en crimes que les Bourreaux, les Voleurs, les Mandrins, et tout ce que l’on a déjà vu. Il dit que la fin est si terrible, qu’à la répétition les pompiers ont pleuré, et qu’il y a deux machinistes qu’il a fallu emporter.
– Combien on meurt-il dans la pièce, Marie ?
– Je crois qu’il n’y a que deux morts, mais il y en a quatre ou cinq qui sont blessés, et la princesse s’évanouit à la fin de chaque tableau ; et puis des décors locals, et tout cela écrit dans une prose superbe, du pur Racine, ma petite… C’est l’ouvrier lampiste qui l’a dit, et c’est un gaillard qui a vécu, il a aussi fait des études pour être garçon tailleur, et il a joué le Blondel de Joconde chez M. Doyen, dans la nouvelle petite salle, au troisième.
J’écoutais cette conversation, lorsque le monsieur au petit peigne se penchant, vers madame Bribri, à laquelle il faisait des yeux très tendres, dit en passant sa main droite sur ses cheveux pour les retenir à leur place :
– Il paraît, mesdames, que vous êtes au courant des mystères de coulisses… Eh ! eh !… vous êtes initiées dans les secrets interdits aux profanes.
Les deux commères qui probablement ne Comprenaient pas ce que voulait dire ce monsieur, se laissèrent aller sur la banquette sans répondre à l’amateur.
Enfin on a donné le signal ; l’ouverture est jouée au milieu du bruit, du tumulte, des réclamations de ceux qui ne retrouvent plus leurs places, et des portes de loges qu’on ferme.
Mais dès que le mélodrame commence, le bruit cesse ; si quelqu’un se mouche ou tousse un peu fort, une voix de tonnerre s’écrie :
– À la porte le poitrinaire !
Et une autre voix enrouée répond :
– Taisez-vous donc, gueulards
Malgré ces légères interruptions, la pièce va son train. Mes voisines sont tout yeux ; l’une d’elles pleure déjà, l’autre prononce de temps à autre des mots entrecoupés :
– Ah ! mon Dieu ! pauvre innocente… scélérat de brigand… tu auras ton compte tout à l’heure…
Le monsieur au petit peigne, qui veut à toute force lier conversation avec ces dames, répond aux derniers mots de madame Bribri :
– Oui… je le crois aussi… C’est fort intéressant… Diable ! ça s’embrouille.
Mais au beau milieu d’une scène, ma voisine se retourne brusquement, et repousse de côté les genoux de ce monsieur en s’écriant :
– Dites donc, cher ami, est-ce que vous avez des fourmis dans les jambes ?… Tâchez donc de ne pas tant frotter vos genoux sur mon châle ; je suis chatouilleuse, voyez-vous.
Le monsieur chauve devient rouge comme un homard ; il balbutie quelques mots, puis se lève, et se tient debout pendant toute la durée de l’acte, après lequel il sort et ne revient plus, étant probablement allé talonner ailleurs. Le premier acte s’achève au bruit de deux cents mains qui frappent les unes contre les autres.
– Les claqueurs sont toujours là, dit le petit maître en haussant les épaules et en m’adressant la parole. Ces théâtres-ci sont insupportables pour cela.
– Ces théâtres-ci, monsieur, n’en ont pas plus que les grands. Pourquoi voulez-vous que les auteurs des petits spectacles se privent d’au moyen de succès exploité par leurs confrères des grands théâtres ? Sans doute il est malheureux de penser que ce sont maintenant les claqueurs et non pas le vrai public qui assurent le succès des pièces… Aussi l’auteur qui a le moyen de payer le plus de mains d’œuvre est-il certain d’avoir les plus beaux succès !… Si vous voulez détruire un abus, faites que la reforme soit générale ; mais non, lorsqu’on crie au scandale, c’est toujours aux pauvres diables que l’on s’adresse, et on laisse en paix les grands seigneurs faire des sottises.
– Face au parterre !… face au parterre !… crient cinq ou six messieurs à casquette, en apostrophant un jeune homme des secondes galeries, qui s’est retourné pour s’appuyer sur la balustrade. Le jeune homme reste immobile, les cris deviennent plus forts. Les Salons du parterre s’irritent de ce qu’on ne défère pas sur-le-champ aux arrêts qu’ils dictent ; ils montent sur les banquettes, allongent les bras, et montrent le poing à l’individu dont ils ne voient que le dos. Il semble que ces messieurs veulent lapider le jeune homme des secondes galeries ; s’ils avaient des pierres, je crois que cela en viendrait là : ce ne sont plus des cris, ce sont des hurlements à faire crouler la salle ; enfin le jeune homme, qui est probablement enchanté de causer tout ce tapage, se retourne, et montre au public une figure ignoble qui rit bêtement en regardant le parterre : c’était bien la peine de faire tant de bruit pour voir cette face-là ! Je m’avance quelquefois pour tâcher d’apercevoir la jolie figure que me dérobe la grande capote pensée. J’ai beau tousser, me retourner cette dame ne fait pas attention à moi ; et tout à l’heure, quand elle a souri, je m’étais imaginé qu’on me voyait déjà favorablement !… Nous avons trop d’amour-propre ! qu’une femme nous regarde deux ou trois fois, et nous nous imaginons avoir fait sa conquête, lorsque souvent on ne veut que rire à nos dépens.
Les deux jeunes filles étaient encore sorties ; elles reviennent avec des marrons et des châtaignes, dont elles ne cessent point de se remplir la bouche ; il faut que ces demoiselles aient un bien bon estomac. Leur vieux voisin est au supplice, elles jettent tes épluchures de marrons de son côté, mais il n’ose plus rien dire, parce qu’il s’aperçoit qu’alors elles remuent et le poussent davantage.
Le second acte commence. Lorsque la scène est gaie, ma voisine se penche sur moi pour regarder dans le parterre en disant :
– Faut que je voie si ça fait rire Bribri lorsque la situation devient attendrissante, c’est encore le même manège de la part de ma voisine, qui tout en se mouchant veut voir si M. Bribri pleure.
L’acte finit.
– C’est magnifique ! disent mes voisines.
– C’est bien mauvais ! dit le petit maître.
– C’est bien amusant, disent les petites ouvrières en enjambant de nouveau les banquettes, probablement pour aller encore chercher des provisions.
Le jeune homme placé derrière nous est le seul qui nuit pas témoigné son opinion. J’ai dans l’idée qu’il croit que le mélodrame est la continuation de la petite pièce, comme ce provincial qui, après avoir assisté à une représentation composée d’Andromaque et des Plaideurs, disait à Racine ; – La douleur de la princesse m’avait d’abord attristé, mais le dénouement est bien joli, et les petits chiens m’ont fait beaucoup rire. Je cherche dans la salle si j’apercevrai quelque connaissance, lorsqu’une voix partie de la loge derrière moi, me dit :
– Comment se porte monsieur Deligny ?
C’est un jeune homme que j’ai vu quelquefois en société ; il est entré dans la loge pour causer avec le monsieur et la dame qu’elle renferme. Il m’a reconnu, et nous échangeons de ces phrases banales qu’on est convenu d’appeler conversation ; puis il me dit bonsoir, et quitte la loge pour retourner à sa place.
Je me rassieds, mais c’est avec surprise que mus yeux rencontrent alors ceux de la dame à la capote pensée. Elle a maintenant repris sa position ; mais lorsque je lorgne à droite ou à gauche dans la salle, je m’aperçois que la jolie figure se tourne bien doucement, et qu’on m’examine avec attention. Oui, c’est bien moi qu’elle regarde… Voilà qui me paraît singulier… C’est depuis qu’on m’a nommé que cette dame cherche à me voir. Si jetais un artiste célèbre, si l’on me citait parmi les poètes, les peintres ou les musiciens, je comprendrais cette curiosité ; mais je ne suis rien de tout cela. Dans le monde je ne pense pas que l’on s’occupe de moi !… J’ai fait, il est vrai, des folies ; j’ai mangé ; depuis quatre ans, presque toute la fortune que m’avait laissée ma mère ; j’ai eu beaucoup d’aventures galantes ; mais cela se voit tous les jours, et ne peut me faire distinguer des autres personnes de mon âge.
Cependant, puisque cette dame paraît maintenant faire attention à moi, pourquoi ne chercherais-je pas à lui parler ? Peut-être le désire-telle aussi ; et, en conscience, elle ne peut, pas commencer. Voyons… essayons… un moyen bien usé, mais qui est toujours commode. Je feins d’être poussé par ma voisine et pousse brusquement le bras de la jolie dame. Elle se retourne, alors je me confonds en excuses :
– Mille pardons, madame ; je suis désolé… mais on est si pressé… si gêné ici…
On me répond :
–Il n’y a pas de mal, monsieur, d’un ton bien bref, bien sec, et on me tourne vite le dos.
Décidément, on ne veut pas entrer en conversation ; mais alors, pourquoi m’examiner ainsi à la dérobée ? Je n’y comprends rien.
Les deux jeunes filles reviennent ; cette fois, elles tiennent du flan dans du papier. En reprenant sa place, la plus âgée en laisse tomber un échantillon sur le pantalon de son vieux voisin. Celui-ci n’y tient plus ; il se met en fureur.
– Mesdemoiselles, c’est trop fort !… Vous le faites exprès ; vous me tachez mon pantalon, avec toutes vos chatteries. Je vais aller chercher un inspecteur… un commissaire, pour qu’on vous fasse tenir tranquilles.
Les petites filles rient aux larmes ; l’aînée répond :
– Je ne crois pas que le commissaire ait le droit de nous empêcher de manger du flan.
– Vous ne devez pas en jeter sur ma culotte, au moins.
– Est-ce qu’on l’a fait exprès ?
– Oui, depuis le commencement du spectacle vous cherchez à me tacher. Ce sont des marrons, des oranges, des pommes…
– Ça n’est pas vrai, nous n’avons pas mangé de pommes.
– Est-ce qu’un théâtre est une cuisine ?
– Tiens, on voit bien que vous n’avez pas dîné à deux heures pour avoir de la place.
Les trois coups mettent fin à cette altercation.
– Dieu merci, cela va finir ! dit le vieux monsieur.
Le dernier acte commence, mais le dénouement trouve des improbateurs ; on siffle d’un côté, on applaudit de l’autre ; les acteurs vont toujours ; madame Bribri est presque constamment couchée sur moi, parce qu’elle craint que son mari ne soit rossé par l’un ou l’autre parti. Grâce au ciel, la pièce s’achève, il était temps, j’étouffais. On nomme l’auteur ; je reste encore ; je ne sais quel charme me relient près de la dame en capote. Je suis curieux de savoir si quelqu’un va venir la chercher. Non, elle se lève… Je présente ma main pour l’aider à gravir les banquettes, elle ne la prend pas, et légère comme une plume, elle est déjà sortie. Je la suis mais quelques personnes nous séparent… Cependant je ne la perds pas de vue… Ah ! maudites soient les robes qui se mettent sous mes pieds, je ne sais pas descendre aussi vite que je le voudrais ; la foule augmente, et à chaque instant un nombre plus considérable de personnes me séparent de cette dame. Nous sommes sous le péristyle, je l’aperçois encore… lorsqu’on me prend brusquement par le bras en me disant :
– Te voilà ! je me doutais bien que je te rencontrerais ici… ne va donc pas si vite, tu vas te faire étouffer dans cette cohue.
Celui qui me disait cela me retenait par le bras, et pendant ce temps la dame inconnue disparaissait à mes regards. Je me débarrasse de ma rencontre en lui disant :
– Attends-moi… je suis à toi…
Puis je me précipite dans la foule, je pousse, je coudoie tout le monde ; mais hélas ! j’arrive trop tard à la porte… Je ne vois plus celle que je suivais : je regarde à droite, à gauche ; je cours de divers côtés sur le boulevard… C’en est fait, j’ai perdu la dame à la capote pensée.
J’étais encore arrêté sur le boulevard devant le café du théâtre ; je regardais de tous côtés, indécis sur la route que je prendrais, lorsque j’entends rire à côté de moi ; c’est Dubois, le jeune homme qui m’avait déjà arrêté sous le péristyle du théâtre, et qui vient de passer son bras sous le mien, en me disant :
– Il paraît, mon ami, que la particulière te tient, au cœur, et qu’elle vaut la peine qu’on monte une garde sur le boulevard, car, Dieu merci, mon pauvre Deligny, voilà cinq minutes que je t’admire courant après tous les chapeaux que tu aperçois.
– Oui, certainement, elle est charmante, et je suis désolé de t’avoir perdue !… C’est toi qui en es cause, tu m’as retenu sous le péristyle…
– Il fallait donc me dire que tu poursuivais un objet… je t’aurais secondé, au contraire… entre amis, ça se fait tous les jours… Donne-moi son signalement, je vais aller m’informer à toutes tes marchandes de marrons si elles l’ont vue passer.
– Ah ! tu plaisantes toujours…
– Viens au café, c’est une affaire manquée, mais nous allons en entamer une autre… J’ai lorgné deux petites filles qui prennent des riz au lait… Jolies comme des amours, surtout vues de profit ; mais nous ne sommes pas forcés de nous mettre en face d’elles. Allons, viens…
– Non, je veux encore attendre…
– Tu vois bien que tout le monde est sorti…
Il n’y a plus à attendre que les ouvreuses de loges, et je ne présume pas que ce soit parmi elles que soit la passion. Viens donc.
Dubois a raison, il n’y a plus personne dans la salle, et quand je resterais cloue sur le boulevard, cela ne me ferait pas retrouver cette jolie dame ; n’y pensons plus, entrons au café.
Dubois, qui entre avec moi, est un jeune homme de mon âge : vingt-sept ans à peu près. Il n’est pas grand, mais il est bien fait, et tient sa tête fort en arrière pour mieux s’effacer. C’est un joli garçon, il a des cheveux bien noirs, de beaux yeux, noirs aussi ; des conteurs qui donnent encore plus de vivacité à sa physionomie, qui est très mobile ; d’assez vilaines dents, mais un sourire agréable ; c’est dommage que dans cette figure, très bien du reste, il y ait quelque chose de canaille ; un comique de mauvais ton, qui décèle sur-le-champ un mauvais sujet du second ordre. Les manières de Dubois sont ce qu’annonce sa figure, des prétentions, des façons de petit-maître, mais qui, affectées ou exagérées, ont constamment l’air de charges : enfin l’habitude de parler très haut, pour se faire remarquer par tous ceux qui l’entourent, et se regardant dans une glace toutes les fois qu’il en trouve l’occasion.
Dubois ne manque pas d’esprit ; il est gai, amusant, il vous force à rire, quoique ses plaisanteries ne soient pas toujours de bon goût ; mais il trouve moyen de tourner tout un comique ; cependant son désir de se faire remarquer, ses prétentions et l’habitude de vouloir parler plus haut que les autres, lui attirent souvent des disputes ; alors il fait beaucoup de bruit, il crie, il menace, il veut battre tout te monde, mais il ne bat jamais personne, et lorsque les querelles deviennent sérieuses, il trouve quelque prétexte pour s’éclipser et ne plus reparaître. Malgré ces défauts, qui tiennent à une éducation négligée et à l’habitude d’être trop souvent en mauvaise compagnie, Dubois est un fort bon enfant, obligeant, serviable, n’ayant rien à lui quand il s’agit de servir ses amis. Dans ce monde, où les égoïstes sont en si grande majorité, lorsqu’on rencontre un bon cœur, on doit lui pardonner bien des défauts. Combien de gens en ont qui ne sont rachetés par aucune qualité ! Dubois est un homme que l’on n’ose pas présenter en bonne compagnie, de crainte qu’il n’y fasse ou n’y dise quelque solide ; mais on le retrouve avec plaisir en petit comité, et il est l’âme des parties de campagne, mi des déjeuners de garçons. Après vous avoir vu trois fois, il vous tutoie, et il vous semble à vous-même que vous le connaissez depuis des années. Toujours gai, insouciant tant que sa personne ne court aucun péril, il vit aussi indépendant que puisse l’être un courtier marron mangeant en une soirée ce qu’il a gagné en un mois, négligeant les affaires pour les plaisirs ; puis, quand il n’a plus le sou, courant gaiement à pied dans les maisons de commerce, et faisant les quatre coins de Paris avec des échantillons de sucre et de café dans ses poches, après avoir été pendant huit jours en tilbury avec une grisette ou une danseuse des petits théâtres ; enfin aimant beaucoup les femmes, et enchanté d’avoir la réputation d’un roué et d’un homme à bonnes fortunes, il s’est promis de ne pas être un jour sans faire une conquête, aussi le voit-on presque continuellement chercher à faire ce qu’il appelle ses frais, c’est-à-dire à noues une nouvelle connaissance, ce qui l’expose souvent à très mal placer ses sentiments.
Il ne me sied guère de critiquer les autres, moi qui viens de me prendre de belle passion pour une femme que je ne connais pas, qui ai fait ce que j’ai pu pour la suivre… qui enfin n’ai pas dans le monde une grande réputation de sagesse !… Mais je vous prie de croire, cependant, que je n’assis pas aussi légèrement que Dubois, et qu’avant de former une liaison je veux savoir à qui j’ai affaire. Cette dame en capote pensée avait l’air très distingué, et quoiqu’elle fût seule au spectacle, ses manières, sa tenue, tout annonçait une personne comme il faut ; malgré cela, si j’avais pu faire sa connaissance, je ne m’en serais pas rapporté aux apparences, et j’aurais fait en sorte de savoir si je pouvais sans rougir lui donner le bras. Mais ne pensons plus à cette dame, il y a tout à parier que je ne la reverrai point, et je ne suis pas encore assez romantique pour soupirer longtemps pour une inconnue.
Il y a foule au café. Là se rendent, en sortant du spectacle, les habitués, les flâneurs, les employés du théâtre, qui viennent donner leur opinion sur la pièce nouvelle ; chacun prouve que si l’on avait suivi ses conseils, on aurait retranché cette scène qui a été sifflée et changé cette situation qui a produit un mauvais effet. À écouter tous ces gens-là, vous croiriez qu’il leur est impossible de se tromper ; ils ont tant l’habitude de la scène, ils connaissent si bien le goût du public !… Il n’est pas jusqu’aux vieux joueurs de dominos qui ne lèvent les épaules en s’écriant :
– Certainement, c’est mauvais, c’est détestable, je l’avais dit !… Et ces messieurs n’ont pas quitté leur partie pendant la représentation de l’ouvrage qu’ils censurent, et dont ils n’ont vu aucune répétition, Pauvres auteurs !… par qui êtes-vous jugés !… Tous ces gens qui coupent et taillent si bien votre pièce après l’évènement, n’auraient pas été capables de changer un mot, ni d’apercevoir un endroit faible avant la représentation. Boileau a bien raison :
En entrant dans le café, j’aperçois mes deux fillettes du balcon qui boivent de la bière et mandent des échaudés avec un jeune homme que j’ai vu jouer dans la petite pièce. Ces demoiselles sont à leur seconde douzaine d’échaudés !… Cela me fait vraiment trembler pour elles, je suis tenté de leur envoyer du thé.
Dubois m’entraîne vers le fond du café en criant à tue-tête ;
– Viens donc par ici…
– Je ne vois pas de place.
– Viens toujours… je m’en ferai faire.
Nous arrivons devant les deux demoiselles qui savourent des riz au lait. À côté d’elles sont deux hommes qui prennent des petits verres et jouent aux dominos : Dubois s’assied sans façon à leur table, en disant :
– Ces messieurs voudront bien permettre et nous faire une petite place.
Les joueurs de dominos regardent Dubois avec ; un air de mauvaise humeur, mais il n’y fait pas attention, passe s’asseoir entre ces messieurs et leurs voisines, et appelle le garçon en criant :
– Garçon ici… Servez-nous… Ces messieurs veulent bien se reculer un peu… Deligny, qu’est-ce que tu prends ?… Du punch, n’est-ce pas ?… Au rhum c’est ce qu’il y a de mieux… Un demi au rhum…
– Es-tu fou ?… Un quart, c’est bien assez pour nous deux.
– Non, non ; nous prendrons bien un demi… D’ailleurs, nous en offrirons un verre à ces dames… si elles veulent bien nous faire le plaisir de l’accepter… Garçon, un demi-bol saigné comme à l’ordinaire.
Les deux petites femmes se sont regardées à la proposition de Dubois ; l’une a souri, l’autre a baissé les yeux, sans répondre. Je lui pousse le genou en lui disant à l’oreille :
– Tu les connais donc, pour leur proposer sur-le-champ du punch ?
Dubois me répond très haut :
– Je n’ai pas l’avantage de connaître ces dames ; mais elles ont l’air trop aimables pour qu’on ne désire pas faire leur connaissance.
– Mon cher ami, lui dis-je en continuant de parler bas, quoiqu’il s’obstine à me répondre très haut, je t’avoue que je n’ai pas fort bonne opinion de ces demoiselles.
– Et moi j’en ai la meilleure… Aussi serais-je enchanté d’être leur chevalier, si toutefois on voulait bien accepter mon bras.
En disant cela, Dubois se mirait, passait sa langue sur ses lèvres, puis lançait des œillades à ses voisines.
– Mais elles ne sont pas jolies.
– Ah ! que, dis-tu là ! Des figures charmantes des nez à la Niobé, bouches de corail, dents d’albâtre et une pudeur virginale répondue sur tout cela.
Je ne trouvais pas une expression bien virginale sur les traits de ces demoiselles, qui souriaient entre elles en écoutant les propos de Dubois.
– Il y en a une qui louche, lui dis-je à l’oreille.
– C’est justement celle qui me plairait le plus… Cependant, je suis bon enfant ; fais ton choix : prends la brune ou la blonde, moi je m’accommoderai sur-le-champ de l’autre ; j’espère que c’est agir en ami…
– Je ne veux ni de l’une ni de l’autre…
– Bah ! quand tu auras bu un verre de punch tu t’attendriras… Est-ce que tu penses encore à la dame que tu poursuivais à la porte ?…
– Tais-toi donc Dubois !…
– Eh bien ! quel mal de courtiser ce sexe charmant… qui répand des fleurs sur le chemin de notre vie !… hein… Ah Dieu ! la jolie main ! si j’étais peintre, je voudrais la croquer sur-le-champ…
La jeune femme à qui ce compliment s’adressait ne put s’empêcher de rire ; je vis cependant son amie qui lui donnait des coups de pied par-dessous la table, probablement pour l’engager à conserver plus de décorum.
– Ah ! vivat ! voilà le punch… Garçon ; ici… posez ça là… Ces messieurs voudront bien recaler un peu leurs dominos.
– Mais, monsieur, je ne vois pas pourquoi nous nous gênerions, dit un des joueurs en faisant un mouvement d’impatiente. Il y a maintenant de la place à d’autres tables, que ne vous y mettez-vous ?
– Nous sommes trop bien ici pour changer de place… Il y a un aimant qui nous y attire… Garçon des macarons.
Les joueurs reprennent leur partie en murmurant contre Dubois, qui n’y fait pas attention, et dit à nos voisines, qui viennent de finir leur riz au lait :
– Si nous osions roue proposer un verre de punch…
– Non monsieur ; je vous remercie !…
– Il est bien doux, bien léger… véritable punch de dames…
– Nous n’en prenons jamais…
Dubois avait versé du punch dans deux verres qu’il pose devant les deux demoiselles.
– Garçon, deux verres blancs…
– Mais, monsieur, c’est inutile, nous ne boirons pas ce punch-là…
– Ah ! mesdames, seulement pour le goûter… Ça fait du bien, après le riz au lait…
– Mais, monsieur…
– Avec un macaron…
Et Dubois jetait un macaron dans chacun des verres. Je voyais l’une de ces demoiselles qui avait envie d’accepter, et l’autre qui lui donnait de nouveau des coups de pied par-dessous la table.
– Nous devrions depuis longtemps être parties, dit l’une de ces dames, celle qui ne louche pas ; et certainement nous ne serions pas entrées au café, si le cousin de mon amie ne Lui avait pas dit qu’il viendrait nous y chercher.
– C’est vrai, répond l’autre ; si nous avions pensé qu’il ne vinsse pas, nous ne serions pas ici ; car, de quoi a-t-on l’air, deux femmes seules dans un café ?
– On a l’air de prendre du riz au lait, mesdames, et pas autre chose ! Buvez donc un peu de punch.
– Dis donc, Charlotte, si Alexandre ne vient pas, il faudrait nous en aller ; car il doit être déjà tard.
– Non, mesdames, pas encore onze heures.
– Par exemple, si mon cousin me jouait un tour comme ça de nous laisser en plan !… je ne lui pardonnerais de ma vie.
– Ces petits scélérats de cousins sont quelquefois bien perfides !… mais s’il ne vient pas, mesdames, j’espère que vous nous permettrez de vous servir de cavaliers, mon ami et moi…
Je pousse à mon tour le pied de Dubois parce que je n’ai nulle envie d’aller reconduire ces demoiselles ; mais il ne m’écoule pas et poursuit ;
– Mon ami n’est pas moins galant que moi, mesdames ; et s’il vous paraît un peu sérieux dans ce moment-ci, c’est parce qu’il pense à une certaine dame dont il est devenu amoureux au spectacle, et qu’il a perdue devant le bureau des cannes.
Les deux petites filles se mettent à rire. J’aurais presque envie de me fâcher, mais avec Dubois il n’y a pas moyen ; je me contente de lui répondre :
– Mon cher ami, je ne t’ai pas dit que j’étais devenu amoureux… on peut attendre quelqu’un à la porte, et cela ne prouve pas que…
– Laissa donc !… je l’ai vu arpenter les boulevards ; figurez-vous, mesdames, qu’il avait l’air de jouer aux barres… C’est que mon ami est très sensible… presque autant que moi… Le petit cousin ne viendra pas, j’espère que nous aurons le plaisir de vous mettre chez-vous.
– Nous demeurons très loin, monsieur.
– Tant mieux ! le plaisir en sera plus long, et d’ailleurs les fiacres ne sont pas là pour les figures de Curtius… Ah ! mesdames, regardez donc cet homme qui vient d’entrer !… quelle tête !… ne dirait-on pas un singe habillé ?
Avec les femmes et surtout avec les grisettes, le meilleur moyen de lier vite connaissance, c’est de les faire rire ; ces dames aiment beaucoup qu’un les amuse. Dubois avait pour cela le tact, et surtout une grande habitude.
Ces demoiselles se retournèrent pour voir l’homme dont Dubois se moquait, elles rirent beaucoup de la plaisanterie qu’il avait faite ; dans ce moment-là, celle qui louchait, et qui depuis longtemps convoitait le verre de punch placé devant elle, oubliant la réserve qu’elle voulait conserver, avala fort lestement la liqueur et le macaron, et son amie, en retournant, la voyant poser sur la table son verre vide, se décida à suivre son exemple.
Alors Dubois se penche vers moi et me dit en clignant de l’œil :
– Elles ont bu, elles sont à nous.
– À nous ! à toi, à la bonne heure ; mais moi, je l’ai déjà dit que je ne donnais pas dans ce genre-là.
– Eh ! mon cher, il faut bien varier ! j’aime aussi les grandes dames, les prudes, les vertus farouches, mais de temps à autre, un petit bonnet à la folle, un tablier de soie noire, une grisette enfin, c’est gentil, ça réveille… Après tout, nous pouvons toujours les reconduire, ça n’engage à rien… Mesdames, vous ne buvez pas… Garçon, du punch… du même, mais qu’il soit meilleur…
– Prenez donc garde, monsieur, vous jetez nos dominos à terre, dit un de nos voisins que Dubois vient de coudoyer en versant à ces dames.
– Monsieur, ce n’est rien, répond Dubois en riant d’un air moqueur, vous n’aviez pas le double six
– Monsieur, je n’ai pas besoin que vous lisiez mon jeu…
– C’est pour vous consoler… Mesdames, encore un macaron… Ça se prend comme une pilule… Je sais cela, moi, j’ai avalé beaucoup de pilules dans ma vie… je veux dire par là que je me suis souvent laissé attraper ; c’est une métaphore.
Je me penche encore vers Dubois et je lui dis à l’oreille :
Ne poussons pas plus loin cette connaissance… il est tard, payons, et laissons ces dames attendre leur cousin…
– Ah ben ! par exemple, tu plaisantes, je suis amoureux de toutes les deux, moi.
– Est-ce que vraiment tu veux reconduire ces petites filles ? cela n’aurait pas le sens commun.
– Il faut absolument que je fasse mes frais…
Il me faut tous les jours une passion. Plutôt que de m’en aller seul, je reconduirais la marchande de sucre d’orge…
Les deux jeunes filles, qui depuis quelques moments se regardaient et paraissaient Indécises, font un mouvement pour se lever, Dubois les retient en s’écriant :
– Où donc allez-vous ?…
– Nous nous en allons, monsieur… il est tard… mon cousin n’aura pas pu venir…
– Il n’est pas tard, la pendule avance… D’ailleurs vous ne pouvez pas partir sans nous ; des femmes seules s’exposer le soir dans les rues de Paris… nous ne le souffrirons pas. Buvez dont un peu…
Les deux amies se rasseyent, je les examine ; elles n’ont cependant pas l’air effronté de ces demoiselles qui fréquentent les cafés… Il y a même quelque chose de bourgeois, d’honnête dans leur mise ; mais des jeunes filles honnêtes ne seraient pas seules là, à onze heures et demie du soir !
– À propos, Deligny, tu ne sais pas, j’ai dîné au Cadran-Bleu aujourd’hui.
Je fais des signes à Dubois, en te priant de ne point crier ainsi mon nom dans le café ; peine perdue ! il ne m’écoute pas, parce qu’en me parlant il se mire ou sourit à nos voisines.
– Nous avons fait un dîner dans le bon style. J’étais avec Saint-Germain… tu sais, ce gros père qui fait des affaires… Il a un cabinet qui vaut de l’or !… Toujours du monde chez lui… On attend son tour pour entrer… C’est comme chez un ministre… C’est agréable d’être homme d’affaires ; d’abord on n’a pas de charge à acheter… Mais ça ne m’aurait pas convenu parce que cela vous tient trop esclave… moi qui aime tant ma liberté… Vive le courtage pour être heureux !… et surtout le courtage en marchandises… Les verres d’eau et de sucre ne me coûtent rien… Je ne consomme que mes échantillons et, Dieu merci ! je n’en manque pas… Je marche sur le sucre et foule aux pieds la cassonade… Mes dames, encore un soupçon de punch.… Ce demi-bol-ci est meilleur que le premier… Oh ! vous avez beau regarder la pendule, il ne faut plus penser au cousin… Mais nous vous en tiendrons lieu… Nous serons vos ondes, vos tuteurs, vos maris… tout ce que vous voudrez… Je te disais donc, mon ami, que j’ai dîné au Cadran-Bleu avec Saint-Germain, Jolivet et Jenneville, cet aimable et infortuné jeune homme qui s’est séparé d’avec sa femme parce que probablement elle le faisait… Hum !… diable, il ne faut pas dire ce mot-là… ces dames se fâcheraient… C’est égal, Jenneville est un bon enfant… Il fait bien les choses, c’est lui qui payait le dîner… Mais tu le sais, car je crois qu’il t’avait engagé à être des nôtres. Il t’aime beaucoup, il était bien contrarié que tu n’aies pas pu venir ; pourquoi donc n’es-tu pas venu ? Mesdames, un petit biscuit de Reims… C’est très bon trempé dans le punch…
Les jeunes filles, fidèles au principe qu’il n’y a que le premier pas qui coûte, après avoir fait des façons pour accepter le verre de punch, se laissent aller maintenant à tout ce que Dubois leur propose. Celui-ci, en faisant l’aimable, en voulant se donner des grâces pour verser, a envoyé son coude dans le visage d’un des joueurs de dominos, qui, déjà fort ennuyé du voisinage et du bavardage de Dubois, se fâche tout à fait :
– Monsieur, aurez-vous bientôt fini vos gestes, et n’irez-vous pas bavarder et boire ailleurs ?
– Comment, monsieur… Je ne vous comprends pas…
– Et moi je vous engage à vous tenir tranquille, ou je me ferai bien comprendre.
– Qu’est-ce que c’est, est-ce que nous nous fâchons ?…
– Vous avez encore l’air de vous moquer, je crois…
– J’ai l’air qui me convient ; s’il ne vous plaît pas, vous n’avez qu’à parler.
– Eh bien ! non, monsieur, il ne me plaît pas… Voilà deux heures que je vous porte sur mes épaules !…
– Il fallait donc le dire plus tôt, je me serais mis sur vos genoux.
– Monsieur vient sans façon se mettre à notre table… il repousse nos dominos…
– Il fallait prévenir que vous vouliez le café pour vous seul, on vous l’aurait peut-être loué…
– Allons, messieurs, dis-je à mon tour, tout cela ne vaut pas la peine qu’on se querelle… Mon ami vous a poussé sans le vouloir, monsieur.
La querelle va se calmer, et probablement se terminer là, lorsque Dubois, qui croit que par son air décidé il a effrayé son adversaire, s’écrie :
– Ce monsieur qui prétend que mon air ne lui plaît pas !… c’est bien malheureux ! changez donc votre figure pour être à son goût !…
Le joueur de dominos se lève alors et, regardant Dubois de très près, lui dit d’une façon fort énergique ;
– Oui, monsieur, je vous trouve la mine d’un fanfaron, je vous répète que vous m’ennuyez ; et si vous ne vous taisez pas, je saurai vous réduire au silence.
Dubois s’aperçoit que son adversaire est un grand gaillard de cinq pieds six pouces, qui ne ferait nullement effrayé de ses rodomontades, il devient rouge jusqu’aux oreilles, mais il crie encore plus haut :
– Monsieur, on ne me fait pas peur à moi… J’ai fait mes preuves, je suis connu…
– Je serais curieux de vous connaître aussi…
– Quand vous voudras, monsieur ; tout le monde sait comment je tire le pistolet… Mais je vous préviens que je ne me bats jamais qu’à trois pas de distance, et que je tire le premier, parce que vous êtes l’agresseur.
J’essaie de mettre le holà, de faire taire Dubois, qui crie bien fort pour faire voir qu’il a du courage. Le maître du café vient aussi interposer son autorité ; il ne veut pas qu’on se dispute chez lui.
– Sortons, dit le joueur de dominos.
– Oui, sortons, répond Dubois ; et il court à la porte, par laquelle il disparaît aussitôt. Les deux messieurs payent leur consommation, puis suivent Dubois ; je cours après eux accompagné de quelques habitués du café pour tâcher d’arranger cette affaire.
Mais, arrivés sur le boulevard, nous cherchons en vain Dubois, impossible de le retrouver. Je l’appelle à plusieurs reprises.