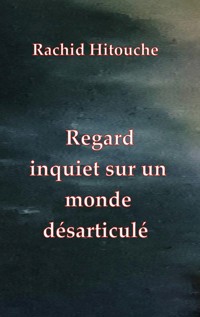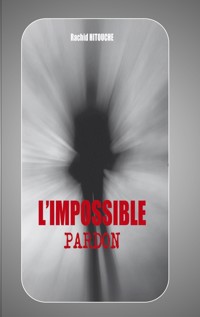
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La lumière des éclairs est le seul moyen de voir de façon instantanée le paysage spectral de cette bourgade engloutie dans un grand noir accentué par les ombres gigantesques des montagnes qui l'entourent. À la recherche d'un pardon, c'est dans ce cadre lugubre qu'un sinistre individu venant de nulle part, programmé pour tuer au nom d'Allah, jaillit devant un homme paisible pour se confesser. Roman inspiré de faits réels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement
L’histoire que vous avez sous les yeux est tirée de faits réels. Des faits qui ont endeuillé l’Algérie et continuent de l’endeuiller de nos jours. Racontée sous forme d’une fiction, nous avertissons d’emblée les lecteurs que toute ressemblance ne serait que pur fruit du hasard.
Qui d’entre nous peut ou pourrait effacer ou encore négliger la douleur d’un peuple entier engendrée par ces faits amers et regrettables, atroces et monstrueux ? Ils hanteront nos âmes éternelles, et nous serons comme tous ceux qui les ont commandités et commis, responsables de notre lâcheté et indignes de la liberté et de la démocratie à laquelle nous aspirons.
Pour que nul n’oublie, pour que les générations futures sachent, nous sommes tenus d’écrire.
Comme l’avait dit de son vivant le poète-écrivain et journaliste algérien Tahar Djaout : « Le silence, c’est la mort. Et toi, si tu dis tu meurs, si tu te tais tu meurs. Alors, dis et meurs. »
Nous sommes comptables de nos faits et gestes. Comme nous sommes aussi tenus par le devoir de vérité, nous ne devons rien cacher à l’avenir.
Tôt ou tard la vérité jaillira, alors, autant que faire se peut. Disons et mourons dignement.
Sommaire
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
« La lumière jaillit mais en vain, ne pouvant ni illuminer ni purifier les âmes sombres, maîtres de leurs culpabilités et de leur tentation vers le diable. Le jour reviendra, comme celui qui vient de mourir, il renaîtra au petit matin, effacera les séquelles et les drames de la nuit où le noir fut roi. Il repartira comme le précédent, incapable d’absoudre l’impossible. À répétition, il reviendra tant que le monde est monde, inutile pour ceux qui l’ont marqué par le crime et la haine. Pour ceux qui ont fait d’un jour lumineux un jour sombre et noir.
Impuissants devant leurs propres agissements, contre lesquels ils ne pourront plus rien, les auteurs des crimes crapuleux s’éterniseront dans le noir du jour, qui leur restera éternel sur les prunelles de leurs yeux.
Ils chercheront leurs guides, qu’ils trouveront parmi leurs propres victimes. Ceux-ci les aideront en leur répondant simplement :
« Nous sommes tous comme vous, nous ne voyons pas ce que vous cherchez à voir. »
Les limites du temps auront cerné leur vie, il leur restera un jour à vivre, aussi long que ce qu’a été toute l’étendue de leur vie antérieure. Le noir du jour. Le jour le plus long. »
Comme dit un proverbe populaire kabyle :
« Quand la mort les répugne, la terre, quant à elle, ne pourra les accueillir. »
I
On ne peut rien distinguer cette nuit-là. Un temps noir et ténébreux à couper le souffle au plus courageux. Les orages font rage. La pluie bat à torrent et ne laisse rien apparaître, à l’exception de quelques silhouettes d’arbres encore debout, épargnées par les incessantes et puissantes rafales de vent, visibles qu’au moment où les éclairs viennent déchirer l’étendue du sombre profond et illuminent les arbres arrachés ou déjà foudroyés auparavant par les fortes décharges de la foudre. Rien ne peut se voir à plus de quatre mètres.
La lumière des éclairs est le seul moyen de voir de façon instantanée le paysage spectral de cette bourgade engloutie dans un grand noir accentué par les ombres gigantesques des montagnes qui l’entourent.
Situé à la lisière d’un oued et au-dessous de deux grands massifs forestiers, Haoucha, un petit village peu habité, conserve également son lot de peur et de frissons, même en plein jour.
Au plus tard vingt heures du soir à Haoucha, village oublié par Dieu et ses saints, les habitants rentrent et se terrent chez eux pour ne ressortir qu’au lever du jour le lendemain. Exceptionnellement, quelques personnes ayant la nostalgie du noir obscur, des frissons et du risque s’aventurent dans ses alentours.
La décennie noire entame sa quatrième année en Algérie, depuis l’attaque meurtrière contre la caserne de Guemmar, petite ville située à l’est du pays, où des dizaines de jeunes appelés militaires, ont eu la tête tranchée par les hordes intégristes islamistes, auteurs de l’attaque au commencement de leur guerre contre tout ce qui représente les institutions étatiques algériennes, puis carrément contre le peuple dans sa globalité.
Une voix sort des bois, qui, sans discontinuer, répète les mêmes mots :
« Je veux mourir, je cours derrière ma mort, je la cherche, je m’en veux terriblement…, oui, je m’en veux…, j’en veux extrêmement à mon sort. Je veux mourir, moi le criminel, le monstre. »
La pluie verse toujours et fait entendre son intense bruit sur le feuillage des buissons. Quelques aboiements de chiens par-ci par-là se mêlent aux coups de tonnerre entrecoupant cette voix, mais sans la faire taire. La voix faiblit sensiblement. Le ton n’est plus le même, il continue à baisser jusqu’à devenir presque inaudible, mais la voix est toujours là, persistante.
Un homme, sous un préau adossé au mur d’une baraque, profitant de cet abri de fortune pour éviter d’être mouillé par les torrents d’eau qui tombent sans cesse du ciel, est là debout, seul, écoutant attentivement cette voix faible, alors que celle-ci, se rapproche de plus en plus de lui. Puis, brusquement d’un buisson, situé en amont et à quelques mètres de la baraque où il se trouve, surgit un homme. Un homme complètement méconnaissable, frisant un état de folie. La silhouette de l’homme debout sous le préau va aggraver le cas en déliquescence mentale avancée de cet inconnu, qui, tel un fauve, s’est éjecté du buisson pour se retrouver, presque nez à nez, avec cette silhouette bizarre à ses yeux.
Sans perdre son sang-froid et de façon très sage et courtoise, l’homme sous le préau s’adresse calmement à l’inconnu sorti du buisson. Certes, il fait très noir, mais l’état tremblant de l’inconnu renseigne largement sur ses capacités très peu normales. L’homme du préau ne voit rien de son visage, ni même de sa tenue. Il est juste sûr qu’il a devant lui une silhouette d’un homme très agité.
— Monsieur, lui dit-il, n’aie pas peur, je suis là… à l’abri de ce préau par crainte d’être trempé par la pluie, viens à côté de moi ! N’aie aucune crainte…, approche-toi ! Tu es déjà trop mouillé et tu risques de tomber malade.
L’inconnu, debout sous la pluie, comme sur un trampoline, ne cesse de faire de petits sauts sur place. Il se tient à quatre mètres de la baraque sans faire le moindre petit pas en avant pour se mettre à l’abri. Il est tétanisé. Il ne sait plus quoi faire ni dire, cependant, il continue sa petite danse, manifestement, pour remonter sa température corporelle trop basse. Dans le grand noir qui entoure les deux hommes, la pluie bat encore en augmentant un peu plus la cadence. Il est même difficile de se faire entendre. L’homme sous le préau essaye d’engager une discussion. L’homme du buisson paraît plus que réticent et ne veut rien savoir. Dans sa folie avancée, il ne veut toujours pas accorder de confiance à l’homme qui ne voulait pourtant que son bien. Il allait faire demi-tour et reprendre sa course, quand l’homme sous préau lui saute dessus et l’immobilise sur le sol boueux et glissant, tout en continuant à le rassurer. L’inconnu se débat comme un forcené, mais c’était compter sans la dextérité du villageois solitaire. Le froid et la faim avaient déjà fait leur travail, il ne lui reste pratiquement plus de force. Il se résigne enfin et se tient tranquille. Il est remis debout, complètement mouillé, grelottant de froid. L’homme du buisson frôle l’hypothermie. Ne pouvant plus tenir sur place, il entame une nouvelle fois une danse rythmée, probablement pour éviter de sombrer totalement.
Doucement et sous l’insistance de l’homme du préau, l’inconnu reprend petit à petit ses esprits et se voit invité aimablement par le villageois à l’accompagner chez lui. Le bienfaiteur veut vraiment aider l’inconnu. Il reconnaît l’état second dans lequel se trouve l’inconnu, mais aussi, conscient de la mort qui le guette à tout instant. Il faut donc faire de son mieux. Sauver une vie est un devoir et un geste indiscutablement humain.
Il n’y a pas beaucoup de maisons dans cette bourgade. Une vingtaine tout au plus, parsemées çà et là, comme de grands rochers immobiles et impassibles face aux rafales de vent et aux torrents d’eau qui leur tombent dessus. Il ne subsiste plus de lumière non plus. Tout est éteint, rajoutant un peu plus le cafard à ce sombre ténébreux, trop ennuyeux et angoissant. La peur accompagne la vie quotidienne des habitants de cette bourgade, vivant de jour comme de nuit sous la menace des escadrons islamistes criminels.
Dans ces villages isolés, la mort peut à tout moment et sans prévenir, s’inviter pour répandre le sang, la terreur et le malheur puis repartir sans être vue. Les tueurs islamistes sont tout bonnement maîtres de ces régions, plutôt volontairement oubliées par les pouvoirs publics et immergées dans la plus grande insécurité. Tout comme ceux qui les habitent encore par nécessité, n’ayant plus où aller. Pour ses occupants, leur survie est comme dans un jeu du quitte ou double. Dormir, conscient qu’on est vivant et se réveiller peut-être au nouveau jour ou, dormir pour ne plus jamais se réveiller.
Entre les deux hommes, aucune présentation n’est faite jusque-là. Sous la pluie et sans se parler, ils marchent traversant un champ accidenté où était tracé un sentier, peu visible, menant en direction de la maison parentale, qui se trouve à une centaine de mètres du lieu de leur rencontre peu ordinaire où uniquement le hasard peut nous y conduire à en faire de pareilles. Seuls les aboiements de chiens se font entendre au passage des deux hommes, rasant les murs des quelques maisons sur leur chemin. Les chiens, ces sympathiques animaux et fidèles amis de l’homme, demeurent le seul moyen d’alerte au cas où les tueurs arrivent. Malgré leurs alarmes, cette nuit-là, les lumières demeurent invisibles.
Après un long combat verbal qui a nécessité tant d’efforts, un aspect de quiétude s’installe finalement entre les deux hommes. Assurément, ni l’un ni l’autre ne doit penser à autre chose que le bien. Une rencontre fortuite n’est forcément pas synonyme de danger, songent les deux hommes. Bien des rencontres de ce genre aboutissent souvent à de très grandes amitiés. Et pourquoi pas la leur, doivent-ils se dire, chemin faisant. Il leur suffit juste de croire à leur destin qui vient de se croiser en pleine nuit où, pluie, vent et tonnerre se sont eux aussi donné rendez-vous, et de façon inhabituelle, pour s’imposer à leur manière sur cette petite bourgade, bien triste et trop oubliée.
Devant la porte d’entrée de la petite maison parentale, l’homme du préau glisse sa main dans la poche de son veston et prend une clé. Il introduit dans la serrure sans faire de bruit, avant de s’adresser presque en ami cette fois, à l’inconnu, lui demandant de ne pas en faire lui aussi, car à cette heure-ci, et comme à ses habitudes, sa mère dort sûrement, paisiblement.
L’inconnu, par un hochement de la tête, fait un signe affirmatif.
La maison, très ancienne, totalise deux chambres, une minuscule cuisine, des sanitaires sans douche, ainsi qu’une petite cour incluse. La lumière était déjà éteinte, la maman dort profondément, malgré la peur de partir dans son sommeil qui ne quitte jamais les âmes qui emplissent cette bourgade.
— Je préfère que nous allions directement dans la cuisine, avec un peu de chance nous trouverons sûrement quelque chose à manger, dit à voix basse le maître de la maison à son invité de la nuit. Et par la même occasion, poursuit-il, nous allons sécher nos habits totalement mouillés. Je commence vraiment à ressentir un léger froid, ajoute encore l’homme du préau.
— Comme tu veux Monsieur ! Lui rétorque doucement et pour la première fois, celui qui reste encore « un inconnu » « un simple homme des buissons ».
Sans bruit, ils regagnèrent directement la cuisine qui se trouve proche de la porte d’entrée. Celle-ci est construite légèrement décrochée des deux autres pièces qui, elles, servent de chambres à coucher pour le fils et la mère.
— Je crois qu’il est bien temps de faire connaissance et cesser de parler sans savoir à qui on le fait, dit le maître de la maison, une fois rentré à l’intérieur de la cuisine.
— Mon nom est Abdelkader, mais on m’appelle couramment Kader, enfin appelle-moi comme tu veux, se présente l’homme des buissons.
— Je suis ravi de connaître ton prénom, au moins comme ça la discussion aura plus de sens, commente le maître de la maison. Moi, je m’appelle Rachid et je ne possède aucun autre prénom, poursuit-il avec un léger sourire, histoire de détendre un peu plus l’atmosphère trop crispée jusque-là.
Dans la petite cuisine, dont la superficie n’ex-cède pas sept mètres carrés et à deux pieds du fourneau à gaz posé sur une plaque métallique à même le sol. Une petite table basse teintée acajou occupe elle aussi, ce qu’on peut appeler le centre de la pièce. Trois petits tabourets de même couleur ont été dispersés tout autour de la petite table basse. Sur deux des murs de la cuisine, étaient fixées également deux petites étagères où ont été posés ou carrément accrochés quelques ustensiles, représentant le trésor ménager de la petite famille.
L’inexistence d’ustensiles genre un peu chic renseigne longuement sur la vie très modeste de cette petite famille, formée de l’unique enfant et de sa mère. Mais leur hospitalité et leur amabilité couvrent largement ce superficiel signe de richesse, voire même d’arrogance pour ceux et celles qui ont l’âme et le cœur si beaux et sains, que ce que peut donner une argenterie en brillance.
Éduqué par sa mère, dans les traditions ancestrales les plus pudiques et respectables, Rachid déborde de gentillesse et de bonté. Sa façon de parler est de toute douceur. Empreintes de respect et de sagesse, ses paroles simples et saines ont la saveur d’un miel naturel. Le genre d’homme qui tourne sept fois sa langue avant de laisser s’échapper le moindre petit mot. Orphelin, il n’a pas eu la chance de connaître son père assassiné à l’indépendance, comme la majeure partie d’autres Algériens tués par l’OAS bien après la signature des accords d’Évian, mettant fin à la guerre de libération nationale. À trente-six ans, toujours célibataire, Rachid s’est forgé une personnalité respectable grâce à ses fréquentations peu nombreuses, mais utiles. L’homme préfère partager son temps libre avec les sages de son village, avoir les yeux penchés sur un livre ou se balader seul à travers les champs, plutôt que de le perdre à jouer aux dominos dans les cafés. « À défaut de ne pouvoir partager mon temps avec les sages de mon village desquels j’apprends de très belles choses, je préfère la lecture ou me balader seul. Supporter ma solitude, plutôt que d’être forcé de dire ou d’écouter ce que je ne souhaite, ne veux, ni ne peux », répond Rachid à ceux qui lui reprochent cette préférence.
— Prends place, ne te gêne surtout pas ! Fais comme chez-toi… Ah ! Je crois avoir trouvé du couscous, il n’y a qu’à le réchauffer. Ma très chère mère me garde souvent ma part, comme nous ne sommes que deux, elle connaît parfaitement ce qu’il nous suffit pour dîner. Jamais de surplus, juste ce qu’il faut, me dit-elle souvent. Elle est vieille, mais très économe. Je l’aime, ma mère ! commente enfin Rachid, en parlant toujours à voix basse à son nouvel ami de la nuit.
L’air presque absent, Kader suit du regard les mouvements de Rachid qui s’affaire à réchauffer le couscous, unique plat pour la nuit. Il le regarde poser la marmite en terre cuite sur le fourneau et laisser chauffer à feu doux le peu de soupe de légumes, qu’elle contenait dans son fond. Au bas du tabouret sur lequel Kader était assis, de ses vêtements complètement imprégnés, coule encore l’eau de pluie. Alors que Rachid, lui, traîne encore par ses pieds les gouttelettes qui lui descendaient du haut de ses habits, le long de ses allées et venues sur le sol de cette minuscule cuisine. Sans prêter attention, l’un comme l’autre, ils laissent cette eau perler comme bon lui semble, en attendant que leurs habits sèchent entièrement à hauteur de la nuit, qui s’enfonce et égratigne timidement de son temps qui s’en va peu à peu vers la rencontre d’un nouveau jour.
— Il n’y a pas grand-chose, mais le peu de couscous qui reste avec la soupe de légumes pourront faire l’affaire. L’essentiel c’est de mettre quelque chose sous la dent, cela va nous aider à nous réchauffer un peu plus, n’est-ce pas Kader ! s’exclame encore Rachid dans un ton toujours bas.
— Pour être honnête avec toi, mon ami, je n’ai même plus d’appétit ni le goût pour manger, je crois même les avoir perdus. Certes, je suis bien chez-toi, mais je ne me sens pas dans ma peau. Je me sens terrifié, bien des choses me passent par la tête, je n’arrive toujours pas à me concentrer. Je suis totalement déséquilibré… des sensations de vertige me gonflent la tête, j’ai l’impression de ne plus pouvoir me tenir debout, répond Kader à son bienveillant ami.
— Détends-toi ! Tu es trop stressé et fatigué. Mets-toi à l’aise…, tu n’as surtout pas à te tracasser. Arrange-toi face à la table et mangeons d’abord, on discutera après si tu le veux bien. La nuit est encore très longue, on aura tout le temps. Rapproche-toi donc de la table et mange s’il te plaît.
Sur la table basse, Rachid pose deux assiettes creuses dans lesquelles il sert deux parts égales, sans oublier la petite marmite contenant la soupe de légumes qu’il répand sur les grains de couscous. Calmement, les deux hommes se mettent, enfin, normalement à manger. Peu après, le regard de Rachid va instinctivement croiser celui de Kader, qui tient encore sa cuillère en demi-volée, entre son assiette et sa bouche. L’air complètement absent, sa main tremblait légèrement, mais à un rythme continu.
— Mange Kader, ne te soucie pas trop, laisse les choses suivre leur cours. Cela ne t’amènera à rien, si tu te fourres toi-même dans de mauvais états, lui lance Rachid, plutôt inquiet en le voyant figé comme une statue, sauf sa main continue à trembler.
Comme s’il venait d’être réveillé d’un profond sommeil, Kader sursaute et lui répond hâtivement.
— Hein… ! Excuse-moi Rachid, j’étais ailleurs qu’ici. Pardonne-moi, je t’en prie.
— Ne te fais pas de mal, mange plutôt, c’est mieux pour toi. Au moins, tu vas récupérer un peu de force… même si le plat de couscous est petit, c’est toujours ça de mieux. Mange, je te prie, lui ajoute Rachid avec un léger sourire.
— Tu es trop généreux, je ne sais pas si un jour j’aurai l’occasion de t’accueillir chez moi, comme tu viens de le faire si gentiment et gracieusement pour moi. Ta gentillesse et ta générosité me rassasient. Je te l’exprime du plus profond de mon cœur, crois-moi.
— Évidemment ! Si je ne dois pas te croire ! Peux-tu me dire ce que tu fais chez moi ? … Mais mon plaisir, c’est de te voir avaler au moins quelques cuillères. Ceci m’enlèvera de la tête l’idée que tu n’es pas gêné, aussi, m’assurera que tu te sens plutôt bien et mieux.
Kader, par respect à son hôte qui l’invite sans cesse à manger, s’efforce finalement. Il reprend sa cuillère et avale comme un pélican, sans vraiment apprécier, le contenu de son assiette.
« Peu importe ! L’essentiel c’est qu’il a mangé, se dit Rachid à lui-même, en voyant qu’il ne restait dans le fond de l’assiette de Kader, que quelques grains de couscous. »
À la fin de ce petit dîner, Rachid se mit debout devant le fourneau pour préparer du café. Mais avant, il demanda à Kader si, lui, ne voudrait pas plutôt d’un thé.
— Non, non ! Je t’en prie, je ne veux même plus entendre parler de thé… Non s’il te plaît, épargne-moi son odeur, répond Kader excité.
— Ce que tu veux ! Les deux sont disponibles de toute façon… En fait, le thé te rend-il malade ou alors tu as simplement la phobie ? Le questionne Rachid, après avoir, instantanément, revu dans sa mémoire le cliché de la manière avec laquelle eut à réagir son invité de la nuit.
— C’est plus qu’une phobie, répond Ka-der, l’air très angoissé, confus et balbutiant dans un flou terrible. Ses mots restent groupés, accrochés à sa langue presque pendue. Puis : c’est terrifiant ! dit-il sèchement. Il me rappelle l’enfer…, il me rappelle des choses… des choses que je n’aurais jamais pu commettre si j’avais refusé de le prendre ce jour maudit. Un jour damné et que je regretterai… que je maudirai, tout le reste de ma chienne de vie.
Rachid se tait un long moment, fait semblant de finir de préparer le café, mais sans oublier l’état de plus en plus inquiétant de cet homme sorti comme un diable des buissons et qui, jusque-là, reste malgré tout un invité de l’inconnu, dont il ignore encore tout. Lucide et calme, il sert une tasse de café chaude qu’il tend à Kader et vient lui aussi se mettre à côté, sa tasse de café à la main.
— Tu te sens bien Kader ? Le questionne-t-il, histoire de reprendre la discussion et éventuellement le ramener à plus de raison.
— Bien ! Je ne ressens plus le froid. Mes habits commencent à sécher. Ça va, ça va ! Et puis j’ai l’habitude, ne t’inquiète pas pour moi.
— Tu es mon invité et j’ai toutes les raisons de m’inquiéter, n’est-ce pas ! Nous prenons soin de nos invités plus que nous ne le faisons de nous-mêmes. C’est une tradition chez nous. Ma chère mère m’a toujours conseillé d’être à la hauteur… de servir au mieux mes invités. Surtout quand ceux-ci arrivent chez moi pour la première fois, en plus par le hasard d’une nuit, finit Rachid avec un sourire tranquille.
— Tu as raison, fait remarquer Kader qui ajoute : je risque peut-être de mourir chez toi, et ma mort vous causera à toi à ta mère, indubitablement beaucoup de problèmes. Je reste jusque-là un étranger que vous ne connaissez pas encore. Ni d’où je viens, ni où je veux me rendre, encore moins ce que je veux proprement dit.
— Ne pense pas à cela, tu te sentiras beaucoup mieux demain matin. Tu vas voir ! Il suffit juste que tu te reposes et que tu essayes d’oublier. Pour le reste, crois-moi sincèrement, je ne te vois pas du tout comme un étranger, mais plutôt comme un ami. Rassure-toi Kader.
— Ah ! Si je pouvais le faire ; ce n’est malheureusement pas le cas. Je n’arrive même plus à penser au sommeil. Je suis hanté par ce que j’ai fait. Et ce qui m’arrive en fin de course me torture et me bouleverse de plus en plus fortement, répond Kader, presque gêné par l’esprit confiant de Rachid.
— Et si on discutait plus clairement et que cesse ce langage codé ! Je crois que l’atmosphère sera beaucoup mieux et claire. Car là, tu m’inquiètes vraiment et je n’arrive pas du tout à te suivre convenablement. Beaucoup de choses dans ce que tu me dis m’échappent. Je suis confus. Sois clair dans tes propos, dis ce qu’as à me dire sans détours. Je suis ton ami, n’aie aucune crainte ! Si je t’ai ramené chez moi Kader, c’est pour ton bien. Je ne te suspecte de rien, j’aimerais juste entendre tout ce que garde secret, le fond de ton cœur et qui te torture si terriblement.
— Je le sais très bien et je n’ai aucun doute… mais que dire ! C’est une longue histoire… On ne va pas en finir. Je t’assure.
— Raconte-moi, je suis là pour t’écouter. S’il le faut, on se passera du sommeil, lui suggère Rachid, intrigué par cette histoire que Kader dit longue et compliquée.
II
A