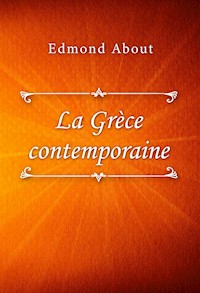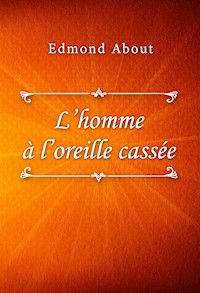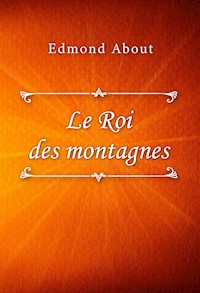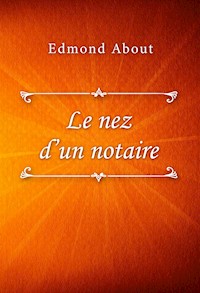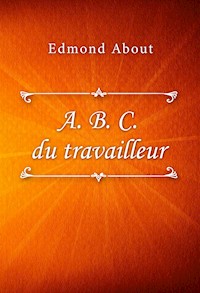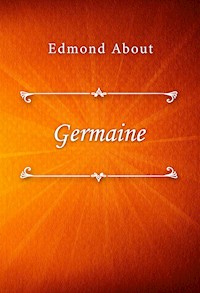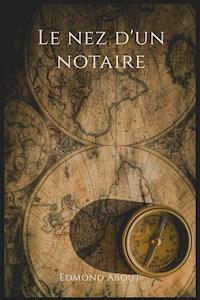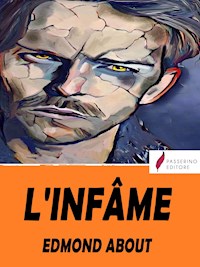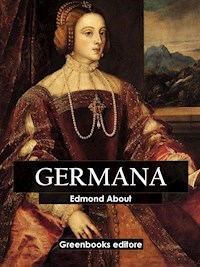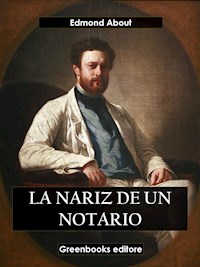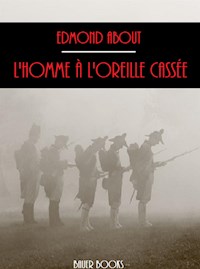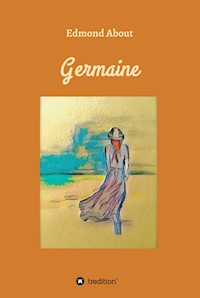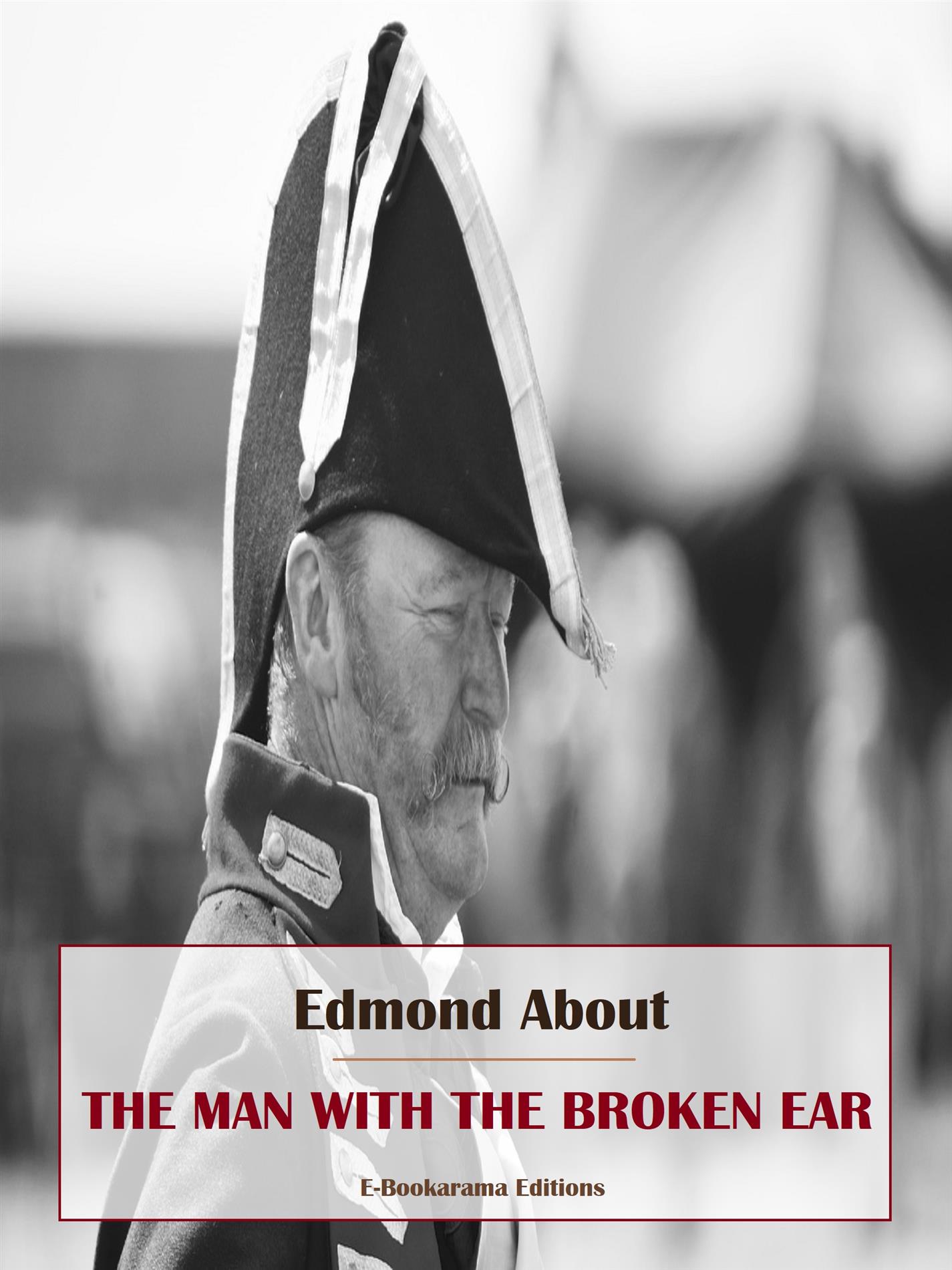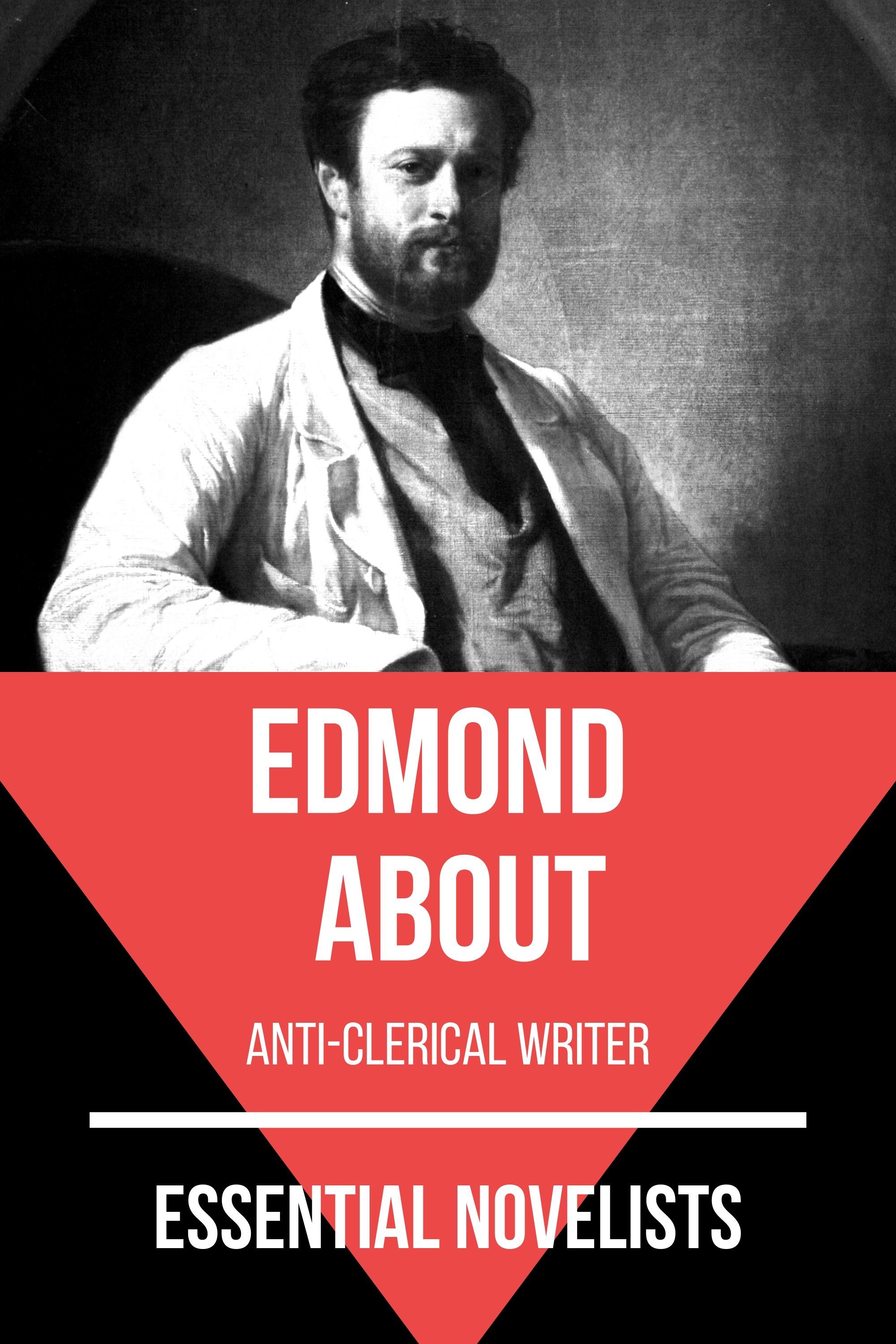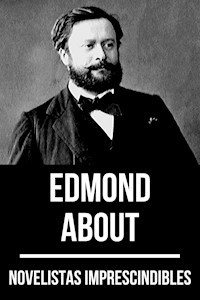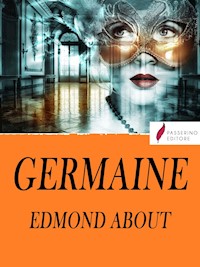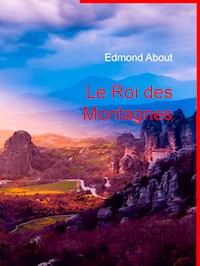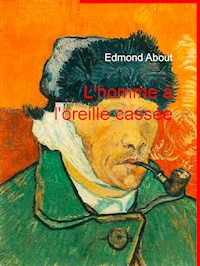0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le 24 janvier 185., ce qu’on appelle tout Paris se poussait, se foulait et se culbutait au bal de ces gens-là.
L’hôtel des Gautripon, qui recevait tous les mercredis, était cité comme un des plus vastes et des plus somptueux de l’avenue des Champs-Élysées. Le suisse et le premier palefrenier se partageaient vingt louis par semaine, rien qu’à montrer les écuries et les mangeoires de marbre blanc. On lisait dans le Guide de l’étranger que tel jour, à telle heure, les Anglais pouvaient voir la galerie de tableaux, et notamment l’incomparable Passion d’Albert Dürer. Madame Gautripon allait aux courses en voiture de gala, comme une reine ; elle achetait les chevaux que l’impératrice avait trouvés trop chers. Ses émeraudes jouissaient d’une réputation européenne depuis l’exposition de Londres, où Webster et Samson les avaient étalées dans une vitrine à part, entre deux policemen. Le train de cette maison bourgeoise représentait au bas prix cent mille francs par mois. Un seul détail vous permettra de mesurer la prodigalité gautriponne : les enfants avaient chacun son service et ses équipages ; or l’aîné marchait sur sept ans et le plus jeune était âgé de dix-huit mois.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1867
Copyright © 2022 Classica Libris
Dédication
À MON AMI
ALEXANDRE DUMAS FILS
Chapitre 1
Le 24 janvier 185., ce qu’on appelle tout Paris se poussait, se foulait et se culbutait au bal de ces gens-là.
L’hôtel des Gautripon, qui recevait tous les mercredis, était cité comme un des plus vastes et des plus somptueux de l’avenue des Champs-Élysées. Le suisse et le premier palefrenier se partageaient vingt louis par semaine, rien qu’à montrer les écuries et les mangeoires de marbre blanc. On lisait dans le Guide de l’étranger que tel jour, à telle heure, les Anglais pouvaient voir la galerie de tableaux, et notamment l’incomparable Passion d’Albert Dürer. Madame Gautripon allait aux courses en voiture de gala, comme une reine ; elle achetait les chevaux que l’impératrice avait trouvés trop chers. Ses émeraudes jouissaient d’une réputation européenne depuis l’exposition de Londres, où Webster et Samson les avaient étalées dans une vitrine à part, entre deux policemen. Le train de cette maison bourgeoise représentait au bas prix cent mille francs par mois. Un seul détail vous permettra de mesurer la prodigalité gautriponne : les enfants avaient chacun son service et ses équipages ; or l’aîné marchait sur sept ans et le plus jeune était âgé de dix-huit mois.
Le monde était témoin de ces magnificences, et le monde parisien, qui sait tout, savait que Gautripon (Jean-Pierre) n’avait pas hérité d’un centime. Ses compagnons d’enfance n’étaient pas morts ; on l’avait vu boursier à la pension Mathey, puis maître d’étude en chapeau râpé, bottes béantes, puis expéditionnaire à dix-huit cents francs. Madame Gautripon, née Pigat, était élève à Saint-Denis, fille d’un vieux capitaine d’infanterie. Son père, honnête Breton de Morlaix, avait laissé le renom d’une droiture et d’une brutalité antiques : dans son ancien régiment, le 62e, on dit encore : « roide comme Pigat. » Mais, comme il n’avait pris aucun Palais d’Été, ce vertueux sauvage n’avait pu donner à sa fille que la dot réglementaire apportée vingt ans plus tôt par sa femme, c’est-à-dire douze cents francs de rente.
Les splendeurs de cette maison étaient donc une énigme proposée à la sagacité de Paris. Personne n’avait entendu dire qu’un oncle d’Amérique eût légué ses dollars à l’ancien maître d’étude ou à la belle Émilie, sa femme. Quelques habitués du logis, par acquit de conscience et pour décrotter le pain qu’ils mangeaient, allaient disant : « Gautripon a le génie des affaires, il spécule, tout lui réussit ; » mais aucun agent de change n’avait acheté ou vendu trois francs de rente pour le compte de Gautripon.
En revanche, il était notoire que la maison possédait un commensal riche et généreux comme un roi. On le nommait Léon Bréchot ; il avait hérité de tous les millions de son père, Nicolas Bréchot, terrassier, puis contre-maître, puis entrepreneur, et en dernier lieu fournisseur de toutes les grandes compagnies de l’Europe. Cet Auvergnat presque illettré, mais calculateur de première force et doué d’un coup d’œil infaillible, vous livrait des chemins de fer et des canaux sur commande, comme un cordonnier livre une paire de bottes : simple, rond, honnête en affaires, camarade de ses ouvriers jusqu’à les battre, et plus dur au travail que le meilleur d’entre eux. Le travail, qui est le seul roi inamovible depuis un certain temps, peut seul édifier des fortunes royales. Quand le père Bréchot, gros mangeur comme tous ceux qui dépensent leurs forces sans compter, prit son indigestion finale, on évaluait son actif à plus de cinquante millions. Le fait est que personne, pas même lui, n’aurait pu en dresser l’inventaire. Ce gros conquérant de millions était, comme Alexandre, Charlemagne et Bonaparte, mieux organisé pour prendre que pour garder ce qu’il avait pris. Ses gains énormes s’étaient logés au hasard ; il y avait de tout dans la succession : des lingots empilés à la Banque, des valeurs de premier ordre en portefeuille avec énormément d’actions véreuses ; des placements hypothécaires, cinq ou six maisons à Paris, une ferme en Sologne, une mine de mercure en Espagne, une carrière de marbre en Algérie, une forêt de dix lieues carrées en Russie, un cru fameux dans le Médoc, une fabrique d’allumettes à Bade, des parts de commandite à Saint-Étienne et force reconnaissances souscrites sur papier à chandelle par de petits emprunteurs peu solvables. Le panorama de ces richesses, brusquement étalé sous les yeux d’un héritier de vingt-cinq ans, avait dû l’éblouir comme un nouveau trésor de Monte-Cristo, car il sortait d’une éducation sévère. Jusqu’à l’âge de dix-huit ans, son père l’avait tenu coffré dans une pension célèbre, chez l’invincible Mathey, terreur du concours général. Élève médiocre et bachelier Dieu sait comment, il quitta la pension pour les bureaux paternels, et fit longtemps la besogne d’un employé à dix-huit cents francs. Il est vrai que son père le logeait, l’habillait, lui prêtait des chevaux et lui servait cent louis par mois pour ses gants et ses cigares ; mais ce père bourru ne payait en dehors que les dépenses motivées ; il défendait le jeu, il bondissait à l’idée que Léon pourrait signer une lettre de change, et disait en fronçant ses gros sourcils : « Avise-toi d’escompter ma mort, et je te déshérite au profit de mes ouvriers! » Ces rigueurs invraisemblables dans un temps aussi relâché que le nôtre avaient allumé chez l’adolescent une soif de dépense et une impatience de jouir qui n’attendit pas même la fin du grand deuil. Il aborda la vie en homme qui ne sait pas le chiffre de sa fortune. Ses compagnons de jeu et ses rivaux du sport lui donnèrent d’emblée un surnom qui rappelait l’industrie paternelle : on le nommait l’entrepreneur de sa ruine. Il le sut, et dit un jour assez plaisamment : « Impossible! Mon père était plus fort dans son genre que moi dans le mien. »
Ce fou n’était pas sot ; il ne manquait pas de repartie. A certain journaliste apprenti qui se vantait trop tôt d’être le fils de ses œuvres, il répondit : « Pardon, mon cher ; vos œuvres sont bien jeunes pour avoir déjà de grands enfants. » Son esprit, sa gaminerie tardive et surtout sa prodigalité trouvèrent grâce devant le monde des viveurs, où il se jeta tête baissée. Paris lui pardonna ses millions à la condition tacite qu’il ne les garderait pas longtemps. Il ne devait être que l’usufruitier de sa fortune ; on le rangeait de confiance parmi les décavés de l’avenir. Cette réputation se fonda si vite et si bien que pas une mère ne fit le geste de lui offrir sa fille. Quant à celles qui ont pour spécialité de s’offrir elles-mêmes, elles tournèrent quelque temps autour de lui, et l’abandonnèrent à son heureux sort dès qu’il fut avéré que son cœur n’était pas disponible. On sut ou l’on crut savoir que Bréchot était accaparé par une famille bourgeoise et qu’il vivait en tiers dans le ménage Gautripon. Le fait parut d’autant plus probable que le train des Gautripon grandissait à vue d’œil. L’ancien caissier de Bréchot père, homme riche et considéré, raconta que Monsieur Léon avait voulu épouser une grisette, mais que le patron s’était mis en travers. Le bruit courut que le fils aîné de la belle Émilie était venu avant terme ; mais la preuve manquait, Madame Gautripon ayant fait ses premières couches en Italie. Une autre légende voulait que le capitaine Pigat fût mort de sa propre main, pour survivre le moins possible à l’honneur de la famille.
A ces imputations mal démontrées, mais qui se soutenaient en l’air par la force de leur vraisemblance, les amis de la maison répondaient : « Bréchot et Gautripon se sont liés de bonne heure ; ils étaient inséparables à la pension Mathey. Gautripon fils, lorsqu’il perdit son père, eut pour correspondant le père de son ami. Léon Bréchot, un an et plus après sa sortie du collège, venait voir Gautripon chez Mathey et lui conter ses amourettes. Jean-Pierre lui rédigeait sur commande des vers bien tournés et surtout corrects, dont l’autre se faisait honneur dans un certain monde. Est-il donc étonnant que le fils de famille, en prenant possession de sa fortune, ait pensé à un camarade si ancien et si cher? Vous le voyez qui jette les millions par la fenêtre, et vous demandez qu’il crie à Gautripon tout seul : Gare dessous! Quand une maison brûle, les voisins ont plus chaud que les autres, et personne ne les accuse d’avoir volé cette chaleur. Nous ne prétendons pas que Gautripon spécule avec l’argent de son patrimoine ; il emprunte pour jouer, mais ce qu’il gagne est bien à lui. »
Ce système de défense était le seul possible. Le moyen d’assimiler Madame Gautripon à ces lionnes pauvres qui comptent deux cents francs un cachemire de mille écus? Il n’y a pas au monde un Jean-Pierre assez naïf pour croire qu’on nourrit douze chevaux sur douze cents francs de rente. Or la communauté n’avait pas d’autre revenu démontré, et l’on ne connaissait pas à monsieur d’autres moyens d’existence, sauf sa profession de mari.
Il était donc montré au doigt ; il portait sur les épaules une charge de mépris qui eût écrasé cinquante éléphants. Le vulgaire rit volontiers d’un mari trompé par sa femme, les gens de cœur qui raisonnent un peu le prennent en pitié ; mais sur le vil complaisant qui vend sa part de bonheur et de dignité il n’y a qu’une opinion : tout le monde s’accorde à le noter d’infamie. Après sept ans de mariage, Gautripon ne s’appelait plus Jean-Pierre ; il était pour tout Paris l’infâme Gautripon.
Lorsqu’il faisait une emplette pour madame et qu’il donnait son nom et son adresse, le caissier du magasin levait la tête, le commis qui l’avait accompagné jusqu’au comptoir le regardait en face, les acheteurs entrants ou sortants se retournaient, et tout ce monde semblait dire : « Ah! ah! voilà comme il est fait! » Ses domestiques, mieux payés que des chefs de bureau, le servaient par grâce, et Dieu sait en quels termes on parlait de lui à l’office! Un jour sa femme achète une paire de chevaux. Le garçon d’écurie qui les avait amenés s’éloigne avec deux louis de pourboire. Un palefrenier de la maison court après lui, l’arrête et lui dit :
« J’espère que tu payes à déjeuner?
— Sur quoi? sur quarante malheureux francs?
— On ne t’a donné que ça?
— Ma parole!
— Qui?
— Monsieur.
— Ah! tu m’en diras tant! Madame a dû donner cinq louis, mais l’infâme en aura mis trois dans sa poche. »
Ce détail en dit plus dans sa brutalité que tout ce qu’on pourrait écrire.
La façade était en pierre blanche et polie comme le marbre. Presque tous les matins la servante du suisse y lavait à grands coups d’éponge le mot « infâme » tracé au charbon par les vertueux polissons du quartier.
Au point de vue de la morale absolue, la trinité de ce ménage était uniformément criminelle. Le mari qui vend, l’amant qui achète et la femme qui se livre comme une marchandise inerte, mériteraient d’être tous enveloppés du même dégoût ; mais la morale et l’opinion sont deux.
L’opinion souriait à Bréchot comme à tous les vainqueurs ; elle se serait attendrie pour un rien sur le malheureux sort d’Émilie ; elle écrasait Gautripon seul. Bréchot était un heureux gaillard, pas autre chose, un homme qui avait bien choisi sa maîtresse et qui se faisait honneur de son argent. Émilie, sacrifiée par un indigne mari, semblait presque aussi intéressante que Joseph vendu par ses frères. Pour Gautripon, les honnêtes gens s’indignaient que le Code pénal n’eût pas un seul article à l’adresse de ce coquin-là.
Si du moins il avait pratiqué ces façons qui désarment la rigueur du monde! Il y a mille accommodements avec le puritanisme de Paris. On passe bien des choses aux scélérats qui savent vivre. Les escrocs obligeants, les faussaires polis obtiennent à la longue une espèce de réhabilitation charitable : la vertu même finit par leur donner la main, de guerre lasse, quitte à se laver après ; mais Gautripon n’avait jamais trouvé mille francs dans sa poche pour assister un malheureux. Autant madame était prodigue, autant il se montrait tenace à garder son ignoble salaire. Lorsqu’un ancien compagnon de détresse allait sonner chez lui, monsieur n’y était pas. Ceux qui lui écrivaient pour demander quelque service d’argent obtenaient un refus piteux, enveloppé de longues phrases filandreuses. Son attitude dans le monde n’était rien moins qu’avenante. Il parlait peu, répondait par monosyllabes, regardait d’un air froid et semblait se tenir en garde contre un affront toujours suspendu. « Ce pauvre Monsieur Gautripon! disait un soir la comtesse Mahler, on croirait qu’il se promène dans une avenue de soufflets. »
S’il assistait aux bals de sa femme, c’était avec une indifférence si marquée que plusieurs invités, dans les commencements, se crurent mal reçus. Il saluait les gens d’un sourire contraint, puis s’effaçait dans le coin le moins éclairé jusqu’à ce que le bruit de la fête et la distraction du public lui permissent de s’évader incognito. Cette étrange façon de recevoir finit par trouver grâce ; on passa par-dessus la triste originalité de l’infâme. On ne le saluait plus que par acquit de conscience, et parmi les jeunes gens qui dansaient le cotillon dans son hôtel quelques-uns se vantaient de n’être pas présentés à lui. Les joueurs le connaissaient encore moins, car il ne touchait jamais une carte ; il ne montait pas même à la galerie du premier étage, où l’on dressait les tables de jeu. Ces messieurs du baccarat, du lansquenet et du rubicon venaient là comme au cercle. Léon Bréchot ne se faisait pas faute d’inviter sans cérémonie ses connaissances du club et du foyer de l’Opéra. Ceux qui étaient venus trois fois dans la maison ne craignaient pas d’en amener d’autres. Au milieu de cette anarchie et de cette prodigalité, tout le monde, excepté Gautripon, était chez soi. Quand il donnait à dîner, les convives étaient choisis avec un peu plus de discernement, mais par madame ou par Bréchot. On les présentait tous au mari, mais il avait si peu de mémoire ou de politesse qu’il ne les reconnaissait pas le lendemain dans la rue. Au milieu des repas les plus somptueux et les plus exquis, il paraissait honteux de son appétit : à peine s’il avalait un potage et quelques bouchées de viande ; mais il cassait et grignotait furtivement son pain par un mouvement machinal qui ne cessait qu’au dessert. Il buvait son eau pure.
Peut-être aussi les vins de cette cave célèbre semblaient-ils insipides à un ancien buveur de vin bleu. L’ancien maître d’étude de la pension Mathey ne pouvait guère apprécier les chefs-d’œuvre du grand Coulard, ce prodige de science volé au prince de Metternich par la diplomatie de Bréchot. Quelques moralistes insinuaient que les goûts bas contractés dès la jeunesse ne se désencanaillent jamais : on accusait Gautripon de se livrer dans l’ombre à des orgies de gras double et de soupe à l’oignon. Cette hypothèse fut confirmée par un témoignage aussi curieux qu’imprévu. Le valet de pied du général péruvien don Pablo Puchinete jura qu’il connaissait Monsieur Gautripon pour avoir déjeuné dix fois auprès de lui dans un bouillon de cochers, rue de la Vieille-Estrapade. La chose était un peu trop forte pour obtenir créance chez les gens qui raisonnent ; il en resta pourtant je ne sais quelle odeur de crapule autour de l’accusé. La simplicité de ses goûts, la vétusté de ses habits toujours râpés et toujours propres, la grosse toile de ses mouchoirs, la modeste percale de sa chemise, toutes ces habitudes d’épargne et de retranchement personnel qui devaient racheter dans une certaine mesure le luxe outrageux de sa maison, furent autant de charges contre lui. On décida que cet homme était ignoble en tout, et le monde ne le vit plus qu’à travers une opinion détestable.
Pour ceux qui auraient pu l’envisager autrement, sa personne n’était ni laide ni repoussante. C’était un grand garçon de trente-deux ans, svelte et bien pris, mais un peu courbé en avant sous le poids de son infamie. Les traits du visage étaient fermes, le nez un peu grand, mais de forme élégante et fière, la bouche petite, les dents belles, le front haut et les sourcils noblement dessinés. Il rasait sa barbe avec soin et portait les cheveux taillés en brosse. Ces cheveux du plus beau noir s’argentaient visiblement sur les tempes, et ce rayon de vieillesse anticipée adoucissait tout son visage. Le misérable, à qui l’on ne donnait la main que par pitié, avait lui-même une main nerveuse, sèche, chaude, une de ces mains qui vous attirent, vous retiennent, et qui s’empareraient de votre amitié, si l’on n’était pas averti.
L’ami de la maison, ce Léon Bréchot que vous savez, était un admirable type d’homme heureux. Ni trop grand ni trop petit, ni gras ni maigre, ni brun ni blond, ni beau ni laid, il se citait lui-même comme le mieux équilibré de tous les mortels. La bonne humeur et la santé rayonnaient sur sa figure ronde et colorée ; ses yeux gris scintillaient ; son nez court, bien ouvert et légèrement retroussé, humait avec une joyeuse avidité le parfum des bonnes choses. La barbe multicolore, blonde aux racines, rousse au milieu, brune au bout, s’épanouissait en éventail pour achever cette figure épanouie. Une coiffure imperceptiblement olympienne relevait ses cheveux châtains du front à l’occiput en deux masses frissonnantes. Buveur solide et beau mangeur, il avait pris juste assez d’embonpoint pour donner une courbure harmonieuse à ses plastrons de batiste, sous le gilet superbement ouvert. Un Lavater aurait lu dans sa physionomie la franchise, la bienveillance, la générosité, le mépris des richesses, l’ignorance du danger, l’ardeur des passions : ce qui manquait un peu, c’était la persévérance, le dévouement, le sérieux, le solide, la force de vouloir et la faculté de souffrir ; mais à quoi bon? Est-ce que les oiseaux ont besoin de nageoires? L’homme aimé, riche, heureux, a-t-il affaire de cette énergie farouche qui lutte corps à corps avec le malheur?
La femme qui se partageait (disait-on) entre ces deux messieurs ne peut être comparée à aucune autre, ni même à aucune créature vivante ; mais on se rendrait compte de sa beauté vraiment particulière, si l’on avait la patience d’étudier avec attention une poupée de grand prix. Les poupées ne représentent ni des femmes ni des enfants, mais un âge intermédiaire : il en était ainsi de Madame Gautripon, quoiqu’elle fût mère de deux garçons et d’une fille. Ses cheveux, plus fins que la soie et d’un blond presque blanc, rappelaient cette toison d’agneau qui coiffe les poupées Huret. Toutefois, le corps n’avait pas la raideur et la sècheresse de la gutta-percha durcie : les mains, les bras, les épaules, tout ce qu’on voit au bal était d’une blancheur uniforme, absolue, comme le corps des poupées de peau. Les yeux noirs, d’un émail étincelant, illuminaient des traits ronds, moelleux, un peu fondus, et doucement colorés comme la cire. La bouche était trop petite, les yeux trop grands, les pieds et les mains presque invisibles, conformément à l’esthétique professionnelle des bimbelotiers. Ses toilettes étaient des costumes aussi riches et aussi bizarres que ceux que Marcelin, l’admirable fantaisiste, dessine au 1er janvier pour la devanture de Siraudin. Elle portait aussi des dentelles trop hautes et des pierreries mal proportionnées à sa taille. L’aménité de son accueil, le charme de sa voix, l’inaltérable douceur de son langage, vous forçaient de penser à ces statuettes du nouvel an qui sont des boîtes de bonbons. Cette petite femme était la fraîcheur même et la suavité en personne, avec certain je ne sais quoi qui éveillait des idées de cherté fabuleuse et de fragilité déplorable. On enviait le bonheur de l’homme qui avait pu se donner un tel joujou pour ses étrennes, et l’on disait aussi : Pourvu qu’il n’aille pas la casser! car on ne la voyait pas sans la désirer peu ou prou ; c’était une nature aimantée qui attirait sinon les cœurs, au moins les convoitises du sexe qui se dit fort. Ses manières n’avaient rien de décourageant ; elle n’était ni courtisane, ni même coquette, et pourtant elle semblait facile. Pourquoi? Par cent raisons, mais surtout parce qu’elle ne témoignait pas plus d’amour à Léon qu’à Jean-Pierre, qu’il n’était pas défendu de lui supposer le cœur libre, et que son laisser aller, ses grâces nonchalamment sensuelles, la désignaient comme un être désarmé. Il eût été paradoxal de la croire infaillible, et plus paradoxal encore de supposer qu’elle ne faillirait plus. Le gros Merryman, qui fait courir, disait à ce propos : « Je connais pas mal de chevaux qui ne sont jamais tombés sur les genoux, mais je n’en sais pas un qui n’y soit tombé qu’une fois. » L’espérance attirait donc un peuple autour d’elle. On y voyait de tout, depuis les princes et les gros banquiers, jusqu’aux sous-lieutenants de la littérature, de l’art et de l’armée, les uns prêts à faire des sacrifices énormes, par cela seul que Léon Bréchot en avait déjà fait, les autres dans l’espoir qu’il n’y en aurait plus à faire, et qu’Émilie était assez riche pour se donner le luxe d’un amour désintéressé.
Cent mille hommes ne suffisent pas à composer un salon, il faut trouver moyen d’attirer les femmes du monde, et ce remplissage est toujours difficile dans une maison aussi diffamée que l’hôtel Gautripon ; il n’est pourtant pas impossible, si les maîtres du logis savent mener le recrutement selon la logique parisienne. Une femme perdue de réputation aurait beau se bâtir un hôtel magnifique, allumer dix mille bougies, réunir l’orchestre du conservatoire et préparer un souper babylonien ; elle n’attirerait personne à ses bals, si elle commençait par inviter les honnêtes femmes de Paris. Plus l’hôtel serait beau, plus l’orchestre serait illustre, plus le souper serait fin, plus on s’honorerait de renvoyer l’invitation comme malséante et impertinente. Une maîtresse de maison qui sait la vie trouve un biais. Elle attire d’abord un certain nombre d’étrangères, et pense avec raison que ces dames n’y regarderont pas de trop près. Ceux qui se dépaysent un moment pour s’amuser, font du plaisir leur principale affaire et prennent leur récréation où ils la trouvent. Ils agissent chez nous comme nous-mêmes en voyage, avec une singulière expansion de tolérance et de facilité. Cela n’engage à rien, pas même à reconnaître au bout d’un an les compagnons ou les distributeurs des plaisirs qu’on a pris. Si une femme du monde est solidaire de celles qu’elle voit dans son pays, elle ne doit compte à personne des relations qu’elle a pu nouer en voyage. Aussi les étrangères accourent-elles, sans faire se prier, partout où l’on ouvre un salon agréable. Il suffit que la maison ne soit pas formellement déclassée, et qu’on voie flotter sur la porte un lambeau de pavillon conjugal. Les Gautripon ou les Bréchot comprirent qu’il fallait avoir les grandes dames de l’étranger, et que c’était le commencement de la sagesse. En effet, le reste alla de soi. Lorsqu’on sut qu’ils faisaient danser des princesses en i, des marquises en o et des comtesses en a, les Parisiennes à la mode jugèrent qu’il y avait sottise à bouder si bonne compagnie, et plus d’une brigua les invitations qu’elle aurait repoussées l’année d’avant, si on les lui avait offertes. Les familles sévères se tinrent obstinément en dehors, mais cette catégorie n’est pas comptée dans le total hétérogène qui s’intitule tout Paris. Les arts, les lettres, la finance de Paris, de Francfort et de Vienne, la noblesse cosmopolite, un lot de bourgeoisie industrielle et marchande, les deux sexes du sport, la fleur de l’inutilité des clubs, composaient un ensemble plus brillant qu’imposant, mais assez considérable en somme. L’élément masculin était en majorité, mais les femmes jeunes et jolies ne manquaient pas. Les yeux s’écarquillaient aux feux des diamants ; l’écho des noms sonores et des titres plus ou moins authentiques caressait agréablement le snobisme parisien.
Quoi qu’on pût dire de la vertu de madame, quoi qu’on pût insinuer sur la complaisance de monsieur, le 24 janvier 185… l’hôtel Gautripon était encore une maison comme les autres et plus agréable que beaucoup d’autres.
Ce qui donnait un caractère un peu singulier à ces fêtes, c’était, comment dirai-je? une certaine atmosphère de mépris répandu. On sait que dans le monde, et surtout dans le monde un peu mêlé, le savoir-vivre est réparti par doses inégales. Les femmes en général en ont plus que les hommes, malgré tous les efforts d’une école nouvelle pour renverser la proportion. Les vieillards et les hommes mûrs sont plus polis que les petits jeunes gens. La naissance, l’éducation, la profession, accentuent plus fortement les inégalités marquées par le sexe et par l’âge : mais le point capital où j’ai besoin d’insister ici, c’est que l’individu devient supérieur ou inférieur à lui-même selon le milieu qu’il traverse et le monde qui l’environne. Il y a des instincts grossiers qui constatent la parenté de l’homme avec la bête. L’éducation les refoule plutôt qu’elle ne les anéantit ; ils demeurent emprisonnés dans quelque coin ténébreux de notre être, guettant l’occasion de s’échapper et de s’épandre. Pour les tenir en respect, la volonté d’un seul homme ne suffit pas ; il faut la collaboration d’un certain milieu, la pression des idées et des mœurs ambiantes. La bonne compagnie exerce une salutaire contrainte sur ceux-là même qui n’en sont point ; la mauvaise relâche inévitablement les habitudes de l’homme le plus correct et le plus délicat. Le même homme boit, mange, danse, parle et rit diversement, selon qu’il est dans un salon respectable, ou familier, ou équivoque. La retenue des invités croît en raison de leur estime pour la maison qui les reçoit. Un homme bien élevé se gêne un peu, même avec ses amis, quoi qu’en dise le proverbe ; tout le monde en prend à son aise et lâche la bride à ses instincts chez les Gautripons de tous étages.
Ainsi les jeunes gens abusaient étrangement de cette hospitalité banale et décriée. Quelques-uns arrivaient sans scrupule après boire ; quelques-uns montaient au fumoir avant de saluer Émilie, et s’y cantonnaient jusqu’au souper, entre les liqueurs et les cigares. D’autres donnaient l’assaut au buffet avec des poussées formidables. Tout le monde commandait aux serviteurs de la maison, qui devenaient familiers dès minuit, grâce aux libations de l’office. On gaspillait outrageusement les boissons et les mets, et si quelque chose venait à manquer par hasard, les invités s’en étonnaient sur un ton qui voulait dire : « Quoi! nous daignons aider à la ruine de ces faquins-là, et ils n’ont plus d’asperges à quatre heures! » Après souper, la jeunesse dansait des pas fantastiques et tenait des discours inouïs, et les dames, acclimatées peu à peu, commençaient à ne plus s’étonner de rien. Les joueurs s’impatronisaient dans la galerie de tableaux jusqu’à midi, voire jusqu’à la soirée du lendemain, et, comme Léon Bréchot était de la partie, on n’essayait pas même de les déloger. Ils commandaient leurs repas, sans plus de façon qu’à l’auberge, et Madame Gautripon disait en s’éveillant sur les deux heures : « Comment! ils sont encore là? Eh bien! donnez-leur tout ce qu’ils voudront! » toujours avec son frais sourire de poupée neuve.
Voici comment l’étourderie d’un jeune homme et la fumée de quelques verres de vin de Champagne changèrent ces beaux yeux d’émail en deux sources de larmes.
Le marquis Lysis de la Ferrade était un magnifique créole de vingt-cinq ans, un de ces Apollons exotiques qui ressemblent aux Français de la métropole comme un palmier de l’île Bourbon à un pommier du pays de Caux. Il avait le teint mat, la lèvre pourpre, les cheveux presque bleus, les yeux fendus en amande et noyés dans ce fluide étincelant et doux qui semble fait de courage et d’amour. Noble, riche, vaillant, admirablement souple aux jeux du corps et de l’esprit, il avait vu toutes les portes s’ouvrir à deux battants devant lui, toutes les mains courir au-devant de la sienne. Ce jour-là même, on venait de fêter sa bienvenue dans un club où les millionnaires n’entrent pas comme au moulin. Par malheur il avait terriblement bien dîné : la folie que les Bordelais, les Bourguignons et les Champenois emprisonnent dans leurs bouteilles s’était mêlée en lui au vin de la jeunesse, qui est le plus absurde et le plus généreux de tous. Il s’était échappé du club à dix heures avec un cortège de joyeux compagnons ; on avait fait une descente au foyer de l’Opéra et mis en fuite les plus jolis oiseaux et les moins farouches du monde ; puis la brillante cohorte, soulevée par ces ailes invisibles que l’ivresse attache aux pieds des jeunes fous, émoustillée par un vent de bise qui fouettait le visage et piquait les oreilles, s’était abattue à grand bruit sous le péristyle de l’infâme. Là, les cochers de ces messieurs, riant d’un rire philosophique et dissertant entre eux sur l’égalité dans le vin, s’étaient rangés à la file, tandis que les valets de pied pliaient les paletots et que les maîtres envahissaient la maison comme une ville conquise.
Vers minuit, Gautripon se faufila discrètement, à son ordinaire, hors des salons où l’on dansait. Il décrocha, dans un couloir obscur, une vieille pelisse doublée de chat râpé, comme on n’en trouve qu’au Temple, et il se mit en devoir de gagner la petite porte des fournisseurs. Un grand tapage appela son attention vers l’office ; il prêta l’oreille, et entendit les mots « monsieur, madame et Bréchot, » répétés plusieurs fois au milieu d’une hilarité brutale. Il se consulta un instant pour savoir s’il devait passer outre ou boire la turpitude de ses gens jusqu’à la lie. La curiosité fut la plus forte : il écouta tout le récit d’un laquais qui venait de déposer un plateau de verres vides et parlait en se tenant les côtes.
L’orateur avait fini et l’auditoire riait encore, que Jean-Pierre était déjà loin. Il rentrait dans les appartements, la souquenille sur le dos et le chapeau sur la tête, escaladait le premier étage, traversait la galerie et se jetait dans la chambre à coucher de sa femme avec l’emportement d’un sanglier blessé.
Dès le seuil, il reconnut le spectacle insolent que les rires de l’office lui avaient dénoncé. On avait mis à nu le lit de Madame Gautripon et fait la couverture. Sur deux larges oreillers étalés côte à côte, on avait couché deux têtes de carton, dont l’une représentait un coq et l’autre une chatte blanche. Au-dessus un grand cerf, drapé dans un tapis de table, allongeait deux longs bras et deux mains gantées de frais sur le couple hétéroclite, comme pour le protéger ou le bénir. Les pincettes du foyer et les accessoires du cotillon avaient fourni les principaux éléments de cette scandaleuse mascarade ; l’auteur de la plaisanterie devait avoir prêté ses gants.
L’infâme poussa un son guttural, ses yeux flamboyèrent ; il se redressa de toute la hauteur de sa taille, plongea un regard effrayant dans le petit groupe de rieurs qui s’ébaudissait à ce spectacle, aperçut un jeune homme déganté et lui sauta à la gorge en criant :
« Misérable lâche! c’est donc toi? »
Monsieur de la Ferrade bondit sous l’insulte et sous l’étreinte. Il écarta par une torsion désespérée les deux mains qui l’étouffaient, regarda son agresseur, le reconnut sans le connaître, lui rit au nez et répondit d’une voix vibrante :
« Monsieur le Gautripon, vous dites des incohérences : ce n’est ni un misérable, ni un lâche, puisque c’est moi! »
Cela dit, il repoussa violemment l’infâme, qui chancela un moment, puis s’élança de nouveau ; mais les amis du jeune homme avaient eu le temps de se jeter entre les deux combattants. Monsieur Gautripon lutta contre eux, glissa sur le tapis et se releva sous une pluie de cartes de visite. Le créole avait profité de la bagarre pour fouiller dans sa poche et vider tout son carnet sur la tête de l’ennemi. « A demain, disait-il, on ne donne qu’une carte à un homme seul ; mais vous qui vous appelez légion, vous partagerez le paquet entre vos amis et connaissances! »
Gautripon demeura comme atterré sous le coup de ce nouvel outrage ; il lui fallut une grande demi-minute pour reprendre ses esprits. Lorsqu’il vint à la riposte, les jeunes gens, au nombre de cinq ou six, étaient déjà au milieu de la galerie. Il prit son élan pour les rejoindre, mais la voix de son ami Bréchot le cloua sur place.
« Je tiens mille louis, disait Léon. »
Les joueurs n’avaient rien vu, rien entendu : ils étaient tout à leur affaire. Le mari se ravisa, rentra dans la chambre, ferma doucement la porte, fit un paquet des cartes du marquis et les serra dans sa poche. Il revint ensuite au grand lit de Madame Gautripon, ramena la couverture sous le traversin, roula les oreillers en cylindre et les mit au pied du lit, étendit sur le tout le grand couvre-pied de guipure et de satin rose, rangea le tapis de table et les pincettes, jeta les gants au feu et replaça les cartonnages dans la corbeille du cotillon.
Le désordre ainsi réparé, il rouvrit la porte à deux battants et regagna l’escalier de service ; mais, au lieu d’y retourner par le même chemin, il prit à gauche et pénétra sur la pointe du pied dans l’appartement des enfants. Les deux garçons et la fillette dormaient du plus riant sommeil sous leurs rideaux de tulle garni de malines. Un précepteur, une gouvernante et deux bonnes anglaises reposaient auprès d’eux. Leur mère les avait entourés de ces mille brimborions ruineux qu’on donne aux enfants d’aujourd’hui pour leur inculquer dès le berceau la sotte vanité des hommes. Le petit monsieur de sept ans était meublé de bois de rose ; on voyait dans son salon particulier une collection de tableaux enfantins et le portrait de son poney favori peint par un maître. Un trophée de cannes et de cravaches à sa taille décorait un des panneaux de la chambre ; sur une pelote à son chiffre brillait toute une collection de riches épingles à son usage. Rien ne manquait à cette réduction des élégances à la mode, pas même une boîte à cigares en argent ciselé, pleine, il est vrai, de cigares de chocolat. Gautripon regarda ce bizarre étalage comme s’il ne l’avait jamais vu ; il haussa les épaules, secoua la tête et vint baiser avec une tendresse plus que paternelle l’enfant qui ressemblait scandaleusement à Bréchot. Sur les trois qu’il embrassa tour à tour, la petite fille seule s’éveilla, ouvrit les yeux à demi, et lui rendit son baiser dans le vide en disant : Je t’aime!
« Et moi aussi, pauvres enfants, je vous aime! murmurait-il en s’éloignant avec des larmes plein les yeux. »
Il sortit de l’hôtel sans encombre et gagna une maison de piètre apparence vers le bas de la rue de Ponthieu ; le portier, qui ne l’attendait plus, vint lui ouvrir en grommelant : il s’excusa d’un ton modeste et donna dix sous… Sa bougie allumée et sa clé détachée du clou, l’infâme gravit un escalier sale et nauséabond, s’arrêta au cinquième étage, enfila un couloir, passa devant quatre ou cinq portes où les noms de locataires se lisaient sur des écriteaux de carton, et entra finalement dans une mansarde très-propre. Les draps du lit et les rideaux de l’unique fenêtre étaient du plus beau blanc ; le papier, à douze sous le rouleau, n’avait ni tache ni égratignure, la couchette de noyer brillait, le carreau de brique rouge miroitait, les humbles flambeaux de la cheminée étincelaient. Six bonnes chaises de paille bien nettes, deux petites tables soigneusement frottées à la cire et un lavabo de quinze francs complétaient l’intérieur honnête et modeste d’un ouvrier qui a de l’ordre ou d’un petit employé.
Gautripon s’y installa comme chez lui. Il s’assit sur une de ces chaises de paille, lut attentivement la carte du beau créole et médita quelques minutes la tête dans ses mains ; puis, souriant à lui-même en homme qui a fait son plan, il se dévêtit, accrocha sa pelisse à un porte-manteau, brossa, plia sa toilette de bal et la serra dans un placard. Cette besogne achevée, il se coucha, souffla sa bougie et s’endormit d’un profond sommeil.
Cependant Monsieur de la Ferrade, un peu dégrisé, se faisait conduire au cercle des colonies, et arrachait son oncle, Monsieur d’Entrelacs, aux plaisirs mathématiques du whist.