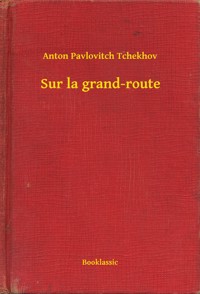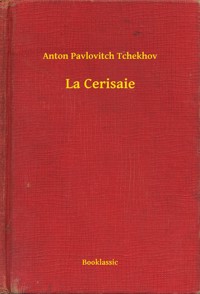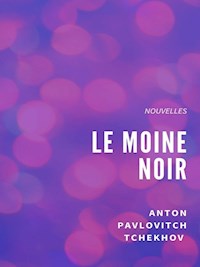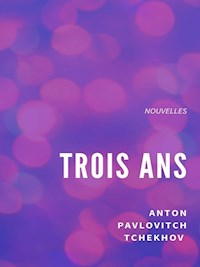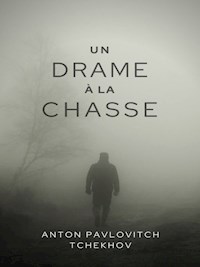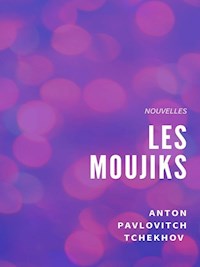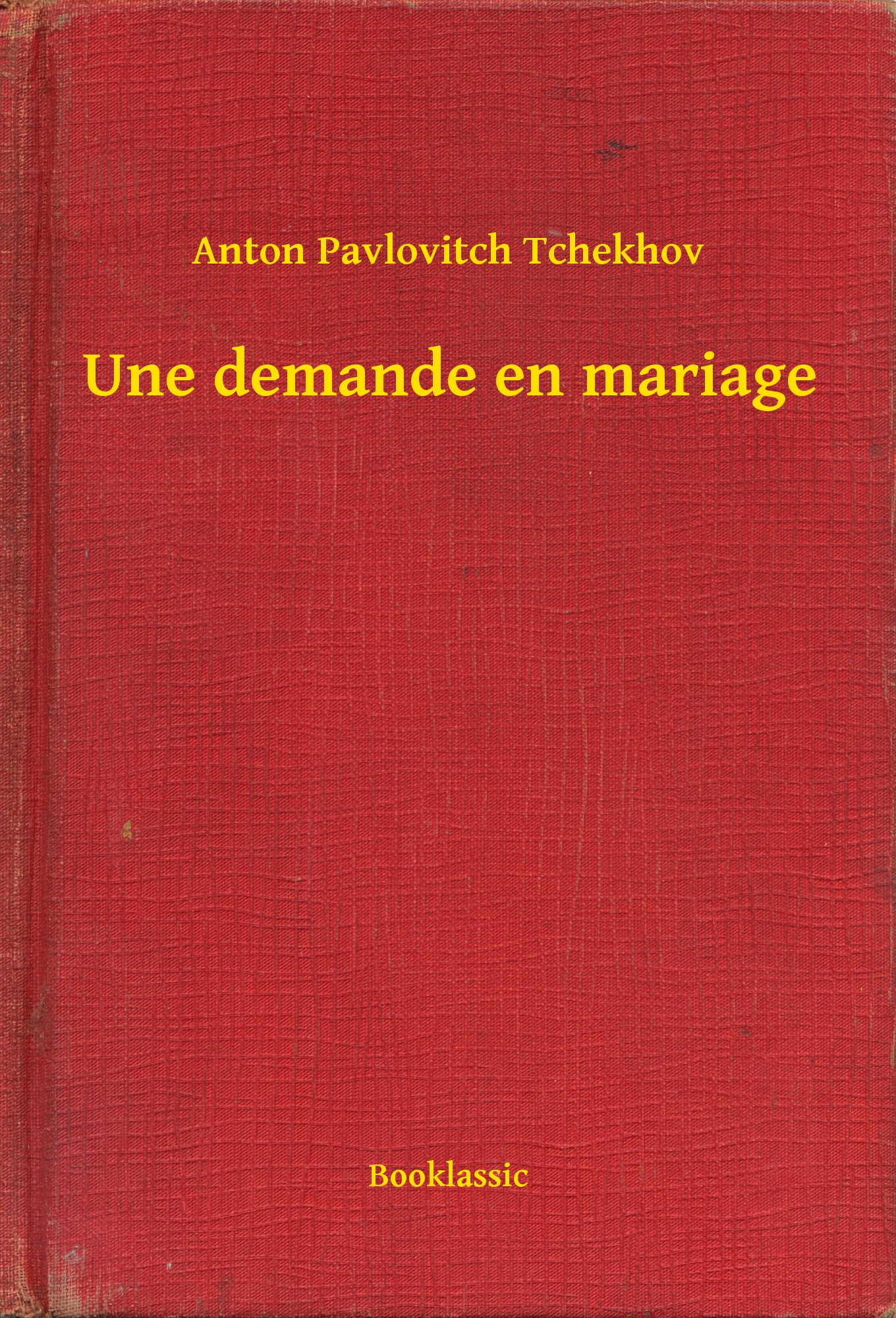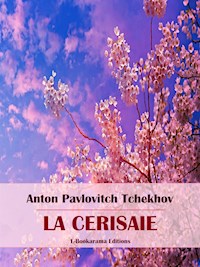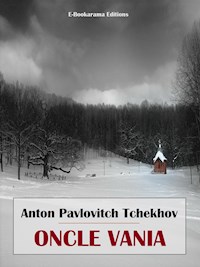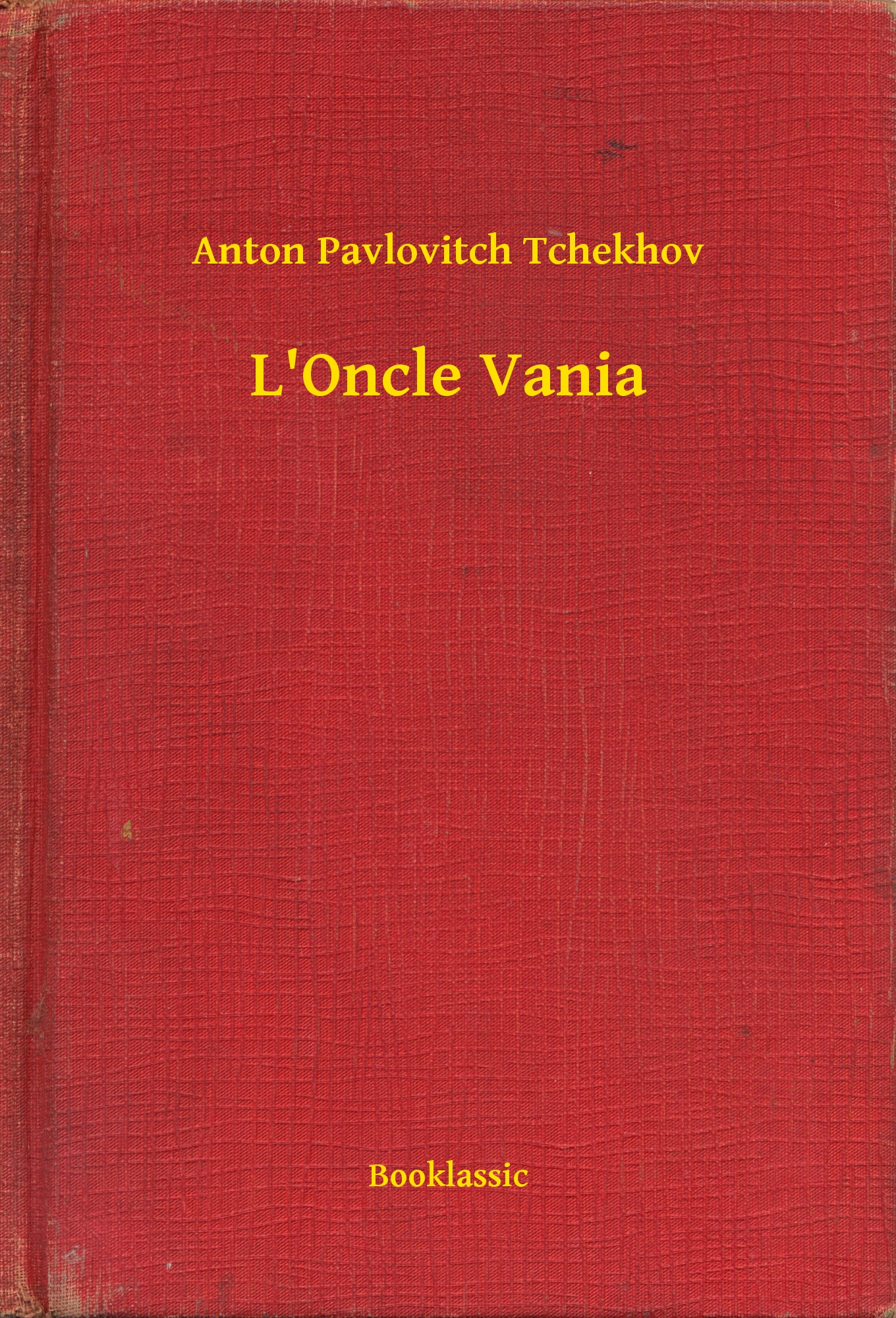
0,88 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
L'automne, le temps gris donnent l'atmosphère de la pièce. Sérébriakov, professeur égoïste et tyrannique et sa nouvelle femme Éléna bouleversent depuis leur arrivée la vie paisible de Sonia, fille de Sérébriakov, de l'oncle Vania, le beau-frère et de Astrov, médecin que désespèrent la disparition de la faune et la destruction des forêts. On ne travaille plus, le temps s'écoule dans l'oisiveté, l'ennui et la souffrance : Sonia n'est pas belle, elle aime Astrov qui voudrait séduire Éléna, dont est amoureux Vania. Jeune et belle femme, Éléna est consciente de son inutilité. Vania a vécu par procuration, dans une admiration totale du professeur qui n'est qu'un raté. Tchékhov tisse les liens entre des personnages incapables d'aimer véritablement (à l'exception de Sonia et de la vieille servante Marina) et de trouver un sens à la vie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
L'Oncle Vania
Anton Pavlovitch Tchekhov
Personnages
SÉRÉBRIAKOV ALEKSANDR VLADIMIROVITCH, professeur en retraite.
SÉRÉBRIAKOVA ELÈNA ANDRÉIEVNA, sa femme, vingt-sept ans.
SOFIA ALEKSANDROVNA (Sonia), sa fille du premier lit.
VOÏNITSKAÏA MARIA VASSILIEVNA, veuve de conseiller privé, mère de la première femme du professeur.
VOÏNITSKI IVAN PÉTROVITCH (oncle Vania), son fils.
ASTROV MIKHAÏL LVOVITCH, médecin.
TÉLÉGUINE ILIA ILITCH, propriétaire ruiné.
MARINA, vieille bonne.
UN OUVRIER.
L’action se passe dans la propriété de Sérébriakov.
Acte I
Un jardin. On voit une partie de la maison avec la terrasse. Dans l’allée, sous un vieux peuplier, une table préparée pour le thé. Bancs et chaises. Sur un des bancs, une guitare. Non loin de la table, une balançoire.
Trois heures de l’après-midi. Temps couvert.
Marina, vieille femme grasse, peu allante, se tient près du samovar et tricote un bas. Astrov va et vient.
MARINA, remplissant un verre. – Bois, petit père.
ASTROV, prenant le verre, sans entrain. – Je n’en ai guère envie.
MARINA. – Peut-être veux-tu une petite goutte[1] ?
ASTROV. – Non ; je n’en bois pas tous les jours… Et aujourd’hui, on étouffe… (Une pause.) Ma bonne, depuis combien de temps nous connaissons-nous ?
MARINA, réfléchissant. – Depuis combien de temps ? Dieu m’en fasse souvenir !… Tu es arrivé dans cette région… quand donc ?… Véra Pétrovna, la mère de Sonietchka, était encore vivante. De son temps, tu es venu ici pendant deux hivers ; alors c’est que douze ans se sont passés. (Après réflexion.) Et peut-être plus…
ASTROV. – J’ai fortement changé depuis ?
MARINA. – Que oui ! Tu étais jeune, beau ; maintenant tu as vieilli. Et tu n’as pas la même beauté. Il faut dire aussi que tu bois.
ASTROV. – Oui… En dix ans, je suis devenu un autre homme. Et pourquoi ? Je me suis surmené, ma bonne. Du matin au soir, toujours sur pied. Je ne connais pas le repos. La nuit, j’ai peur qu’on me tire du lit pour me traîner chez un malade. Depuis tout le temps que nous nous connaissons, je n’ai pas eu un jour libre. Comment ne pas vieillir ? Et en elle-même la vie est ennuyeuse, bête, sale… Cette vie nous enlise. Autour de nous, rien que des toqués. En vivant avec eux deux ou trois ans, on le devient peu à peu, sans s’en apercevoir. Destin inévitable ! (Il tortille ses longues moustaches.) Tu vois, il m’est poussé une moustache énorme… Un monstre de moustache… Je suis devenu un toqué ! Bête, je ne le suis pas encore devenu : Dieu merci. Ma cervelle est en place. Mais mes sentiments se sont comme émoussés. Je ne veux rien, n’ai besoin de rien ; je n’aime personne… sauf toi peut-être… (il lui baise la tête.) Dans mon enfance, j’ai eu une nounou qui te ressemblait.
MARINA. – Tu veux manger, peut-être ?
ASTROV. – Non… La troisième semaine du grand carême, je suis allé à Malitskoïé où il y avait une épidémie : le typhus exanthématique. Dans les isbas, des corps partout… Saleté, puanteur, fumée. Les veaux, pêle-mêle avec les malades. Les petits cochons de lait aussi. J’ai travaillé toute la journée, sans me reposer ni avaler une graine de pavot. Et, rentré à la maison, on ne m’a pas laissé souffler. On m’avait apporté du chemin de fer un aiguilleur ; je le mets sur la table pour l’opérer, et le voilà qui me passe sous le chloroforme. Et les sentiments, quand il ne fallait pas, s’éveillent en moi ! Ça me pèse sur la conscience, comme si je l’avais tué exprès… Je m’assieds, je ferme les yeux, et je pense à ceux qui vivront cent ans, deux cents après nous, et pour lesquels nous déblayons aujourd’hui le chemin. Ceux-là honoreront-ils notre mémoire d’un mot aimable ? Ma bonne, ils ne se souviendront pas de nous !
MARINA. – Les hommes, non, mais Dieu s’en souviendra.
ASTROV. – Ah ! merci. Tu as bien dit cela.
Entre Voïnitski. Il a fait un somme après le déjeuner et a l’air défait. Il s’assied sur le banc et arrange son élégante cravate.
VOÏNITSKI, comme réfléchissant. – Oui… (Un temps.) Oui…
ASTROV. – Tu as bien dormi ?
VOÏNITSKI. – Oui… très bien. (Ilbâille.) Depuis que le professeur habite ici avec sa femme, la vie a changé de cours… Je ne dors pas à mon heure ; à déjeuner et à dîner, je mange toute sorte de sauces infernales ; je bois du vin… Tout cela est malsain ! Avant on n’avait pas une minute libre ; nous travaillions, Sonia et moi, je ne te dis que ça. Maintenant Sonia est seule à travailler ; moi, je dors, je bois, je mange… Ce n’est pas bon !
MARINA, hochant la tête. – Drôle de vie ! Le professeur se lève à midi et le samovar bout depuis le matin. Avant qu’ils n’arrivent, on dînait toujours vers une heure, comme on fait partout chez les braves gens, et, avec eux, on dîne vers sept heures. La nuit, le professeur lit et écrit, et tout à coup vers deux heures, on sonne… Imaginez cela, mes amis ? Il lui faut du thé ! Et que je te réveille les domestiques pour lui ; que j’installe le samovar. Drôle de vie !
ASTROV. – Resteront-ils longtemps encore ?
VOÏNITSKI, il siffle. – Cent ans ! Le professeur a décidé de s’installer ici.
MARINA. – Vois, le samovar est depuis deux heures sur la table. Et ils sont allés se promener.
VOÏNITSKI. – Les voilà qui arrivent… Ne t’agite pas.
On entend des voix. Du fond du jardin arrivent, revenant de la promenade, Sérébriakov, Elèna Andréïevna, Sonia et Téléguine.
SÉRÉBRIAKOV. – Points de vue merveilleux ! Très beau, très beau !
TÉLÉGUINE. – Remarquables, Excellence !
SONIA. – Papa, nous irons demain à l’établissement forestier. Veux-tu ?
VOÏNITSKI. – Messieurs, allons prendre le thé !
SÉRÉBRIAKOV. – Mes amis, ayez la bonté de m’envoyer du thé dans mon cabinet ; il faut encore que je travaille aujourd’hui.
SONIA. – L’établissement te plaira certainement.
Elèna Andréïevna, Sérébriakov et Sonia entrent dans la maison. Téléguine s’approche de la table et s’assied près de Marina.
VOÏNITSKI. – Il fait chaud, lourd, et notre grand savant a son pardessus, ses caoutchoucs, une ombrelle et des gants.
ASTROV. – C’est qu’il se soigne.
VOÏNITSKI. – Et comme elle est belle !… Comme elle est belle !… De ma vie je n’ai vu une femme si belle…
TÉLÉGUINE. – Que j’aille aux champs, Marina Timoféïevna, que je me promène dans un bois sombre, que je regarde cette table, je ressens une béatitude inexprimable. Le temps est magnifique, les oiseaux chantent, nous vivons tous en paix et en accord ; que nous faut-il de plus ? (Prenant un verre de thé que Marina lui présente.) Je vous suis sensiblement reconnaissant !
VOÏNITSKI, rêvant. – Elle a des yeux !… Une femme splendide !
ASTROV. – Raconte-nous donc quelque chose, Ivan Pétrovitch.
VOÏNITSKI, mollement. – Que te raconter ?
ASTROV. – N’y a-t-il rien de neuf ?
VOÏNITSKI. – Rien. Tout est vieux. Je suis le même que j’étais ; peut-être suis-je devenu pire, parce que je paresse, ne fais rien, et que je grogne comme un vieux barbon. Maman, ma vieille pie, parle toujours de l’émancipation des femmes. D’un œil elle regarde la tombe, et de l’autre elle cherche dans ses livres savants l’aube d’une vie nouvelle.
ASTROV. – Et le professeur ?
VOÏNITSKI. – Le professeur reste comme toujours du matin à la nuit noire dans son cabinet de travail, et il écrit. « Concentrant notre esprit, ridant le front, nous écrivons toujours des odes ; nous les écrivons et on n’entend de louanges ni pour nous, ni pour elles[2] . » Pauvre papier ! Le professeur ferait mieux d’écrire son autobiographie. Quel excellent sujet ! Un professeur en retraite, comprends-tu, un vieil homme sec, un cyprin savant ! La goutte, le rhumatisme, la migraine. De jalousie et d’envie, le foie hypertrophié… Le cyprin vit dans le bien de sa première femme, et y vit malgré lui parce que la vie, en ville, dépasse ses ressources… Il se plaint sans cesse de ses malheurs, bien qu’en réalité il soit extraordinairement heureux. (Nerveusement.) Voyez un peu quel bonheur ! Fils d’un simple chantre, boursier, il atteint des grades universitaires et une chaire. Il devient Excellence, le gendre d’un sénateur, etc. Tout cela d’ailleurs est sans importance. Mais écoute bien ! Cet homme, depuis vingt-cinq ans, fait des cours et écrit sur l’art sans y rien comprendre. Depuis vingt-cinq ans, il remâche les idées des autres sur le réalisme, le naturalisme, et toute autre ineptie. Depuis vingt-cinq ans, il professe et écrit ce que les gens intelligents savent, et ce qui n’intéresse pas les imbéciles ; c’est-à-dire que, depuis vingt-cinq ans, il transvase du vide. Et néanmoins quelle présomption ! Il a pris sa retraite, et pas une âme vivante ne le connaît. Il est totalement ignoré. Cela veut dire que, pendant vingt-cinq ans, il a occupé la place d’un autre. Et regarde-le, il marche comme un demi-dieu !
ASTROV. – Allons, il semble que tu lui portes envie !
VOÏNITSKI. – Oui, je l’envie ! Et quel succès auprès des femmes !… Aucun don Juan n’a connu un succès aussi complet ! Sa première femme, ma sœur, une créature charmante et douce, pure comme ce ciel bleu, noble, magnanime, qui avait eu plus d’adorateurs que lui d’élèves, l’aimait comme seuls des anges purs peuvent aimer des êtres aussi purs et aussi beaux qu’eux-mêmes !… Ma mère, son ancienne belle-mère, l’adore encore maintenant, et il lui inspire une crainte sacrée. Sa seconde femme, belle, intelligente – vous n’avez fait que la voir – s’est mariée avec lui quand il était déjà vieux ; elle lui a donné sa jeunesse, sa beauté, sa liberté, son éclat… Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi ?
ASTROV. – Elle lui est fidèle ?
VOÏNITSKI. – Hélas, oui !
ASTROV. – Pourquoi hélas ?
VOÏNITSKI. – Parce que cette fidélité est fausse d’un bout à l’autre. Il y a en elle beaucoup de rhétorique, mais pas de logique. Tromper un vieux mari qu’on ne peut pas souffrir, ce serait moral ; mais tâcher d’étouffer en soi sa malheureuse jeunesse et son sentiment vrai, ce n’est pas immoral.
TÉLÉGUINE, d’une voix plaintive. – Vania, je n’aime pas que tu dises des choses pareilles. Oui, c’est vrai… Qui trompe sa femme, ou son mari, n’est pas un être fidèle. Cet être-là peut vendre sa patrie !
VOÏNITSKI, avec ennui. – Ferme ta bouche, Grêlé.