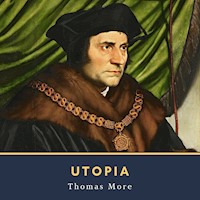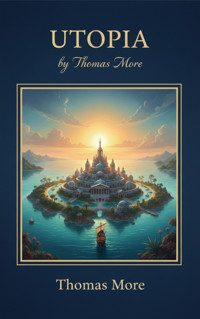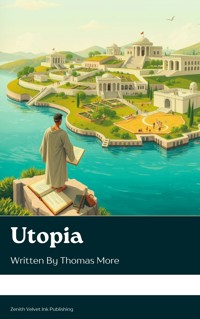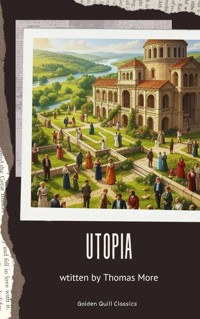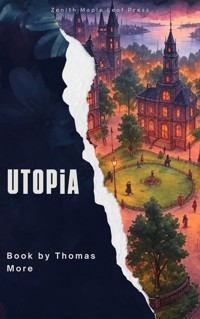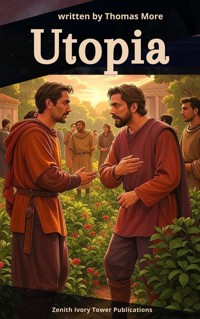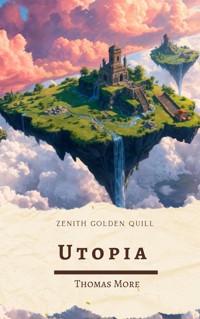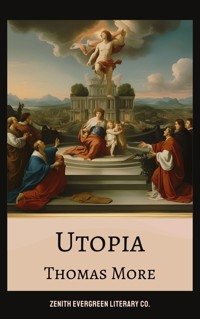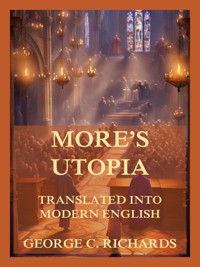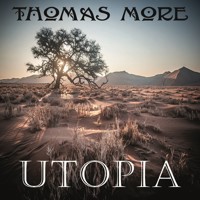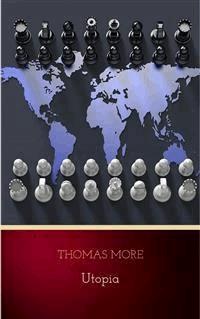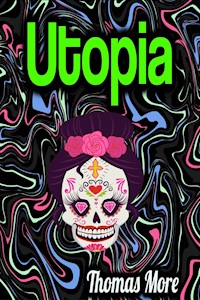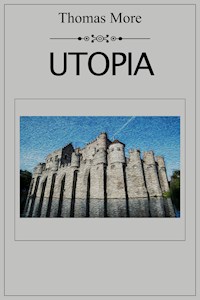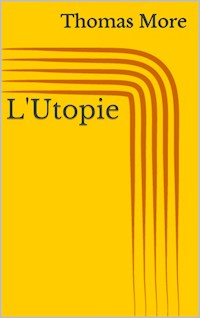
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Utopia" (le titre complet en latin est "De optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia, ou par extense, Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia") est un ouvrage de Thomas More paru en 1516. Il s'agit d'un livre fondateur de la pensée utopiste, le mot "utopie" étant lui-même dérivé de son titre. L'ouvrage a connu un succès particulier en France au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Le titre est construit d'après une racine grecque signifiant " lieu qui n'est nulle part ", "οὐ τοπος (ou topos)" en grec. Bien que Thomas More ne fût pas économiste, mais juriste, historien, théologien et homme politique, Utopia, qui n'était pas un traité d'économie, mais plutôt une satire de la société de son temps, fut repris au XIXe siècle, sans doute par un effet de biais, pour construire des théories économiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introduction
L’Utopie de Thomas Morus est un renseignement précieux pour les économistes qui étudient les diverses phases de la science sociale ; pour les hommes d’état attentifs aux développements de la politique anglaise.
Du reste, cette publication n’est pas l’œuvre de l’esprit de parti. Il y a loin de la société vraiment évangélique de Thomas Morus au communisme sensuel et athée de nos jours.
Une autre différence essentielle sépare l’Utopie de la plupart des systèmes de nos réformateurs modernes.
Ceux-ci brisent d’un seul coup les nationalités. La nationalité d’un peuple n’est pas, à leurs yeux, la ceinture de sa force et de son indépendance, mais la chaîne qui le retient esclave et affaibli. Ils font des plans immédiats pour le genre humain ; ils prennent tous les peuples à la fois, sans distinction d’âge ni de mœurs ; puis les jettent pêle-mêle dans le moule où doit se fondre la grande famille homogène, une, indissoluble.
Thomas Morus ne procède pas ainsi. Son livre n’est pas précisément le code du genre humain, ni le programme de la paix universelle. C’est plutôt une formule d’organisation intérieure et de politique extérieure, à l’usage d’une nation distincte qui, pour un Anglais, ne pouvait être que l’Angleterre. Cette nation, au point de vue de l’auteur, a sur les pays voisins la supériorité d’intelligence, de richesse, d’activité et d’influence. Peu à peu elle les absorbe dans sa propre substance ; elle les assimile à sa vie sociale par le commerce, la colonisation, la conquête. Cette assimilation progressive de plusieurs peuples en un seul n’est-elle pas la marche naturelle des choses ? Du moins, l’histoire tend à prouver que, jusqu’à présent ; telle a été la loi des destinées humaines.
La rédaction de l’Utopie est rapide, concise et méthodique ; on voit que l’auteur n’avait pas de temps à perdre, et qu’il se pressait d’enfermer une foule d’idées sous le plus petit volume. La forme de l’ouvrage est très simple ; c’est une conversation intime où Thomas Morus aborde ex abrupto les questions les plus neuves et les plus difficiles. Sa parole est tantôt satirique et enjouée, tantôt d’une sensibilité touchante, souvent d’une énergie sublime. Chez cet homme de bien, le cœur parlait aussi fort que la tête.
L’Utopie se divise en deux livres : l’un critique et l’autre dogmatique.
Le premier livre est le miroir fidèle des injustices et des misères de la société féodale ; il est, en particulier, le martyrologe du peuple anglais sous le règne de Henri VII. Ce prince, qu’une insurrection avait fait roi, eut à combattre plus d’une insurrection pour se maintenir. Il versa donc le sang de ses sujets ; mais sa préoccupation dominante fut de prendre leur argent, par tous les moyens qu’un pouvoir à peu près sans limite fournissait à la cupidité la plus effrénée. Il entassa impôts sur impôts, couvrit l’Angleterre d’un vaste réseau de prohibitions, de délits et d’amendes, et fit de la justice un vrai crible, par où il tamisait toutes les fortunes privées. Le Parlement, au lieu de résister aux ignobles instincts du monarque, lui servait absolument de machine à battre monnaie[1].
Le peuple d’Angleterre n’était pas seulement la victime de l’avarice de son roi, d’autres causes d’oppression et de souffrance le tourmentaient encore. La noblesse possédait, de commun avec le clergé, la majeure partie du sol et de la richesse publique ; et ces biens immenses, placés dans des mains paresseuses ou égoïstes, demeuraient stériles pour la masse des travailleurs. De plus, à cette époque d’anarchie, les grands seigneurs entretenaient à leurs gages une multitude de valets armés, soit par amour du faste, soit pour s’assurer l’impunité, soit pour en faire des instruments en toute occasion de violence ou de débauche. Cette valetaille était le fléau et la terreur du paysan et de l’ouvrier. D’un autre côté, le commerce et l’industrie de la Grande-Bretagne ne pouvaient avoir qu’une existence chétive et bornée, avant les voyages de Colomb et de Gama. L’activité infatigable de ce peuple, qui menace aujourd’hui d’envahir tout le globe, se consumait dans les guerres civiles, ne trouvant pas d’issue au dehors. Ainsi, les générations s’accumulaient sans but, sans travail et sans pain. L’agriculture tombait en ruine, parce que la culture proprement dite était délaissée pour l’élève des bêtes à laine, opération qui donnait alors de brillants bénéfices. En conséquence, les gros capitalistes accaparaient le sol outre mesure, changeaient les terres labourables en prairies ; ce qui réduisait une foule de gens de la campagne à la plus affreuse disette.
Ce triste état de choses multipliait nécessairement dans une progression effrayante la mendicité, le vagabondage, le vol et l’assassinat. Au lieu de guérir tant de maux par une administration habile et bienfaisante, les politiques du temps ne savaient leur appliquer d’autres remèdes que la prison et le bourreau. La loi anglaise était même sévère jusqu’à l’absurdité et la barbarie ; elle tuait indistinctement le voleur et l’assassin, pressée, pour ainsi dire, de noyer la misère publique dans le sang.
On concevra maintenant l’amertume des critiques et la violence des colères de Thomas Morus contre une société aussi profondément désorganisée. Sa malédiction est impitoyable pour le privilégié oisif et corrompu ; sa compassion, pleine d’amour et de larmes pour le malheureux qui travaille et qui souffre. Depuis l’Utopie, rien n’a été écrit de plus hardi, de plus neuf, de plus révolutionnaire et de plus démocratique en fait de démolition et de réforme. À lire ces pages toutes brûlantes de la passion de la justice, on croit entendre le jugement dernier des iniquités sociales, et comme une prophétie des terribles représailles exercées par Cromwell, et chez nous par 93.
Si l’auteur de l’Utopie est dans la vérité quand il attaque la législation et l’administration de son pays, il n’a pas le même droit d’accuser la politique de la France. Louis XII et François Ier étaient des types d’honneur et de loyauté auprès de souverains tels que Ferdinand le Catholique, Maximilien Ier, Jules II, Léon X et Henri VIII. Mais l’année où l’Utopie fut écrite (1516), le cardinal Wolsey, violant les traités d’avril 1515, payait secrètement l’invasion du duché de Milan par l’empereur, préparait une coalition contre François Ier, et cherchait à détacher le peu d’alliés fidèles à ce prince. Thomas Morus, que le cardinal avait récemment chargé d’une mission diplomatique en Flandre, devait subir l’influence de ces événements, sans parler de l’influence éternelle de l’antagonisme national. Voilà pourquoi il épouvante ses lecteurs du fantôme de l’ambition de la France ; rappelle à l’archiduc Charles ses mariages manqués avec les princesses Claude et Renée ; rappelle aux Vénitiens le traité de Blois et la ligue de Cambrai, qui leur reprit Crémone et la Ghiarra d’Adda ; pourquoi il justifie, par l’énumération de prétendus griefs, la violation flagrante des traités que la cour de Londres commettait alors.
Le plus singulier de ces griefs est dans le reproche adressé au ministère français de se méfier de la stabilité de l’alliance anglaise. Certes, il y avait de bonnes raisons pour cela ; et, au commencement du seizième siècle, cette alliance se manifestait déjà extrêmement inconstante et mobile. Depuis le 23 mars 1510 jusqu’en avril 1515, l’Angleterre avait fait avec la France trois traités d’amitié et de paix, et signé contre elle trois ligues de guerre offensive. À l’heure même où l’auteur de l’Utopie se plaint de la méfiance des ministres français, Wolsey continuait à ourdir cette suite d’intrigues d’où sortit la ligue défensive de Londres, du 29 octobre 1516[2].
Ainsi, l’on voit que Thomas Morus s’égare d’une façon étrange dans ses récriminations. En cette occasion et en plusieurs autres, il parle comme un véritable Anglais, toujours armé de ce patriotisme exclusif et partial, qui est le fond du caractère de cette nation, et constitue peut-être un des premiers éléments de sa force.
Néanmoins, il faut le reconnaître, cet homme, dont l’honnêteté était en exemple à son siècle, traversa le monde diplomatique avec dégoût. Sa conscience se trouvait mal à l’aise dans ces négociations, où l’ambition, le mensonge et la perfidie s’agitaient sous une enveloppe fastueuse de religion, de morale et d’honneur. Lui-même l’écrivait à son ami Érasme en ces termes : « Vous ne croirez pas avec quelle répugnance je me trouve mêlé à ces affaires de princes ; il n’est rien au monde de plus odieux que cette ambassade. » In negociis istis principum haud credas quàm invitus verser ; neque potest esse quicquàm odiosiùs mihi quàm est ista legatio. (Epistola ad Erasmum.)
Après avoir abattu, Thomas Morus se met en œuvre d’édifier. Il a convaincu de déraison et de vanité la plupart des institutions établies, flétri leurs turpitudes et leurs abus ; il a jeté par terre la vieille société. Il va dérouler, au second livre de son ouvrage, le plan d’une vie sociale toute nouvelle, que Platon avait rêvée, et que les premiers chrétiens pratiquaient volontairement, selon ces paroles des Actes :
« Tous ceux qui croyaient étaient égaux et avaient toutes choses communes. — Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun[3]. »
L’exposition du système utopien est facile à résumer.
L’Utopie est une île dont les habitants se divisent en cités égales pour la population et le territoire. — La cité se divise elle-même en familles égales pour le nombre des membres, mais qui professent chacune un métier, une industrie à part. — La propriété individuelle et les valeurs monétaires sont abolies ; tout appartient à la communauté.
Le gouvernement est électif et se compose d’un prince nommé à vie, mais révocable ; d’un sénat et de magistrats populaires.
Le sénat dresse annuellement la statistique générale de l’île. — Il vérifie l’état de la population, les besoins de l’année courante, la somme existante des produits de l’agriculture, du commerce et de l’industrie. D’après ces données, la richesse nationale est distribuée, par portions égales, à chaque cité, où elle se ramifie entre les familles, jusqu’aux individus. — Des lois particulières déterminent la durée journalière du travail habituel, règlent l’exécution des travaux extraordinaires et d’utilité publique, maintiennent l’équilibre de la population.
Les familles se perpétuent au moyen du mariage, tempéré par le divorce.
L’éducation est publique. Elle comprend un enseignement élémentaire, uniforme et commun à tous. Ensuite, elle devient professionnelle et spéciale, et se continue dans les cours publics, ouverts à tous les citoyens, pendant les heures libres.
Les peines des grands crimes sont l’esclavage et les travaux forcés, très rarement la mort, jamais la réclusion permanente et isolée.
Il y a une religion publique tellement simple et générale dans ses dogmes et les cérémonies de son culte, qu’elle ne peut heurter aucune conscience. Toutes les croyances sont protégées et respectées, à l’exception de l’athéisme et du matérialisme. La manifestation des doctrines de cette dernière espèce est prohibée ; on les regarde comme une dépravation attentatoire à l’existence sociale.
Finalement, les institutions utopiennes sont calquées sur la nature humaine, et n’ont en vue que son entier perfectionnement. Elles assurent d’abord à chacun la satisfaction des besoins légitimes du corps ; mais la vie de la chair n’étant que la moitié de l’homme, elles développent aussi soigneusement, chez tous les citoyens, l’exercice des facultés de l’esprit. En sorte que la science, la philosophie, la morale, l’industrie, les arts et la culture font en ce pays de merveilleux progrès.
Les mœurs du peuple utopien sont en harmonie parfaite avec ses institutions. L’on n’y connaît pas les vices qui dégradent, les passions qui troublent les individus, les familles et les états. La fraternité, l’amour de l’ordre et du travail, le respect des magistrats, le dévouement à la patrie, la foi religieuse, la modération dans le plaisir, le mépris du luxe et des distinctions frivoles y sont des vertus communes et ordinaires.
Thomas Morus omet souvent des détails nécessaires à l’intelligence complète et à l’application de son plan. Souvent il se contente de poser des principes et des faits généraux, de combiner les termes les plus simples du problème. Cependant, la solution qu’il donne est encore le produit d’un beau génie, et laisse en arrière bien des choses écrites ou innovées depuis trois siècles, en fait d’administration civile, de système pénitentiaire et d’éducation publique. Mais le mérite essentiel, le mérite principal de l’Utopie est d’avoir tenté une œuvre, dont la réalisation doit être sans doute la tendance caractéristique des progrès ultérieurs de l’humanité. Nous voulons parler de l’accord à établir entre les droits et les devoirs, la liberté et la loi, l’égalité et la hiérarchie, la science et la religion, le bonheur terrestre et la morale chrétienne.
Il a été dit, au début de cette introduction, que l’Utopie n’était pas précisément le code du genre humain, ni le programme de la paix universelle. Cela se confirme par la lecture du second livre, et la conduite de la république utopienne à l’égard de l’étranger. — La politique de ce peuple-modèle s’éloigne absolument des principes d’égalité et de justice, qui président à son organisation intérieure. Elle porte l’empreinte de ces temps de machiavélisme raffiné, où Thomas Morus composa son livre ; elle sent l’impure école de César Borgia.
L’Utopien, modeste dans la vie privée, est insolemment fier de la supériorité de son pays ; il méprise les autres nations, et prendrait de droit toute la terre, s’il en avait besoin, pour s’y loger et vivre. Ce peuple ne reconnaît pour alliés que ceux qui lui demandent des lois et des chefs, acceptent sa protection, son commerce et son empire. Non content de posséder au loin d’immenses territoires, il veut encore être l’arbitre des continents qui l’avoisinent. Quand l’honneur ou l’intérêt lui commandent une guerre, il commence par inonder le pays ennemi de proclamations, d’or et d’agents secrets, afin de soulever les révoltes et les déchirements ; de soudoyer la guerre civile et l’anarchie ; de pousser à la trahison les généraux et les ministres ; de provoquer à l’assassinat du chef de l’État et des hommes les plus dangereux. Si tous ces moyens de décomposition intérieure ne suffisent pas, il organise une coalition, et fait entrer en campagne les armées étrangères. Enfin il marche en dernière ligne avec ses auxiliaires ; le sang utopien est trop précieux, il ne faut le verser qu’après que le sang des alliés a fini de couler.
Ici la pensée se reporte, malgré soi, sur la conduite constamment suivie par les conseillers d’un état voisin ; et ces luttes systématiques, monstrueuses, que soutint la France pendant la révolution et l’empire.
Quoi que l’on fasse de cette observation, il est clair que le peuple utopien, souverainement juste, et humain chez lui et pour lui, se montre dans ses relations extérieures, souverainement despote, cruel et perfide.
D’où vient une contradiction aussi tranchée, de la part d’un écrivain dont la probité est devenue proverbiale ? On peut l’attribuer premièrement à une exagération patriotique mal entendue, mais surtout aux déceptions répétées que l’Angleterre avait subies, de 1511 à 1515.
Durant cette courte période, le cabinet de Londres s’était maladroitement mêlé des affaires d’Italie. Croyant enlever à la France deux ou trois provinces, il avait prodigué ses soldats et ses trésors au seul profit du roi d’Aragon, du pape et de l’empereur[4]. Ces mystifications ruineuses lui ouvrirent les yeux. Il comprit qu’il était la dupe de ses alliés, et qu’en définitive la ruse et la fourberie leur avaient servi, beaucoup plus qu’à lui l’audace et la victoire. Sans doute les diplomates anglais, et Thomas Morus avec eux, trouvèrent-ils convenable et utile d’adopter, en principe, cette politique inqualifiable, justifiée à leurs yeux par le succès, et dont la politique utopienne est la traduction[5].
Maintenant, quelques mots sur la communauté des biens, base essentielle des théories de Thomas Morus. Terminer ces prolégomènes, sans toucher de notre opinion personnelle à cette question célèbre, serait une discrétion vraiment inexplicable. Toutefois le cadre de cette publication ne se prête pas à une discussion approfondie, il ne peut admettre que des réflexions simples et brèves.
La communauté sociale est une idée ancienne, et les premières législations en offrent des applications remarquables. Dans nos sociétés modernes, les institutions les plus utiles, les plus conservatrices, les plus vigoureuses sont établies sur le principe de la vie commune. Ainsi, les armées, les maisons d’éducation publique, les hôpitaux, les prisons, les ordres religieux, etc. En général, partout où il faut une autorité robuste et absolue, pour soumettre une multitude à la même fonction, au même état, c’est le régime communautaire qu’il convient d’adopter. Il est certain que ce régime, mieux que tout autre, économise et recueille les forces, en diminuant les résistances.
Mais il y a plusieurs observations à faire.
Les communautés établies ne vivent pas d’une vie sociale, indépendante et complète. Elles sont organes d’un corps principal, qui leur communique le mouvement et la sève ;
Elles séparent les sexes et rejettent la famille. Cette mutilation simplifie admirablement leur mécanisme et leurs conditions d’harmonie ; mais elle suppose une société enveloppante qui les nourrit et les perpétue ;
Elles suppriment, à peu de chose près, la valeur et la liberté de l’individu, son droit d’initiative et de spontanéité. Ce qui peut éteindre l’émulation et le génie chez l’individu, et par suite comprimer le développement progressif de la masse ;
La rigidité de leur constitution despotique résiste naturellement à toute innovation qui ne vient pas d’en haut.
Enfin, elles se conservent par une violente contrainte ; et les 99/100 des hommes leur préfèrent les chances de la liberté la plus aventureuse.
Tout cela ne prouve pas que l’établissement de la communauté, sur une grande échelle, soit impossible. Cela prouve seulement qu’entre un système complet et les plans infiniment réduits des communautés existantes, il y a un abîme.
En fait, une communauté nationale et volontaire exigerait, pour subsister, le dévouement le plus héroïque, ou la plus haute raison. Cette forme, qui est le dernier terme de la perfectibilité sociale, ne paraît guère possible et sa durée concevable, qu’avec des fanatiques religieux, des chrétiens purs ; ou bien chez un peuple de Socrates et de philosophes presque divins[6].
Dans le premier cas, le principe social est l’immolation du moi humain, le crucifiement de la chair et de ses convoitises, le mépris de tout ce qui ne mène pas au salut éternel. Le riche se fait pauvre, à l’exemple de Jésus-Christ, par dévouement pour ses frères qui lui sont égaux en origine, en rédemption et en destinée. Il se débarrasse de sa richesse comme d’une chaîne qui l’attache à la terre, et l’empêche de s’élever à cette angélique union de l’âme avec la vérité, qui est Dieu. Des hommes spiritualisés à ce point sont très aptes et très disposés à mettre toutes choses en commun ; puis, à exécuter le peu de travail nécessaire à la conservation d’une existence aussi mortifiée. Les chrétiens de la primitive église en donnèrent une magnifique preuve.
Dans le second cas, la passion n’est ni tuée, ni maudite, ni émancipée ou développée indéfiniment ; elle est réglée par une raison et une morale. L’égoïsme, l’Orgueil et les avidités infinies du moi se soumettent à la justice. La vertu pour l’homme consiste à vivre suivant les lois de sa nature, à observer les rapports qui l’unissent à tous les êtres. Les sciences qui font connaître ces lois et ces rapports doivent être cultivées et perfectionnées. Il en est de même des arts, de l’industrie, de l’agriculture et du commerce, qui appliquent les données scientifiques à nos besoins, à nos usages ou à nos plaisirs. La religion sanctionne la morale, glorifie la science, et s’identifie avec elle ; cette alliance explique la foi et divinise l’intelligence humaine. Chacun est actionnaire social au même titre, parce que chacun travaille librement et de corps et d’esprit avec une égale perfection, ou du moins avec une égale ardeur.
Malheureusement ces deux hypothèses ne sont que brillantes ; et la réalité les brise comme verre.
Un peuple de Socrates est encore une chimère.
La philosophie, la raison pure n’ont rien produit, à part des livres, qui puisse faire espérer l’avènement prochain de la communauté. La philosophie a été plus stérile que le christianisme ; elle a manqué jusqu’à présent de vigueur créatrice, d’unité de principes, et d’une certaine discipline des intelligences.
D’un autre côté la vie ascétique des premiers chrétiens, cette vie suprêmement contemplative et sacrifiée, a bien pu réunir le petit nombre d’apôtres et d’adeptes d’une foi nouvelle ; mais, elle ne pouvait constituer un état normal et constant ; car elle appauvrit l’organisme, paralyse le développement de la nature sensuelle, débilite et immobilise la société politique, et compromet les destinées terrestres de l’humanité. Aussi, à mesure que le christianisme grandit, la faveur primitive diminue d’intensité en s’éloignant du foyer d’origine ; elle se refroidit au contact de la civilisation romaine, au milieu des affections et des soins de famille ; elle fléchit sous le poids des réactions passionnelles, et de mille servitudes de l’existence positive. Néanmoins, l’esprit de communauté ne fut pas perdu ; il éleva cette foule d’institutions religieuses et monastiques, véritables abstractions vivantes, qui ne sauraient servir de modèles, puisqu’elles sont édifiées sur la pauvreté, la continence et l’obéissance passive.
Que dire des doctrines matérialistes, qui prêchent la communauté en exaltant l’égoïsme et la fureur des jouissances ? Ces doctrines, considérées froidement, ont une tendance éminemment anticommunautaire. Elles détruisent le devoir, le dévouement, la morale et toute inspiration généreuse. Leur effet naturel, logique, est la dissolution des grandes masses sociales, le fractionnement des peuples en petites tribus. Aussi les matérialistes conséquents arrivent-ils à l’état sauvage ou à l’extrême tyrannie. Car, en l’absence de toute foi, de toute obligation divine ou de conscience, il n’y a qu’une tyrannie formidable qui puisse donner la cohésion et la forme à la poussière des individualités ; qui puisse brider l’insatiabilité des appétits, forcer au travail et à la ration, et protéger la parfaite égalité de tous contre les séditieuses attaques de la liberté de chacun. Mais alors quelle garantie assez terrible exiger de ceux qui tiennent la manivelle du pouvoir, qui sont les dépositaires et les distributeurs de la fortune publique ? Quelques uns pensent tourner la difficulté et faciliter la besogne en bestialisant la nature humaine. D’après cette théorie, l’homme n’est qu’une matière organisée pour la nutrition et la reproduction. Le libre arbitre, le génie, le progrès sont des superfétations dangereuses, autant que la science, les arts, l’industrie et le commerce. Chaque terre nourrit ses habitants, et deux ou trois métiers indispensables suffisent à leur entretien. La société prospère et multiplie comme un bétail précieux ; elle se gouverne comme un essaim d’abeilles. Supposons que ces dégradantes absurdités se réalisent aujourd’hui sur un peuple, il faudrait l’enfermer hermétiquement, afin qu’il ne fût pas troublé et envahi par l’activité et la civilisation du dehors. Outre cette cause de décomposition, il y aurait encore les ambitions de conquête soulevées à l’étranger par le singulier spectacle d’une nation descendue à l’état de ruche, ou convertie en parc d’animaux à l’engrais.
Notre conclusion, c’est que la communauté chrétienne, philosophique ou matérialiste, n’est ni dans les mœurs, ni dans les aptitudes, ni dans les intérêts de ce siècle. On peut dire avec T. Morus, lorsqu’il parlait de l’établissement du système utopien :
Je le souhaite plus que je ne l’espère.
Cependant, il serait téméraire d’affirmer que la communauté sociale est une idée absurde, et que sa réalisation est à jamais impossible. Cette loi divine et inviolable, par laquelle toutes les choses du monde sont gouvernées, nous est inconnue, aussi bien que la série des transformations séculaires qui affectent la nature humaine, et la conduisent lentement à ses mystérieuses destinées.
Notice bibliographique
Thomas Morus écrivit l’Utopie en latin, depuis le commencement jusque vers la fin de l’année 1516. Il revenait alors de Flandre, où il avait exercé une mission diplomatique, en compagnie de Cuthbert Tunstall, chef de l’ambassade.
À cette époque de sa vie, Thomas Morus, âgé de 34 ans, était syndic (vicecomes) de la cité de Londres. Cette magistrature consistait à rendre la justice dans les causes civiles, à régler ou à défendre les privilèges de la cité.
Les bibliographes ne sont pas d’accord sur la date précise de la rédaction de l’Utopie. La date que nous adoptons ici est la même que Stapleton assigne (Vita Thomæ Mori.). En outre, elle est clairement vérifiée par la lecture des premières lignes de l’ouvrage, et par la correspondance qui s’établit entre les savants au moment de son apparition.
Mais les Actes de Rymer ne laissent aucun doute à cet égard. Cette collection renferme, sous le titre Pro intercursu Mercium, des lettres-patentes données à Westminster, le 7 mai 1515, qui nomment Cuthbert Tunstall, Thomas Morus, écuyer, et trois autres Anglais, ambassadeurs en Flandre, avec plein pouvoir de conclure un traité de commerce entre Henri VIII, roi d’Angleterre, et Charles, prince de Castille.
Cuthbert Tunstall et Knyght, qui, plus tard, fut adjoint à cette ambassade, avaient en même temps mission spéciale de négocier la confirmation de la paix.
Il paraît que la députation anglaise fut très froidement reçue par le cabinet de Bruxelles, et qu’elle éprouva même certaine difficulté à entamer les négociations.
Quoi qu’il en soit, les conférences s’ouvrirent à Bruges, et furent interrompues presque aussitôt. Thomas Morus profita du loisir que lui laissait la suspension du congrès pour aller à Anvers.
C’est là probablement qu’il conçut l’idée et le plan de l’Utopie, en confia le secret à un petit nombre d’amis intimes, leur promettant de développer par écrit, à son retour en Angleterre, ce qu’il leur communiquait de vive voix, dans des conversations improvisées et fugitives. Du moins, il est naturel d’interpréter ainsi la fiction par laquelle Thomas Morus suppose que son livre est le simple récit d’un entretien qu’il eut à Anvers avec Raphaël Hythlodée, personnage entièrement imaginaire.
Les conférences diplomatiques furent enfin renouées, et le traité de commerce fut signé le 24 janvier 1516 à Bruxelles par les commissaires anglais.
C’est donc vers cette époque que Thomas Morus commença la rédaction de son Utopie, qui ne fut terminée que peu de temps avant le mois de novembre de la même année. Cela résulte suffisamment d’une lettre, datée du 1er novembre 1516, dans laquelle Pierre Gilles annonce à Jérôme Busleiden qu’il vient de recevoir le manuscrit de l’Utopie.
Les détails qui précèdent n’étaient pas inutiles ; ils avaient pour but de déterminer un point douteux, quoique intéressant de bibliographie. Mais une considération d’une autre espèce en justifiait encore l’opportunité.
L’on sait que la moralité personnelle d’un homme, la trempe particulière de son génie, ne sont pas les seules causes qui modifient la nature et la forme de ses productions littéraires. La position de l’écrivain, son entourage, et divers autres agents externes, projettent sur ses œuvres des lueurs ou des ombres bien marquées.
En sorte qu’un livre est la résultante visible de toutes les forces individuelles et sociales qui sollicitent habituellement l’âme de l’écrivain.
Il n’était donc pas indifférent de rechercher avec exactitude les événements au milieu desquels l’Utopie fut composée, et la part que Thomas Morus prit à ces événements. Car il est possible de trouver dans cette connaissance, et l’origine même de l’ouvrage, et l’explication des sentiments et des principes que l’auteur y a déposés.
L’Utopie, n’étant encore que manuscrit, fut communiquée à plusieurs savants, qui la reçurent avec bonheur, comme une primeur littéraire de haute qualité. Pierre Gilles, ami de l’auteur, l’avait reçue directement de lui, quelque temps avant le 1er novembre 1516 ; il s’occupa bientôt après de la faire imprimer à Louvain, en ajoutant au texte original l’alphabet utopien, un fragment de la langue utopienne et des notes en marge. Cette édition, qui est certainement la première, parut vers la fin de décembre 1516, suivant Panzer et Brunet.
Henri Hallam, dans son histoire littéraire de l’Europe (XVe, XVIe et XVIIe siècles), affirme qu’une édition de l’Utopie avait paru à la fin de l’année 1515. Cette assertion nous semble inconciliable, soit avec les faits, soit avec les épîtres qui accompagnèrent l’apparition de cet ouvrage.
La deuxième édition est celle de Bâle, imprimée par Jean Froben, l’an 1518, 1 vol. in-4°. L’on y trouve les deux livres de l’Utopie, six épîtres latines, les exercices (progymnasmata) de Thomas Morus et de William Lelly, une pièce de vers grecs de Melanchton, adressée à Érasme, les épigrammes de Thomas Morus et d’Érasme, et des gravures en bois dont deux ont été faites sur les dessins d’Holbein. La bibliothèque de la ville de Bordeaux possède un exemplaire de cette édition, exemplaire qui a servi à rédiger cette traduction nouvelle.
L’Utopie, dès qu’elle fut publiée, obtint un succès prodigieux ; elle excita comme un tumulte d’enthousiasme dans le monde des philosophes et des savants. Alors, le moyen âge tombait déjà en poussière ; une aspiration immense se faisait de toutes parts vers un nouvel avenir ; des géants d’érudition et de travail entassaient volumes sur volumes pour combler l’abîme de dix siècles de ténèbres et frayer un chemin à la marche si longtemps arrêtée de l’antique civilisation. Tous ces hommes laborieux s’émurent et s’inclinèrent devant le génie, presque divin, qui leur avait révélé la république utopienne. Les uns admiraient la hardiesse, l’originalité et la profondeur de la conception, les autres louaient particulièrement la verve, la pureté et la spirituelle aisance du style.
Guillaume Budé, le patriarche de la science en France, trouvait dans l’Utopie la trace d’un esprit supérieur, une grâce infinie, un savoir large et consommé ; il n’hésite pas à placer l’auteur de ce livre au nombre des premières gloires littéraires de son temps et à lui consacrer un autel dans le temple des muses. L’Allemagne paya aussi son tribut ; et une lettre de l’helléniste B. Rhénanus, à Bilibalb Pirckhémer témoigne assez que le talent et le nom de Thomas Morus y étaient en grande estime.
Il devait en être ainsi à une époque où l’éloge récompensait, sans exception, toute espèce de travail d’intelligence ; où la critique eût été absurde, parce qu’il fallait sortir au plus vite de la barbarie du passé, et que, pour cela, tous les efforts, tous les ouvriers étaient bons. Néanmoins, ces louanges, qui nous semblent aujourd’hui ridicules, n’étaient pas déplacée, en s’adressant à l’Utopie ; car ce livre, au commencement du XVIe siècle, était une œuvre de génie et même de bon goût. Érasme, il est vrai, avait publié ses Adages, et Budé son traité de Asse, ouvrages étonnants qui éclairaient enfin la nuit de l’antiquité, et qui déployaient la plus vaste connaissance des littératures grecque et romaine. Mais il n’avait pas encore paru de création plus originale, plus brillante que celle de l’Utopie ; l’on ne pouvait rien lire, ni de plus fortement pensé, ni de plus facilement écrit.
Thomas Morus était déjà connu des gens de lettres par de petites comédies, des dialogues, des épigrammes en latin et en grec, qui ne sont pas sans mérite. Son latin, plus vif et plus coulant que celui de Budé, ne le cède qu’à celui d’Érasme ; sa phrase est parfois obscure et embarrassée ; mais elle crépite çà et là de traits étincelants qui frappent l’attention et la réveillent.
Les principes exposés dans l’Utopie