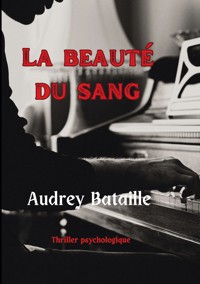
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Henri Lécroux, né en 1983, grandit dans une solitude glaciale, négligé par des parents chercheurs en mathématiques. Très tôt, il trouve refuge dans la musique de Chopin, mais c'est Dracula qui réveille en lui une fascination pour l'obscur. Au fil de son enfance, des déviances commencent à s'installer, façonnant un esprit de plus en plus isolé et tourmenté. Pour devenir un pianiste exceptionnel, il se convainc qu'il lui faut l'adrénaline d'un meurtre. À 17 ans, Henri se reconnaît psychopathe, un diagnostic qui alimente ses désirs de pouvoir et de contrôle. Ce récit est son monologue, une plongée dans ses pensées dérangées où obsessions, meurtres et musique se mêlent, l'entraînant inexorablement vers la gloire qu'il recherche à tout prix sur fond de trahison, de secret inavoué.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Il n’y a sans doute rien de plus émouvant dans une vie d’homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué. »
Michel Tournier
Table des matières :
Livre divisé en trois parties.
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Première partie
Je m’adresse à vous, dossier sur les genoux, stylo glissant entre vos doigts pour simuler votre allégresse. Votre autre main grattant votre menton vous trahit.
Vous souhaitez compléter nos entretiens et les examens que j’ai subis pour me poser un diagnostic, alors laissez-moi vous guider.
Je m’appelle Henri Lécroux et pour faire simple, je suis un psychopathe. C’est la seule certitude qui me reste.
Ce n’est pas un médecin psychiatre dans un bureau hideux qui me l’a dit. Je me suis auto-diagnostiqué.
Comment j’ai identifié ce désordre psychique ? Mon comportement différait quelque peu de celui des autres. J’en avais conscience, mais j’ignorais l’existence du terme qualifiant mes troubles de la personnalité.
C’est en l’an 2000 que j’ai trouvé, dans le grand Robert, la définition de psychopathe :
Psychiatrie – Déséquilibre psychique, caractérisé par une déficience du contrôle des émotions et des impulsions, l’incapacité d’adaptation au milieu menant à des conduites antisociales.
Et pour être sûr du diagnostic, je suis retourné à la lettre A du dictionnaire.
Antisocial – L’individu antisocial est décrit comme un individu « non socialisé » produisant des comportements conflictuels envers la société. Il est décrit comme égoïste, sans empathie ni sentiment de culpabilité.
J’avais 17 ans et ces définitions m’ont permis d’exister. Puisque même un antisocial a besoin de reconnaissance.
Être rangé dans une case, ça fait du bien.
Ça m’a aussi conforté dans le choix d’arrêter de faire des efforts pour essayer de ressentir des émotions. J’aurais aimé que tout le monde le sache.
« Ne vous épuisez pas et ne m’épuisez pas. Je suis un psychopathe et votre sympathie m’est totalement indifférente. Vous constaterez vite que la qualité de ma compagnie, rejoint la froideur que je me fais de la vôtre.»
Je suis né en 1983 et j’ai grandi entouré de parents mathématiciens indisponibles, trop occupés à faire des recherches sur les théories des nombres et des ensembles. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’ils ont choisi de me donner le prénom du mathématicien, qui a découvert le chaos : Henri Poincaré. Le chaos est dans mes cordes, sans formules mathématiques aucune.
Ma solitude s’est construite petit à petit, au fil des années. Je ne saurais dire si je suis né ainsi ou si c’est la vie qui m’a façonné. En l’occurrence, je peux affirmer que je suis doté de circonstances atténuantes.
Et pendant qu’Alex assaisonne ses pâtes sèches avec des épices troquées contre une promesse de protection, je vais vous raconter mon histoire. Tenté de vous livrer, à votre demande, la chronologie exacte, la précision des détails et mes émotions enfouies au fin fond de ma personnalité troublée.
Écrire permet, à la différence de nos entretiens verbaux, de réfléchir avant de coucher les mots sur le papier.
Mes affres vous seront donc livrées de façon soigneuse et minutieuse.
1986
Ce sont les souvenirs les plus lointains qu’il me reste. J’avais trois ans.
Mes parents et moi habitions rue Louis Pasteur, à Alberty-Ville, dans une grande maison que ma mère avait héritée de son paternel. Une maison bourgeoise, entourée, avec un parc, un étang, un bosquet, un grand piano à queue, des tableaux de maîtres, des moulures et tout ce qu’il faut pour se faire taper à la récréation.
J’avais même une nounou qui s’est occupée de moi jusqu’à mes 10 ans. Elle s’appelait Suzanne. Elle était déjà vieille, à l’époque et elle sentait le terreau.
La main verte, elle dépotait, elle rempotait, elle s’occupait des heures entières dans le jardin. C’est avec elle que j’ai découvert la nature. Chaussé de bottes de pluie, je l’accompagnais au potager. Elle me faisait enlever les mauvaises herbes, elle me laissait jouer avec les escargots et m’apprenait à reconnaître les feuilles des différentes espèces d’arbres et de plantes.
Elle ne s’opposait pas à ma culture de colimaçons. Je me permettais de cueillir les plus dodus d’entre eux, pour le plaisir de les contraindre à s’épanouir dans ma boîte en plastique, garnie de salade, plutôt que de les laisser évoluer dans leur milieu naturel.
Suzanne me souriait presque tout le temps. Elle était douce et patiente.
Cette année-là a été marquante, car mes parents, Maryse et Jules Lécroux, sont partis pendant huit mois à l’étranger pour leurs travaux de recherches et de statistiques en mathématiques. C’est donc Suzanne qui les a remplacés. Elle s’est installée dans la maison rue Louis Pasteur. En s’improvisant maman de substitution, elle me prépara de bons petits plats à base de légumes ramassés directement dans le jardin.
Dans la cuisine silencieuse, le chant des grillons était la seule nuisance sonore que nous subissions. Nous étions assis, tous les deux, à la petite table face à la fenêtre ouverte. Le vent amenait le rideau fluide jusqu’à mes chevilles et les caressait.
Suzanne me laissait équeuter les haricots verts qu’elle faisait cuire dans une espèce de chaudron. J’étais petit et la grosse gamelle en cuivre me paraissait sortir de la maison d’une sorcière.
En les mangeant, je me souviens avoir fait la grimace plus d’une fois. Comme beaucoup d’enfants, je préférais les aliments de couleur jaune et frits, si possible.
Un après-midi d’août, Suzanne est sortie de la cuisine tenant un gâteau qu’elle avait fait elle-même. Trois bougies allumées et plantées dedans, elle s’était approchée de moi précautionneusement en me chantant l’air approprié à la situation : Joyeux anniversaire.
Je n’étais qu’un garçonnet à peine sevré de lait infantile et pourtant, je m’en souviens encore. Le cœur qu’elle mettait à me donner un peu de joie en l’absence de mes parents m’avait touché, c’est vrai. Mais le vide que je ressentais à l’intérieur construisait peu à peu ma déchéance.
Début septembre.
C’était Suzanne qui m’avait réveillé pour mon premier jour d’école, en maternelle. Elle m’avait pris en photo dans la cour de la maison. Elle souriait, elle était fière.
Cette photo, je l’ai conservée et seul ce support me rappelle mon entrée à l’école.
Toutes ces années restent vagues pour moi. J’ai chassé de mes pensées les cours préparatoires et élémentaires. On peut oublier les agressions, les coups, les intimidations et bien que l’abandon de la mémoire aide à combattre le passé, celui-ci reste planté en vous de manière indélébile et fait de vous ce que vous êtes et ce que vous serez.
Parfois, j’assiste à ces scènes en tant que spectateur. Je me revoie me faire rouer de coups, près des toilettes de l’école, par cette brute de Jonathan Walter et de son acolyte Sébastien Girard : les stars de l’école. Du moins, c’était l’air qu’ils voulaient se donner.
En réalité, ils figuraient parmi les personnes les plus détestées et craintes. La puissance et le contrôle qu’ils exerçaient sur les autres obligeaient la majorité d’entre nous à en faire des tonnes, à les flatter, à leur vouer une dévotion hypocrite, sournoise, mais nécessaire. C’était le comportement qu’il fallait adopter pour ne pas faire partie de leurs victimes.
Moi, jeune garçon introverti, j’ignorais l’usage de ces codes.
C’était mon seul ami de l’école, Toby Lebourg, qui me dictait les bonnes pratiques sociales. Je me souviens qu’il portait une veste marron avec un col chemise. Il posait une main sur mon épaule, me regardait droit dans les yeux et prenait une posture dominante :
— Tu dois t’effacer devant eux. Toi, plus qu’un autre. Mais s’ils te donnent l’impression de s’adresser à toi, adhère à tout ce qu’ils te disent, ok ? Sans en faire des tonnes... S’ils plaisantent, ris tranquillement, sans effusion.
J’ai essayé de faire partie de la majorité. Je leur ai souri, j’ai ri à leurs blagues stupides. Je ne les ai jamais contredis. Mais malgré mes efforts contrôlés, Toby avait raison. Je devais en faire plus qu’un autre. Disons que la vie n’avait pas été clémente avec moi et que, injustement, je le payais cher.
Je suis né avec un relâchement d’une de mes paupières : un ptôsis. J’ai donc un œil rétrécit, presque fermé. L’autre, bien expressif, semble être la seule fenêtre que je veux bien laisser ouverte sur ce monde.
Ce regard déséquilibré était un motif idéal pour servir de punching-ball. Les obèses, les défavorisés mal fringués s’en sortaient mieux que moi. J’étais la cible parfaite. Et pour motiver davantage leur choix, j’avais la fragilité de ne pas être soutenu par mes parents.
C’était d’ailleurs à chaque fois que je passais le portail de l’établissement scolaire, que leur absence me paraissait plus qu’évidente et anormale. En voyant les parents de Toby attendre dehors quotidiennement, j’ai commencé à observer les autres enfants. Il n’y en avait pas un, sur toute l’année scolaire, qui n’a pas dit le mot « maman » ou « papa » en s’adressant à la personne qui venait les chercher. J’étais le seul. J’étais toujours seul.
Sur le trajet de l’école, le soleil dans le dos, je me consolais en regardant mon ombre. Je remuais mes épaules et jouais des jambes pour avoir le sentiment d’être accompagné. Les mouvements sombres sur le macadam de la rue Louis Pasteur, donnaient de la vie à ma solitude. J’imaginais un frère faisant l’imbécile devant moi. Il m’aurait alors incité à faire la course jusqu’à notre maison familiale et nos parents auraient ri de nous voir ainsi, enjoués.
La réalité était tout autre. Le portail de la maison passé ; je retraversais l’entrée sans âme, abandonnée, dépourvue de vie. Il n’y avait pas de manteau dans la penderie. Le porte-parapluie était vide et sec. Aucune odeur de crêpes ou de gâteaux ne venait stimuler mon odorat. Aucun pas ne sonnait le carrelage.
Depuis l’entrée, je voyais le piano à queue imposant, qui était le cœur de la propriété. Il était placé à l’intersection de toutes les autres pièces. L’escalier menant à l’étage était également une des artères reliées à l’instrument. Je restais là, à attendre. Je naviguais dans les pièces démesurées, espérant l’arrivée de Suzanne.
Elle venait préparer le repas tous les soirs pour mes parents et moi. Repas que je prenais seul. Mes parents rentraient aux environs de 23 heures. J’entendais la porte claquer, depuis ma chambre, et je me couchais aussitôt. Il n’était pas nécessaire d’aller les voir. Quelquefois, la porte de ma chambre s’ouvrait et je distinguais un faisceau lumineux à travers mes paupières closes. Ils devaient vérifier que j’étais encore là, vivant ! Pourtant, la porte de ma chambre ne s’ouvrait pas tous les soirs. Un contrôle de temps en temps devait leur suffire.
Au cours de mon année de CM1, Suzanne s’est montrée plus présente.
Je l’avais surprise, un soir, au téléphone. Recroquevillée contre le buffet de la cuisine, de dos à la porte et surveillant la cuisson des pommes de terre qui doraient dans la poêle, elle parlait à ma mère. Dissimulé derrière l’encadrement de la porte de la cuisine, j’espionnais la conversation.
— Je voudrais pouvoir manger avec lui le soir… il est seul en permanence et cela me chagrine de préparer le repas et le quitter, le laissant livrer à lui-même…
Je m’étais retiré tout doucement et m’étais collé contre le mur du couloir. J’avais alors ressenti une vive émotion. Quelqu’un souffrait de me voir seul. Quelqu’un avait senti ma tristesse, ma détresse et voulait prendre soin de moi.
À partir de cette soirée, Suzanne a dîné avec moi tous les soirs et, de fil en aiguille, elle a négocié avec ma mère pour me sortir de la maison quelques heures par semaine. Elle m’a emmené partout. Au musée, au parc d’attractions, dans les boutiques, à la piscine.
Nous sommes devenus complices et lorsque mes parents étaient présents physiquement les soirs, je voyais ma mère tendre de l’argent à Suzanne. Ainsi, par ce geste, elle lui déléguait mon éducation.
Je me souviens du jour où elle m’a emmené à la fête foraine. Je montais dans sa voiture et je souriais. Je fixais ma ceinture de sécurité avec entrain. Je savais que je passerais un bon moment. Suzanne se confiait à moi. Derrière la barbe à papa gigantesque qu’elle m’avait offerte, elle me parlait comme à un adulte.
— Tu sais, tu es gâté de faire des sorties. Ma petite-fille n’a pas cette chance. Quand on n’a pas d’argent, on ne fait rien. On attend. Je ne peux pas le faire pour elle, alors ça me réconforte de le faire pour toi !
Je ne comprenais pas ce qu’elle me disait. Tout en faisant fondre la boule cotonneuse édulcorée sous mes doigts collants, j’imaginais sa petite-fille attendre assise sur une chaise, face à la porte d’une cuisine, d’un salon, d’une chambre… ma vie d’avant ! Rien d’extraordinaire en sommes. Cette attente interminable, je l’avais vécue aussi… alors pourquoi pas sa petite-fille !
Je profitais de ces instants avec Suzanne. Cela me rendait plus fort. Elle possédait un visage maternel.
Les rides qu’elle cumulait au coin des yeux figeaient ses fous rires d’antan, sa joie de vivre à toute épreuve. Son teint hâlé respirait la santé et malgré son âge, elle gardait en elle des traits juvéniles. Elle se mordait la lèvre inférieure et une malice étincelait son regard lorsque je commettais une maladresse. Ensuite, elle explosait de rire et dévoilait ses dents, petites et serrées, manquant de place, se superposant les unes sur les autres. Ses imperfections assumées la rendaient unique. Avec des dents droites et alignées, elle aurait perdu en saveur.
Je me suis attaché à elle.
Elle est venue à presque toutes mes sorties d’école cette année de CM1. Je n’étais plus seul. Je ne jouais plus avec les ombres, rue Louis Pasteur. Elle était bien réelle cette personne qui m’accompagnait. On se souriait, on se parlait. Toby la saluait devant le portail de l’école. Les autres voyaient que j’avais quelqu’un dans ma vie, aussi, tout comme eux. Je m’étais redressé ! Mon œil fermé n’était plus qu’un détail.
D’ailleurs, me voyant plus ouvert sur le monde et accompagné dans ma vie privée, Jonathan Walter et Sébastien Girard ont cessé leurs agissements néfastes envers moi. J’étais en paix.
Un mercredi après-midi, Suzanne m’a emmené dans les magasins. Elle avait décidé que je pourrais choisir un lecteur CD portable. Déjà équipé d’un Walkman à cassettes audio, cette fois, c’était avec fierté que je quittai l’enseigne de multimédia, arborant un objet révolutionnaire dans la main.
Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mes parents étaient présents et ils avaient préparé le dîner. Cela n’était jamais arrivé. La table était dressée et ils ont demandé à Suzanne de rester pour manger. Ce fut le meilleur dîner de mon existence. Nous avons échangé, tous les quatre, dans la bonne humeur. Je pense que mes parents, par cette action, remerciaient Suzanne de me divertir et de me faire grandir à leur place.
Lors de ce repas, Suzanne exposa à nouveau ses problèmes financiers :
— C’est tellement plaisant de voir la joie dans le regard d’Henri lorsque je l’emmène se divertir. Je ne peux pas me permettre de le faire avec ma petite-fille et cela est bien dommage. Elle a seulement trois ans de moins qu’Henri, ils s’entendraient bien !
Suzanne regarda mes parents à tour de rôle cherchant une réaction de leur part, mais ils n’exprimèrent rien sur l’instant. Embarrassée, elle baissa la tête et regarda l’assiette de légumes persillés devant elle. Puis, ma mère prit soudainement la parole :
— Suzanne, je trouverais ça fabuleux que vous preniez votre petite-fille, à présent, lors des sorties avec Henri.
— Euh… je doute que ce soit une bonne idée, lâcha mon père.
— Et pourquoi pas ? Henri aurait de la compagnie…
— J’ignore si c’est bien, voilà tout… Oh et puis… débrouillez-vous entre femmes…
Mon père se leva et se dirigea au bar, non loin de notre table à manger, se servir un digestif qu’il avala cul sec. Il posa son verre bruyamment et il hérissa ses cheveux dans ses mains. Je le regardais.
Pendant ce temps, ma mère et Suzanne discutaient de l’intégration de la fillette lors de nos prochaines sorties récréatives. Suzanne était ravie. Malgré tout, elle avait ressenti le malaise que mon père avait perpétré. Celui-ci ayant quitté la pièce, elle s’excusa auprès de ma mère, en chuchotant :
— Je ne voulais pas déclencher une tempête entre vous.
— Ne vous en faites pas Suzanne, il s’y fera.
Elles paraissaient complices. Leurs regards se connectaient et elles se comprenaient sans même avoir besoin de verbaliser.
— Sur ce, je vous laisse pour ce soir. Merci beaucoup madame Lécroux de permettre à Charlotte de s’épanouir aussi.
Elle s’appelait donc Charlotte cette petite-fille qui allait me voler l’attention que Suzanne me portait.
Appuyé contre le piano, je la regardais partir. Ma mère lui serra la main.
Pourquoi mon père avait-il eu une réaction aussi abusive ? Avait-il des problèmes d’argent qui le dissuadait de financer les prochaines sorties de Charlotte ? En regardant partout autour de moi, cela me semblait peu probable. De la richesse, il y en avait partout, du sol au plafond. De plus, ils travaillaient sans relâche, blanchissant de craie leurs deux grands tableaux noirs dans leur bureau. Là où s’entassaient des formules de mathématiques illisibles.
Ma mère salua Suzanne une dernière fois de la main et se retourna. Elle me sourit.
— Est-ce que ça te fait plaisir que sa petite-fille vous accompagne pour les prochaines sorties ?
— Oui ! Enfin, je ne sais pas trop… elle est encore petite !
— Elle a six ans. C’est vrai, c’est encore petit. Mais tu pourras lui apprendre des choses !
Ce soir-là, ma mère était douce et disponible. Moi qui ne l’avais jamais trouvée jolie, aujourd’hui, elle rayonnait. Elle restait là, avec moi, on discutait simplement. Neuf ans d’existence sans que cela ne se produise. Pour quelle raison ? Fallait-il l’intervention de Suzanne pour que sa sensibilité de mère se décrispe ?
— Tu peux lui apprendre des choses, tout comme moi, je peux t’apprendre le piano !
Son visage s’éclaira et elle s’assit sur la banquette de l’instrument imposant. Elle avait pris soin de placer sa longue jupe plissée marron d’un côté de l’assise. Elle tourna les partitions qui se trouvaient sur le pupitre. Je me tenais debout, à sa droite, je la regardais chercher un morceau qu’elle pourrait jouer sans hésitation, sans fausses notes.
Sa tête se penchait vers le pupitre. Elle portait des petites lunettes rondes. Je la voyais froncer ses sourcils devant les titres des morceaux de musique. Elle continuait de tourner les pages jusqu’à s’arrêter net, d’un coup. Le visage détendu, elle se tourna vers moi.
— Tu es prêt pour ta première leçon ?
Je regardai immédiatement la partition sur laquelle elle choisissait de performer. Il était écrit Frédéric Chopin – Nocturne op.55 no.1 en fa mineur.
Dans mon Walkman, je n’avais écouté que les titres de David Bowie prêtés par Suzanne. Depuis qu’elle l’avait vu en concert lors de sa tournée ‘‘Glass Spider tour’’, elle s’était enquise de tous ses tubes. Je connaissais Ziggy Stardust par cœur. J’aurais pu la chanter, à voix haute, sans avoir à rougir de mon anglais. Mon accent était semblable à celui de Bowie. C’est ainsi lorsqu’on apprend des textes phonétiquement.
Le choix musical de ma mère, ce soir, était tout autre.
— Je vais jouer cet opus et ensuite tu pourras essayer de te familiariser avec l’instrument. Observe bien la position de mes doigts !
Par un mouvement de tête, j’acceptais son offre. Je n’avais jamais entendu ma mère jouer, jusque là. J’ignorais son niveau. J’avais longtemps pensé que ce piano se trouvait là comme signe de richesse. À l’entrée de la maison, histoire d’impressionner instantanément les visiteurs… ce meuble monstrueux symbolisait le haut niveau culturel que les gens aisés veulent se donner.
Ma mère regarda vers le plafond et souffla un grand coup. Elle fit une sorte de gymnastique des doigts. Elle pencha son cou côté gauche puis côté droit. Était-ce obligatoire ?
Elle commença à frapper les touches et sa nuque s’inclina largement vers l’avant. Elle n’avait pas besoin de regarder le clavier. Dès les premières notes, elle semblait être comme « habitée ». Ses deux mains, concentrées vers le centre des 88 touches, prenaient la posture de deux aranéides en plein ballet. Ses doigts étaient courbés, ce qui donnait assez d’aplomb pour que le marteau frappe la corde, associée à la touche, et fasse profiter du son qu’émet sa vibration.
C’était du génie !
Je pouvais ressentir la passion de ma mère. Elle jouait avec une dextérité incroyable. Son visage pouvait tantôt se crisper, tantôt se relâcher et elle rejetait une sorte de souffle retenu. Comme s’il ne fallait pas expirer trop bruyamment et gâcher, ainsi, la mélodie.
Moi, je profitais du spectacle. Voir ma mère exulter devant mes yeux, c’était de l’ordre de l’intime. Je partageais un moment privé avec elle.
Et le fait de me sentir aussi proche de ma mère n’était pas le seul plaisir que je ressentais.
Cette musique… D’où venait-elle ? Comment pouvait-on passer à côté ? À la seconde où ma mère a fait vibrer la première corde, j’ai compris. Les accords qui ont suivi n’ont fait que confirmer l’adoration que je portais au son émit par l’instrument.
Durant l’écoute de cet opus, je me suis laissé attraper comme on pourrait se vulnérabiliser volontairement et accepter la domination de quelqu’un sur nous. Je ressentais la moindre vibration jusque dans mes tripes.
Cette délicatesse et ce romantisme interprétés musicalement, ressemblaient à de l’improvisation tellement les doigtés étaient fluides. J’arrivais tout de même, malgré mon âge, à deviner l’intensité du travail pour en arriver à ce niveau de perfection.
Je n’avais pas écouté la version de Chopin, mais celle de ma mère valait au moins la sienne.
À la fin du nocturne, ma mère fixa quelques secondes le pupitre, face à elle, sans dire un mot. Il lui fallait un petit temps d’adaptation, afin que la magie mystérieuse qui avait plané durant ces quelques minutes, disparaisse et que l’entrée de la maison retrouve sa fonction normale. Je la regardais et j’attendais. Des rides d’amertume se fissurèrent le long des commissures de ses lèvres.
Je pense qu’elle était émue.
Elle se leva, reprit sa jupe et la replaça élégamment le long de ses jambes, me regarda et me dit :
— Et bien ! Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué… Est-ce que cela t’a plu ?
— Oui, beaucoup, vraiment… j’ai adoré t’écouter et ça me donne envie de jouer, mais j’ai un doute quand même.
— Quel doute ?
— Je ne sais pas si on prend autant de plaisir en jouant qu’en écoutant !
Elle me fit un sourire et se baissa quelque peu pour atteindre ma hauteur.
— Tu as pris du plaisir en écoutant, n’est-ce pas ?
— Oui !
— Et bien, dis-toi que quand tu joues, c’est cent fois pire !
On s’est mis à rire tous les deux. Elle m’a même touché le dos lorsqu’à mon tour, j’ai investi la banquette du piano. Elle a réglé l’assise et a commencé à m’expliquer ce que je voyais devant moi : le clavier.
— Tu vois la touche noire est toujours associée à la touche blanche voisine. Ce sont les mêmes notes, mais d’une tonalité différente. Écoute… ce « do » est un demi-ton en dessous que le « do » de la touche blanche.
Elle était penchée au-dessus de moi et guidait mes mains. Elle m’a montré les différentes notes, les octaves, les dièses et les bémols. J’ai commencé à jouer quelques accords de façon très scolaire.
Dans ma tête, les notes défilaient, la nostalgie des sons me pénétrait. Je n’étais qu’au tout début de mon apprentissage, mais le rêve était permis : rivaliser avec ma mère et ne faire qu’un avec l’instrument.
Le pianiste et le piano étaient, selon moi, aussi important l’un que l’autre. Le pianiste initiait la mélodie, il frappait les touches, mais il n’était pas responsable de la qualité du son qu’il en ressortait. Le mécanisme du piano m’impressionnait tout autant que la maîtrise du musicien. Jouer de cet instrument, c’était comme être au service de quelqu’un d’important. On se devait d’être bon.
Il était tard. Je n’ai pas levé les yeux pour lire les aiguilles de la grosse pendule. Je ne voulais pas que ça s’arrête, mais je me souviens avoir entendu la voix grave de mon père, qui parlait depuis le haut de l’escalier menant à l’étage.
— Tu viens ? Tu crois que c’est en jouant du piano que tu vas obtenir la médaille Fields ?
— Oui, oui ! J’arrive !!...
Ma mère mit ses mains sur mes épaules.
— Je suis désolée, Henri. C’est vrai que je concoure pour un prix prestigieux en mathématiques. J’ai du travail. On remet ça, hein ?
— Oui, d’accord, je vais continuer à m’entraîner.
— Euh… je n’avais pas vu l’heure ! Il vaut mieux aller te coucher ! Bonne nuit !
Et elle partit à l’étage me laissant à nouveau seul. Je me sentais moins stimulé sans elle. Je tournai les pages du livre de partitions et je tentai de déchiffrer la musique. Décidément c’était comme les travaux de mes parents en mathématiques : indéchiffrable !
Je ressentais la froideur de la solitude. J’avais réellement froid, physiquement. La température des murs de la maison, glacés comme le marbre, infiltrait mes tissus jusqu’à atteindre le siège symbolique où se concentrent les émotions : le cœur. Ces murs et ces plafonds, témoins d’aucune manifestation affectueuse, d’aucun fou rire, ne vibraient que par le bruit sec du tic-tac de la vieille pendule de l’entrée. L’environnement glacial et inodore de la maison austère pesait lourd. Je manquais d’aisance. Personne ne me permettait d’exister en tant qu’être humain.
Qui aurait pu prétendre connaître mes goûts… mes désirs, mes envies ?
Mes parents savaient-ils, au moins, si j’obtenais de bons résultats scolaires ? Non… personne ne s’intéressait au petit garçon que j’étais. Mon cœur d’enfant se figeait par l’écrasante lourdeur de la charpente, qui me piégeait chaque jour, dans cette maison sans âme.
Je suis monté à l’étage pour gagner ma chambre. Dans le couloir, j’ai entendu mes parents s’engueuler derrière la porte de leur suite parentale.
— Je trouve que Suzanne prend beaucoup de place. Elle s’embête pas quand même de vouloir ramener sa petite-fille à nos frais ! Et puis après ce sera qui ?
Je collai mon oreille contre la porte.
— Tu exagères, Suzanne qui s’occupe d’Henri depuis sa naissance ! Tu te rends compte que ce soir, c’est la première fois que je passe du temps avec ! Quand j’y pense, ça me rend dingue !
— Laisse tomber, essaie de gagner ce concours, déjà !
J’entendais les pas de mon père qui s’approchaient de la porte. Je déguerpis de façon mesurée, afin de ne pas faire craquer le plancher.
Après une soirée comme celle-là, les mots de mon père ont résonné en moi toute la nuit. Ça devait être à cause de lui que je me retrouvais toujours seul. Il poussait ma mère à travailler. Sûrement qu’elle était meilleure que lui. Elle me l’avait prouvé en jouant au piano. Si elle se trouvait aussi douée en mathématiques, cela ne me surprenait pas qu’elle se déplaçait aux quatre coins de la planète pour exposer ses travaux de recherches.
Les jours suivants furent monotones. La présence de ma mère était redevenue inexistante. Je me retrouvais à nouveau orphelin. Connaître la chaleur d’une mère — même si ce n’était que le temps d’une soirée — rendait la cassure d’autant plus frustrante. Je me suis même demandé si l’attention qu’elle me porta, le soir-là, je l’avais réellement mérité.
C’était étrange. J’ai commencé à pisser au lit. Pas toutes les nuits. Peut-être qu’une fois par mois… ou deux...
Suzanne était au courant, c’est elle qui s’occupait du linge de la maison. Elle ne me grondait pas. Elle prenait les draps, en silence et se dirigeait vers la buanderie. Nous n’en parlions pas. Cela m’arrangeait.
En parallèle de mes énurésies nocturnes, j’ai rencontré la fameuse Charlotte.
Un mercredi après-midi, Suzanne est venue me chercher. Nous sommes allés au parc Briau à Alberty-Ville, à pied. Il faisait beau, nous approchions de l’été et la fin de mon année de CM1 s’annonçait.
La petite-fille de Suzanne donnait la main à sa grand-mère. Je marchais du côté de la route, à l’opposé de Charlotte. Mes yeux roulaient dans sa direction sans qu’elle ne le remarque. Elle tenait, dans sa main, une espèce de chiffon troué par des mordillements et durci par une accumulation de salive séchée. Je voyais deux nattes qui dépassaient de sa main. Il se pouvait donc que ce tissu usé soit, en réalité, une poupée coiffée d’une tresse de chaque côté de sa tête, qui se trouvait elle-même écrasée par la main de la gamine.
Elle était bruyante. Elle chantait et elle se dandinait faisant vaciller Suzanne. Je pensais alors, que l’avoir avec nous perturberait notre tranquillité. D’emblée, je pouvais dire que je ne l’aimais pas. Je ne voulais pas apprendre à la connaître.
Arrivés au parc équipé de jeux pour enfants, je suis allé à la balançoire, seul, comme d’habitude. Je ne l’ai pas attendue. Je n’ai pas cherché à savoir auprès de Suzanne s’il fallait que je prenne Charlotte par la main et la guider pour sa première sortie à trois. Elle était la petite-fille de Suzanne, elles étaient liées par le sang et n’avaient qu’à se débrouiller entre elles.
Malgré tout, j’ai quand même cherché à l’impressionner. Alors que j’avais escaladé la façade de la structure de jeux et que je longeais une poutre en bois, protégée par un filet, à plus d’un mètre du sol où on voyait au travers, je la regardais fièrement de ma hauteur. Elle stationnait sous mes pieds et jouait dans le sable qui recouvrait le sol de presque toute la surface où s’étaient dressées les différentes aires de jeux et portiques proposés au parc Briau.
Je vérifiais qu’elle était témoin de ma hardiesse. Et lorsqu’elle me regardait, j’en faisais des tonnes. Je passai une petite porte qui me mena à une corde afin de regagner le plancher des vaches. Mes mouvements étaient brusques, mon regard devait être, je le devine, condescendant. J’avais trois ans de plus qu’elle et il fallait que ça se voit.
Tous les gamins font cela, je crois.
Suzanne restait assise sur un banc et tricotait. Je l’observais de temps à autre pour voir l’implication qu’elle nous consacrait. Je ne voulais pas qu’elle décharge son rôle de grand-mère sur moi. C’était à elle de surveiller Charlotte. Elle semblait concentrée sur son tricot et ne relevait pas le nez.
J’eus une idée.
Je suis devenu mielleux avec la gamine. Je crois qu’elle n’attendait que cela, d’ailleurs. Alors qu’elle était assise dans le sable, je lui ai tendu la main. Elle a saisi la mienne, s’est hissée et je me suis retrouvé face à son visage porcelaine, les yeux dans les yeux. Elle m’a souri. Son semblant d’attachement m’importait peu. Ceci dit, je lui ai rendu son sourire histoire de la mettre en confiance.
J’ai traîné la blondinette jusqu’à la balançoire. J’ai choisi l’assise la plus haute pour justifier de mon aide. Je l’ai portée et je l’ai installée dessus. Ce fut un peu laborieux, mais j’y suis arrivé. Je faisais tout de même une tête de plus qu’elle.
Charlotte n’était jamais vraiment sortie de chez elle. Se retrouver perchée sur une balançoire dans une aire de jeux, avec un enfant, devait représenter beaucoup pour elle. Je l’ai déchiffré dans son regard et je m’en suis servi, c’est vrai…
Elle riait pendant que je me faufilais derrière son dos pour commencer à la pousser. Elle savait qu’elle allait enfin profiter des sensations dont rêve tout gosse normalement constitué, lorsqu’il se rend sur ce genre de portique. Du moins, c’est ce qu’elle a dû penser à ce moment-là.
J’ai regardé une dernière fois Suzanne. Elle statuait toujours sur son tricot bleu pétrole. J’ai donc agi.
Charlotte riait de décoller ainsi. Ses pieds s’élevaient dans les airs et sa robe rouge se soulevait et laissait apparaître ses jambes immaculées, dénuées d’hématomes ou de griffures, signe qu’elle inaugurait sa vie de petite fille intrépide à cet instant même. Je continuais à la pousser. Son dos revenait de plus en plus rapidement contre mes mains ouvertes et érigées vers le ciel. Elle a commencé à brailler. Je pense que la vitesse et la hauteur l’inquiétaient. Ses pieds ne touchaient pas le sol et j’étais la seule personne en mesure de stopper sa peur. J’ai continué. Mais pas longtemps. Il ne fallait pas sortir Suzanne de son tricot tout de suite. Toutefois, il ne fallait pas traîner. Cela s’est passé très vite.
Alors que son dos se rapprochait de moi, il était temps d’agir. J’ai saisi brutalement le siège de la balançoire avec mes deux mains et je l’ai bloqué net. Charlotte a été éjectée de l’assise et a hurlé. Au sol, elle s’est recroquevillée et elle a pleuré très fort. Elle se tenait la jambe. Je me suis approché.
Suzanne, alertée par les cris, a enfin quitté son tricot. J’avais réussi. C’est tout ce que je voulais. C’était à elle de s’occuper de sa petite-fille, non à moi. Elle le saurait maintenant. Elle m’a regardé, paniquée et m’a demandé d’aller à une cabine téléphonique appeler du secours. J’ai aperçu la blessure de Charlotte. Sa jambe laiteuse de tout à l’heure ressemblait maintenant à une image que j’avais vue à l’école, en cours d’anatomie. On pouvait voir ce qui s’apparentait au muscle, c’était rouge, filandreux et du sable s’infiltrait dans sa plaie.
Puisque je me dois de faire un effort pour livrer mes émotions, je peux dire que cela ne m’a pas dégoûté. A priori, vu mon jeune âge et mon absence d’exposition à ce genre d’accident, j’aurais dû avoir des nausées, ressentir une sorte de malaise. Il n’en était rien. Je n’ai pas deviné sa souffrance non plus. J’ai vu qu’elle pleurait, mais cela ne m’a pas inquiété.
J’ai fait ce que Suzanne m’a dit. Je suis allé dans une cabine téléphonique, qui se trouvait dans le square. Les pompiers sont arrivés très vite. Suzanne est montée avec eux, pour accompagner Charlotte. Elle avait besoin de soin. Elle pleurait un peu moins et elle m’a regardé bizarrement lorsque les secouristes l’ont embarquée dans le camion. Suzanne m’a demandé de rentrer sagement chez moi, à pied. C’est ce que j’ai fait.
En passant la porte d’entrée, je n’y pensais presque plus. Je me suis installé sur le piano et j’ai commencé à faire des gammes. Je pianotais sur le « do » du milieu du clavier jusqu’au « do » de l’octave suivant. J’écoutais les sons. Je tentais, avec ma voix, de les reproduire. Je forgeais mon oreille à la musique. Avec l’instrument greffé au bout de mes doigts, je me sentais fort. Il était toujours là… disponible pour moi. Avec sa taille imposante, il ne risquait pas de m’être enlevé.
C’est cet instrument qui m’a aidé à occuper mon esprit et oublier quelque peu ma solitude.
Ce soir-là, mes parents sont rentrés plus tôt.
Ma mère avait été prévenue que Suzanne ne serait pas présente pour préparer le dîner. Elle s’est approchée de moi pour me questionner.
— Que s’est-il passé avec la petite Charlotte ?
— Je crois qu’elle s’est blessée au parc de jeux.
— Tu crois ?... Suzanne m’a appelé pour me prévenir.
— Elle t’a dit quoi ?
— Rien de précis. Sa petite-fille est sortie de l’hôpital, mais elle doit rester avec elle. Je suis rentrée rapidement, sinon tu n’aurais pas eu à manger. D’ailleurs je vais lui téléphoner.
— Est-ce que je peux écouter ?
— Oui…
Je ne m’inquiétais pas spécialement pour l’état de santé de la fillette, mais je voulais connaître les répercussions que mes agissements engendreraient. Après cet accident, reverrais-je Suzanne ?
Ma mère composa le numéro en plantant son index dans le cadran rotatif de l’appareil couleur cumin. Je saisis l’écouteur que je plaçai sur mon oreille gauche. La sonnerie aigüe qu’émit le téléphone me déboucha aussitôt le conduit auditif. Je l’éloignai de quelques centimètres. À l’autre bout de la ville, Suzanne devait quitter le chevet de Charlotte pour décrocher le combiné.
— Allô ?
— Bonsoir Suzanne. Je voulais prendre des nouvelles de la petite…
— Merci, ça va. Elle a moins de douleurs, mais elle va avoir une belle cicatrice. Sa plaie est assez étendue.
— J’en suis navrée.
— Moi aussi… je croyais qu’Henri s’occupait d’elle. Je n’ai rien vu venir. Je pensais qu’il sentirait qu’il fallait la protéger. C’est de ma faute tout ça…
— Non, Suzanne, ne culpabilisez pas. Cela arrive tout le temps. Les enfants ne se rendent pas compte du danger.
Suzanne pleurnichait un peu au téléphone. J’entendais ses mots se hacher. Elle exhalait des soupirs convulsifs. Elle reprit le dialogue :
— Et je suis désolée pour Henri… Je vais être contrainte de rester avec ma petite-fille. Je ne pourrai plus assurer sa garde quelque temps… vous savez… je ne pourrai pas compter sur la mère de Charlotte…
— Euh… oui… Bien entendu Suzanne. Je vais m’arranger pour être là les soirs. C’est bientôt la fin de l’année scolaire. Henri aura moins d’impératifs horaires. Tenez-nous au courant. Au revoir.
Je reposai l’écouteur sur le socle et ma mère se mit à peler des carottes.
— Tu ne surveillais pas la petite Charlotte ? me lâcha-t-elle.
— Ce n’était pas à moi de le faire.
Je restai là, figé, un blanc s’installa. Puis je repris :
— Pourquoi la mère de Charlotte ne peut pas s’occuper de sa fille ?
— Elle a des soucis. Elle est souvent hospitalisée.
Ma mère quitta l’économe et la carotte à moitié pelée, s’essuya les mains dans un torchon et me regarda.
— Suzanne fait ce qu’elle peut. Elle est fatiguée. Il va falloir que tu en fasses un peu plus maintenant. Je ne sais pas quand elle reviendra ni même si je pourrai être là tous les soirs. Tu peux te faire à manger, seul ? Suzanne t’a un peu appris ?
— Je crois que je pourrai me débrouiller… c’est pas important tout ça… Par contre, y’a quelque chose que j’aimerais.
— Quoi ?
— Je voudrais encore entendre Frédéric Chopin opus 55 n°1 en fa mineur.
Ma mère arrêta définitivement de se défouler sur le tubercule et me fit un sourire.
— D’accord, viens !
Elle sortit de la cuisine et demanda à mon père, qui buvait un scotch au bar de notre salle à manger, de continuer à préparer le repas. Celui-ci se leva, accompagné de son verre et s’exécuta.
Rendez-vous dans l’entrée de la maison. Je repris exactement la même place que pour sa première représentation. Elle régla la banquette, choisit la partition, souffla, leva la tête et ses doigts brandirent sur le clavier bicolore. Elle y mit encore plus d’ardeur. J’eus d’ailleurs la frayeur que son enthousiasme la fit se perdre dans les accords. Mais c’était comme réciter un texte que l’on aurait appris par cœur depuis des décennies : peu importe l’émotion et la vivacité qu’on y mettait, on ne se trompait jamais. Et elle me prouva encore qu’elle excellait sur ce morceau.
C’était ma deuxième écoute. Je ressentais encore de la surprise. Je pensais alors qu’il me faudrait de nombreuses écoutes pour simplement m’y habituer. Je pensais aussi que le temps que je passerais sur terre ne suffirait pas à me lasser de cet opus. Je compris que le son de ce piano, actuellement, demeurait la seule source de plaisir qu’il m’était donné de ressentir.
Une fois ma mère debout, je me suis mis à l’applaudir chaleureusement. Elle a bien senti que l’instrument était spécial à mes yeux.
C’était la seule chose qui nous unissait, jusqu’à présent et je pris la décision de travailler dur pour l’impressionner, pour la rendre fière. Le but étant de me sentir aimé d’elle et de briser ma solitude extrême.
— Suzanne ne t’avait pas emmené dans un magasin choisir un lecteur CD ?
— Si !
— Viens, suis-moi.
Elle m’emmena dans la suite parentale. Cette pièce était immense et une ouverture de la même largeur que celle d’une porte se situait au milieu d’un des murs perpendiculaires à celle de l’entrée de la chambre : leur bureau ! L’endroit où se dressaient les deux grands tableaux noirs chargés de poussière de craie. Des papiers recouvraient les meubles, des piles de livres se superposaient à certains endroits, au sol. Des étagères contenant ouvrages en tout genre dissimulaient les murs. C’est vers l’une d’elle qu’elle me dirigea.
— Regarde, me dit-elle.
Des dizaines de CD campaient dans un des compartiments du meuble. Et pour mon plus grand plaisir, il n’y figurait que de la grande musique. Je vis rapidement Chopin sur plusieurs coffrets ; Chopin nocturnes sur l’un d’eux. Je vérifiai immédiatement au dos de la jaquette si l’opus 55 y figurait. Et, oui, il y était. Entre les toiles d’araignées, j’aperçus également les noms de Mozart, Beethoven, Debussy, Brahms et d’autres. Bien sûr, ce sont des noms que j’avais déjà entendus. Nous avions un poste de télévision et une radio… Je possédais un minimum de culture générale.
Mais j’allais pouvoir les côtoyer, les tutoyer, sentir et ressentir la musique par le biais de mon lecteur Sony gris métallisé.
— Tu peux en prendre quelques-uns, dans un premier temps. Ton père n’aime pas trop que tu viennes ici… c’est vrai, tu pourrais effacer nos recherches sans le vouloir… mais si tu veux de la musique, demande-moi !
Je n’ai pris que du Chopin. Ces trois compilations m’attendaient, au milieu de cette étagère. Les tenants fermement dans ma main, je regardai les tranches des livres rangés verticalement dans un autre compartiment. Le panel de lectures me semblait bien fourni.
Tous les genres y figuraient ; de la fiction aux livres de sciences, en passant par des romans dédiés aux jeunes lecteurs. Des BD remplissaient un compartiment entier. J’ignore pourquoi je fus attiré par Dracula de Bram Stoker. Sûrement à cause de la police d’écriture… ou parce que j’avais entendu parler de ce personnage énigmatique qui fascine par le doute de son existence réelle, entre mythe et réalité… le dégoût de l’apparence faussement humaine du comte qu’on s’en fait et le besoin de croire en quelque chose dont nous ignorons tout, qui nous dépasse. C’était pour toutes ces raisons que, de mon index, j’ai délogé l’œuvre de l’étagère empoussiérée. Sans demander l’accord de ma mère qui me regardait, surprise. Elle s’approcha de moi.
— Ce livre t’intéresse ?
— Oui, enfin, je crois !
— Attends… je ne sais pas si c’est pour toi. Tu n’as que neuf ans et cette histoire est un peu… euh…
— J’ai bientôt 10 ans !
Elle me prit le livre des mains pour chercher l’âge légal des lecteurs de cet ouvrage.
— C’est 12 ans ! me dit-elle en levant le livre près de son visage.
— Ah ! Je vais devoir attendre. Le temps sera long sans Suzanne. Un livre que je trouvais intéressant m’aurait occupé l’esprit.
— Tu peux t’exercer au piano en attendant. Elle replaça le livre à sa place. Et tu as les CD à écouter !
— Oui… c’est déjà ça. C’est vraiment dommage que toi et papa ne soyez pas plus présents, à la maison. Je me sens seul la plupart du temps.
Elle émit un soupir de désespoir. Elle allongea son bras gauche et reprit le livre discordant. Elle le tendit vers moi et tout en se baissant :
— Retiens bien que c’est une fiction. Malgré tous les fantasmes que ce personnage représente, les vampires n’existent pas. D’accord ?
— Oui, d’accord.
Je quittais donc la pièce chargée de ces trois CD et de ce roman non approprié à mon âge. J’avais réussi.
En attendant que le repas soit prêt, j’ai investi le fauteuil de ma chambre. Casque aux oreilles, CD de Chopin bien calé dans le lecteur, j’ai appuyé sur Play. Je disposais de l’opus 55 à ma guise. Je voyais cela comme une grande avancée. Les notes défilaient dans ma tête. J’ignorais réellement leurs noms, mais j’arrivais à entendre.
Entendre les doigts, enfoncer les touches.
Entendre et visualiser la position des mains sur le clavier.
Entendre et différencier les notes blanches des notes noires.
Cela m’était livré comme un cadeau. C’était comme si Chopin infusait son génie en infiltrant sa musique jusqu’à mon cerveau. De mes tympans jusqu’à mes étriers, à proximité de ma matière grise, le son vibrait et pénétrait ma mémoire. Je le ressentais. Les connexions se faisaient. Je chopais l’oreille musicale !
Et c’est dans cette lancée mystique, que j’attrapai le livre de Bram Stoker.
Après seulement quelques pages, au chapitre II, Jonathan Harker rencontrait le comte de Dracula.
« … à peine avais-je franchi le seuil qu’il vint vers moi, se précipitant presque, et de sa main tendue saisit la mienne avec une force qui me fit frémir de douleur — d’autant plus que cette main était aussi froide que de la glace et ressemblait davantage à la main d’un mort qu’à celle d’un vivant. »
Ma mère m’avait prévenu. C’était de la fiction. Et pourtant… Je ressentais quelque chose en lisant ce roman. Additionné à l’écoute des nocturnes de Chopin, je me sentais moi-même. Et j’avais un avantage. Le CD et le livre étant des objets, je pouvais les utiliser dès que je le souhaitais. C’était différent des gens qui vont et qui viennent, qui ont toujours des obligations, des priorités et qui vous laissent dans la solitude la plus complète.
Les oreilles déjà prises, je n’entendais pas ma mère qui m’appelait pour venir dîner. Elle s’introduisit dans ma chambre :
— Bah alors, ça fait 10 minutes que je t’appelle ! On mange !
— Je viens tout de suite.
Je laissai, le temps du repas, l’œuvre de Bram Stoker. Le casque posé sur le lit, j’abandonnai le piano un instant. La mélancolie en fa mineur de Chopin associée à la demeure froide et vide du comte de Dracula collait parfaitement à ma misanthropie débutante. Je sentais que les choses étaient en train de changer. Les prémices d’une mutation s’installaient en moi.
Avec le recul que j’ai, à présent, je peux dire qu’ainsi, je me protégeais du sentiment d’abandon. Suzanne ne viendrait plus, pour le moment. Et bien que mes parents essaieraient d’être plus présents, il n’y avait là aucune garantie. L’instabilité grandissait en moi ainsi que la colère. Je ne pouvais pas compter sur le genre humain. C’était la musique et la lecture, notamment Chopin et Dracula, qui me serviraient d’exutoire.
Lors du repas, avec mes parents, nous avons un peu discuté.
— On mange rapidement, faut que tu bosses tes recherches, entama mon père.
— Oui, mais ça devrait aller… j’ai bien avancé.
— C’est quand même pour la médaille Fields.
— Et pourquoi tu ne concours pas ? intervins-je.
J’osai m’immiscer dans la conversation voyant mon père qui mettait, sans cesse, la pression à ma mère pour cette médaille !
— Je l’ai déjà tentée ! Mais à présent, je suis trop vieux, voilà tout ! C’est un prix réservé aux mathématiciens de moins de 40 ans. Ta mère n’a plus que cette année. On n’a pas le choix, c’est notre dernière chance.
Ma mère haussa ses sourcils. Elle semblait blasée par l’esprit de compétition de mon père. Je crois qu’elle aurait préféré rester là, à la maison, et avoir une vie normale comme les parents de Toby. Il avait toujours ses deux parents avec lui. Sa mère faisait des gâteaux, vérifiait ses devoirs et le weekend, il lui arrivait de bricoler avec son père.





























