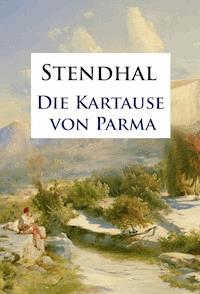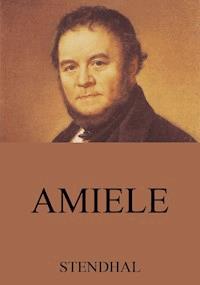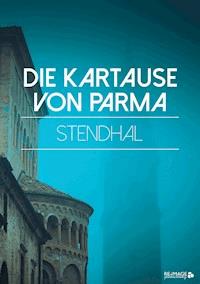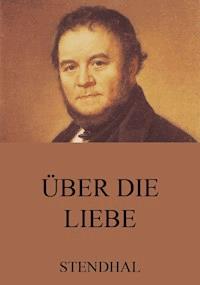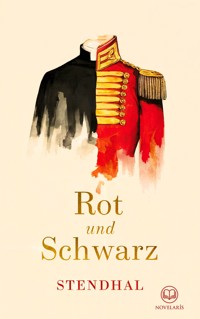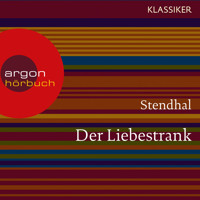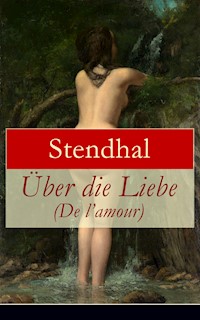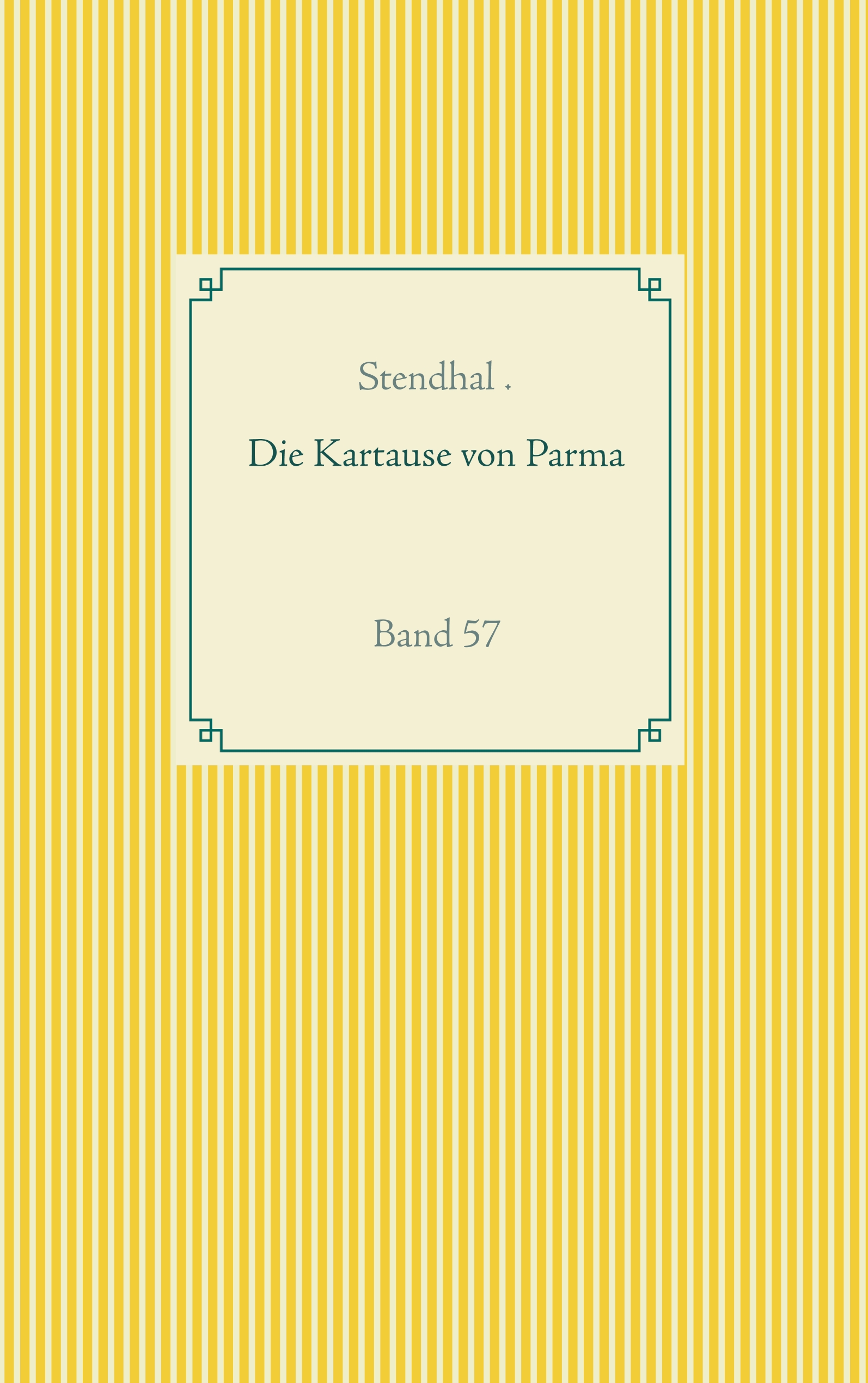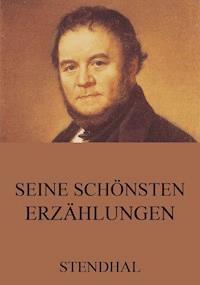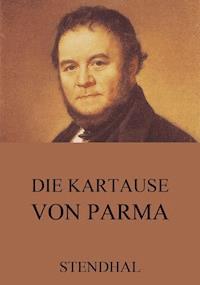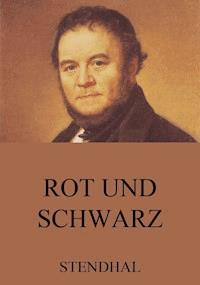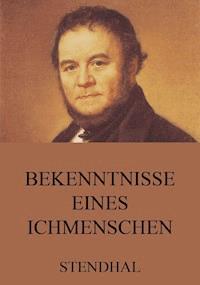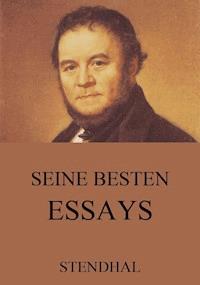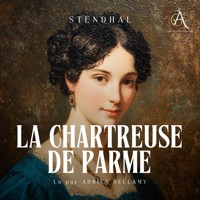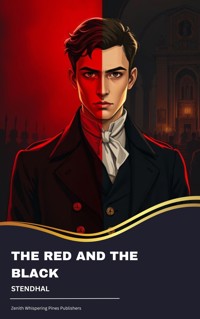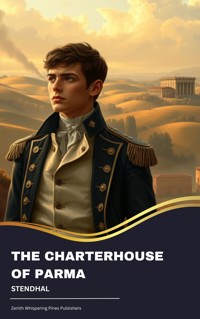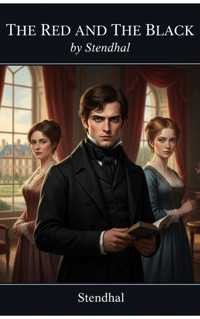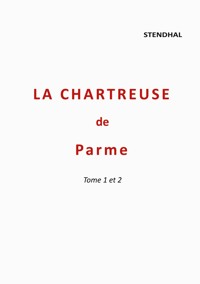
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Chartreuse de Parme est un roman de Stendhal, paru en deux tomes. C'est l'une des oeuvres majeures de l'auteur qui lui valut plus tard sa célébrité. Nous avons publié dans le même livre le tome 1 et 2. Ce roman s'inspire des guerres napoléoniennes et raconte l'histoire de Fabrice del Dongo, un jeune noble italien qui quitte son confortable château familial pour rejoindre l'armée napoléonienne. Résumé Le 15 mai 1796, les Français de Bonaparte envahissent le milanais. En vertu du droit de l'occupant, le leutenant Robert est logé chez les Del Dongo.Il y fait connaissance du marquis et de son fils Asciano, conservateur obtus et de la jeune et pétillante soeur du marquis, Gina avec qui il aura une liaison. Cette dernière accouchera d'un enfant: Fabrice. A dix sept ans, Fabrice décide d'aller rejoindre les armées de Napoléon à Waterloo.... Bonne lecture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 939
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
LA CHARTREUSE DE PARME
PRÉFACE
Avertissement
TOME 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
TOME 2
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
PRÉFACE
C’est en 1842 que mourut l’auteur de la Chartreuse de Parme et de vingt-cinq autres volumes dont quelques-uns étaient de premier ordre ; et le lendemain il ne fut pas plus question de lui dans le monde que s’il n’avait jamais existé. Il n’avait pas fait grand bruit de son vivant, n’étant estimé et goûté que d’un petit nombre de lettrés et de délicats ; il sembla que la mort l’eût pris tout entier ; qu’il se fût enfoncé dans l’oubli comme ces vaisseaux qui sombrent en pleine mer, et dont on dit qu’ils ont péri corps et biens.
Le silence se fit sur ses ouvrages aussi bien que sur sa tombe. Le grand public ne les avait pas lus ; ses amis mêmes parurent les oublier. Il fut rayé de la mémoire des hommes. Le fait paraîtra sans doute extraordinaire aux jeunes gens qui me lisent en 1883. Veulent-ils une preuve bien singulière de ce que j’avance ?
En quarante-huit, j’entrai à l’École normale. Nous nous trouvions là une soixantaine de jeunes gens, qui avions tous la passion des lettres, qui dévorions pêle-mêle, avec ce robuste et impartial appétit de la jeunesse, et les chefs-d’oeuvre de l’antiquité, et les productions contemporaines ; qui nous piquions d’être au courant de tout ce qui s’écrivait en France, prose ou vers, et ne nous faisions pas faute d’en dire notre avis. Eh bien ! aucun de nous, – entendez bien cela ! – aucun de nous ne connaissait Stendhal, même de nom ; ou si son nom était par hasard tombé sous nos yeux, il n’avait point frappé notre esprit, car il ne nous rappelait aucun livre qui eût jamais fixé notre attention.
Ce petit fait, dont je garantis l’authenticité, montre bien l’épaisseur de la nuit qui s’était faite autour de Stendhal. Il avait été servi par delà ses souhaits : « Je ne tiens, avait-il souvent répété, je ne tiens à être lu qu’en 1880. C’est seulement en 1880 que l’on commencera à me comprendre. » Ses contemporains l’avaient pris au mot, et plus peut-être qu’il n’eût désiré. Quand la Chartreuse de Parme parut pour la première fois en 1839, il s’en vendit une centaine d’exemplaires, grâce à Balzac, qui en fit un éloge splendide dans sa revue. Le reste de l’édition demeura chez l’éditeur ou s’éparpilla sur les quais.
C’est dans une boîte à vingt sous, qu’en 1849 je trouvai la Chartreuse de Parme, et l’achetai sans penser à mal. L’ouvrage nous avait été signalé par un de nos professeurs, M. Jacquinet, grand admirateur de Mérimée, et j’en avais gardé le titre dans ma mémoire.
Je ne puis encore aujourd’hui, après tant d’années, me rappeler sans une sorte de plaisir rétrospectif la folie d’enthousiasme qui nous saisit, mes camarades et moi, à la lecture de ce livre. Nous nous prîmes d’une passion, qui m’est aujourd’hui inconcevable, pour les héros de Stendhal et pour Stendhal lui-même. Nous achetâmes tous ses ouvrages les uns après les autres, et ce n’est pas assez dire que nous les lûmes, nous les dévorâmes ; Balzac était notre Dieu ; nous fîmes dans la chapelle qui lui était réservée une niche à côté de lui pour Stendhal.
Tout nous plaisait chez lui : son amour du petit fait, simple, nu et probant ; son style sec et précis ; son goût de psychologie exacte et minutieuse ; son horreur des généralités vagues et de la phrase flottante ; son mépris des vérités convenues et sa façon ironique d’en parler ; il n’y avait pas jusqu’aux obscurités calculées dont il enveloppe parfois sa pensée, jusqu’aux réticences derrière lesquelles il la dérobe, qui ne nous charmassent. Nous lui pardonnions tout ; ou plutôt nous n’avions rien à lui pardonner : nous l’aimions pour ses défauts tout autant que pour ses qualités ; ses défauts étaient une séduction de plus. Jamais il ne se vit pareil engouement.
Je puis bien dire que j’ai lu plus de vingt fois en ma jeunesse et la Chartreuse de Parme, et le Rouge et le Noir, et l’Amour, et les Chroniques italiennes, et qu’à chaque fois j’y trouvais de nouvelles raisons d’admirer ; j’étais, ou pour mieux parler, nous étions victimes de ce phénomène, qu’il a si joliment décrit au début de son livre de l’Amour, et qu’il appelle la cristallisation. Nous avons, la chose est positive, cristallisé pour Stendhal, et cela n’a pas duré qu’un jour.
Au sortir de l’école, nous nous sommes répandus dans le monde. Quelques-uns de nous sont arrivés d’un train plus ou moins rapide à la célébrité ; nous avons tous travaillé à propager les livres et le nom de notre auteur bien-aimé. Taine a été l’un des ouvriers les plus actifs de cette réhabilitation. C’est lui qui a le premier imprimé cette phrase devenue célèbre : Stendhal qui fut le plus grand psychologue des temps modernes, et comme si ce n’était pas déjà un assez bel éloge, il ajouta en note au bas de la page : et peut-être de tous les temps ; About, Weiss, Yung et bien d’autres s’attelèrent à cette renommée. Je ne parle pas de moi : il me serait impossible de compter le nombre de personnes que je forçai, en quelque sorte, à lire le Rouge et le Noir et la Chartreuse de Parme. Je m’en allais partout, comme saint Paul, répandant la bonne nouvelle d’un homme de génie retrouvé.
Je me souviens que plus tard, quand j’eus l’honneur de connaître Sainte-Beuve et de causer avec lui, il ne me parla pas sans quelque impatience de ce coup de fouet donné à la réputation d’un écrivain qu’il n’aimait que médiocrement.
Comme je l’avais mis sur le compte de Stendhal :
— Oh ! me dit-il, je sais bien ; vous êtes de l’École normale ; c’est de la rue d’Ulm qu’a commencé de souffler le vent qui apportait le nom de Stendhal au grand public. Si vous l’aviez connu, comme moi !…
Sainte-Beuve se trompait ici, je crois ; et je pris la respectueuse liberté de le lui dire. Nous avions sans doute contribué dans une certaine mesure à hâter le jour où Stendhal devait entrer en communication avec la foule, qui l’avait trop longtemps ignoré. Mais la chose se serait faite sans nous, tout aussi bien et le plus naturellement du monde.
Stendhal avait comme une obscure intuition de la vérité, quand il disait de lui : Je ne serai lu et compris qu’en 1880. Il n’écrivait pas pour la génération, qui se pâmait aux magnifiques amplifications de Chateaubriand, qui écoutait avec transport les tirades emphatiques de Cousin ou les ingénieux développements de Villemain, qui se plaisait à cette phraséologie sentimentale, creuse et sonore, que les disciples de Jean-Jacques avaient mise à la mode. Il s’adressait à un autre genre d’esprits, dont il prévoyait l’éclosion prochaine, qui aimeraient le fait pour le fait, parce qu’il est, comme nous disons aujourd’hui, un document humain ; qui ne demanderaient au peintre des passions humaines que des détails vrais, exactement pris sur nature, sans aucun arrangement de style.
L’école naturaliste n’était point née, quand Stendhal entra enfin dans la célébrité. Mais déjà elle s’agitait sourdement dans tous les ordres de la pensée et de l’art. M. Émile Zola n’a fait que résumer en un corps de doctrine un ensemble de tendances éparses dans la littérature de son temps ; il leur a donné un nom ; il en a été le parrain plus encore que le père.
Notre génération et celle qui suivit reconnurent Stendhal pour un aïeul, ou plutôt pour un précurseur ; et sa gloire n’en jaillit qu’avec plus de force pour avoir subi longtemps une dure compression. Les réactions sont toujours violentes. Il y avait dans les éloges dont nous l’accablions comme un secret plaisir à le venger du dédain qu’il avait souffert, — que dis-je ? — qu’il avait provoqué, cherché ! Nous lui savions un gré infini d’avoir fui la renommée avec autant de soin que d’autres courent après et la gueusent. Nous savions que le lendemain du jour où il paraissait un volume de lui, il prenait la poste et se sauvait à deux cents lieues pour n’en pas entendre parler, que jamais il n’avait quémandé chez les journalistes des articles à sa louange, et que pour dépister même les admirations banales, il signait ses ouvrages de noms bizarres, Cotonnet, Durand, Fabrice, afin de se donner la joie exquise d’être deviné par une demi-douzaine d’amateurs. Nous nous sommes aperçus depuis qu’il y avait bien de la pose dans cette fierté farouche ; que cet amant du simple et du vrai était un homme terriblement compliqué, qui joignait à une timidité inavouée, et dont il enrageait, un orgueil tout plein de petitesses. Mais en ce temps-là nous ne comprenions rien à ces mystères subtils de vanité souffrante ; nous attribuions à une noble indépendance de caractère, à un superbe mépris de la popularité bête les calculs d’un amour-propre raffiné qui se tourmente lui-même. Il n’y a pas à dire : nous cristallisions.
Ajoutez qu’il y avait dans son talent comme dans la conduite de sa vie un je ne sais quoi d’énigmatique qui irritait encore notre curiosité. Balzac est un colosse tout en dehors : on le voit tout entier et on le mesure d’un coup d’oeil. Le génie de Stendhal ressemblait à une de ces boîtes du Japon, extraordinairement compliquées, qu’il faut démonter morceau par morceau pour découvrir la figurine qui s’y cache ; et encore s’aperçoit-on, quand l’opération est terminée, qu’on a oublié quelque tiroir secret, qui ne s’ouvre que par la pression d’un ressort invisible. Ce mystère même piquait notre admiration. Nous étions bien aises de nous prouver à nous-mêmes notre sagacité, en ne laissant aucun coin inexploré. Moi, qui vous parle, vous me croirez si vous voulez, de vingt à trente ans, j’avais compris d’un bout à l’autre le livre de l’Amour ; j’en avais sondé les obscurités les plus impénétrables ; je me les étais expliquées ; les théories les plus absconses de Stendhal n’avaient plus de secret pour moi. Je goûtais la joie pleine et parfaite des initiés, qui est, comme on sait, d’être en communication intime avec Dieu. Plus tard, je relus l’Amour, qui était sorti de ma mémoire. J’avais sans doute perdu ma clef dans l’intervalle ; il y eut nombre de pages où je n’entrai plus. Je les trouvai peu claires, et il faut bien avouer qu’elles l’étaient.
Tous les hommes de ma génération ont connu, comme moi, ces oscillations de goût, dont je conte aujourd’hui l’histoire. Nous avons trouvé Stendhal inconnu, méprisé presque ; nous nous sommes pris pour lui d’un enthousiasme sans bornes ; nous l’avons bombardé grand homme, sans dire gare ; nous avons crié son nom à tous les échos de la popularité ; nous avons imposé l’admiration de ses ouvrages au grand public, qui les a achetés avec plus d’empressement qu’il ne les a lus. Cette première ferveur est tombée peu à peu. Nous avons eu le temps, depuis 1850, de recouvrer notre sang-froid et de reprendre notre équilibre. Quand il nous arrive à présent de relire une des oeuvres de Stendhal qui ont passionné notre jeunesse, nous éprouvons ce mélange d’attendrissement et d’inquiétude que l’on sent quand on se retrouve en présence d’une ancienne maîtresse que l’on a beaucoup aimée autrefois, et depuis longtemps perdue de vue. On ne saurait la regarder sans émotion, car chacun des traits de son visage rappelle le souvenir des illusions premières, et rien de plus délicieux que cette lointaine image ; mais on est averti en même temps, par une foule de signes qui éclatent aux yeux, des imperfections que l’on n’avait pas aperçues alors et que l’âge a encore accentuées.
C’est cette épreuve que je viens de faire subir à la Chartreuse de Parme, sur l’invitation de M. Conquet, qui m’avait prié d’écrire une préface pour cette édition.
Qui eût dit à Stendhal, il y a quarante ans, qu’un jour viendrait où son oeuvre de prédilection serait choisie par un éditeur, ami des beaux livres, pour être relevée de toutes les séductions de la typographie, pour être enrichie de toutes les lumières et de toutes les grâces que l’art du dessin ajoute au texte, pour être offerte, comme une perle rare dans un magnifique écrin, à un public d’amateurs triés sur le volet ? J’imagine que s’il pouvait revenir au monde et s’admirer sous ce vêtement somptueux, il sentirait quelque chose de cette orgueilleuse satisfaction dont il fut si délicieusement chatouillé, quand Balzac, de sa robuste main, lui renversa sur la tête une énorme charretée d’éloges.
C’était justement à propos de cette Chartreuse de Parme dont nous allons nous entretenir ensemble.
Balzac ne trouve qu’une critique à faire : c’est que le roman ne se tient pas ; il ne forme pas un tout organisé et vivant. C’est une biographie plutôt qu’un roman : l’auteur prend son héros à l’époque même où il est né, et même quelque peu auparavant, il conte ingénument les accidents de sa vie, sans trop s’inquiéter de les relier les uns aux autres ; il imite en cela les procédés de la nature, qui ne se met en peine ni de logique ni d’art ; mais le romancier n’est-il qu’un simple annaliste ? Son seul but doit-il être de suivre le courant des faits, et d’aller là où ils le portent, sans se marquer par avance un but à atteindre ? Balzac, et après lui Zola, montrent doctement qu’il y a trois romans superposés dans ce roman, et que le dernier même n’est pas terminé. Stendhal l’arrête à peine commencé, et met un point final.
Ces observations sont justes et elles ne le sont pas ; elles sont justes sans l’être. L’idée première de Stendhal a été de peindre les moeurs de l’Italie à un moment donné de son histoire. Il lui fallait un héros qui traversât des milieux différents et touchât aux plus hautes comme aux plus basses conditions de la hiérarchie sociale. Il a inventé un Fabrice, comme Lesage a imaginé un Gil Blas. Fabrice, qui a l’air d’être le principal personnage de la Chartreuse de Parme, n’est à vrai dire qu’un passe-partout, un porte-paroles, un homme de paille, d’un caractère moyen et neutre, sans grandes vertus ni vices bien tranchés, qui soulève autour de lui, à mesure qu’il avance dans la vie, toute une poussière de faits, de ces faits que Stendhal avait coutume d’appeler des faits probants, parce qu’ils révèlent un caractère, une situation, un état social. Il ne faut donc point chercher dans la Chartreuse de Parme un roman bien composé, où Fabrice, figure prédominante, ramène autour de lui tous les éléments d’une seule et même action. Laissez-vous aller au récit des événements qui portent Fabrice, et vous aurez le plaisir de connaître l’Italie, telle que l’a vue ou se l’est figurée Stendhal, qui l’a connue, aimée et pratiquée durant la meilleure part de sa vie.
Aussi ne puis-je me ranger à l’avis de M. Émile Zola, qui trouve trop longue et inutile toute la première partie de la Chartreuse de Parme. Elle m’avait enchanté autrefois ; le charme ne s’en est point affaibli pour moi, et j’ai encore lu avec ravissement ces pages exquises. On voit là une peinture exacte et animée tout à la fois de ce que furent les joies, les tristesses, les espérances, les façons de vivre et d’être heureux de l’Italie du Nord, depuis 1796, époque de la première campagne d’Italie, jusqu’en 1813, année où prirent fin les beaux jours de la cour du prince Eugène.
C’est un tableau merveilleux, d’un trait étonnamment précis et d’une couleur bien vive : Stendhal peignait là ce qu’il avait vu de ses yeux, et il n’y en eut jamais de plus perçants. On sent dans tous ces chapitres une note personnelle qui leur donne une saveur toute particulière.
C’est là que se trouve ce fameux récit de la bataille de Waterloo, qui est resté un modèle de narration ; on l’a refait vingt fois, sans jamais égaler la première épreuve. Vous verrez en le lisant que Fabrice assista à la bataille de Waterloo, sans savoir si c’est réellement une bataille dont il a été témoin, et si vraiment on peut dire qu’il s’est battu. Admettons, si l’on veut et pour faire plaisir à M. Émile Zola, que ces trente pages soient un hors-d’oeuvre ; mais ce serait alors le cas de s’écrier : Felix culpa ! car ce hors-d’oeuvre est un pur chef-d’oeuvre. Je ne serais pas étonné que de tout le roman ce ne fussent ces premiers chapitres d’exposition qui vous plairont le mieux. Ils vous donneront, je crois, un plaisir sans mélange, et m’ont rendu à moi les fraîches impressions de ma jeunesse.
Ils ne sont pas aussi étrangers qu’on a bien voulu le dire à l’action qui va suivre ; car nous y apprenons à nous familiariser avec les divers mondes qui s’agitaient à cette époque de réaction folle (1816) en Italie ; et nous y faisons la connaissance de quelques-uns des personnages qui vont emplir le drame futur, et surtout de cette charmante duchesse Sanseverina, dont nous avons tous été amoureux fous en notre jeunesse, et que j’ai encore trouvée bien aimable, lors de ma dernière visite, à cinquante ans passés.
Ah ! que j’en veux à M. Émile Zola de la mauvaise humeur qu’il témoigne à cette pauvre Gina ! Il lui reproche ses amants et son indifférence à les prendre comme à les quitter. Mais Gina ne serait pas de son pays si elle n’avait point d’amants ; une fois avec le comte Mosca, elle ne lui fait plus que les infidélités qui lui sont commandées par d’impérieuses nécessités de salut, et elle les lui avoue si ingénument ! Elle aime peut-être un peu plus qu’il ne faudrait son beau neveu Fabrice ; mais elle se souvient toujours qu’elle pourrait être sa mère. Elle fait assassiner le prince de Parme ; mais c’est de si bonne grâce ! elle a si peu de scrupules et elle croit de si ferme propos que la passion excuse tout et qu’une jolie femme a tous les droits quand son coeur est en jeu ! Ces crimes ne sont que gentillesses pour elle, et nous lui donnons raison avec l’auteur. Il l’a faite si séduisante ! une âme toujours maîtresse d’elle-même, un coeur extraordinairement tendre, un esprit libre de tout préjugé, et avec cela si vive, si naturelle en tous ses emportements, si chatte et si lionne ! M. Émile Zola aura beau dire ; j’en raffole.
Il n’est guère mieux porté pour son amant, le comte Mosca, à qui il en veut de n’être pas le grand diplomate qu’y a vu Balzac, qui avait cru que Stendhal avait sous les traits du comte Mosca voulu peindre le célèbre Metternich. Eh ! mais, Stendhal n’a jamais dit que le comte Mosca fût un grand homme, ni en paix ni en guerre. Il nous le donne pour un ministre d’infiniment d’esprit, très capable en affaires, mais ne trouvant pas dans cette cour minuscule du roi de Parme matière à exercer ses hautes facultés.
C’est un spectacle bien amusant de voir ce diplomate, qui a le génie de l’homme d’État et du courtisan, manoeuvrer à travers toutes les intrigues de cette cour de Parme et s’en démêler avec une adresse prodigieuse, malgré les coups de tête de Gina, qui de temps à autre se jette à la traverse et piétine ses toiles d’araignée.
Toute cette peinture d’une petite cour dans un gouvernement despotique est une merveille d’invention et d’ingéniosité. Songez qu’il a fallu créer tous les personnages épisodiques qui se meuvent sur cet étroit théâtre, comme des vibrions dans la goutte d’eau où ils se poursuivent et se dévorent. Tous sont enlevés de main de maître, et le prince Ranuce, ce faux Louis XIV, avec ses terreurs, ses rages, ses cruautés et son fonds irrémédiable de vanité sotte ; et le fiscal Rassi, ce polichinelle terrible qui tend le dos aux coups de pied et prononce les condamnations à mort en faisant des lazzi ; et le jeune prince héritier avec ses timidités rougissantes et ses sournoises rancunes ; et la pauvre princesse Isola, confinée dans son orgueil de princesse du sang comme une sainte en sa châsse ; et le bon archevêque, un roturier à genoux devant la noblesse, mais retrouvant quand il le faut, dans les grandes circonstances, l’énergie de l’homme de Dieu, qu’il enveloppe et ouate de finesses italiennes ; et cet imbécile de Conti, le gouverneur de la citadelle ; et cette perverse comtesse Raversi ; et toute la clique bourdonnante des courtisans. Et j’allais oublier cette figure si vivante, si curieuse, de Ferrante Palla, le tribun sauvage amoureux des belles mains blanches, un personnage de fantaisie sans doute, un personnage à la Walter Scott ; mais comme il saisit l’imagination !
Quelle admirable galerie d’originaux ! En deux traits, Stendhal a donné à chacun d’eux une physionomie si particulière et les a peints si vivants, si criants de ressemblance, qu’on croit les reconnaître, et qu’ils laissent dans l’esprit un souvenir inoubliable. Et quand je me sers du mot de galerie, j’ai tort. Une galerie suppose des portraits rangés le long de la muraille et qu’on regarde l’un après l’autre. Tous ces personnages s’agitent à la fois et se mêlent à une des actions les plus compliquées à la fois et les plus claires qu’un romancier ait jamais imaginées.
Ici nous pouvons répéter avec Balzac « qu’il a fallu du génie pour créer les incidents, les événements, les trames innombrables et renaissantes au milieu desquelles se déploie le caractère du comte de Mosca. Quand on voit, s’écrie-t-il, que l’auteur a tout inventé, tout brouillé et tout débrouillé, comme les choses se brouillent et se débrouillent dans une cour, l’esprit le plus intrépide, et à qui les conceptions du roman sont le plus familières, reste étourdi, stupide, devant un tel travail. »
Je tiens l’éloge pour juste.
On pourra objecter que l’Italie de Stendhal est par endroits une Italie de fantaisie ; qu’il s’est amusé à attribuer aux Italiens de 1815 quelques-unes des formes de passions et des tours de pensées qui étaient familiers aux contemporains de Benvenuto Cellini. Il y a du vrai dans cette remarque ; mais Stendhal n’en aura pas moins eu le mérite, nous transportant dans un autre milieu, de donner aux événements comme aux personnages une saveur exotique. Dans quelle Italie sommes-nous ? on peut discuter sur ce point. Ce qu’il y a de certain, c’est que nous ne sommes plus en France, mais bien en Italie, dans cette Italie où la grosse affaire est d’aimer et de jouir de la vie, en se moquant du qu’en-dira-t-on.
Il m’a toujours paru que cette admirable partie du récit plaisait moins aux femmes qu’aux hommes. Peut-être les personnages y sont-ils trop nombreux, les événements trop touffus, et il faut, pour se reconnaître dans ce fouillis d’intrigues, une extraordinaire contention d’esprit dont les lectrices de roman sont d’ordinaire peu capables.
Un autre défaut, si tant est que ce soit là un défaut, peut encore les inquiéter et gâter leur plaisir. Stendhal est un psychologue ; il aime à démêler les secrets ressorts de nos actions, à démonter en quelque sorte l’âme de ses héros, pour voir le jeu de chaque rouage. Il semble qu’il ait inoculé cette passion à ses personnages ; tous se regardent, s’examinent, se scrutent, et, pour me servir d’une jolie comparaison de M. Émile Zola, ils s’écoutent penser, comme un enfant qui met son oreille à une montre. De là des monologues, qui sont fréquents et interminables. Ils nous plaisent à nous que l’éducation universitaire a rompus aux subtilités de l’analyse la plus poussée et la plus délicate ; à nous qui lisons avec un plaisir toujours nouveau tous les moralistes, Larochefoucauld, La Bruyère, Joubert, et tant d’autres qui sont en quelque sorte les chimistes du coeur humain. Toute cette chimie ne plaît qu’à demi aux femmes.
Elles prendront leur revanche en lisant les derniers chapitres de la Chartreuse de Parme, qui devient un vrai roman d’aventure.
Qui ne sait l’histoire de Fabrice en prison, oubliant d’être malheureux pour causer d’amour avec la belle Clélia Conti, à travers le grillage d’une fenêtre ! Qui ne se rappelle cet admirable récit d’évasion, qui peut pour l’intérêt poignant de la scène être mis à côté de celui de Monte Christo ou des Mémoires de Casanova !
J’ai relu ces merveilleuses pages avec les mêmes palpitations de coeur qu’au temps jadis. Cela est, je ne l’ignore pas, d’un cru moindre. C’est du roman d’aventure, mais n’est-ce donc rien de tenir durant tout un demi-volume son lecteur haletant de curiosité et d’émotion ? Toute cette histoire est peu vraisemblable, je l’avoue ; mais celle de Monte-Christo chez l’abbé Faria l’est-elle davantage ? L’action si complexe et si mêlée, quand nous étions à la cour de Parme, court ici nette et dégagée et, pour ainsi dire, les coudes au corps.
C’est un morceau qu’on ne saurait trop louer.
Peut-être eût-il mieux valu que la Chartreuse de Parme se terminât aux scènes qui suivent cette évasion et forment une conclusion au récit. Stendhal, en mariant Clélia Conti à un homme qu’elle déteste et en lui donnant pour amant Fabrice, devenu archevêque, a commencé un nouveau roman, le roman du prêtre éperdument amoureux d’une dévote. Mais il n’a pas traité le sujet, et brusquement il a mis à son ouvrage un point final, en supprimant Clélia qui meurt de chagrin et en renfermant Fabrice pour le reste de ses jours à la Chartreuse de Parme. D’où le titre de l’ouvrage.
La Chartreuse de Parme est donc un livre mal composé ; tous les critiques l’avaient remarqué avant moi, et Balzac lui-même, dans ce panégyrique à outrance qu’il avait fait de l’oeuvre, avait passé condamnation sur cet article. C’est aussi, hélas ! un livre mal écrit. D’autres se piquent de style ; Stendhal se piquait de n’en point avoir. Il prétendait qu’avant de se mettre à la besogne, il lisait deux ou trois chapitres du Code pour se donner le ton. C’était une pose ajoutée à tant d’autres. Le fait est que Stendhal, comme beaucoup d’honnêtes gens, avait une conscience obscure de ses défauts et les avait, à l’aide d’une belle théorie, érigés en qualités. Il écrivait très vite, au courant de la plume, ne s’occupant que des choses à dire, sans se mettre en peine du tour à leur donner. Son ami Colomb, qui a laissé de lui une biographie très minutieuse, conte qu’un jour, rassemblant sur sa table de travail les cahiers épars du manuscrit de la Chartreuse de Parme, il n’en put retrouver un qui s’était égaré. C’était un cahier de soixante à quatre-vingts pages. Il ne perdit pas son temps à le chercher. Il le récrivit à bride abattue. Quand il eut fini, son ami Colomb, qui fouillait toujours, mit la main sur le précieux cahier, qui s’était enfoui sous une liasse de vieux papiers. Stendhal ne voulut pas même le relire et comparer les deux manuscrits. Il faisait profession de tenir en médiocre estime la façon d’exprimer ses idées
Aussi son style est-il le plus souvent sec, composé de petites phrases brèves et incolores. D’autres fois il s’embarque dans des périodes dont il ne peut plus sortir ; il les enchevêtre de qui et de que d’où l’on ne se démêle pas plus que lui. S’il a besoin dix fois du même mot, il le répète dix fois sans scrupule, et ce n’est presque jamais un mot qui peigne. Il y a pourtant, surtout dans la première partie, de jolies descriptions de paysages ; les vues du lac de Côme et des environs sont charmantes ; mais le trait est toujours chez lui trop précis et trop sec ; la couleur n’y est pas. Stendhal avait plus de sensibilité que d’imagination.
C’est une grosse question de savoir si un livre où le style manque est fait pour durer.
Hippocrate dit : oui, et Galien dit : non.
Et moi, comme le personnage de Molière, je ne dirais ni oui, ni non. Je sais un livre qui a déjà traversé un siècle et demi et qui est tout simplement d’une bonne langue courante : c’est Manon Lescaut. Il est probable que nos arrière-neveux le liront encore et avec grand plaisir. Pourquoi ? C’est que l’abbé Prévost a peint la courtisane dans une courtisane. Il a créé un type. Stendhal a aussi ce suprême honneur d’avoir créé et mis au monde des êtres vivants, qui nous apprennent tout ce que nous pouvons savoir sur toutes les formes de l’amour connues et à connaître.
Cela suffit à sa gloire.
Francisque Sarcey.
Avertissement
C’est dans l’hiver de 1830 et à trois cents lieues de Paris que cette nouvelle fut écrite ; ainsi aucune allusion aux choses de 1839.
Bien des années avant 1830, dans le temps où nos armées parcouraient l’Europe, le hasard me donna un billet de logement pour la maison d’un chanoine : c’était à Padoue, charmante ville d’Italie ; le séjour s’étant prolongé, nous devînmes amis.
Repassant à Padoue vers la fin de 1830, je courus à la maison du bon chanoine : il n’était plus, je le savais, mais je voulais revoir le salon où nous avions passé tant de soirées aimables, et, depuis, si souvent regrettées. Je trouvai le neveu du chanoine et la femme de ce neveu qui me reçurent comme un vieil ami. Quelques personnes survinrent, et l’on ne se sépara que fort tard ; le neveu fit venir du café Pedroti un excellent zambajon. Ce qui nous fit veiller surtout, ce fut l’histoire de la duchesse Sanseverina à laquelle quelqu’un fit allusion, et que le neveu voulut bien raconter tout entière, en mon honneur.
— Dans le pays où je vais, dis-je à mes amis, je ne trouverai guère de soirées comme celle-ci, et pour passer les longues heures du soir je ferai une nouvelle de votre histoire.
— En ce cas, dit le neveu, je vais vous donner les annales de mon oncle, qui, à l’article Parme, mentionne quelques-unes des intrigues de cette cour, du temps que la duchesse y faisait la pluie et le beau temps ; mais, prenez garde ! cette histoire n’est rien moins que morale, et maintenant que vous vous piquez de pureté évangélique en France, elle peut vous procurer le renom d’assassin.
Je publie cette nouvelle sans rien changer au manuscrit de 1830, ce qui peut avoir deux inconvénients :
Le premier pour le lecteur : les personnages étant Italiens l’intéresseront peut-être moins, les coeurs de ce pays-là diffèrent assez des coeurs français : les Italiens sont sincères, bonnes gens, et, non effarouchés, disent ce qu’ils pensent ; ce n’est que par accès qu’ils ont de la vanité ; alors elle devient passion, et prend le nom de puntiglio. Enfin la pauvreté n’est pas un ridicule parmi eux.
Le second inconvénient est relatif à l’auteur.
J’avouerai que j’ai eu la hardiesse de laisser aux personnages les aspérités de leurs caractères ; mais, en revanche, je le déclare hautement, je déverse le blâme le plus moral sur beaucoup de leurs actions. À quoi bon leur donner la haute moralité et les grâces des caractères français, lesquels aiment l’argent par-dessus tout et ne font guère de péchés par haine ou par amour ? Les Italiens de cette nouvelle sont à peu près le contraire. D’ailleurs, il me semble que, toutes les fois qu’on s’avance de deux cents lieues du midi au nord, il y a lieu à un nouveau paysage comme à un nouveau roman. L’aimable nièce du chanoine avait connu et même beaucoup aimé la duchesse Sanseverina, et me prie de ne rien changer à ses aventures, lesquelles sont blâmables.
23 janvier 1839.
TOME 1
Gia mi fur dolci inviti a empir le carte I luoghi ameni.
Ariost., Sat. IV
Source : Ce livre est extrait de la bibliothèque numérique Wikisource et les
illustrations de Wikimedia Commons, la médiathèque libre. Cette oeuvre est mise à
disposition sous licence Attribution – Partage dans les mêmes conditions 3.0 non
transposé. Pour voir une copie de cette licence, visitez :
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
Chapitre 1
Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l’Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi ; huit jours encore avant l’arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu’un ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté Impériale et Royale: c’était du moins ce que leur répétait trois fois la semaine un petit journal grand comme la main, imprimé sur du papier sale.
Au moyen âge, les Lombards républicains avaient fait preuve d’une bravoure égale à celle des Français, et ils méritèrent de voir leur ville entièrement rasée par les empereurs d’Allemagne. Depuis qu’ils étaient devenus de fidèles sujets, leur grande affaire était d’imprimer des sonnets sur de petits mouchoirs de taffetas rose quand arrivait le mariage d’une jeune fille appartenant à quelque famille noble ou riche. Deux ou trois ans après cette grande époque de sa vie, cette jeune fille prenait un cavalier servant : quelquefois le nom du sigisbée choisi par la famille du mari occupait une place honorable dans le contrat de mariage. Il y avait loin de ces moeurs efféminées aux émotions profondes que donna l’arrivée imprévue de l’armée française. Bientôt surgirent des moeurs nouvelles et passionnées. Un peuple tout entier s’aperçut, le 15 mai 1796, que tout ce qu’il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le départ du dernier régiment de l’Autriche marqua la chute des idées anciennes : exposer sa vie devint à la mode ; on vit que pour être heureux après des siècles de sensations affadissantes, il fallait aimer la patrie d’un amour réel et chercher les actions héroïques. On était plongé dans une nuit profonde par la continuation du despotisme jaloux de Charles-Quint et de Philippe II ; on renversa leurs statues, et tout à coup l’on se trouva inondé de lumière. Depuis une cinquantaine d’années et à mesure que l’Encyclopédie et Voltaire éclataient en France, les moines criaient au bon peuple de Milan, qu’apprendre à lire ou quelque chose au monde était une peine fort inutile, et qu’en payant bien exactement la dîme à son curé, et lui racontant fidèlement tous ses petits péchés, on était à peu près sûr d’avoir une belle place en paradis. Pour achever d’énerver ce peuple autrefois si terrible et si raisonneur, l’Autriche lui avait vendu à bon marché le privilège de ne point fournir de recrues à son armée.
En 1796, l’armée milanaise se composait de vingt-quatre faquins habillés de rouge, lesquels gardaient la ville de concert avec quatre magnifiques régiments de grenadiers hongrois. La liberté des moeurs était extrême, mais la passion fort rare d’ailleurs, outre le désagrément de devoir tout raconter au curé, sous peine de ruine même en ce monde, le bon peuple de Milan était encore soumis à certaines petites entraves monarchiques qui ne laissaient pas que d’être vexantes. Par exemple l’archiduc, qui résidait à Milan et gouvernait au nom de l’Empereur, son cousin, avait eu l’idée lucrative de faire le commerce des blés. En conséquence, défense aux paysans de vendre leurs grains jusqu’à ce que Son Altesse eût rempli ses magasins.
En mai 1796, trois jours après l’entrée des Français, un jeune peintre en miniature, un peu fou, nommé Gros, célèbre depuis, et qui était venu avec l’armée, entendant raconter au grand café des Servi (à la mode alors) les exploits de l’archiduc, qui de plus était énorme, prit la liste des glaces imprimée en placard sur une feuille de vilain papier jaune. Sur le revers de la feuille il dessina le gros archiduc ; un soldat français lui donnait un coup de baïonnette dans le ventre, et, au lieu de sang, il en sortait une quantité de blé incroyable. La chose nommée plaisanterie ou caricature n’était pas connue en ce pays de despotisme cauteleux. Le dessin laissé par Gros sur la table du café des Servi parut un miracle descendu du ciel ; il fut gravé dans la nuit, et le lendemain on en vendit vingt mille exemplaires.
Le même jour, on affichait l’avis d’une contribution de guerre de six millions, frappée pour les besoins de l’armée française, laquelle, venant de gagner six batailles et de conquérir vingt provinces, manquait seulement de souliers, de pantalons, d’habits et de chapeaux.
La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Lombardie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s’aperçurent de la lourdeur de cette contribution de six millions, qui, bientôt, fut suivie de beaucoup d’autres. Ces soldats français riaient et chantaient toute la journée ; ils avaient moins de vingt-cinq ans, et leur général en chef, qui en avait vingt-sept, passait pour l’homme le plus âgé de son armée. Cette gaieté, cette jeunesse, cette insouciance, répondaient d’une façon plaisante aux prédications furibondes des moines qui, depuis six mois, annonçaient du haut de la chaire sacrée que les Français étaient des monstres, obligés, sous peine de mort, à tout brûler et à couper la tête à tout le monde. À cet effet, chaque régiment marchait avec la guillotine en tête.
Dans les campagnes l’on voyait sur la porte des chaumières le soldat français occupé à bercer le petit enfant de la maîtresse du logis, et presque chaque soir quelque tambour, jouant du violon, improvisait un bal. Les contredanses se trouvant beaucoup trop savantes et compliquées pour que les soldats, qui d’ailleurs ne les savaient guère, pussent les apprendre aux femmes du pays, c’étaient celles-ci qui montraient aux jeunes Français la Monférine, la Sauteuse et autres danses italiennes.
Les officiers avaient été logés, autant que possible, chez les gens riches ; ils avaient bon besoin de se refaire. Par exemple, un lieutenant, nommé Robert, eut un billet de logement pour le palais de la marquise del Dongo. Cet officier, jeune réquisitionnaire assez leste, possédait pour tout bien, en entrant dans ce palais, un écu de six francs qu’il venait de recevoir à Plaisance. Après le passage du pont de Lodi, il prit à un bel officier autrichien tué par un boulet un magnifique pantalon de nankin tout neuf, et jamais vêtement ne vint plus à propos. Ses épaulettes d’officier étaient en laine, et le drap de son habit était cousu à la doublure des manches pour que les morceaux tinssent ensemble ; mais il y avait une circonstance plus triste : les semelles de ses souliers étaient en morceaux de chapeau également pris sur le champ de bataille, au delà du pont de Lodi. Ces semelles improvisées tenaient au-dessus des souliers par des ficelles fort visibles, de façon que lorsque le majordome de la maison se présenta dans la chambre du lieutenant Robert pour l’inviter à dîner avec madame la marquise, celui-ci fut plongé dans un mortel embarras. Son voltigeur et lui passèrent les deux heures qui les séparaient de ce fatal dîner à tâcher de recoudre un peu l’habit et à teindre en noir avec de l’encre les malheureuses ficelles des souliers. Enfin le moment terrible arriva. « De la vie je ne fus plus mal à mon aise, me disait le lieutenant Robert ; ces dames pensaient que j’allais leur faire peur, et moi j’étais plus tremblant qu’elles. Je regardais mes souliers et ne savais comment marcher avec grâce. La marquise del Dongo, ajoutait-il, était alors dans tout l’éclat de sa beauté : vous l’avez connue avec ses yeux si beaux et d’une douceur angélique, et ses jolis cheveux d’un blond foncé qui dessinaient si bien l’ovale de cette figure charmante. J’avais dans ma chambre une Hérodiade de Léonard de Vinci, qui semblait son portrait. Dieu voulut que je fusse tellement saisi de cette beauté surnaturelle que j’en oubliai mon costume. Depuis deux ans je ne voyais que des choses laides et misérables dans les montagnes du pays de Gênes : j’osai lui adresser quelques mots sur mon ravissement.
« Mais j’avais trop de sens pour m’arrêter longtemps dans le genre complimenteur. Tout en tournant mes phrases, je voyais, dans une salle à manger toute de marbre, douze laquais et des valets de chambre vêtus avec ce qui me semblait alors le comble de la magnificence. Figurez-vous que ces coquins-là avaient non seulement de bons souliers, mais encore des boucles d’argent. Je voyais du coin de l’oeil tous ces regards stupides fixés sur mon habit, et peut-être aussi sur mes souliers, ce qui me perçait le coeur. J’aurais pu d’un mot faire peur à tous ces gens mais comment les mettre à leur place sans courir le risque d’effaroucher les dames ? car la marquise pour se donner un peu de courage, comme elle me l’a dit cent fois depuis, avait envoyé prendre au couvent où elle était pensionnaire en ce temps-là, Gina del Dongo, soeur de son mari, qui fut depuis cette charmante comtesse Pietranera : personne dans la prospérité ne la surpassa par la gaieté et l’esprit aimable, comme personne ne la surpassa par le courage et la sérénité d’âme dans la fortune contraire. »
Gina, qui pouvait alors avoir treize ans, mais qui en paraissait dix-huit, vive et franche, comme vous savez, avait tant de peur d’éclater de rire en présence de mon costume, qu’elle n’osait pas manger ; la marquise, au contraire, m’accablait de politesses contraintes ; elle voyait fort bien dans mes yeux des mouvements d’impatience. En un mot, je faisais une sotte figure, je mâchais le mépris, chose qu’on dit impossible à un Français. Enfin une idée descendue du ciel vint m’illuminer je me mis à raconter à ces dames ma misère, et ce que nous avions souffert depuis deux ans dans les montagnes du pays de Gênes où nous retenaient de vieux généraux imbéciles. Là, disais-je, on nous donnait des assignats qui n’avaient pas cours dans le pays, et trois onces de pain par jour. Je n’avais pas parlé deux minutes, que la bonne marquise avait les larmes aux yeux, et la Gina était devenue sérieuse.
— Quoi, monsieur le lieutenant, me disait celle-ci, trois onces de pain !
— Oui, mademoiselle ; mais en revanche la distribution manquait trois fois la semaine, et comme les paysans chez lesquels nous logions étaient encore plus misérables que nous, nous leur donnions un peu de notre pain.
« En sortant de table, j’offris mon bras à la marquise jusqu’à la porte du salon, puis, revenant rapidement sur mes pas, je donnai au domestique qui m’avait servi à table cet unique écu de six francs sur l’emploi duquel j’avais fait tant de châteaux en Espagne.
« Huit jours après, continuait Robert, quand il fut bien avéré que les Français ne guillotinaient personne, le marquis del Dongo revint de son château de Grianta sur le lac de Côme, où bravement il s’était réfugié à l’approche de l’armée, abandonnant aux hasards de la guerre sa jeune femme si belle et sa soeur. La haine que ce marquis avait pour nous était égale à sa peur, c’est-à-dire incommensurable : sa grosse figure pâle et dévote était amusante à voir quand il me faisait des politesses. Le lendemain de son retour à Milan, je reçus trois aunes de drap et deux cents francs sur la contribution des six millions : je me remplumai, et devins le chevalier de ces dames, car les bals commencèrent. »
L’histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français ; au lieu de se moquer de la misère de ces braves soldats, on en eut pitié, et on les aima.
Cette époque de bonheur imprévu et d’ivresse ne dura que deux petites années ; la folie avait été si excessive et si générale, qu’il me serait impossible d’en donner une idée, si ce n’est par cette réflexion historique et profonde : ce peuple s’ennuyait depuis cent ans.
La volupté naturelle aux pays méridionaux avait régné jadis à la cour des Visconti et des Sforce, ces fameux ducs de Milan. Mais depuis l’an 1624, que les Espagnols s’étaient emparés du Milanais, et emparés en maîtres taciturnes, soupçonneux, orgueilleux, et craignant toujours la révolte, la gaieté s’était enfuie. Les peuples, prenant les moeurs de leurs maîtres, songeaient plutôt à se venger de la moindre insulte par un coup de poignard qu’à jouir du moment présent.
La joie folle, la gaieté, la volupté, l’oubli de tous les sentiments tristes, ou seulement raisonnables, furent poussés à un tel point, depuis le 15 mai 1796, que les Français entrèrent à Milan, jusqu’en avril 1799, qu’ils en furent chassés à la suite de la bataille de Cassano, que l’on a pu citer de vieux marchands millionnaires, de vieux usuriers, de vieux notaires qui, pendant cet intervalle, avaient oublié d’être moroses et de gagner de l’argent.
Tout au plus eût-il été possible de compter quelques familles appartenant à la haute noblesse, qui s’étaient retirées dans leurs palais à la campagne, comme pour bouder contre l’allégresse générale et l’épanouissement de tous les coeurs. Il est véritable aussi que ces familles nobles et riches avaient été distinguées d’une manière fâcheuse dans la répartition des contributions de guerre demandées pour l’armée française.
Le marquis del Dongo, contrarié de voir tant de gaieté, avait été un des premiers à regagner son magnifique château de Grianta, au delà de Côme, où les dames menèrent le lieutenant Robert. Ce château, situé dans une position peut-être unique au monde, sur un plateau à cent cinquante pieds au-dessus de ce lac sublime dont il domine une grande partie, avait été une place forte. La famille del Dongo le fit construire au quinzième siècle, comme le témoignaient de toutes parts les marbres chargés de ses armes ; on y voyait encore des ponts-levis et des fossés profonds, à la vérité privés d’eau mais avec ces murs de quatre-vingts pieds de haut et de six pieds d’épaisseur, ce château était à l’abri d’un coup de main ; et c’est pour cela qu’il était cher au soupçonneux marquis. Entouré de vingt-cinq ou trente domestiques qu’il supposait dévoués, apparemment parce qu’il ne leur parlait jamais que l’injure à la bouche, il était moins tourmenté par la peur qu’à Milan.
Cette peur n’était pas tout à fait gratuite : il correspondait fort activement avec un espion placé par l’Autriche sur la frontière suisse à trois lieues de Grianta, pour faire évader les prisonniers faits sur le champ de bataille, ce qui aurait pu être pris au sérieux par les généraux français.
Le marquis avait laissé sa jeune femme à Milan : elle y dirigeait les affaires de la famille, elle était chargée de faire face aux contributions imposées à la casa del Dongo, comme on dit dans le pays ; elle cherchait à les faire diminuer, ce qui l’obligeait à voir ceux des nobles qui avaient accepté des fonctions publiques, et même quelques non nobles fort influents. Il survint un grand événement dans cette famille. Le marquis avait arrangé le mariage de sa jeune soeur Gina avec un personnage fort riche et de la plus haute naissance ; mais il portait de la poudre : à ce titre, Gina le recevait avec des éclats de rire, et bientôt elle fit la folie d’épouser le comte Pietranera. C’était à la vérité un fort bon gentilhomme, très-bien fait de sa personne, mais ruiné de père en fils, et, pour comble de disgrâce, partisan fougueux des idées nouvelles. Pietranera était sous-lieutenant dans la légion italienne, surcroît de désespoir pour le marquis.
Après ces deux années de folie et de bonheur, le Directoire de Paris, se donnant des airs de souverain bien établi, montra une haine mortelle pour tout ce qui n’était pas médiocre. Les généraux ineptes qu’il donna à l’armée d’Italie perdirent une suite de batailles dans ces mêmes plaines de Vérone, témoins deux ans auparavant des prodiges d’Arcole et de Lonato. Les Autrichiens se rapprochèrent de Milan ; le lieutenant Robert, devenu chef de bataillon et blessé à la bataille de Cassano, vint loger pour la dernière fois chez son amie la marquise del Dongo. Les adieux furent tristes ; Robert partit avec le comte Pietranera qui suivait les Français dans leur retraite sur Novi. La jeune comtesse, à laquelle son frère refusa de payer sa légitime, suivit l’armée montée sur une charrette.
Alors commença cette époque de réaction et de retour aux idées anciennes, que les Milanais appellent i tredici mesi (les treize mois), parce qu’en effet leur bonheur voulut que ce retour à la sottise ne durât que treize mois, jusqu’à Marengo. Tout ce qui était vieux, dévot, morose, reparut à la tête des affaires, et reprit la direction de la société : bientôt les gens restés fidèles aux bonnes doctrines publièrent dans les villages que Napoléon avait été pendu par les Mameluks en Égypte, comme il le méritait à tant de titres.
Parmi ces hommes qui étaient allés bouder dans leurs terres et qui revenaient altérés de vengeance, le marquis del Dongo se distinguait par sa fureur ; son exagération le porta naturellement à la tête du parti. Ces messieurs, fort honnêtes gens quand ils n’avaient pas peur, mais qui tremblaient toujours, parvinrent à circonvenir le général autrichien : assez bon homme, il se laissa persuader que la sévérité était de la haute politique, et fit arrêter cent cinquante patriotes : c’était bien alors ce qu’il y avait de mieux en Italie.
Bientôt on les déporta aux bouches de Callaro, et, jetés dans des grottes souterraines, l’humidité et surtout le manque de pain firent bonne et prompte justice de tous ces coquins.
Le marquis del Dongo eut une grande place, et, comme il joignait une avarice sordide à une foule d’autres belles qualités, il se vanta publiquement de ne pas envoyer un écu à sa soeur, la comtesse Pietranera : toujours folle d’amour, elle ne voulait pas quitter son mari, et mourait de faim en France avec lui. La bonne marquise était désespérée ; enfin elle réussit à dérober quelques petits diamants dans son écrin, que son mari lui reprenait tous les soirs pour l’enfermer sous son lit, dans une caisse de fer : la marquise avait apporté huit cent mille francs de dot à son mari, et recevait quatre-vingts francs par mois pour ses dépenses personnelles. Pendant les treize mois que les Français passèrent hors de Milan, cette femme si timide trouva des prétextes et ne quitta pas le noir.
Nous avouerons que, suivant l’exemple de beaucoup de graves auteurs, nous avons commencé l’histoire de notre héros une année avant sa naissance. Ce personnage essentiel n’est autre, en effet, que Fabrice Valserra, marchesino del Dongo, comme on dit à Milan1. Il venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent, chassés, et se trouvait, par le hasard de la naissance, le second fils de ce marquis del Dongo si grand seigneur, et dont vous connaissez déjà le gros visage blême, le sourire faux et la haine sans bornes pour les idées nouvelles. Toute la fortune de la maison était substituée au fils aîné Ascanio del Dongo, le digne portrait de son père. Il avait huit ans, et Fabrice deux, lorsque tout à coup ce général Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit du mont Saint-Bernard. Il entra dans Milan : ce moment est encore unique dans l’histoire ; figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Peu de jours après, Napoléon gagna la bataille de Marengo. Le reste est inutile à dire. L’ivresse des Milanais fut au comble ; mais, cette fois, elle était mélangée d’idées de vengeance : on avait appris la haine à ce bon peuple. Bientôt l’on vit arriver ce qui restait des patriotes déportés aux bouches de Cattaro ; leur retour fut célébré par une fête nationale. Leurs figures pâles, leurs grands yeux étonnés, leurs membres amaigris, faisaient un étrange contraste avec la joie qui éclatait de toutes parts. Leur arrivée fut le signal du départ pour les familles les plus compromises. Le marquis del Dongo fut des premiers à s’enfuir à son château de Grianta. Les chefs des grandes familles étaient remplis de haine et de peur ; mais leurs femmes, leurs filles, se rappelaient les joies du premier séjour des Français, et regrettaient Milan et les bals si gais, qui aussitôt après Marengo s’organisèrent à la Casa Tanzi. Peu de jours après la victoire, le général français, chargé de maintenir la tranquillité dans la Lombardie, s’aperçut que tous les fermiers des nobles, que toutes les vieilles femmes de la campagne, bien loin de songer encore à cette étonnante victoire de Marengo qui avait changé les destinées de l’Italie et reconquis treize places fortes en un jour, n’avaient l’âme occupée que d’une prophétie de saint Giovita, le premier patron de Brescia. Suivant cette parole sacrée, les prospérités des Français et de Napoléon devaient cesser treize semaines juste après Marengo. Ce qui excuse un peu le marquis del Dongo et tous les nobles boudeurs des campagnes, c’est que réellement et sans comédie ils croyaient à la prophétie. Tous ces gens-là n’avaient pas lu quatre volumes en leur vie ; ils faisaient ouvertement leurs préparatifs pour rentrer à Milan au bout des treize semaines ; mais le temps, en s’écoulant, marquait de nouveaux succès pour la cause de la France. De retour à Paris, Napoléon, par de sages décrets, sauvait la révolution à l’intérieur, comme il l’avait sauvée à Marengo contre les étrangers. Alors les nobles lombards, réfugiés dans leurs châteaux, découvrirent que d’abord ils avaient mal compris la prédiction du saint patron de Brescia : il ne s’agissait pas de treize semaines, mais bien de treize mois. Les treize mois s’écoulèrent, et la prospérité de la France semblait s’augmenter tous les jours.
Nous glissons sur dix années de progrès et de bonheur, de 1800 à 1810 ; Fabrice passa les premières au château de Grianta, donnant et recevant force coups de poing au milieu des petits paysans du village, et n’apprenant rien, pas même à lire. Plus tard, on l’envoya au collège des jésuites à Milan. Le marquis son père exigea qu’on lui montrât le latin, non point d’après ces vieux auteurs qui parlent toujours de républiques, mais sur un magnifique volume orné de plus de cent gravures, chefs-d’oeuvre des artistes du XVIIe siècle ; c’était la généalogie latine des Valserra, marquis del Dongo, publiée en 1650 par Fabrice del Dongo, archevêque de Parme. La fortune des Valserra étant surtout militaire, les gravures représentaient force batailles, et toujours on voyait quelque héros de ce nom donnant de grands coups d’épée. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Sa mère, qui l’adorait, obtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan ; mais son mari ne lui offrant jamais d’argent pour ces voyages, c’était sa belle-soeur, l’aimable comtesse Pietranera, qui lui en prêtait. Après le retour des Français, la comtesse était devenue l’une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugène, vice-roi d’Italie.
Lorsque Fabrice eut fait sa première communion, elle obtint du marquis, toujours exilé volontaire, la permission de le faire sortir quelquefois de son collège. Elle le trouva singulier, spirituel, fort sérieux, mais joli garçon, et ne déparant point trop le salon d’une femme ; à la mode du reste, ignorant à plaisir, et sachant à peine écrire. La comtesse, qui portait en toutes choses son caractère enthousiaste, promit sa protection au chef de l’établissement, si son neveu Fabrice faisait des progrès étonnants, et à la fin de l’année avait beaucoup de prix. Pour lui donner les moyens de les mériter, elle l’envoyait chercher tous les samedis soir, et souvent ne le rendait à ses maîtres que le mercredi ou le jeudi. Les jésuites, quoique tendrement chéris par le prince vice-roi, étaient repoussés d’Italie par les lois du royaume, et le supérieur du collège, homme habile, sentit tout le parti qu’il pourrait tirer de ses relations avec une femme toute-puissante à la cour. Il n’eut garde de se plaindre des absences de Fabrice, qui, plus ignorant que jamais, à la fin de l’année obtint cinq premiers prix. À cette condition, la brillante comtesse Pietranera, suivie de son mari, général commandant une des divisions de la garde, et de cinq ou six des plus grands personnages de la cour du vice-roi, vint assister à la distribution des prix chez les jésuites. Le supérieur fut complimenté par ses chefs.
La comtesse conduisait son neveu à toutes ces fêtes brillantes qui marquèrent le règne trop court de l’aimable prince Eugène. Elle l’avait créé de son autorité officier de hussards, et Fabrice, âgé de douze ans, portait cet uniforme. Un jour, la comtesse, enchantée de sa jolie tournure, demanda pour lui au prince une place de page, ce qui voulait dire que la famille del Dongo se ralliait. Le lendemain, elle eut besoin de tout son crédit pour obtenir que le vice-roi voulût bien ne pas se souvenir de cette demande, à laquelle rien ne manquait que le consentement du père du futur page, et ce consentement eût été refusé avec éclat. À la suite de cette folie, qui fit frémir le marquis boudeur, il trouva un prétexte pour rappeler à Grianta le jeune Fabrice. La comtesse méprisait souverainement son frère : elle le regardait comme un sot triste, et qui serait méchant si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabrice, et, après dix ans de silence, elle écrivit au marquis pour réclamer son neveu : sa lettre fut laissée sans réponse.
À son retour dans ce palais formidable, bâti par les plus belliqueux de ses ancêtres, Fabrice ne savait rien au monde que faire l’exercice et monter à cheval. Souvent le comte Pietranera, aussi fou de cet enfant que sa femme, le faisait monter à cheval, et le menait avec lui à la parade. En arrivant au château de Grianta, Fabrice, les yeux encore bien rouges des larmes répandues en quittant les beaux salons de sa tante, ne trouva que les caresses passionnées de sa mère et de ses soeurs. Le marquis était enfermé dans son cabinet avec son fils aîné, le marchesino Ascanio. Ils y fabriquaient des lettres chiffrées qui avaient l’honneur d’être envoyées à Vienne ; le père et le fils ne paraissaient qu’aux heures des repas. Le marquis répétait avec affectation qu’il apprenait à son successeur naturel à tenir, en partie double, le compte des produits de chacune de ses terres. Dans le fait, le marquis était trop jaloux de son pouvoir pour parler de ces choses-là à un fils, héritier nécessaire de toutes ces terres substituées. Il l’employait à chiffrer des dépêches de quinze ou vingt pages que deux ou trois fois la semaine il faisait passer en Suisse, d’où on les acheminait à Vienne. Le marquis prétendait faire connaître à ses souverains légitimes l’état intérieur du royaume d’Italie qu’il ne connaissait pas lui-même, et toutefois ses lettres avaient beaucoup de succès : voici comment. Le marquis faisait compter sur la grande route, par quelque agent sûr, le nombre des soldats de tel régiment français ou italien qui changeait de garnison, et, en rendant compte du fait à la cour de Vienne, il avait soin de diminuer d’un grand quart le nombre des soldats présents. Ces lettres, d’ailleurs ridicules, avaient le mérite d’en démentir d’autres plus véridiques, et elles plaisaient. Aussi, peu de temps avant l’arrivée de Fabrice au château, le marquis avait-il reçu la plaque d’un ordre renommé : c’était la cinquième qui ornait son habit de chambellan. À la vérité, il avait le chagrin de ne pas oser arborer cet habit hors de son cabinet ; mais il ne se permettait jamais de dicter une dépêche sans avoir revêtu le costume brodé, garni de tous ses ordres. Il eût cru manquer de respect d’en agir autrement.
La marquise fut émerveillée des grâces de son fils. Mais elle avait conservé l’habitude d’écrire deux ou trois fois par an au général comte d’A*** ; c’était le nom actuel du lieutenant Robert. La marquise avait horreur de mentir aux gens qu’elle aimait ; elle interrogea son fils et fut épouvantée de son ignorance.