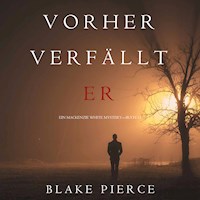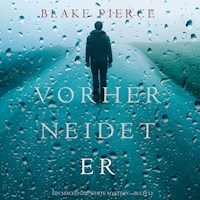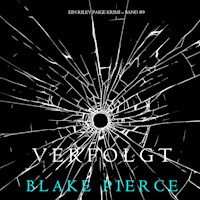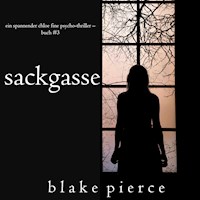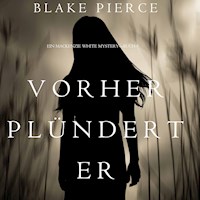0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lukeman Literary Management
- Kategorie: Krimi
- Serie: Un roman policier d'Ava Gold
- Sprache: Französisch
« UN CHEF-D'ŒUVRE DE THRILLER ET DE MYSTÈRE. Blake Pierce a accompli un travail magnifique en développant des personnages à la psychologie si bien décrite que nous avons l'impression d'être dans leur tête, de suivre leurs peurs et de nous réjouir de leur succès. Riche en rebondissements, ce livre vous tiendra éveillé jusqu'à la dernière page. » --Critiques de Livres et de Films, Roberto Mattos (à propos de Once Gone) Voici le premier roman d'une nouvelle série très attendue de Blake Pierce, auteur n°1 de best-sellers et best-seller du USA Today, dont les œuvres à succès ont reçu plus de 1 000 critiques cinq étoiles. Dans les rues mal famées du New York des années 1920, Ava Gold, 34 ans, veuve et mère célibataire, se bat pour gravir les échelons et devenir la première femme inspecteur de la brigade criminelle de son commissariat du NYPD. C'est une dure à cuire, prête à s'imposer dans un monde d'hommes. Mais lorsqu'un tueur en série psychopathe se déchaîne, assassinant de jeunes femmes à travers la ville, Ava devra explorer les sombres méandres de l'esprit torturé du tueur si elle veut avoir une chance de le traquer. Alors que le profilage psychologique n'en est qu'à ses balbutiements et que la plupart s'en moquent, Ava se retrouvera encore plus seule pour suivre son instinct et le pourchasser dans un dangereux jeu du chat et de la souris. Alors que les enjeux semblent ne pouvoir être plus élevés, Ava fait une terrible découverte : elle pourrait bien être la prochaine cible. Au milieu des bars clandestins, des clubs de jazz, des réseaux de prohibition tenus par la mafia, des asiles d'aliénés terrifiants et des ruelles sombres de la ville, Ava parviendra-t-elle à accomplir ce qu'aucun homme n'a réussi : pénétrer l'esprit malade d'un tueur et l'arrêter avant que d'autres femmes ne meurent ? Un thriller à suspense haletant, rempli de rebondissements choquants, cette série authentique et pleine d'atmosphère est un récit captivant qui se dévore d'une traite, nous attachant à un personnage fort et brillant qui saura vous séduire et vous tiendra en haleine jusque tard dans la nuit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
LA CITÉ DES PROIES (UN ROMAN POLICIER D'AVA GOLD — TOME 1)
UN ROMAN POLICIER D'AVA GOLD
BLAKE PIERCE
CHAPITRE UN
CHAPITRE DEUX
CHAPITRE TROIS
CHAPITRE QUATRE
CHAPITRE CINQ
CHAPITRE SIX
CHAPITRE SEPT
CHAPITRE HUIT
CHAPITRE NEUF
CHAPITRE DIX
CHAPITRE ONZE
CHAPITRE DOUZE
CHAPITRE TREIZE
CHAPITRE QUATORZE
CHAPITRE QUINZE
CHAPITRE SEIZE
CHAPITRE DIX-SEPT
CHAPITRE DIX-HUIT
CHAPITRE DIX-NEUF
CHAPITRE VINGT
CHAPITRE VINGT-ET-UN
CHAPITRE VINGT-DEUX
CHAPITRE VINGT-TROIS
CHAPITRE VINGT-QUATRE
CHAPITRE VINGT-CINQ
CHAPITRE VINGT-SIX
CHAPITRE VINGT-SEPT
CHAPITRE VINGT-HUIT
CHAPITRE VINGT-NEUF
CHAPITRE TRENTE
CHAPITRE TRENTE-ET-UN
CHAPITRE TRENTE-DEUX
CHAPITRE TRENTE-TROIS
CHAPITRE TRENTE-QUATRE
CHAPITRE TRENTE-CINQ
ÉPILOGUE
CHAPITRE UN
New York City
Août 1928
Les acclamations, les cris et les applaudissements commençaient à lui taper sur les nerfs. Les trottoirs étaient envahis par une foule bruyante venue assister à un rassemblement politique et à une marche—et, à son grand dégoût, il n’y avait presque que des femmes. Depuis que les femmes avaient, d’une façon ou d’une autre, obtenu le droit de vote, elles semblaient croire qu’il fallait absolument sortir et se donner en spectacle. On chantait, on criait, on lançait des hourras et des sifflets. Au milieu de tout cela, il apercevait des pancartes en papier journal et en contreplaqué. Beaucoup affichaient le même slogan : Votez SMITH pour une Amérique plus forte !
Il était parti acheter du pain, mais le vacarme dans les rues était assourdissant et plus il s’éloignait de chez lui, plus le bruit empirait. Il avait fait demi-tour, sentant les cris et les chants derrière lui comme une vague le repoussant vers la rive. Il pourrait acheter du pain demain. Ce n’était pas comme s’il avait une famille qui comptait sur lui à la maison.
Aucune épouse ne l’attendait avec un repas chaud dans l’après-midi, aucun enfant pour réclamer son attention et son temps. Il n’y avait que sa mère malade, pas vraiment souffrante mais clairement déséquilibrée—toujours en train de gémir et de hurler, voulant savoir pourquoi il peinait toujours à joindre les deux bouts, voulant savoir pourquoi il n’avait pas épousé une gentille jeune femme pour enfin lui donner des petits-enfants.
Sentant les pensées à propos de sa mère enfler en lui comme un vent furieux, il les chassa et se concentra sur sa marche. Il était six heures du soir, la journée glissait doucement vers le crépuscule. Et même si la chaleur de la journée s’atténuait, il sentait la migraine arriver. Peut-être était-ce le vacarme de la foule, un bruit inhabituel dans les rues qu’il considérait comme chez lui. Peut-être était-ce la tension de savoir ce qui l’attendait à la maison. Quoi qu’il en soit, le mal de tête montait vite, partant de la mâchoire, traversant ses dents, remontant jusqu’au crâne.
Après ce qui lui sembla une éternité, il arriva chez lui. C’était une simple maison de deux chambres, située dans un quartier ni misérable, ni vraiment aisé.
Il referma la porte et les bruits de la foule ne furent plus qu’un murmure. Il resta là un instant, les doigts posés sur la porte. La maison avait toujours cette odeur de poussière, avec une pointe de légumes sur le point de pourrir. Cela l’accueillait comme une étreinte dont il se serait bien passé, alors qu’il se détournait de la porte.
— Qu’est-ce que tu fiches ? lança la vieille voix éraillée du salon.
Il tourna la tête à droite, et aperçut sa mère. Elle était assise dans le même fauteuil qu’à son habitude. Depuis un an et demi, alors qu’elle avait renoncé à tout espoir de se remarier ou de retrouver une vie sociale après la mort de son mari, il avait vu l’espace vide de ce fauteuil se réduire de semaine en semaine. Sa mère avait pris au moins quarante kilos en dix-huit mois, à force de gâteaux et de pâtisseries qu’il rapportait souvent de la ville.
— Rien, répondit-il, s’éloignant enfin de la porte d’entrée.
— T’es sorti hurler et brailler avec toutes ces garces prétentieuses ? demanda-t-elle.
Il remarqua des miettes dans les plis de sa chemise et quelque chose qui ressemblait à de la confiture au coin de sa bouche. Il nota aussi que ses yeux exprimaient toujours la même déception mêlée de colère quand elle le regardait. Par-dessus tout, il y avait ce bourdonnement sourd de la marche politique dans la rue et, debout là, à la regarder et à écouter ce bruit lointain, il comprit pourquoi les cris des femmes l’avaient tant troublé.
C’était elle. À force de perdre des emplois et d’être incapable de séduire une femme, elle était devenue, à ses yeux, l’incarnation de toutes les femmes. Toujours à le dévisager, toujours à exiger davantage, toujours déçue.
— Pourquoi tu me fixes comme ça, abruti ? lança-t-elle. Bouge-toi, va donc dans la cuisine et rapporte-moi mon brandy.
La migraine rugissait dans sa tête. C’était comme une bombe, projetant des éclats dans chaque recoin de son crâne. Il inspira profondément, ravalant la douleur.
— Va le chercher toi-même, vieille vache.
Son air choqué était en grande partie atténué par la lourdeur de ses joues et ses petits yeux plissés.
— Qu’est-ce que tu viens de me dire ?
— Tu m’as très bien entendu, Maman.
Il s’éloigna d’elle, bien décidé à rejoindre sa chambre pour s’allonger dans l’obscurité. Sous son regard et avec le vacarme des défilés et des cris dehors, il sentit sa migraine empirer encore. S’il pouvait se reposer dans une pièce sombre, peut-être que les pulsations s’apaiseraient.
Sa voix l’arrêta alors qu’il s’éloignait.
— Ton père croyait aussi savoir ce qui était bon pour moi, dit-elle. Mais regarde lequel de nous deux est encore en vie. Maintenant, va me chercher mon brandy, pauvre idiot inutile.
La douleur explosa de nouveau, cognant dans sa tête comme une boule de démolition. Des taches noires envahirent sa vision et des rideaux sombres ondulèrent à la périphérie de son regard. Il grimaça et aspira une bouffée d’air vicié. Les dents serrées, il répondit :
— Oui, Maman.
Il descendit le petit couloir, ses pas faisant gémir les vieux planchers. Il entra dans la cuisine mais ne s’arrêta pas à l’armoire où sa mère rangeait son brandy. Il avançait comme poussé par une force invisible, peut-être par les cris des innombrables femmes dans la rue. Sans même y réfléchir, il se dirigea vers la porte de derrière et l’ouvrit. Il sortit sur le perron, un simple bloc de béton qui donnait sur leur arrière-cour presque entièrement morte.
Il ferma les yeux, la migraine s’enfonçant dans son crâne comme des clous de chemin de fer. Il entendait les acclamations et les rires dans la rue, un million de femmes, semblait-il, toutes en train de l’encourager à faire ce qu’il s’apprêtait à faire ou de se moquer de lui parce qu’il était si impuissant face à sa mère.
Sur la droite, il y avait une petite pile de bois pourri qu’ils utilisaient parfois pour alimenter la vieille cheminée presque hors d’usage du salon. Appuyée contre la maison, la hachette dont il se servait pour fendre le bois. Elle était vieille et émoussée, et il se souvenait, enfant, de son père lui apprenant à tailler des copeaux et à repérer la fissure au sommet d’une bûche pour la fendre plus facilement.
Il saisit la hachette et rentra — repassa par la cuisine, puis le couloir. Il trouvait étrange et presque poétique de savoir que les grincements du plancher seraient parmi les derniers sons que sa mère entendrait jamais.
Les craquements du sol résonnaient avec sa migraine. Très loin, il percevait encore les acclamations de toutes ces femmes, leurs longs cheveux chauffés par le soleil, leurs corps provocants, moites et interdits.
Au dernier grincement, juste avant d’entrer dans le salon, tout devint noir, la migraine abattant un rideau de fer sur sa vue et ses sens.
Quelques instants plus tard, il laissa tomber la hachette et ressortit par la porte d’entrée.
Couvert de sang, il marcha vers le bruit joyeux des femmes. À chaque pas, la migraine s’estompait et les sons de fête l’engloutissaient, taches de sang et tout le reste.
CHAPITRE DEUX
New York
Juillet 1929
Son mari était mort, allongé dans le cercueil à moins d’un mètre d’elle, et tout ce qu’Ava Gold parvenait à penser, c’était qu’il y avait une profusion de chapeaux dans le petit club où se tenait la veillée. Hommes et femmes, civils comme policiers, portaient des couvre-chefs de toutes formes et tailles. Dehors, le soleil brillait, la journée était splendide, gâchée par la nécessité d’enterrer son mari de trente-quatre ans, et tous ces chapeaux autour d’elle lui rappelaient les parasols qu’elle voyait souvent à Coney Island. Étrange, pensa-t-elle, comme le cerveau fait tout pour détourner l’attention de la réalité de la mort.
En ce moment, son esprit tentait d’assimiler l’idée qu’elle allait devoir vivre le reste de sa vie sans son mari. Elle savait que c’était la vérité, mais cela ne lui semblait pas réel. Elle repassait les faits dans sa tête encore et encore, comme si elle répétait les paroles d’une chanson qu’elle avait chantée des centaines de fois : son mari, Clarence Gold, abattu de cinq balles alors qu’il répondait à un simple appel pour vol. Le suspect portait un manteau de travail épais, était plutôt petit—et c’était tout ce qu’elle savait. C’étaient là tous les détails que les témoins avaient pu fournir.
Elle ne s’était pas attendue à voir autant de policiers à la veillée, mais ils étaient venus en masse. Leurs uniformes semblaient presque donner une cohérence à toute la scène, comme s’ils avaient eux-mêmes cousu ce moment. Dans environ cinq minutes, ils se déplaceraient tous au cimetière, et elle supposait que ce serait pareil. Des képis et des policiers, l’encerclant comme des abeilles.
Même maintenant, alors que le pasteur de leur église lisait des Psaumes, elle percevait vaguement un policier qui donnait une tape encourageante sur l’épaule de son fils. Jeffrey, assis à sa gauche et fixant le cercueil comme s’il s’agissait d’une énigme à résoudre, semblait ne rien remarquer. Ava comprenait ce qu’il ressentait et aurait voulu pouvoir l’expliquer. Elle avait fait de son mieux ces trois derniers jours, mais elle en était venue à la conclusion qu’il était impossible de traverser le deuil avec un enfant de neuf ans quand son propre esprit refusait d’accepter la réalité de la situation. Jeffrey n’avait presque rien dit depuis la mort de son père. À neuf ans, elle supposait que la mort était vraiment une drôle de bête. Trop jeune pour en saisir toute la finalité, mais assez grand pour comprendre qu’il y avait de la douleur, et qu’on attendait de vous une certaine réaction.
À sa droite, Ava était encadrée par son père, un homme auprès duquel elle trouvait d’ordinaire du réconfort. Mais à présent, elle le voyait comme un homme simplement présent, un visage de plus dans la foule venue pleurer la perte de son mari. Ava se disait qu’ils auraient peut-être été plus proches si son père avait passé plus de temps avec elle lorsqu’elle était enfant, au lieu de le passer sur un ring de boxe. Elle s’était toujours sentie coupable d’avoir savouré la nuit où il était rentré avec la main gauche brisée ; elle avait compris, même à l’époque, que cela signifiait la fin de sa carrière de boxeur. À présent, Roosevelt Burr, qui avait préféré le ring à sa famille, pleurait un autre homme qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille.
Le pasteur termina sa lecture, prononça une prière à laquelle Ava prêta à peine attention. Certains y virent le signal pour venir dire « bonjour » ou « toutes mes condoléances » ou encore « il est dans un monde meilleur maintenant ».
Puis tout le monde fut invité à sortir. Tandis que les rangs de policiers commençaient à quitter la salle pour rejoindre les Model T qui les conduiraient au cimetière, quelqu’un se mit à jouer de la trompette sur la pelouse. Alors que l’air de « Blessed Assurance » emplissait la pièce de ses notes cuivrées et ténues, Ava aperçut quelque chose qui lui semblait familier, entier—quelque chose qui lui rappelait que oui, elle assistait bien à la veillée de son mari et que oui, tout cela était réel. Le son de la trompette, même si l’hymne le rendait plat et monotone, parvenait toujours à lui remonter le moral. En se levant et en prenant la main de Jeffrey, Ava songea à toutes les façons dont le trompettiste pourrait améliorer l’air. Un petit passage ici, une variation là, et elle pourrait y ajouter sa voix.
Du jazz, pensa-t-elle. Tu penses vraiment au jazz en ce moment ?
Elle sentit la main forte de son père sur son bras, la guidant vers l’avant. Apparemment, elle s’était arrêtée de marcher. C’était le chagrin, supposait-elle. Elle le sentait monter en elle et savait qu’à un moment, la digue céderait et qu’elle perdrait pied. Elle avait envie de se retourner vers le cercueil, mais n’osa pas.
— Ava ? appela une voix d’homme.
Elle cligna des yeux comme si elle sortait d’une sieste et tourna la tête vers la droite. Elle reconnut le visage du capitaine Douglas Minard. Il avait un visage doux, que l’âge était en train de ravager sans ménagement. Il approchait de la soixantaine, mais son vécu le faisait paraître bien plus vieux, presque quatre-vingts ans. Il prit sa petite main dans la sienne, large et couverte de callosités. Lorsqu’il la regarda, elle apprécia qu’il ait pleuré ; ses yeux étaient rouges et les traces de larmes bien visibles autour.
— Capitaine, dit-elle. Merci beaucoup d’être venu.
— Bien sûr. Je voulais que tu saches à quel point j’estimais Clarence. C’était l’un des meilleurs… au sein du service comme en dehors. Et Dieu sait combien il t’aimait, il ne cessait de parler de toi avec fierté.
Ava lui adressa un sourire chaleureux, se demandant si le capitaine Minard essayait de la faire pleurer, de briser la tension qui la tenait.
— Oui, il l’était. Il était mon…
Mais elle ne trouva pas les mots. Chaque fois qu’elle avait tenté de le décrire ces trois derniers jours, elle s’était sentie stupide. C’était comme si son vocabulaire s’était desséché, chaque mot d’amour pour Clarence pourrissant sur le sol tremblant de son esprit.
— Ava… est-ce qu’il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, ou quelqu’un du service ?
Sa langue forma le mot non, mais son cerveau l’en empêcha au dernier moment. En regardant le capitaine Minard, elle se demanda si la prière qu’elle adressait depuis la mort de Clarence était en train d’être exaucée. Et quand les quatre mots suivants franchirent ses lèvres, elle en fut la première surprise. Elle ne put s’empêcher de se demander si Clarence était là, d’une façon ou d’une autre, peut-être en train de la guider depuis l’au-delà.
— Je voudrais un travail.
— Un travail ? demanda Minard, manifestement abasourdi. S’il n’avait pas pleuré, elle pensa qu’il aurait pu en rire.
— Je dois subvenir aux besoins de Jeffrey. Et je veux empêcher le prochain salaud de transformer un enfant en orphelin… une femme en veuve.
Le capitaine Minard jeta un regard autour de lui, observant les gens qui quittaient la pièce, comme s’il cherchait une bouée de sauvetage dans cette situation étrange. Il remarqua aussi le père d’Ava, debout à un mètre de là, qui n’essayait même pas de cacher qu’il écoutait.
— Ava, c’est peut-être la douleur qui parle, dit Minard à voix basse. Tu ne veux tout de même pas travailler à la police. En plus d’être une femme, les gens que tu devras affronter sont—
— Et qu’est-ce qu’il y a de mal à être une femme ? demanda Ava. Elle espérait presque qu’il fasse une remarque stupide sur l’inaptitude des femmes à la police.
— Rien. Mais tu ne peux pas… Il s’interrompit, à court d’arguments. Elle eut presque pitié de le mettre dans cette position, mais après tout, c’est lui qui avait posé la question.
— Je ne vais pas rester les bras croisés alors que mon mari a été abattu, ajouta-t-elle, étonnée de la fermeté de sa voix.
— Ava, tu ne peux pas juste… Je veux dire, on a déjà assez d’hommes compétents pour retrouver les meurtriers et—
— Alors, où est l’assassin de mon mari ?
Minard eut l’air de recevoir une gifle. Et était-ce une lueur de colère qu’elle aperçut ? Apparemment, la vérité faisait mal. Quatre hommes avaient vu son mari se faire tirer dessus ; quatre hommes avaient vu celui qui avait appuyé sur la gâchette. Pourtant, son meurtrier courait toujours. Minard chercha du regard son père, espérant toujours s’en sortir, mais Rosie Burr se contenta de hausser les épaules et de sourire.
— Tu es chanteuse, non ? demanda Minard. Une très bonne chanteuse, d’après ce qu’on dit. Pourquoi ne pas continuer le jazz ? Pourquoi ne pas—
— Je suis plus qu’un oiseau qui chante, coupa Ava. Les femmes aussi savent appuyer sur la détente. Elle sentait la colère monter et l’accueillit volontiers. Elle préférait être en colère que triste, en cet instant. Cette rage serait peut-être ce qui lui permettrait de tenir pendant la cérémonie, sans s’effondrer en larmes.
Elle fit un pas de plus vers Minard, s’efforçant de rester polie et respectueuse, mais ferme à la fois.
— Clarence m’a dit un jour que les hommes avec qui il travaillait étaient comme une famille. Qu’ils étaient comme des frères. Il m’a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, ses frères veilleraient sur moi. Et maintenant, je réponds honnêtement à votre question. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Oui : vous pouvez me trouver un poste de détective.
Minard recula de deux pas, réalisant qu’il tenait encore sa main. Il la lâcha lentement et jeta un regard autour de la pièce. La trompette jouait toujours dehors, et le salon était vide, à l’exception d’Ava, du capitaine Minard, de Roosevelt Burr et du cercueil de Clarence Gold. Jeffrey avait apparemment été escorté dehors par un des amis de Clarence. Constatant cela, Minard prit une voix plus grave. Toute trace de tristesse ou de compassion semblait s’effacer.
— D’accord, Ava, dit-il. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je peux te dire tout de suite que tu ne deviendras pas détective. Ce n’est tout simplement pas une place pour une femme. Quel que soit le poste que je pourrai t’obtenir…
Il s’arrêta là, cherchant le regard du père d’Ava. Minard avait sûrement entendu parler des années de boxe de Rosie Burr et pesait ses mots avec soin.
— Le poste que je pourrai te trouver n’offrira aucune perspective d’évolution, mais tu toucheras un salaire régulier. Viens au bureau lundi et je m’occuperai de toi.
Elle hocha la tête, de peur de dire autre chose. Cela ressemblait à une victoire, bien sûr, mais elle avait aussi l’impression qu’un gros bonnet venait de la mettre au défi. Et, d’une façon encore plus étrange, elle sentit que c’était la première chose qu’elle faisait depuis la mort de Clarence dont il aurait été fier.
— Merci, dit Ava, sans détourner les yeux.
Le capitaine Minard se détourna et fit quelques pas vers la porte avant de s’arrêter et de se retourner vers elle.
— Je suis content que ton père ait entendu tout ça. Comme ça, on ne pourra pas m’accuser quand tu commenceras à avoir des problèmes. Et tu en auras. La plupart des femmes ne tiennent pas plus de deux semaines.
Sur ces mots, Minard sortit, suivant le son assourdi de la trompette.
Rosie eut un petit rire et passa un bras autour de sa fille.
— Qu’est-ce qui te fait rire ? demanda Ava.
— La plupart des femmes ne tiennent pas deux semaines, répéta Rosie, citant Minard. Dommage pour lui que tu ne sois pas « la plupart des femmes », hein ?
Elle esquissa un sourire, mais, sans trop savoir pourquoi, la remarque lui serra la gorge et elle sentit la tension en elle prête à éclater. La tête baissée, appuyée contre l’épaule de son père, Ava Gold sortit et chercha à trouver un rythme à cette vieille trompette mélancolique, tandis qu’elle se préparait à enterrer son mari.
CHAPITRE TROIS
Ava observa le 37e commissariat depuis l’autre côté de la rue. L’espace d’un instant, elle eut l’impression de contempler un autre monde, un lieu fantastique dont elle n’avait entendu parler qu’en rêve. Le bâtiment était imposant, à deux détails près d’être élégant. Il se détachait nettement comme l’édifice le plus remarquable du quartier, comme un phare rappelant aux criminels où ils finiraient.
Un mélange d’excitation et de nervosité la traversa alors qu’elle traversait la rue. Elle était si absorbée qu’elle faillit se jeter devant une Ford T. Le conducteur hurla quelque chose à propos d’une « folle dingue », levant le poing alors que la voiture cahotait plus loin. C’était comme si elle avait fait abstraction du monde extérieur—pendant une ou deux secondes, il n’y avait eu qu’elle et le 37e commissariat.
Six jours s’étaient écoulés depuis les funérailles de Clarence. Cela ne lui semblait pas suffisant pour tourner la page, pour commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Mais en même temps, ces six jours lui paraissaient une éternité. Et puis… Clarence n’aurait jamais voulu qu’elle reste là à pleurer sur son sort. Elle avait la certitude d’agir comme il l’aurait souhaité.
Quand elle entra, elle en eut presque le vertige. Un vaste espace ouvert s’étendait devant elle, des gens circulaient derrière des bureaux et ce qu’elle devina être le « plateau » dont Clarence avait parlé à plusieurs reprises. Elle s’approcha de l’accueil et posa les yeux sur l’homme pâle et corpulent assis derrière le comptoir.
Il la regarda avec un sourire qui semblait sincère.
— Je peux vous aider ? demanda-t-il.
— Oui, je m’appelle Ava Gold. J’ai rendez-vous avec… enfin, je ne sais pas exactement qui. Mais le capitaine Minard m’attend.
À l’évocation de son nom, la compréhension illumina son regard.
— Ah oui, bien sûr. On vous attendait.
Il décrocha le combiné du téléphone interne posé sur son bureau. Il appuya sur un bouton comme s’il poignardait quelqu’un, attendit une seconde, puis prononça deux mots dans le combiné :
— Elle est là.
Aucun d’eux ne dit un mot, et alors que quelques secondes s’écoulaient, Ava sentit le regard d’autres hommes sur elle, tandis qu’ils passaient, vaquant à leurs tâches matinales. Certains ne la détaillaient pas comme un insecte, à la manière de l’homme corpulent, mais plutôt comme un morceau de viande appétissant à dévorer.
Moins d’une minute plus tard, un homme d’âge mûr traversa rapidement le plateau en direction de l’accueil. Il fixa Ava droit dans les yeux et avançait d’un pas pressé. Une moustache grisonnante couvrait sa lèvre supérieure et il portait des lunettes qui faisaient briller ses yeux bruns.
— Madame Gold ? demanda l’homme à la moustache.
— Oui.
— Ravi de vous rencontrer, dit-il. Il sembla vouloir lui tendre la main pour la saluer, puis se ravisa, jugeant sans doute que ce n’était pas approprié. — Je suis Wayne Gibb et j’ai le plaisir de vous faire visiter. Ce n’est pas vraiment une formation, mais c’est tout ce qu’on a.
Il lui adressa un sourire un peu hésitant, puis lui fit signe d’avancer.
— Suivez-moi.
Gibb ouvrit la petite porte battante qui menait derrière le plateau. Quand Ava passa, elle eut l’impression que tout le commissariat retenait son souffle. Un silence étrange s’installa et elle sentit leurs regards peser sur elle. Elle comprenait, en un sens — mais cela ne le justifiait pas. L’adoption du Dix-neuvième Amendement n’avait pas changé autant de choses que les gens voulaient bien le croire. Oui, les femmes pouvaient voter, mais elles restaient perçues comme de simples êtres vivants destinés à tenir la maison propre pour leur mari ; on attendait d’elles qu’elles fassent le ménage, la cuisine, et qu’elles donnent naissance à un enfant dès que leur époux jugeait le moment opportun.
Elle s’efforça d’ignorer tout cela tandis que Gibb lui faisait découvrir le commissariat. Elle avait entendu Clarence en parler des dizaines de fois, mais le voir de près avait quelque chose d’irréel. Elle découvrit tous les bureaux et couloirs, la galerie des suspects sur le mur de droite près d’un groupe de bureaux qu’elle supposa être ceux des inspecteurs. Elle aperçut des panneaux indiquant la direction du service courrier, des cellules de détention, et même du petit gymnase — dont elle savait, grâce à Clarence, qu’il servait souvent à entreposer les prisonniers arrêtés tard dans la nuit, pour qu’on puisse les photographier et dresser leur profil le lendemain matin. Elle aurait aimé se laisser gagner par l’émotion en réalisant qu’elle marchait dans les mêmes couloirs que Clarence autrefois, mais ce ne fut pas le cas. Elle n’allait certainement pas pleurer devant ces hommes qui misaient déjà sur son échec.
— Vous serez bien sûr affectée au Bureau des femmes, annonça Gibb. Il y a là-bas un groupe de filles très sympathiques qui vous aideront à prendre vos marques.
Elle avait plusieurs questions sur le Bureau des femmes, mais ne voulut pas paraître trop enthousiaste ou ignorante, alors elle garda le silence. Elle suivit Gibb et écouta son tour du commissariat, peu inspiré : salle de pause, toilettes, plateau, emplacement des téléphones internes reliant tous les bureaux, armurerie, et enfin le Bureau des femmes. Elle ne fut pas vraiment surprise de découvrir qu’il se trouvait tout au fond du bâtiment. Il fallait même descendre un petit escalier, comme pour rappeler aux femmes qu’elles ne faisaient pas vraiment partie du club d’en haut.
Alors qu’elle avançait aux côtés de Gibb, elle remarqua de nombreux hommes la dévisager. Certains affichaient de petits sourires en coin. Tout cela la poussait à se demander s’ils se fichaient vraiment d’avoir passé plusieurs années à travailler avec son mari—à le connaître, à le respecter. Tout cela disparaissait-il simplement parce qu’elle avait eu l’audace de croire qu’elle pouvait travailler ici ? Elle se demanda si Gibb était au courant. Elle supposait que oui, si Minard l’avait affecté à elle. Elle ne savait pas si elle devait apprécier le fait que Gibb n’ait rien mentionné ou si cela l’agaçait.
— Il y aura un peu de paperasse, bien sûr, dit Gibb alors qu’ils arrivaient au bas des escaliers menant au Bureau des Femmes. Mais on te remettra tout ça d’ici la fin de la journée. Des questions ?
Elle en avait beaucoup, mais ne voulait pas passer pour une idiote, alors elle posa simplement la plus urgente.
— Y a-t-il une sorte de programme de formation ?
Gibb haussa les épaules, et Ava vit bien qu’il faisait de son mieux pour ne pas sourire.
— Tu vas y avoir droit tout de suite. On t’a assignée à une collègue du bureau. Elle t’apprendra les ficelles du métier.
Ils arrivèrent au bout du couloir, devant une double porte encastrée dans le mur. Un panneau suspendu au chambranle indiquait NYPDWB. Comme si la situation n’était pas déjà assez gênante, pensa Ava, même l’abréviation est maladroite.
Gibb ouvrit la porte mais ne franchit pas le seuil. Il lui adressa un sourire et dit :
— Si tu as la moindre question, n’importe laquelle de ces dames pourra sûrement y répondre. Sinon, tu peux toujours revenir à l’accueil et demander après moi.
— Merci, répondit Ava.
Sur ces mots, Ava entra dans la pièce et fit le premier pas sur le chemin qu’elle était bien décidée à transformer en carrière.
***
Presque aussitôt, il devint évident que ces femmes—elles étaient quatorze en tout—savaient que personne ne les prenait au sérieux, et elles semblaient en tirer une certaine fierté. Toutes étaient cordiales, mais chacune avait quelque chose de particulier. Ava le sentit sans même leur avoir encore adressé la parole.
Une femme de petite taille, aux épaules larges, vint à sa rencontre dès qu’elle franchit la porte. Son visage était quelconque, mais ses cheveux semblaient particulièrement soignés. Ils ondulaient juste au-dessus de ses épaules lorsqu’elle s’approcha d’Ava.
— Gold, c’est bien ça ? demanda la femme.
— Oui, c’est bien ça. Ava Gold.
— Ava, je m’appelle Frances Knight. Je vais te superviser jusqu’à ce que tu sois à l’aise. Je suis là depuis le début—ce qui ne fait pas longtemps, crois-moi—et je connais à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur le WB—le Bureau des Femmes.
Avant qu’Ava ait pu dire un mot, Frances Knight posa une main dans son dos et la guida à travers la pièce. Marchant côte à côte, Ava réalisa qu’elle dépassait Frances d’au moins vingt centimètres. Elle jeta un coup d’œil autour d’elle et remarqua très vite que cet endroit, comparé au reste du bâtiment, n’était guère plus qu’un sous-sol vaguement réaménagé.
— Ton bureau est ici, dit Frances en désignant d’un signe de tête un bureau posé devant elles comme une épave rejetée par la mer. Et non, on ne peut pas le déplacer.
Le bureau était une antiquité massive, reléguée dans un coin. Il était si vieux et marqué qu’Ava pouvait facilement imaginer qu’une partie de la Constitution y avait été rédigée. Une pile de papiers y trônait, accompagnée de deux stylos flambant neufs.
— Le protocole veut que tu lises tous ces documents, expliqua Frances. Il n’y a ni test, ni formation, ni récitation après. Tu dois juste signer un papier attestant que tu as tout lu et compris.
— D’accord…
— Bon, si tu veux bien m’excuser, il faut que je retourne à mon rapport. N’hésite pas si tu as la moindre question.
Frances parlait vite et, lorsqu’elle commença à retraverser la pièce, Ava eut l’impression d’avoir survécu à un ouragan. Elle balaya la salle du regard en s’asseyant et remarqua que quelques femmes la fixaient. Elle constata aussi que seules quelques-unes portaient du maquillage, et que la plupart arboraient des coiffures simples et ternes. Il y avait neuf femmes dans la pièce, mais quatorze bureaux. Parmi ces neuf femmes, trois l’observaient avec curiosité, et une autre avec une sorte d’inquiétude.
Ava détourna les yeux et se concentra sur les papiers devant elle. Elle se mit à les lire et fut surprise de constater à quel point certains passages lui rappelaient des conversations qu’elle avait eues avec Clarence à propos de son travail. On y trouvait des détails sur les procédures d’enquête appropriées, mais tout cela restait très succinct. Elle se demanda à quel point les documents avaient été édulcorés pour le WB, par rapport à ceux destinés aux hommes à l’étage.
Au bout d’une vingtaine de minutes, elle tomba sur un ensemble de documents détaillant le comportement et la tenue qu’elle devait adopter. Certains passages la firent grimacer. Le ton employé donnait presque l’impression que les femmes du 37e commissariat n’étaient guère plus que des animaux de compagnie.
En parcourant les consignes Tenue appropriée pour les femmes, une femme mince au menton pointu se pencha par-dessus son épaule.
— Le mieux que tu puisses faire avec ça, dit-elle, c’est de le ramener chez toi et de t’en servir comme papier toilette. Peu importe ce que tu portes ici, les hommes te reluqueront quand même. Et crois-moi, ma belle, ce n’est pas flatteur.
— Ce qu’ils supportent vraiment pas, lança une autre femme assise à un bureau voisin, c’est quand tu oublies de mettre un soutien-gorge.
Un éclat de rire général s’ensuivit, mais il retomba aussitôt. Quelques femmes, surprises de s’être laissées aller, se replongèrent aussitôt dans leurs dossiers et leur paperasse.
La grande femme au menton pointu poussa un soupir.
— Ça, dit-elle, ça s’appelle rire. On n’en entend pas beaucoup ici, au WB. Les femmes, au cas où tu l’ignorerais, doivent être vues, pas entendues… Le dix-neuvième amendement ou pas.
— J’espérais un peu que ce serait différent ici, avoua Ava.
— Parfois, ça l’est. La femme fit alors quelque chose qu’Ava n’avait jamais vu : elle lui tendit la main, comme deux hommes qui s’apprêtent à discuter.
— Je m’appelle Lottie Mattingly, dit-elle.
— Ava Gold, répondit Ava en serrant la main de Lottie. Sa poigne était ferme et assurée. Ava sut tout de suite qu’elle appréciait Lottie Mattingly.
— Tu sais, certaines d’entre nous ont déjà croisé ton mari, dit Lottie. C’était un sacré bonhomme. Il faisait partie des rares à ne pas rechigner à travailler avec nous. Pour lui, on était des collègues, pas juste des nanas. Elle fronça les sourcils et ajouta : Je suis vraiment désolée pour ta perte.
— Merci. Il était—
Elle fut interrompue par un bruit assourdissant. Il lui fallut un instant pour comprendre qu’il s’agissait du téléphone. Ava n’en avait jamais entendu d’aussi bruyant. Il vibrait et sonnait comme une alarme. Elle remarqua que même certaines habituées sursautaient, la main sur la poitrine, en riant nerveusement.
Ava regarda autour d’elle alors que le téléphone sonnait une seconde fois. À l’autre bout de la pièce, Frances marmonnait une série de jurons en se levant de son bureau, stylo à la main, pour se diriger vers le téléphone mural fixé sur le mur en parpaings.
— Knight à l’appareil, annonça Frances dans le combiné. Ava remarqua qu’elle tenait le téléphone contre sa tête comme si elle s’en méfiait—comme s’il s’agissait d’une arme chargée plutôt que d’un simple téléphone.
— Oui, monsieur, dit Frances, hochant la tête en suivant la conversation. Oui, monsieur. Bien sûr… Vous en êtes certain ? Oui, je suis désolée, bien sûr. Oui, monsieur.
Frances reposa le combiné sur le socle du téléphone et poussa un soupir. Elle observa la pièce en secouant la tête. Très doucement, elle murmura :
— Quelle bande de pauvres types sans relief.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda l’une des femmes. Ava remarqua qu’elles fixaient toutes Frances avec une sorte d’attente fébrile. Cela lui fit penser qu’elles ne recevaient pas souvent d’appels des hommes du dessus.
Frances regarda directement Ava et soupira.
— Tu as bientôt fini avec ces papiers ?
— Presque. Pourquoi ?
— Signe vite et passe à la suite, dit Frances. Je viens de recevoir un ordre direct du capitaine Minard. Il veut que je t’emmène en patrouille.
Un brouhaha s’éleva parmi les femmes. Certaines semblaient presque amusées, d’autres étaient manifestement horrifiées. Ava remarqua que quelques-unes lui lançaient des regards de pitié, comme si elle était un veau qu’on s’apprêtait à mener à l’abattoir.
— Mais ça n’a aucun sens, protesta Ava. Je suis là depuis même pas deux heures.
— Tu m’en diras tant, répondit Frances.
— Il veut te donner une leçon, lança Lottie depuis son bureau. Il veut que tu aies peur. Il veut que tu doutes de toi.
Ava mit un moment à assembler les morceaux et, quand elle comprit, elle se sentit à la fois en colère et gênée.
— Donc vous savez toutes… ?
— Que tu lui as demandé du travail à la veillée de Clarence ? dit Lottie. Oui, on sait. Et personne ici ne te juge. Si je pouvais faire disparaître le lâche qui l’a tué, je le ferais. J’imagine à peine ce que tu ressens.
— En d’autres termes, dit Frances en jetant son stylo sur son bureau, sois prête dans cinq minutes. Toi et moi, on va arpenter les rues.
***
N’ayant aucune idée qu’elle partirait en patrouille dès son premier jour, Ava s’était habillée sobrement mais avec soin. La robe violette de jour était l’une des préférées de Clarence, alors cela lui avait semblé approprié. La robe convenait pour marcher sur le parcours de patrouille, mais les escarpins façon garçonne allaient vite transformer ses pieds en enfer. Après seulement un pâté de maisons, elle se promit mentalement d’acheter de meilleures chaussures de marche.
Elle observa aussi les rues elles-mêmes. Marcher à cette heure de la journée lui rappelait brutalement que la ville comptait désormais près de six millions d’habitants, et qu’elle semblait grandir chaque jour. L’air sentait l’eau de Cologne, le parfum, et une légère odeur d’alcool là où la police prohibitionniste avait récemment vidé des bouteilles dans les caniveaux. Et même si elle s’était un peu habituée à la silhouette imposante des nouveaux gratte-ciel, elle ne pouvait s’empêcher de se sentir minuscule au milieu de tout cela.
— Tiens, c’est pour toi, dit Frances alors qu’elles traversaient un passage piéton à la hâte. Elle tendit à Ava un petit sifflet accroché à une chaîne. Porte-le autour du cou, et siffle si tu vois quelque chose qui nécessite l’intervention de la police.
— Mais… on n’est pas la police ? demanda Ava.
— Si, mais on est des femmes. On voit un délit, on siffle, et les hommes rappliquent.
Une bouffée familière de colère et de ressentiment monta en Ava. Elle n’avait jamais été douée pour accepter la place de seconde zone réservée aux femmes dans ce monde.
— Et ça ne laisse pas le temps aux criminels de filer ?
— C’est vrai, et c’est une façon bien idiote de faire ce boulot. Mais c’est…
Frances s’arrêta à l’angle de la rue suivante et tira Ava sur le côté.
— Écoute-moi bien. Ce monde appartient aux hommes. Ça a toujours été comme ça, et ça ne changera jamais. Si tu as pris ce poste en pensant qu’il y avait de l’égalité dans la police, tu ferais mieux de faire tes valises et de rentrer chez toi tout de suite. Ne te méprends pas… ça peut être gratifiant, et parfois, ça permet à des femmes méritantes d’être sous les projecteurs, le temps d’une journée ou deux. Et de temps en temps, qui sait ? Peut-être que tu participeras à quelque chose d’excitant. Mais la plupart du temps… voilà à quoi ça ressemble. Patrouiller, avoir l’air innocente et insignifiante. C’est pénible, mais c’est aussi ingénieux. La plupart des hommes capables de commettre des crimes nous voient et pensent qu’on n’est que deux femmes quelconques. Et toi… eh bien, ils voient une jolie fille. Jamais ils ne s’imagineraient que tu es flic.
— Flic ?
— C’est comme ça que certains abrutis du coin appellent les policières.
— Ah.
— Alors, continue d’avoir l’air jolie et garde bien ce sifflet caché sous ta robe. Et en parlant de cette robe, tu devrais vraiment faire plus attention aux consignes sur la tenue à adopter.
Fidèle à son style de tornade, Frances se remit à marcher dès qu’elle eut fini sa phrase. Sans se retourner vers Ava, elle poursuivit :
Ava comprit que cette femme aimait son métier et voulait que d’autres femmes réussissent. C’était le genre de femme qui avait accepté que les femmes soient considérées comme inférieures, et non seulement elle l’acceptait, mais elle semblait en tirer parti.
— À moins qu’il n’y ait un grand bouleversement, reprit Frances, tes rondes se limiteront à Morningside Heights et Harlem. Peu de criminalité, une patrouille facile. Tu verras peut-être des petits vols ou des disputes quand les hommes partent travailler. Mais ça s’arrête là. Maintenant, si tu—
Frances fut interrompue par un homme qui passa près d’elles, un sourire narquois aux lèvres.
— Salut, beauté. Montre-moi un peu la longueur de tes gambettes !
Il ricana en s’éloignant dans l’autre sens.
— Et tu ferais bien de t’habituer à ça aussi, ajouta Frances. Soyons honnêtes. Regarde-moi. Observe bien. On ne me fait pas souvent ce genre de remarques. Mais certaines des autres filles, si. Et tu n’y pourras pas grand-chose. Tu auras un badge un jour, mais la plupart des hommes s’en fichent complètement.
— Tu crois qu’ils s’en soucieraient si je leur en collais une ?
— Peut-être, répondit Frances en souriant. Mais c’est le meilleur moyen de te faire virer. J’aime bien ton côté bagarreur, cela dit. Ça vient du fait d’être mariée à Clarence ?
— Et d’avoir un père boxeur. Il m’arrivait de m’entraîner avec lui de temps en temps.
— De la vraie boxe ?
— Oui, répondit Ava, essayant de ne pas paraître trop fière.
— Bon à savoir. Je ferai attention à rester dans tes bonnes grâces.
Elles continuèrent leur chemin, Frances expliquant longuement à quoi s’attendre. Elle précisa à Ava que, la plupart du temps, la brigade féminine ne s’aventurait pas dans les quartiers plus difficiles comme le Lower East Side ou le quartier italien.
— C’est là que traînent pas mal de ces crapules de la mafia, expliqua Frances. Pas l’endroit idéal pour une femme, même si elle sait boxer. Ne te méprends pas… il peut y avoir des coins louches ici aussi. La prostitution devient un vrai problème et les bars clandestins poussent partout. Alors, reste bien vigilante. C’est facile à repérer : cherche les femmes habillées comme des filles de joie et les hommes rouges comme des tomates qui tiennent à peine debout.