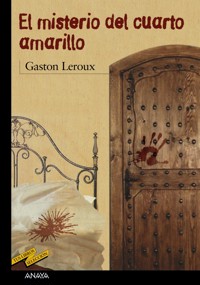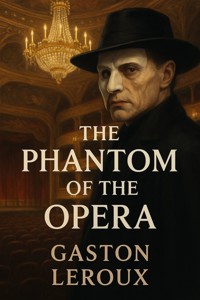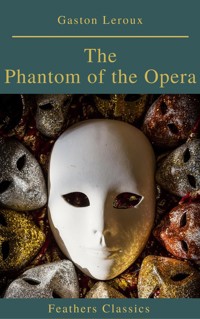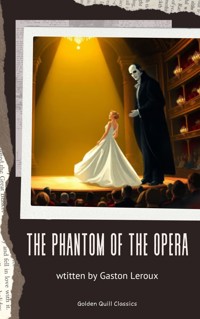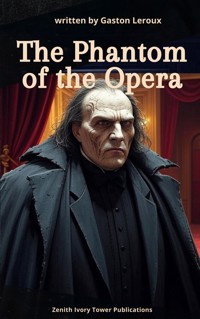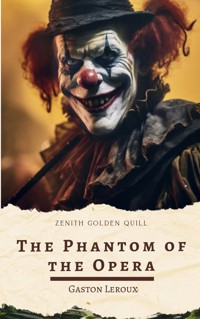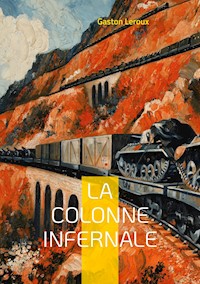
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : **** "La colonne infernale" de Gaston Leroux, Tome I, nous plonge dans une époque tumultueuse où les tensions politiques et sociales façonnent le destin des personnages. L'intrigue se déroule pendant la Révolution française, une période marquée par le chaos et l'incertitude. Le récit suit un groupe de personnages variés, chacun avec ses propres motivations et défis, alors qu'ils naviguent à travers les dangers de la guerre civile. Le protagoniste, un jeune homme idéaliste, se retrouve pris dans le tourbillon des événements révolutionnaires. Animé par un sens aigu de la justice, il s'engage dans une lutte contre les forces oppressives qui menacent de détruire tout ce qu'il chérit. À travers son parcours, le lecteur découvre les complexités des relations humaines et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés ceux qui vivent en temps de guerre. Leroux, avec sa maîtrise narrative, dépeint les horreurs de la guerre tout en explorant les thèmes de loyauté, de trahison et de rédemption. Les personnages secondaires, chacun avec une histoire riche, ajoutent de la profondeur à l'intrigue, offrant un aperçu des différentes perspectives sur la révolution. Le roman est un témoignage poignant de la résilience humaine face à l'adversité, illustrant comment même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'humanité peuvent prévaloir. À travers des descriptions vivantes et un rythme soutenu, Leroux captive le lecteur, l'entraînant dans un voyage émotionnel à travers l'histoire. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : **** Gaston Leroux, né le 6 mai 1868 à Paris, est un écrivain français renommé pour ses romans policiers et ses récits d'aventure. Avant de se consacrer à l'écriture, Leroux a fait ses débuts en tant que journaliste, couvrant des affaires judiciaires et des événements politiques majeurs. Cette expérience a nourri son goût pour le mystère et l'intrigue, des éléments récurrents dans ses oeuvres. Leroux est surtout connu pour son roman "Le Fantôme de l'Opéra", publié en 1910, qui a été adapté de nombreuses fois au théâtre et au cinéma. Son style est caractérisé par une narration captivante, un sens aigu du suspense et une capacité à créer des personnages mémorables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I : Lui !
Chapitre II : À Potsdam
Chapitre III : Monique
Chapitre IV : Réveil
Chapitre V : L’enveloppe
Chapitre VI : On peut entrer ?
Chapitre VII : Hanezeau
Chapitre VIII : Deux faces pâles dans l’ombre
Chapitre IX : Un léger cercle d’or
Chapitre X : Auto
Chapitre XI : Gérard
Chapitre XII : De quelques événements qui survinrent au bureau de poste de Brétilly-la-Côte
Chapitre XIII : Où la petite fonctionnaire cesse de rire
Chapitre XIV : Où nous retrouvons Monique dans son auto
Chapitre XV : Où il commence à être démontré que le doigt de la Providence peut prendre parfois l’aspect d’un simple timbre à date
Chapitre XVI : L’auberge du Cheval-Blanc
Chapitre XVII : Une « réunion de saucisses »
Chapitre XVIII : Où il continue à être démontré que le doigt de la Providence peut prendre parfois l’aspect d’un timbre à date
Chapitre XIX : Stieber II
Chapitre XX : Un flirt de Guillaume II
Chapitre XXI : Lui et elle !
Chapitre XXII : Une intrigue à Potsdam
Chapitre XXIII : Deutschland
Chapitre XXIV : Monique arrivera-t-elle ?
Chapitre XXV : Monique comprend
Première partie
LES HANEZEAU
I
Lui !
La chaleur de ces premiers jours d’août était accablante.
Par les fenêtres entrouvertes du vieux château, la clameur d’un peuple en délire entrait, venait réjouir les oreilles des courtisans casqués, bottés, éperonnés, des dames en toilette de demi-gala, attendant dans la salle des Colonnes Leurs Majestés pour se former en cortège et se rendre dans la grand-salle à manger où devait être servi le dîner de ce glorieux jour.
Par-delà le Lustgarten et le pont de l’Empereur-Guillaume gardé par ses Victoires, toute la vie grondante de la Königstrasse et d’Unter den Linden, toute la fureur belliqueuse de Berlin se traduisait dans ce cri retenu tant d’années au fond des gorges teutonnes : Nach Paris ! Nach Paris !
Et, dans cette salle de fête, en dépit de l’apparat et du protocole somptuaire qui ordonnait le silence religieux dans l’attente du maître, ce cri était répété. On ne pouvait pas le retenir. On ne le pouvait pas ! Les hommes le sifflaient entre leurs dents aiguës ; ces dames, toutes rouges, toutes brûlantes, se donnaient des poignées de main de Walkyries en se disant : Nach Paris ! Ils en étaient tout secoués, les mâles dans leurs uniformes de guerre, les femmes dans les cuirasses de satin qui enfermaient péniblement leurs cœurs avides : Nach Paris ! Nach Paris !
À Paris ! délicieuse musique militaire, tant promise, tant attendue, qui mettait des flammes dans les yeux de proie.
Il y avait des visages qui n’en pouvaient plus de bonheur.
Le général von Delmling, gouverneur de Strasbourg, que l’empereur avait fait venir pour lui donner des ordres particuliers et qu’il avait invité en ce jour solennel, von Delmling, dans son hautcol, allait certainement éclater. Il avouait lui-même à Son Excellence Bethmann-Hollweg qu’il était temps ! Que personne n’avait plus la vertu d’attendre le premier coup de canon. Non ! personne ! « J’en ai assez de tirer à blanc ! grondait-il, même si l’Angleterre doit s’en mêler ! » Mais nul ne croyait encore que l’Angleterre oserait intervenir ; et c’était vrai, ils en avaient tous assez ! de cette longue privation de carnage et de butin, tous assez au palais et hors du palais ! dans tout l’empire ! Nach Paris ! Nach Paris !
Le ministre de la Guerre, von Falkenheyn, était très entouré, en l’absence de von Moltke déjà occupé ailleurs. Tous les fils de l’empereur avaient rejoint leur commandement. Mais le général von Stein et le général von Voigts-Rhetz du grand État-Major et tous ceux de l’entourage immédiat de Sa Majesté, ces statues de guerre qu’étaient les généraux von Gontard, von Chelins, le colonel Mutins, le lieutenant-colonel von Hanke disaient la joie qu’ils avaient eue ce matin-là à endosser leur uniforme, « la tunique du roi », non plus pour la parade mais pour la guerre… pour la guerre ! pour la vraie guerre ! Gott ! wie bin ich froh ! Oui, oui, ils en étaient tous bien aises ! Les mains sur la garde des sabres tremblaient du désir de tuer.
Nach Paris ! Nach Paris ! Là serait la curée ; dans quinze jours au plus tard !… On citait des mots de Sa Majesté qui citaient la date exacte, l’heure.
Les derniers arrivés apportaient des nouvelles inouïes ; ces choses couraient de bouche en bouche : Revolutzion in Paris, et l’on avait assassiné le président de la République après Jaurès. Was ! C’est une chose inouïe ! Inouïe en vérité ; mais à quoi ne devait-on pas s’attendre ? Que le mot d’ordre soit : « Du sang français ! »
Deutschland über alles ! Un grondement plus formidable attira l’attention générale aux fenêtres. C’était le délire berlinois qui débordait des tilleuls pour envahir le Lustgarten malgré les escadrons de la garde qui, sous les ordres du colonel von Reutter, de retour de Saverne, avaient toute la peine du monde à rester maîtres des ponts et de la place du château. Quant à la police, elle renonçait à mettre un frein à un enthousiasme qu’elle partageait d’ailleurs. On voulait voir l’empereur ! On voulait l’entendre. On savait qu’il avait quitté Potsdam pour parler à son peuple au nom de son bon vieux Dieu et que le dîner de demi-gala en une saison où le vieux château était généralement fermé n’avait point d’autre raison d’être !
Dans la salle des Colonnes cependant, sur un mot du maréchal de la cour, le silence s’était fait, absolu. Les deux « dames du jour », c’est-à-dire de service, la hautaine et déjà bien mûre comtesse Fernow et, la timide Fräulein von Katze, se sont placées un peu devant les autres invités. D’une minute à l’autre, Leurs Majestés peuvent entrer.
Soudain, la porte s’ouvre à deux battants ; immédiatement, chacun, sans plus attendre, commence les salutations, mais c’est une fausse alerte ; car les teckels seuls, les petits chiens hargneux de l’empereur, font leur entrée. Et chacun se félicite aussitôt de n’être point ce soir en bas de soie mais dans de belles bottes solides car les favoris de Sa Majesté ne respectent rien et ont la dent mauvaise. Toutefois ils ont pris leur parti de cette déconvenue et se vengent immédiatement, en levant la patte, l’un devant la comtesse Fernow et l’autre devant Fräulein von Katze, en vérité !
Au même moment, l’empereur entre, donnant son bras à l’impératrice. Les deux nobles dames n’ont que le temps de s’incliner profondément pendant que les teckels, soulagés, gambadent autour de Leurs Majestés. L’empereur, de son œil d’aigle, a tout vu. Il éclate de rire :
– Oh ! les vilains garçons ! fait-il, si vous recommencez, vous serez battus !… et, tourné vers l’une des dames du jour qui se relève cramoisie de honte et de dépit : Gnädige Grafin (noble comtesse), exprime-t-il avec une large bonne humeur souveraine, consolez-vous donc de cette petite mésaventure en songeant que la tour Eiffel est en train de sauter !
À ces mots, tout protocole est oublié. Un éclat de rire prodigieux, kolossal, accompagne le rire du dieu ! Mein Gott ! La tour Eiffel en train de sauter ! Les teckels eux-mêmes, ma parole, semblent s’en réjouir en reniflant les glorieux mollets prudemment enfermés dans les belles bottes brillantes comme des glaces.
L’impératrice, qui avait été tout d’abord choquée du sans-gêne inexprimable de ces maudits taquins de chiens de Wilhelm, rit aimablement en affirmant à son auguste époux que son esprit d’àpropos impérial est véritablement extraordinaire, tout à fait sans exemple ! Et par-derrière, l’on entendait – oh ! si humblement – la timide voix de Fräulein von Katze elle-même dont la délicate robe d’un satin pâle, si impressionnable, avait été si honorablement arrosée, glousser : Ah ! ah ! wahrhaftig ist entzückend ! (en vérité, c’est délicieux !) et cela sans de trop grandes grimaces qui eussent inévitablement laissé choir le râtelier tout en or, qui était, jusqu’à la dernière minute du jour où elle le mettait à reposer dans son petit précieux coffre-fort de chambre, l’objet de sa constante préoccupation.
Quant à l’empereur, il résumait alors toute l’allégresse parfaite de son immense et tout-puissant peuple. Il paraissait moins terrible que jovial ; ce qui arrive au plus redoutable guerrier quand il a vraiment la conscience de sa force et quand il peut se dire, en toute sécurité, qu’il n’a qu’à étendre le bras pour ramasser le fruit de la victoire. Mein Gott ! Voilà un homme heureux, le plus prodigieux des rois et qui dit simplement à Augusta-Victoria :
– Dona, vous avez une toilette ravissante, ce soir !
Oui, il est vrai qu’il dit cela simplement, mais si l’on songe qu’il ne se souvenait plus que bien rarement de ces deux chères petites syllabes des premiers temps du mariage : dona, et si l’on veut bien considérer que Sa Majesté n’avait jamais été prodigue de compliments sur la toilette, on ne sera point surpris par le frémissement qui parcourut Augusta-Victoria, de sa tête imposante à ses pieds solides. Elle dit en rougissant de bonheur :
– Merci Wilhelm, mais j’ai peur que cette couleur ne supporte pas la lumière électrique.
L’empereur sourit en posant sa main sur celle de l’impératrice qui est admirable et spécialement soignée à cause de la passion du maître pour les jolies mains :
– Je te rapporterai beaucoup de robes de Paris, dona !
Il avait dit cela assez haut, pour que tout le monde se prît à rire comme à propos de la tour Eiffel, ce qui arriva inévitablement.
Nul ne reconnaissait plus le froid cérémonial de la Cour, et le cortège, joyeusement, se forma. En tête marchait le Hanshofmeister, et le chambellan du jour, suivis des aides de camp. Immédiatement après venait l’impératrice au bras d’un Hohenzollern, puis l’empereur donnant le bras à l’une de ses tantes, et puis les ministres, les courtisans, à la place qui leur était soigneusement assignée par leur rang et leur situation. Mais il n’y avait là, assurément, du plus grand au plus petit, qu’une seule et même famille, réunie dans la même pensée invincible de triomphe et de butin ; et, à la vérité, à cette table impériale comme au fond des brasseries de la Frederickstrasse, dès les premières bouchées, ce fut Paris que l’on dévora.
Ils en prenaient d’énormes morceaux, à s’étouffer. Jamais, même la dinde rôtie chère à Guillaume et à sa cour qui en raffole, la Vaterbroten, ou même le plat national aux chères petites saucisses n’avaient excité ces magnifiques appétits comme ces pièces montées que chacun, ce soir-là, du prince au valet, voyait dans les assiettes. L’Arc de triomphe pour les entrées en fanfare, le Louvre, Notre-Dame où l’on installerait le bon vieux Dieu allemand, les palais excitaient les gloutonneries déchaînées et ces dames réclamaient qu’on les fît venir quand il serait question de se partager les grands magasins. Nach Paris ! Nach Paris !
L’empereur, assis en face de l’impératrice, lui adressa soudain la parole et tout le monde se tut.
– Tu as cru, tout à l’heure, dona, que je plaisantais avec cette tour Eiffel qui saute ; mais il ne faut pas voir là une boutade. Je puis le dire maintenant que tout est accompli. Nobles dames ! Messieurs, la tour Eiffel n’existe plus ! et combien d’autres stations radiotélégraphiques de l’ennemi qui étaient condamnées dès la première minute de la déclaration de guerre ; et combien de ponts et de gares stratégiques et d’ouvrages dignes d’admiration en temps de paix et que l’on n’admirera plus, parce que c’est la guerre !
Une crise d’enthousiasme secoua la noble assemblée. Elle ne put retenir ses bravos, elle ne le put pas ! Et comme le Kaiser avait dit : « parce que c’est la guerre ! » Oh ! comme il avait dit cela ! d’une façon, en vérité, qui promettait tout ce que la guerre peut donner ! Ah ! oui ! certes ! on aurait tout ! Tout avait été si bien préparé ! L’Allemagne, se congratulaient-ils entre eux, avait les premiers espions du monde ! qui avaient tout préparé, tout, pour faire tout sauter le premier jour de la déclaration du guerre ! L’empereur attendait ce soir même le détail de cette énorme première opération de guerre et aussi le détail de l’épouvante de l’ennemi héréditaire empêché dans sa mobilisation.
C’est ce que Sa Majesté expliquait : il attendait le Herr Direktor de la Police de guerre, d’une minute à l’autre, avec ses dépêches. Quelle nouvelle à donner en pâture à cette foule patriotique qui se rapprochait de plus en plus du château, pour voir, pour entendre son empereur. Mais quoi ! le Herr Direktor devrait déjà être là !
Stieber a dû télégraphier les derniers événements à Herr Direktor, car l’empereur a découvert son nouveau Stieber, son nouveau chef de l’espionnage de campagne comme il a son nouveau Moltke à la tête du grand État-Major ! Avec deux noms comme ceux-là, deux noms à l’instar de 70, comment ne vaincrait-il pas le monde, par-dessus et par-dessous ! Car Sa Majesté a un défaut royal : elle est superstitieuse.
Mais Guillaume n’aime pas attendre, surtout quand l’effet a été si bien préparé ! Son impatience lui a fait devancer l’arrivée des dépêches. Il devait offrir la tour Eiffel au dessert à ses invités ! et à son peuple ! Herr Direktor tarde bien ! Et le peuple, en bas, s’impatiente. Nach Paris ! Nach Paris ! L’empereur se décide : le maréchal de la cour lui affirme, selon le rite, que s’il ne se montre pas, il sera impossible de maintenir la foule. Et voici Guillaume II sur le balcon du vieux château des terribles vieux rois de Prusse, parlant à son peuple prussien.
Il a tiré sa fulgurante épée. Saint Georges, dans la cour même du vieux château, terrassant le dragon, n’est pas plus beau. Mais Guillaume terrasse le monde, le vaste monde. Et, comme saint Georges, il a l’appui du Dieu tout-puissant ! Il le dit, et il le dit comme il le croit ; grâce à Guillaume et à Dieu, l’Allemagne immortelle écrasera les barbares ! Ce sont des mots qui éclatent dans sa bouche et dont un peuple en extase reçoit et recueille, en bas, sur la place, les morceaux ! Les quais sont noirs de monde pour voir briller cette épée impériale au soleil d’août. Les Victoires de marbre, sur le pont, soutiennent des groupes palpitants de foi et de désir furieux, les portant, les soulevant vers l’empereur, pour qu’il en fasse de la chair de bataille ! Encore quelques phrases, quelques mots : « l’Histoire !… Mon infléchissable armée !… Je ne remettrai mon épée au fourreau qu’avec honneur ! » et l’apparition disparaît…
Quand Guillaume II se retrouva au milieu de la cour, il vit en face de lui un homme qui était d’une pâleur mortelle. C’était Herr Direktor de la Police de guerre. L’empereur entraîna Herr Direktor dans un coin du salon, et, dès les premiers mots de leur mystérieuse conversation, devint aussi pâle que lui.
II
À Potsdam
On savait à la cour que l’empereur ne pourrait s’attarder à Berlin et qu’il lui faudrait regagner de bonne heure Potsdam où tous les services étaient organisés et où il avait donné rendez-vous pour travailler à d’importants personnages, mais la précipitation avec laquelle le départ du vieux château s’effectua inquiéta tout le monde.
On crut à de mauvaises nouvelles de l’Angleterre, malgré la belle assurance du Bethmann-Hollweg et du Jagow. Quant à imaginer qu’il pourrait survenir quelque surprise désagréable du côté de la France, nul ne l’eût osé ! Il ne pouvait y avoir dans cette guerre aucune surprise. Tout avait été prévu ! tout ! C’était là la force invincible du système prussien !
Cependant Augusta-Victoria n’était point tranquille ; déjà, dans l’auto qui l’avait ramenée du Schloss au nouveau palais de Potsdam, elle s’était ouverte de ses méchants pressentiments à la « Grande Maîtresse », et maintenant, c’était dans ses appartements particuliers, dans son cabinet de toilette même qui précède la chambre commune que l’auguste dame suppliait l’opulente et hautaine comtesse Fernow de lui donner quelque chose sur un morceau de sucre.
– Je suis tout à fait émue, disait-elle, ayez pitié de moi ! avez-vous vu la pâleur de Sa Majesté quand elle parlait au directeur de la Police de guerre ? Il y a quelque chose qui ne va pas, c’est sûr !… Où est Fräulein von Katze qui sait toujours tout ?… Mein Gott ! je voudrais tant savoir ce que fait l’empereur !
La comtesse Fernow, qui passait pour avoir été jadis tout à fait dans la faveur du Kaiser, et que cette réputation, d’ailleurs usurpée, mais à laquelle elle tenait beaucoup, grandissait à ses propres yeux, cherchait avec négligence quelque flacon sur la table de toilette, cette fameuse table de toilette de marbre noir, aux pieds d’argent, dont Augusta-Victoria était plus fière assurément que de tous les chefsd’œuvre qui pouvaient remplir les garde-meubles de l’Empire : table intime toujours tellement encombrée de pots, onguents et pommades que Guillaume s’était écrié certain soir : « Je ne savais pas que ce fût ici l’apothicaire du palais ! »
– Quelque chose ! Quelque chose sur un morceau de sucre ! s’impatientait Augusta-Victoria.
– C’est qu’on s’y perd dans tous ces flacons, répondait sans s’émouvoir la noble comtesse qui avait de fort beaux yeux mais qui était myope comme une taupe. Et elle laissa choir le flacon d’arsenic.
Augusta-Victoria prend en effet de l’arsenic en vue de conserver sa fraîcheur, de la magnésie en vue de se blanchir le nez ainsi que les joues qui ont tendance à rougir quand Sa Majesté a les pieds trop serrés dans ses bottines ; enfin, elle absorbe de l’iode en vue de se faire maigrir ; et bien d’autres drogues qui ont fini par miner une superbe santé toute dévouée au maître et qui se meurt d’avoir voulu trop lui plaire.
– Voulez-vous un peu d’éther, Votre Majesté ?
– Ce que vous voudrez, mais donnez-moi quelque chose, de grâce !… Une soirée qui avait si bien commencé et couronné ce beau jour de notre gloire ! Ah ! voilà Fräulein von Katze !… Mein Gott ! parlez si vous savez quelque chose !
– Quelque chose de très grave, Votre Majesté ! fit aussitôt à voix basse Fräulein von Katze qui entrait, l’air fort affairé, et qui mit d’autorité à la porte la première femme de chambre. L’empereur est arrivé ici avec le directeur de la Police de guerre, n’a fait que passer dans son cabinet de travail où il a fait demander l’aide de camp de service qui est revenu aussitôt avec des plis cachetés dans la salle des ordonnances. Ceux-ci ont reçu l’ordre de faire attendre toute la nuit s’il le fallait les personnages qui ont été convoqués par Sa Majesté ; enfin de ne déranger Sa Majesté sous aucun prétexte. Puis l’empereur, toujours suivi du Herr Direktor de la Police de guerre, a traversé le palais par le petit couloir et est descendu dans le sous-sol privé par l’escalier secret.
– Il a quitté encore Potsdam par le souterrain ! s’écria l’impératrice. Où peut-il être allé ? Ce souterrain me fera mourir !
De fait, à cause de ce passage, creusé par Frédéric II, qui relie les fondations du nouveau palais aux casernes du bataillon de Lehr et Wehr situées juste en face, on ne sait jamais exactement où peut se trouver l’empereur quand il dit qu’il travaille ou qu’il repose, ni les visites mystérieuses qu’il est susceptible de recevoir dans le sous-sol privé !
Mais Fräulein von Katze continue en secouant la tête, et en raffermissant, d’un coup de main sûr, son précieux râtelier !
– L’empereur n’a point quitté le palais. Que Sa Majesté me permette de lui dire combien le major von Katze, mon cher jeune frère, lui est tout dévoué. À cause de son zèle, je puis affirmer à Sa Majesté qu’une auto entièrement close est entrée vers les sept heures du soir dans la petite cour arrière de la caserne de Lehr et qu’on a fait le vide autour du bâtiment où aboutit le passage souterrain. C’est le major von Katze lui-même qui avait reçu l’ordre de faire exécuter cette consigne. Ainsi, Sa Majesté ne s’étonnera point si, grâce à lui, je suis en mesure de lui dire le nom du mystérieux visiteur du sous-sol privé.
– Dites-le donc ! commanda l’impératrice avec la plus grande impatience.
– Ni plus ni moins que Herr Stieber lui-même !
L’impératrice tressaillit.
– Il est donc revenu, ce sale espion ! murmura-t-elle.
De fait, elle lui faisait l’honneur de le détester. Le nouveau Stieber (cela était connu de tout le monde) avait commencé sa fortune auprès de l’empereur en servant les amours du maître.
– Et il n’est point revenu seul, ajouta Fräulein von Katze d’une seule haleine et si vite qu’elle faillit avaler la moitié de ses dents en or… Il se trouvait avec une femme en grand deuil.
– Une femme !…
– Oui, une femme qui se laissait conduire par lui. Mon frère l’a reconnue pour l’avoir vue une fois à la chasse de Sa Majesté lors de l’affaire du scandale du traîneau.
– Le scandale du traîneau ! Ah ! Fräulein von Katze, ne me parlez plus de cette vilaine affaire !
– Votre Majesté, c’est Monique Hanezeau elle-même !
L’Impératrice se pâmait, mais elle revint vite à elle, avec quelques gouttes d’éther sur le morceau de sucre.
– Vous avez eu tort ! dit sévèrement la comtesse Fernow à Fräulein von Katze, de raconter à Sa Majesté cette histoire à dormir debout ; si « la grande maîtresse » savait cela !…
– Je vous défends de lui en dire un mot ! Que tout ceci reste entre nous ! gémit Augusta-Victoria.
À ce moment, « la grande maîtresse » montra justement le bout de son nez et de sa mantille officielle :
– Le maréchal de la cour, fit-elle, de sa voix la plus aimable, ose faire demander à Sa Majesté si elle a été satisfaite du dîner de ce soir ?
– Vous lui direz de ma part, répondit assez rudement Augusta-Victoria, que tout se serait très bien passé si les cuillers n’avaient pas eu le goût de poudre à argenterie !…
Tout ce qu’avait rapporté Fräulein von Katze était l’expression de l’exacte vérité. Et, dans le moment même, l’empereur avait un furieux entretien, devant le directeur de la Police de guerre, avec son chef de service d’espionnage de campagne, le nouveau Herr Stieber en personne…
Tous trois se trouvaient enfermés dans une petite pièce du sous-sol privé, en un endroit que ne connaissaient certainement point dix sujets dans tout l’empire.
Dans cette sorte de cave éclairée par une lampe électrique que le Kaiser tenait dans sa main et dont il dirigeait les feux impitoyables sur le visage atrocement « défait » de Herr Stieber, on eût pu donner la torture à un serviteur infidèle ; ses cris n’eussent été entendus de personne, de personne ! On eût même pu le laisser crever là comme un chien, personne ne serait occupé de lui, ma foi, personne !
L’empereur venait de se taire enfin, ne pouvant plus trouver les phrases qui eussent exprimé justement sa colère, et Stieber put parler :
– Sire ! fit-il, d’une voix glacée tandis que son front blême ruisselait de sueur… Tout ce qu’a dit le Herr Direktor à Votre Majesté est encore au-dessous de la vérité. Nous avons été trahis au moment suprême et la mobilisation en France se fait normalement sans que nous ayons pu faire sauter un pont, sans qu’un viaduc se soit écroulé, sans qu’une seule gare ait subi un dommage quelconque, sans qu’une station radiotélégraphique ait été atteinte ! Nos hommes, qui se préparaient à agir, ont tous été arrêtés dans le plus grand mystère ; quelques-uns qui avaient commencé déjà leur action ont été traqués au fond de leur trou, fusillés sur place. Les suspects, dans les arsenaux où ils devaient nous rendre tant de services, ont été mis dans l’impossibilité de nuire. Bref, tout notre plan qui consistait à frapper la mobilisation dans ses moyens de transport, dans son outillage et dans son matériel de guerre, a échoué ! La grève a échoué ! La révolution a échoué ! Paris et la France s’arment contre nous avec ordre et dans l’enthousiasme. Voilà la vérité : celle pour laquelle je suis venu ici, celle que l’on doit à son empereur ! Le prodigieux mécanisme d’espionnage inventé par le grand Stieber et humblement continué par votre serviteur, sire, a été dérangé d’un coup, en une minute, par une main, une seule, et ce geste a suffi pour que le travail de plus de quarante années s’écroulât comme j’avais rêvé de faire crouler la tour Eiffel ! Sire, vous savez tout : je n’ai plus qu’à mourir !
L’empereur lâcha sa lampe ; elle tremblait dans sa main et il lui déplaisait qu’on le vît trembler, même dans un pareil moment. Puis, par un effort qui coûta prodigieusement à cette nature expulsive, il se détourna de Stieber qu’il eut volontiers étranglé, fit quelques pas dans la pièce et enfin s’arrêta devant le directeur de la Police de guerre :
– Monsieur, lui dit-il, laissez-nous !…
Herr Direktor s’inclina et disparut.
– Tu dis que tu vas mourir, fit l’empereur, en revenant à Stieber… Dummer zug ! (Quelle stupidité !) pas avant de m’avoir dit, en tout cas, quelle main a fait toute cette belle besogne !
– Sire ! c’est une petite main et vous la connaissez !
– Parle !…
Le chef de l’espionnage de campagne montra une porte.
– Elle est là ! sire !
La double porte fut ouverte par Stieber et Guillaume s’avança sur le seuil.
Une femme était là, qui dormait. Sa tête, pâle et fine, reposait sur le dossier du fauteuil de cuir où la fatigue venait de clore ses belles paupières. Cette femme était habillée de voiles noirs.
Elle dormait paisiblement, la bouche entrouverte, une bouche d’enfant, aux lèvres pourpres, aux dents admirables. Elle ! c’est elle qui aurait accompli cette besogne surhumaine dont avait parlé Stieber ! L’empereur ne voulut pas le croire.
Il se pencha en frémissant sur ce souffle honnête et paisible, sur cette tranquille haleine :
– Elle ! avait-il soupiré en l’apercevant, et il s’était avancé, les bras tendus, les mains avides : Elle !
L’avoir dans un jour pareil ! Elle, cette Parisienne qu’il avait tant désirée et qui s’était toujours détournée de lui avec tant de mépris ! Comment eût-il pu douter de son bon vieux Dieu ! N’étaitce pas lui qui la lui envoyait, en un jour pareil ! en un jour pareil !…
Il lui sembla que c’était déjà toute la France qu’il avait là, à sa disposition, au fond de ce cachot, et dont il allait pouvoir faire tout ce qu’il voudrait, tout, selon sa fantaisie d’empereur et de reître !
Après s’être assuré que Stieber les avait laissés seuls, il ricana glorieusement et prononça ce mot :
– Monique !
III
Monique
Qui était Monique ?
Une femme qui venait, au cours d’une aventure effroyable où elle avait failli laisser plus que sa vie : son honneur, de ruiner d’un seul coup comme l’avait dit Stieber, tout le travail d’avant-guerre de l’espionnage allemand !
Cette aventure, pleine de mystère et de sang, qui avait commencé quelques jours plus tôt aux environs de Nancy, nous en devons l’horrible et héroïque détail avant qu’elle ne se continue à Potsdam même, devant l’empereur…
À la fin de juillet 1914, Monique Hanezeau dansait.
Toute la France dansait.
Même sur la frontière.
À Nancy, plus que partout ailleurs, le tango faisait fureur et les femmes portaient la jupe fendue.
Monique dansait en montrant sa jambe, qui était belle. C’était la mode, elle n’en rougissait pas. Monique cependant eût dû être raisonnable, car elle avait joliment dépassé la trentaine, mais elle était loin encore des quarante ans, et comme elle en paraissait vingtcinq, elle se trouvait bien des excuses.
Elle oubliait assez facilement qu’elle avait un fils qui venait d’entrer au régiment. Elle oubliait tout quand elle dansait. C’était une belle enfant gâtée.
Mariée à seize ans à la marque Frédéric Hanezeau, dont le H bizarrement enchevêtré de quatre F qui se faisaient front se dressait à tous les carrefours de France pour signaler aux automobilistes qu’ils ne pouvaient être mieux servis que par cette célèbre maison, elle n’avait jamais exprimé un désir qui n’eût été, sur-le-champ, satisfait.
Son mari l’aimait et elle ne le détestait point. Elle l’avait accepté bien qu’il eût le double de son âge parce que ses parents l’en avaient priée et que l’on était tout à fait gêné par le manque d’argent chez les Vezouze. Elle était obéissante et bonne. Elle était coquette mais honnête. Elle ne trompa point son mari.
Elle aimait flirter. Elle semblait n’attacher d’importance à rien pourvu que tout ce qui l’entourait fût aimable et joyeux. Le Tout-Paris cosmopolite dont elle était l’une des reines, les étrangers richissimes qui fréquentaient assidûment chez elle, ou qui, l’été, étaient invités sur son yacht, la jugeaient mal. Elle le savait mais ne s’en inquiétait guère. Elle disait couramment quand on lui rapportait quelque propos déplaisants pour sa vertu : « J’ai ma conscience pour moi ! » Et c’était vrai.
Elle avait été bonne mère, ayant eu son fils à l’âge où l’on pleure ses poupées. Et maintenant, Gérard était pour elle un délicieux camarade, un bon frère aîné dont elle écoutait volontiers les conseils. Il avait vingt ans.
L’exceptionnelle situation industrielle des Hanezeau les avait mis en relations mondaines avec des princes qui avaient fait leur cour à la mère. Monique n’en avait pas eu la tête dérangée. En revanche, on racontait qu’elle avait « tourné » celle du Kaiser lui-même, au cours d’une croisière dans les mers du Nord où le yacht des Hanezeau s’était trouvé bord à bord avec celui des Hohenzollern et où il y avait eu une invitation impériale.
Guillaume II avait été très intéressé, disait-on, par cette Parisienne d’une troublante élégance et il s’en était suivi des invitations aux chasses de Silésie, invitations qui avaient brusquement cessé de par la volonté de Monique.
Elle disait, à cette époque : « J’ai assez vu l’empereur, je suis patriote, moi ! »
C’était encore vrai ; mais de ce qu’elle fût cela, autour d’elle, on souriait, car un patriotisme qui ouvre toutes grandes les portes de ses salons à de certains jargons dont les T se prennent pour des D ne paraissait pas bien sérieux aux uns, ni bien dangereux aux autres.
Donc, à la fin de juillet 1914, Monique dansait.
Elle donnait une fête costumée de jour dans son château de Brétilly-la-Côte entre Nancy et Arracourt, vieux château lorrain des terrasses duquel on découvrait l’un des plus jolis coins de la vallée de la Meurthe et le plateau d’Amance.
Ses amies de Paris, de Nancy et du vaste monde étaient accourues à son appel, traînant, comme une troupe de comédie, des malles pleines des travestissements les plus extravagants.
Chacun avait été laissé libre de se livrer à la plus audacieuse fantaisie. La plupart des femmes n’avaient qu’à suivre la mode, pour exhiber les modèles qui étaient alors à l’ordre du jour et qui faisaient de ces dames les contemporaines de Cléopâtre ou de Sémiramis. Plus ou moins folles du tango, habituées des bals persans s’offrant à toutes les curiosités et à toutes les promiscuités dans le tourbillon lascif, avec une tranquille et magnifique inconscience ou avec une hâte maladive de s’amuser qui eût pu faire croire qu’elles redoutaient une prochaine et irréparable catastrophe, on retrouvait ces belles mondaines, partout, dans toutes les fêtes, infatigables et presque nues.
Or, Monique Hanezeau traînant ses petits pieds gantés de dentelle dans des babouches de conte d’Orient, le sein à peine couvert de sa tunique brodée d’argent aux grandes arabesques noires, souriait à toutes ces délicieuses poupées qui se déhanchaient avec application sous le rythme obsédant des violons, glissant voluptueusement du parquet précieux des salons au marbre poli des terrasses.
Soudain, Monique poussa un cri : « Gérard ! » Un soldat, un fantassin, un pioupiou, un pousse-caillou, venait de tomber au milieu de la fête. C’était son fils. Elle ne l’attendait pas. « Quelle bonne surprise ! Gérard ! »
Le pioupiou regarda ces dames qui s’étaient arrêtées dans leurs trémoussements, regarda sa mère déshabillée en princesse de Babylone, d’après un dessin du portraitiste à la mode, Kaniosky, et dit :
– Mais maman, vous ne savez donc pas que c’est la guerre !…
– Tu es fou, Gérard !…
– Je vous dis que c’est la guerre !
La guerre !… Le mot eût pu éclater comme une bombe au milieu de cette foule joyeuse et changer bien des visages ! Il fit long feu et n’éclaira personne…
La guerre ! Personne n’y croyait ! Personne n’en voulait ! Pas plus Berlin que Paris ! On était au courant : c’était un bluff, comme toujours !… Et, les violons ayant repris leur émouvante musique, les danses recommencèrent cependant que des rires se moquaient de ce bon garçon de Gérard.
Il avait une bonne touche au milieu de cette fête, avec sa capote et il en avait « de bonnes avec la guerre ».
Gérard se pencha à l’oreille de sa mère :
– Maman, on mobilise, il faut que je te parle…
Elle l’entraîna dans le cabinet d’Hanezeau. Cette pièce assez obscure se trouvait au rez-de-chaussée dans une aile en retrait, loin des salons, loin des bruits du bal.
– Voyons ! qu’est-ce que tu racontes ? Et elle s’assit dans le grand fauteuil d’Hanezeau qui était devant le bureau, sorte de cathèdre copiée sur le fameux fauteuil de saint Gérard qui se trouve à Saint-Étienne de Toul ; et, tout à coup, lorsqu’elle fut là, parfaitement dans l’ombre, elle eut honte d’être ainsi presque nue, au fond de cette solitude, en face de son fils, et elle jeta sur ses épaules, ramena sur sa gorge, le pardessus du père qu’elle trouva sur le dossier du fauteuil.
Alors Gérard parla : sous le prétexte d’une période d’instruction, on rappelait les réservistes par ordre individuel, mais c’était la mobilisation, la mobilisation secrète… Le général Tourette, un ami de la famille, rencontré à Nancy, avait affirmé à Gérard lui-même pour qu’il le répétât à ses parents qu’il n’y avait plus aucun espoir d’arrangement et que, cette fois, c’était bien la guerre. L’Allemagne avait déclaré déjà l’état de danger de guerre, ce qui lui permettait d’achever sa mobilisation avant même que celle-ci fût annoncée. La mobilisation de l’Autriche était décrétée. La flotte allemande, qui manœuvrait sur les côtes de Norvège, avait reçu l’ordre de rentrer. L’empereur n’avait pas pour rien abandonné sa croisière. Tout cela était réglé. Le coup avait été bien monté entre l’Allemagne et l’Autriche. On allait assister à des choses effroyables. Pourvu que la France fût prête à temps, mon Dieu !
– Tatatata ! fit Monique. Te voilà bien emballé ! Le général Tourette a toujours fait rire ton père avec ses idées de guerre… et ton père en sait plus long que lui ! Ce n’est pas la première alerte qui lui fait hausser les épaules… Il est tout naturel que le gouvernement prenne ses précautions, mais que tu t’émeuves, toi, mon bon Gérard, cela m’étonne !… Je ne te croyais pas si jeune !
– Après tout, tu as peut-être raison, en tout cas j’ai cru de mon devoir de vous en avertir ! Adieu maman !… Amuse-toi bien !
– Tu t’en vas… sans voir ton père !
– Tu m’excuseras auprès de lui… Je suis venu dans l’auto d’un ami qui est pressé.
– Qui ?
– Théodore !
– Ah ! si tu es avec ton ami Théodore, je comprends que tu voies tout en noir ! Il va toujours aussi mal, ton ami Théodore ?
– Toujours, maman !… Surtout, si tu le rencontres, ne va pas lui dire qu’il a bonne mine !…
– Et il est toujours aussi gai ?…
– Qu’est-ce que tu veux, maman, moi, sa tristesse m’amuse ! Tu ne sais pas que cette année il suit un traitement à Plombières. Et tu ne sais pas ce qu’il est venu faire à Nancy ? Acheter un dictionnaire de médecine dans lequel il est sûr, dit-il, de trouver le nom de sa véritable maladie ! Adieu, maman, je t’adore !…
– Dis-moi la vérité. Où cours-tu si vite que ça ?…
– Il faut que je passe par la poste… ah ! ne ris pas… un télégramme à envoyer !…
– Allons donc ! tu en pinces toujours pour la petite fonctionnaire !…
– Maman !… ma petite maman… pour une fois, sois sérieuse… je t’en prie !...
– Je te le promets, mon fils !…
Gérard embrassa tendrement sa mère.
– Tu sais, j’ai vu ta toilette, tu n’as pas besoin de la cacher, elle est ravissante !
– C’est Kaniosky qui l’a dessinée !
– Tu lui feras mes compliments.
Gérard se retourna sur le seuil :
– Dis donc, maman ! Si c’est la guerre, je compte que tu viendras m’embrasser à Saint-Dié… ça me donnera du courage pour mourir pour la patrie ! ajouta-t-il en riant.
– Gérard !…
Mais après un dernier baiser du bout des doigts, il était parti…
Elle resta quelques minutes, pensive, au fond du fauteuil gothique. Quand elle leva la tête, dans l’ombre, elle aperçut une forme noire qui venait de pousser la porte opposée à celle par où venait de disparaître Gérard.
Cette forme noire était celle d’un pénitent qui avait déjà intrigué les invités de Monique derrière son capuchon. Il s’avança vers le bureau, ne cessant de regarder la porte qui donnait directement sur la terrasse comme s’il redoutait une entrée intempestive ; puis il jeta une lourde enveloppe sur le bureau devant Monique et dit d’une voix rapide et sourde :