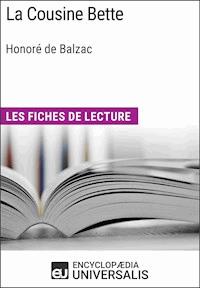
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Avant-dernier roman d’Honoré de Balzac (1799-1850), paru en feuilleton en 1846,
La Cousine Bette forme avec
Le Cousin Pons le diptyque des
Parents pauvres.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur La Cousine Bette d'Honoré de Balzac
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852294837
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici La Cousine Bette, Honoré de Balzac (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LA COUSINE BETTE, Honoré de Balzac (Fiche de lecture)
Avant-dernier roman d’Honoré de Balzac (1799-1850), paru en feuilleton en 1846, La Cousine Bette forme avec Le Cousin Pons le diptyque des Parents pauvres. Composées simultanément, les deux œuvres présentent d’importants parallélismes. Toutes deux « Études de mœurs » et « Scènes de la vie parisienne », elles mettent au premier plan un célibataire, déshérité par la nature, n’ayant jamais été aimé, vivant en marge de parents éloignés qui le dédaignent mais sur la destinée desquels il exercera une influence décisive. Leur différence toutefois est que là où Le Cousin Pons décrit le complot qui écrase un vieux garçon, La Cousine Bette raconte la vengeance d’une vieille fille contre sa famille. En outre, si Pons demeure un personnage central, Bette se voit peu à peu reléguée au second plan, éclipsée par l’acharnement de ceux qu’elle veut punir à être leurs propres bourreaux.
• La vengeance d’une femme
Vieille fille laide et revêche, Lisbeth Fischer, dite Bette, vit dans l’ombre de la famille de sa cousine Adeline. Celle-ci est l’épouse du baron Hulot d’Ervy, frère d’un maréchal d’Empire et directeur, en 1838, au ministère de la Guerre. Malgré ce beau mariage, Adeline vit dans la gêne et ne sait comment doter sa fille Hortense. Elle demande son aide au beau-père de son fils, Crevel, un ancien parfumeur parvenu qui, séduit par sa beauté, lui offre de l’argent en échange de ses faveurs. Outrée, elle refuse. Crevel lui révèle alors la vie dépravée de son époux qui dilapide sa fortune pour entretenir des courtisanes.
Bette a recueilli Wenceslas, un jeune artiste polonais qui, dans la misère, allait mettre fin à ses jours, et le surveille « avec la tendresse d’une mère, la jalousie d’une femme et l’esprit d’un dragon ». Elle confie son secret à Hortense et lui donne un cachet sculpté par son protégé. Éblouie, celle-ci tombe amoureuse de l’artiste. Le baron Hulot s’emploie à faire la fortune du jeune homme et lui accorde la main de sa fille. Abandonné par sa maîtresse Josépha, il s’est entiché d’une piquante créole, Valérie Marneffe, qui habite la maison de Bette. C’est par elle que celle-ci apprend le projet de mariage entre Hortense et Wenceslas. Folle de rage et de douleur, elle jure de mener la famille Hulot à sa perte. Valérie, avec qui elle scelle un pacte, sera l’instrument de sa vengeance.
Dénuée de tout scrupule, aidée par un mari complaisant, celle-ci entreprend de ruiner le baron et l’humilie en devenant aussi la maîtresse de Crevel et en s’affichant avec un ancien amant, Montès, un riche Brésilien. Enfin, pour parachever la vengeance de Bette, elle séduit Wenceslas qui abandonne sa femme pour elle. Afin de financer ses folies, Hulot a expédié en Algérie l’oncle de sa femme pour qu’il y monte des affaires douteuses. Mises au jour, celles-ci risquent de susciter un scandale. Pour sauver son mari et payer ses dettes, Adeline s’offre « comme une prostituée » à Crevel qui la repousse. Atteint par le déshonneur, le maréchal Hulot décède, au grand désarroi de Bette qui rêvait de l’épouser. Privé d’appui, le baron est contraint de démissionner et abandonne sa famille. Veuve de Marneffe, Valérie se marie avec Crevel, mais tous deux, empoisonnés par Montès, meurent dans d’atroces souffrances. Leurs biens passent à la famille Hulot qui retrouve tout son lustre, tandis que Bette disparaît sans avoir pleinement accompli sa vengeance. Le baron, quant à lui, persévère dans son vice. Après avoir entretenu de jeunes ouvrières, il est revenu vivre auprès de sa femme, mais courtise la fille de cuisine qu’il promet d’épouser une fois veuf. Ayant surpris les propos de son mari, Adeline est foudroyée par une commotion.
• Requiem pour la monarchie de Juillet
Dès sa publication dans Le Constitutionnel, La Cousine Bette remporta un « succès étourdissant ». Dopé par l’accueil du public, Balzac n’a cessé d’étoffer ce qui ne devait être au départ qu’une simple nouvelle, achevant son roman en moins de deux mois. Lui qui, à peine un an plus tôt, se sentait en perte de vitesse et confiait : « La Comédie humaine, je ne m’y intéresse plus », redevenait un auteur en vogue. Pourquoi une telle réussite ? C’est qu’il continuait d’utiliser les procédés du roman-feuilleton, qui avaient déjà assuré la fortune de Splendeurs et misères des courtisanes : le parti pris d’une narration qui va sans cesse de l’avant, sans s’encombrer des digressions qu’affectionnait jadis l’auteur ; le recours aux coups de théâtre les plus débridés, comme l’empoisonnement de Valérie ou l’entrée en scène de Vautrin, qui font s’emballer l’action et renouent avec la fantaisie du roman noir ; enfin et surtout une nouvelle plongée dans le monde des viveurs, des courtisanes et des vieillards libidineux, rendu cette fois avec un rythme fiévreux, des couleurs grises et glauques qu’il n’avait encore jamais connus.
Cette atmosphère doit beaucoup à des personnages qui vivent dans le constant paroxysme de la passion ou des sens. On sait que les créatures balzaciennes sont bourrées d’énergie jusqu’à la gueule. Mais jamais peut-être l’auteur n’avait créé des êtres à ce point tendus par la force de leur obsession. C’est le cas évidemment de Bette, à la fois pétrifiée et transportée par la haine : « Bette, comme une vierge de Cranach et de Van Eyck, comme une Vierge byzantine, sorties de leur cadre, gardait la roideur, la correction de ces figures mystérieuses, cousines germaines des Isis... C’était du granit, du basalte, du porphyre qui marchait. » C’est plus encore le cas de Hulot, incontinent et impénitent, allant de femme en femme et de déchéance en déchéance. Certes, de Goriot à Grandet, les monomanes ne manquent pas chez Balzac, mais leur ressassement délirant ne les empêche pas de conserver en eux quelque chose de positif. Ici leur énergie semble vouée à la seule destruction : « Je voudrais réduire tout ce monde en poussière », dit Bette. D’où un récit qui fait table rase des références passées. Il n’y a plus de héros : Wenceslas est un artiste raté, Crevel, même dans la débauche, demeure un boutiquier. Il n’y a plus de valeur, sinon l’argent qui permet l’assouvissement de tous les désirs.
Sur la société vaine et corrompue de la fin du règne de Louis-Philippe, Balzac jette un regard désabusé, qui le force à faire mourir presque tous ses personnages sauf Hulot, qui, dans sa nostalgie des fastes de l’Empire, garde un reste de panache. À ce pessimisme s’ajoute une profonde misogynie : qu’elle ait l’aspect repoussant d’une Bette, pour laquelle l’auteur disait s’être inspiré de sa propre mère, ou la séduction d’une Valérie Marneffe, la femme est toujours l’instrument de la destruction de l’homme.
Philippe DULAC
Étude
A. LORANT, « Les Parents pauvres » d’H. de Balzac. Étude historique et critique, Genève, Droz, 1967.BALZAC HONORÉ DE (1799-1850)
Prométhée, Protée, homme à la robe de bure, créateur halluciné immortalisé par Rodin, Balzac a suscité toutes les imageries et toutes les gloses. L’œuvre immense vit, de réédition en réédition : elle est traduite et lue dans le monde entier et la télévision lui a redonné, plus que le cinéma, peut-être, une nouvelle fortune.
La prodigieuse vitalité de cette vie aux multiples entreprises et au gigantesque travail littéraire se développe sur le terrain d’une famille bourgeoise représentative des ascensions de ce temps de mutations. La famille du père, né Balssa, est une famille de paysans du Tarn. Le père, Bernard-François, petit clerc de notaire, monte à Paris à vingt ans et finit comme directeur des vivres aux armées. La mère, née Laure Sallembier, appartient à une famille de passementiers-brodeurs parisiens. Quand Balzac naît à Tours le 20 mai 1799, le père a cinquante-trois ans et la mère vingt et un. Balzac est l’aîné de quatre enfants : Laure, la sœur bien-aimée, naît en 1800 ; Laurence en 1802 ; Henri-François en 1807, vraisemblablement fils naturel de M. de Margonne, le châtelain de Saché. Bachelier en droit, d’abord clerc de notaire et clerc d’avoué à Paris, Balzac décide, à vingt ans, de se consacrer à la littérature. C’est en effet sa principale occupation de 1820 à 1824, puis de 1829 à 1848, deux ans avant sa mort. Mais, de 1824 à 1828, et pendant tout le reste de sa vie, parallèlement à l’œuvre littéraire, les entreprises de tout ordre se sont succédé. En 1825, l’édition. En 1826, l’imprimerie. En 1827, une société pour l’exploitation d’une fonderie de caractères d’imprimerie. C’est l’échec ; ce sont, déjà, les dettes. Après le retour à la littérature, les années 1829-1833 sont des années d’intense activité journalistique. Des ambitions électorales se manifestent en 1831. En 1836, c’est l’entreprise malheureuse de la Chronique de Paris





























