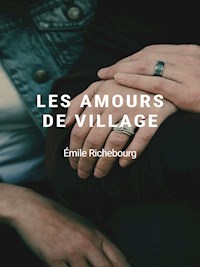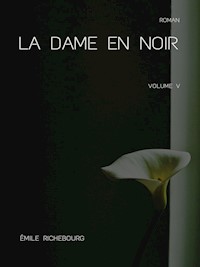
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cycle en 8 volumes.
CINQUIÈME PARTIE . CLAIRE ET HENRIETTE
Das E-Book La Dame en noir wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Histoire de famille, AVENTURES, littérature française, Classique, romance
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Dame en noir
La Dame en noirCINQUIÈME PARTIE. CLAIRE ET HENRIETTEI. LE VOYAGEII. ÉDOUARD ET ANDRÉIII. CE QU’IL FAUT APPRENDRE AU LECTEURIV. LES JEUNES FILLESV. CE QUI SE DIT ENTRE JEUNES FILLESVI. UNE FÊTEVII. LES ANGOISSES DE LA COMTESSEVIII. LA MÈRE ET LE FILSIX. DOULEURS D’ARTISTEXI. RELÈVE-TOI !XII. LE SOUS-PRÉFETXIII. LA FÉE DU CHÂTEAUXIV. OÙ L’ON NE PEUT PAS DIRE : TELLE MÈRE, TELLE FILLEXV. UN SOURIRE DU CIELXVI. COUSIN ET COUSINEXVII. DOULEURS D’AMOURXVIII. PREMIER BAISERPage de copyrightLa Dame en noir
Émile Richebourg
CINQUIÈME PARTIE. CLAIRE ET HENRIETTE
I. LE VOYAGE
André et Édouard étaient entrés au lycée Louis-le-Grand.
À la Maison maternelle, pendant deux ans, ils avaient étudié, comme nous l’avons dit, sous la direction de professeurs qui les avaient préparés aux fortes études.
Très studieux, dociles, disciplinés, pleins d’émulation, sentant le besoin d’apprendre, de savoir, ils s’étaient donnés de tout cœur au travail et avaient compté parmi les meilleurs élèves du lycée.
En entrant à Louis-le-Grand, Édouard, plus âgé qu’André, se trouvait aussi plus avancé dans ses études ; mais à la fin de la première année, André s’était mis au niveau de son ami, et il arriva même à le distancer dans le courant de la deuxième année sur plusieurs parties du programme des études.
Empressons-nous d’ajouter que le plus heureux des deux n’était pas celui qui faisait d’aussi rapides progrès, en effet, les triomphes d’André étaient la joie d’Édouard. Les deux lycéens s’aimaient de telle sorte qu’aucun sentiment de jalousie ni d’envie ne pouvait avoir prise sur leur mutuelle affection.
Assurément, André était joyeux de ses succès, d’être constamment aux premières places ; mais il n’en tirait ni vanité, ni orgueil ; et s’il était fier de lui, ce dont il avait le droit, c’est qu’il savait combien il rendait sa mère heureuse.
N’était-ce pas en pensant constamment à sa mère qu’il travaillait avec tant d’ardeur et que les longues heures d’étude lui semblaient si courtes ? Certes, André avait ce stimulant puissant qui manquait à Édouard.
Édouard était un littéraire ; il connaissait comme pas un ses auteurs anciens et modernes ; il les avait sérieusement étudiés et solidement approfondis. Certaines de ses compositions, où il établissait des comparaisons entre tels et tels grands écrivains et tels et tels autres, avaient été fort remarquées.
Il était également de première force en histoire, et l’année même où il avait subi brillamment les épreuves du baccalauréat ès lettres, il avait obtenu le prix d’excellence en histoire générale.
Mais s’il étudiait encore, non sans succès, les sciences physiques et naturelles, par contre il ne pouvait pas mordre aux mathématiques. Il avait beau piocher, il ne parvenait pas à se fourrer dans la tête l’algèbre ni les équations avec leurs degrés. Ça, c’était de l’hébreu pour lui.
Souvent, pendant la leçon de mathématiques, il tirait subrepticement une feuille de papier de son cartable et se mettait à crayonner la tête du professeur, celle du surveillant ou d’un de ses condisciples.
Et tout en crayonnant et en donnant à son dessin humoristique – car il y avait en lui du Gavarni – une expression singulièrement comique, il pensait au jour où, ayant quitté le lycée, il entrerait comme élève dans l’atelier d’un de nos grands artistes peintres.
Peindre, être un artiste, un artiste de talent, c’était son rêve.
En attendant, autant que cela lui était possible, il jetait sur le papier ses jeunes inspirations, se perfectionnait dans l’étude du dessin, et l’habileté de son crayon faisait pressentir celle du pinceau.
Il ne pouvait pas se livrer à ses goûts tout à fait à l’insu de ses camarades. Ceux-ci s’emparaient de temps à autre de quelques-uns de ses dessins, qui, alors, passaient de mains en mains ; et il y avait telle ou telle charge d’un pion, d’un élève, d’un domestique et même d’un professeur qui faisait rire à se tordre les joyeux et malins écoliers.
Parfois, les maîtres saisissaient les dessins au passage et les examinaient entre eux. Ils reconnaissaient qu’il y avait là plus que quelque chose, mais déjà un talent réel. Édouard n’en était pas moins réprimandé, mais si doucement ! Après tout, n’était-il pas un bon élève ?
Si les écoliers avaient ri d’une charge vraiment désopilante, les professeurs riaient à leur tour, sans le faire voir et sans le dire, bien entendu. Le proviseur lui-même n’avait pas dédaigné de jeter les yeux sur les ébauches du jeune Lebel et il avait dit aux professeurs :
– Nous ne pouvons rien contre cela ; on n’entrave pas une vocation.
Seul, le professeur de mathématiques n’était pas content. Pour lui, Édouard Lebel n’était qu’un cancre. Il n’avait pas dans son cours un plus piètre élève. André Clavière, à la bonne heure ! en voilà un qui travaillait et lui faisait honneur !
De fait, André était admirablement doué, et toutes les études, même les plus ardues, semblaient lui être faciles. Dans les lettres et les sciences il avait les mêmes succès.
Un an après Édouard, à seize ans, il avait été reçu bachelier ès lettres le troisième sur cinquante candidats, et l’année suivante, avec un égal bonheur, il avait conquis le diplôme de bachelier ès sciences.
Quant à Édouard, il échouait pour la troisième fois aux épreuves du baccalauréat ès sciences. Mais ce fut avec une explosion de joie qu’il embrassa et félicita son ami.
– Mon cher Édouard, lui dit André, j’aurais préféré que ce fût toi.
– Je t’assure, mon cher André, que je n’ai aucun chagrin de mes échecs. Je ne serai pas bachelier ès sciences ; mais je n’ai nul besoin de ce titre pour faire de la peinture. Maintenant, rendons-nous vite auprès de ton excellente mère. Ah ! André, comme elle va être heureuse !
Oui, la Dame en noir était heureuse. Et comment ne l’aurait-elle pas été quand ses fils, ses deux enfants lui donnaient toutes les satisfactions désirables ?
Si, à juste titre, elle était fière d’André, elle était également fière d’Édouard, dont elle appréciait les grandes qualités du cœur et de l’esprit, et qui, par son affection pour André et sa tendresse filiale pour elle, savait si bien la récompenser de ce qu’elle avait fait pour lui.
Édouard ignorait encore, dans ses détails, la douloureuse histoire de sa mère, mais il savait que Mme Clavière avait tenu et au delà les solennelles promesses qu’elle avait faites à Marceline Lebel à son lit de mort. Aussi, à mesure qu’il avait avancé en âge, le sentiment de la plus vive reconnaissance avait grandi dans son cœur.
Il aimait, il vénérait celle qui n’avait pas voulu qu’il fût un enfant abandonné, qui l’avait adopté, le plaçant dans son cœur à côté d’André, et il pensait qu’il ne pourrait jamais assez lui prouver qu’il n’était pas ingrat.
Les études au lycée étaient terminées. Un repos était nécessaire aux deux jeunes gens.
– Mes enfants, leur dit un matin Mme Clavière, nous allons faire en Suisse, en Italie et en Espagne le voyage que je vous ai promis ; faisons donc nos préparatifs de départ, et samedi prochain nous nous mettrons en route.
– Nous trois seulement ? fit André.
– Et Louise, qui nous accompagnera.
André et Édouard, ravis, se jetèrent au cou de Mme Clavière.
Ce même jour, un jeudi, on fit quelques visites à Paris : on alla voir M. Mabillon, les époux Pinguet, qui parlaient déjà de vendre leur maison et de se retirer des affaires, Julie Verrier, la Chiffonne, et son amie Aurélie, qui avaient quitté Saint-Mandé et s’étaient installées rue du Sentier, au centre du commerce parisien, où elles avaient dans leur atelier une trentaine d’ouvrières passementières.
La dernière visite, ce jour, fut pour M. Chevriot. On ne pouvait pas partir sans avoir embrassé le bon docteur.
Bien qu’il fût dans sa quatre-vingt-quatrième année, M. Chevriot jouissait encore de toutes ses facultés. C’était une belle vieillesse. Mais il était affaibli, cassé, ses jambes n’avaient plus de force, son corps se courbait, et il sentait qu’il avait déjà un pied dans la tombe.
Il disait quelquefois en souriant :
– Mon ami Chevreul est plus âgé que moi et il est encore d’une agilité extraordinaire ; il me verra partir et d’autres encore après moi, car il arrivera, lui, à sa centième année.
Il reçut les visiteurs avec son bon sourire et un éclair de bonheur dans le regard ; l’un après l’autre il serra André et Édouard dans ses bras.
– Mes chers amis, mes enfants, dit-il, comme je suis heureux de vous avoir vus grandir sous mes yeux ! Aujourd’hui vous êtes des hommes ; vous êtes le présent et l’avenir ; moi, je suis le passé. Oh ! je ne regrette rien, j’ai bien employé ma vie, et maintenant, tranquillement, prêt à lui sourire, j’attends la mort.
Je n’ai pas de conseils à vous donner, je sais ce que vous êtes et ce que vous valez ; d’ailleurs, vous avez en votre mère un sûr Mentor. Aimez-la bien, aimez-la toujours, cette fidèle gardienne de votre avenir.
Ah ! votre avenir ! il sera beau, mes enfants. Comme je le vois s’ouvrir devant vous large, ensoleillé, fleuri !
Oh ! oui, aimez toujours votre mère et vous verrez combien votre affection pour elle sera féconde en grandes choses. Soyez toujours unis, mes chers amis, comme vous l’êtes maintenant, et ne cessez jamais de vous aimer comme deux frères.
Le vieillard se tourna vers Mme Clavière :
– Marie, reprit-il, pendant combien de temps pensez-vous faire durer votre voyage ?
– Si rien ne vient se mettre en travers de nos intentions, nous quittons Paris pour plusieurs mois ; nous ne reviendrons qu’au printemps prochain.
M. Chevriot hocha la tête. Et, avec un sourire doux et triste :
– À votre retour, fit-il, vous ne me retrouverez plus.
– Oh ! mon père, ne me dites pas cela ! s’écria Mme Clavière.
– Je crois bien, Marie, que mes jours sont comptés là-haut ; mais je me trompe peut-être.
– Oui, oui, vous vous trompez !
– Enfin, nous verrons. En attendant, mes enfants, donnez toujours au vieillard le baiser des adieux.
Le docteur Chevriot ne se trompait pas : il devait s’éteindre doucement, cinq mois plus tard, dans les premiers jours de janvier.
Le lendemain vendredi, veille du départ, Mme Clavière et ses fils se rendirent à la Maison maternelle ; cette visite leur était également chère à tous trois.
Après avoir vu les enfants et causé avec la mère Agathe et les autres religieuses, on se dirigea vers le cimetière de Boulogne ; on avait là une autre visite à faire, une visite à une tombe.
Le monument élevé à la mémoire de Marceline Lebel et placé dans un coin de la nécropole était très simple : une pierre tombale en granit avec une croix. Sur la pierre étaient gravés ces mots :
ICI REPOSE
LE CORPS DE MARCELINE LEBEL
DÉCÉDÉE DANS SA VINGT-HUITIÈME ANNÉE
Priez pour elle.
Édouard s’agenouilla sur la pierre et fondit en larmes.
La Dame en noir et André, debout, la tête inclinée, pleuraient aussi.
Bien des fois Édouard était venu là verser des larmes sur la tombe de sa mère. Quand il se fut relevé et eut essuyé ses yeux, il arrêta sur Mme Clavière son regard interrogateur.
Celle-ci lui prit la main, et le regardant avec attendrissement :
– Plus tard, mon ami, dit-elle, attendez encore ; quand le moment sera venu, vous connaîtrez les malheurs de votre mère.
– Elle a souffert ?
– Beaucoup souffert, plus peut-être qu’aucune autre femme.
– Ma pauvre mère !
– Elle vous a bien aimé, Édouard.
– Oh ! oui. Je conserve le souvenir des derniers baisers qu’elle m’a donnés, et il me semble que je la vois encore pâle, raide, glacée sur son lit de mort.
– Gardez pieusement tous ces souvenirs, mon ami, et que dans votre cœur la mémoire de celle qui repose en paix sous cette pierre soit toujours vénérée…
– Ainsi, elle n’avait pas mérité ses malheurs ?
– Édouard, votre mère a été une victime ! Mais je vous le répète, je vous raconterai un jour sa navrante histoire.
Le jeune homme courba la tête, prononça le mot « adieu » et suivit Mme Clavière et André.
*
* *
Nous ne suivrons point Mme Clavière et ses fils pas à pas dans leur voyage. Ils s’arrêtaient dans une ville, quelquefois même dans un village et y séjournaient plus ou moins longtemps, selon les excursions intéressantes qu’il y avait à faire dans les environs.
Ils visitèrent entièrement la Suisse, si riche en sites pittoresques, en paysages admirables, avec ses lacs superbes, ses gorges profondes, ses glaciers imposants et terribles que ne parviennent pas à fondre les chauds rayons du soleil, ses torrents redoutables, ses montagnes chauves, ses pics gigantesques couverts de neiges éternelles, et ses belles et vertes vallées luxuriantes de végétation.
Édouard et André n’avaient pas seulement étudié le latin et le grec, ils avaient appris l’allemand, l’italien et l’espagnol. Très souvent ils se parlaient dans l’une ou l’autre de ces langues étrangères, afin de se familiariser avec les difficultés de la prononciation.
La connaissance de la langue allemande leur fut très utile en Suisse, comme celle de la langue italienne allait leur être d’un grand secours en Italie.
Ils entrèrent par le Simplon dans le royaume conquis par Victor-Emmanuel, grâce au concours des armes françaises, ce que les Italiens paraissent avoir complètement oublié aujourd’hui. On rencontre partout l’ingratitude.
À Rome, à Milan, à Florence, à Pise et dans beaucoup d’autres villes, on consacra des journées entières à visiter les musées, les églises et autres édifices où l’on peut admirer les chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture.
Édouard était aux anges. Grave, réfléchi, il examinait, étudiait la vigueur du dessin, la grâce des poses, la chaleur des tons, l’harmonie et la puissance des couleurs ; il s’inspirait de ces grands maîtres de l’école italienne qui, pendant plusieurs siècles, ont été les premiers artistes du monde, et il s’affermissait de plus en plus dans sa résolution de travailler avec ardeur afin de devenir, lui aussi, un grand peintre. Il s’oubliait dans son admiration et, souvent, il fallait l’arracher à ses contemplations.
– Oh ! disait-il enthousiasmé, je crois qu’aucune satisfaction ne peut être comparée à celle que j’éprouve. Que de merveilles, que de grandes choses dans ce beau pays d’Italie !
Et, avec effusion, il remerciait Mme Clavière du bonheur qu’elle lui procurait.
On avait mis un mois à parcourir la Suisse ; on était depuis trois mois en Italie, et l’on était loin encore d’avoir tout vu.
Mais on tenait à suivre l’itinéraire qu’on avait tracé avant de quitter Paris.
On se rendit en Espagne en traversant le midi de la France et en franchissant les Pyrénées. On visita successivement les principales villes de la Péninsule : Barcelone, Saragosse, Murcie, Ségovie, Grenade, Cadix, Séville.
Nos voyageurs étaient à Madrid lorsqu’ils apprirent par un journal français la mort du docteur Chevriot. Le journal donnait le compte rendu des obsèques du vieux savant et citait les noms des hauts personnages qui y avaient assisté.
Mme Clavière et ses fils pleuraient.
C’était plus qu’un ami, c’était un père qu’ils avaient perdu.
– Hélas ! dit Marie, il avait le pressentiment de sa fin prochaine. Je n’oublierai jamais le sourire qu’il avait sur les lèvres et la façon dont il hocha la tête, en nous disant :
« À votre retour, vous ne me retrouverez plus. »
– Je me rappelle bien ces paroles, dit André, et aussi celles qu’il a prononcées avant que nous le quittions, ayant de grosses larmes dans les yeux :
« Mes enfants, donnez au vieillard le baiser des adieux. »
– Cher et bon docteur ! murmura Mme Clavière.
La tête inclinée, absorbée en elle même, elle pensait au passé, à la première visite qu’elle avait faite à M. Chevriot, au charbon qu’elle avait allumé, voulant en finir avec la vie, à son mariage, à la mort d’André Clavière, à la naissance de son fils, à ses douleurs, à ses joies, à l’affection sincère et dévouée que le bon docteur lui avait témoignée et dont il lui avait donné tant de preuves.
André et Édouard se regardaient tristement et restaient silencieux pour ne point troubler la méditation de Mme Clavière.
À la fin, cependant, André s’inquiéta de l’attitude douloureuse de sa mère.
– Maman, à quoi penses-tu ? lui demanda-t-il en l’entourant de ses bras.
Elle sursauta comme brusquement réveillée, se redressa et, étreignant son fils, elle répondit :
– Je pense à des choses lointaines.
– À la mort de mon père, n’est-ce pas ?
Une seconde fois elle tressaillit.
– Oui, André, murmura-t-elle, à la mort de ton père, et à d’autres choses encore que tu dois toujours ignorer.
– Va, je sais que tu as beaucoup souffert, cela me suffit ; mais maintenant, ma mère chérie, sois tranquille, je ferai tout au monde pour que tu sois heureuse.
Et André colla ses lèvres sur le front de sa mère.
– J’aiderai André dans sa tâche, dit Édouard, et comme à lui, elle me sera douce et facile.
– Heureuse, mes enfants, répondit Mme Clavière avec émotion, mais ne le suis-je pas déjà, grâce à vous, autant que je puisse l’être ?
– Maman, nous voulons, Édouard et moi, que tu aies toutes les joies, tous les bonheurs.
Le regard de la Dame en noir eut un rayonnement céleste.
– Mes enfants, reprit-elle après un moment de silence, notre voyage est terminé, notre deuil ne nous permet pas de le continuer.
Les jeunes gens approuvèrent par un mouvement de tête.
– Alors, dit André, nous retournons à Paris ?
– Non, mon ami. Ainsi que cela a été dit et convenu, nous ne rentrerons à Paris qu’au mois de mars. Nous passerons le reste de l’hiver à Cannes. En cette saison, le climat des Alpes-Maritimes est doux et bienfaisant. Je reverrai avec plaisir cette petite ville du littoral méditerranéen où j’ai vécu tranquille et solitaire pendant plus d’une année et où tant de fois, assise sur un rocher, les yeux fixés sur la mer bleue, mes longues rêveries ont été bercées par le murmure des vagues qui venaient mourir à mes pieds.
Et toi-même, André, ne te sera-t-il pas agréable de connaître Cannes, cette jolie petite ville où tu es né, si coquettement assise au bord de la Méditerranée ?
– Très agréable, chère mère.
Le soir même on quitta Madrid, et le surlendemain on était à Cannes.
Ce fut dans cette ville que, pour la première fois, Mme Clavière interrogea sérieusement Édouard et André sur ce qu’ils avaient l’intention de faire en vue de leur avenir, demandant à chacun à quoi il se destinait.
Sans hésiter, Édouard répondit :
– Je serai artiste-peintre.
– Ainsi, mon ami, vous avez toujours les mêmes idées, vous persistez dans votre résolution ?
– Plus que jamais.
– Pour arriver, il vous faudra du talent, beaucoup de talent.
– J’espère en avoir.
– Oui, vous en aurez, c’est ma conviction ; malgré cela, mon cher Édouard, vous rencontrerez de nombreuses difficultés.
– Avec le courage et la persévérance, je les surmonterai.
– C’est votre vocation ; obéissez donc, mon ami, à ce mouvement intérieur qui vous dirige vers la peinture.
– Moi, dit André, je veux faire mes études de droit.
– Est-ce que tu désires être notaire, avoué ou avocat ?
– Je ne sais pas encore, chère mère ; quand je serai docteur en droit, je verrai.
– Je crois, André, que tu n’as pas un goût bien prononcé pour la chicane.
– Ce goût peut me venir, chère mère.
– J’en doute fort. J’aurais préféré que tu entrasses à l’école polytechnique afin de devenir ingénieur des ponts et chaussées ou des mines comme notre excellent ami Philippe Beaugrand. L’année dernière, c’était à peu près décidé entre nous.
– C’est vrai, mais depuis j’ai réfléchi.
– Bien réfléchi ?
– Oui, maman, et, comme celle d’Édouard, ma résolution est fermement prise. Il ne me plairait nullement d’être notaire et moins encore avoué ; avocat, passe encore. S’il y a de mauvaises causes à défendre, il y en a aussi de bonnes, de belles, de justes. Entre celles-ci et les autres, l’avocat a le droit de choisir.
– Peut-être, quand il a des clients, une réputation.
– La réputation vient et les clients viennent aussi. Du reste, chère mère, ce n’est pas le titre d’avocat que j’ambitionne ; je désire faire mes études de droit, être reçu docteur et après, comme je le disais tout à l’heure, je verrai. Plusieurs carrières sont ouvertes au jeune docteur en droit : il y a l’administration, le contentieux, la magistrature.
– Et la diplomatie, ajouta Édouard. Chère mère, continua-t-il, André, sérieux, grave, réfléchi, très fin et d’un tact parfait, a déjà toutes les qualités du diplomate.
Mme Clavière ne put s’empêcher de tressaillir et elle pâlit.
– Rassure-toi, maman, dit vivement André, se méprenant sur la cause de l’émotion de sa mère, Édouard ne sait pas ce qu’il dit ; mon ambition ne va pas jusqu’à désirer entrer dans la diplomatie, cette carrière me serait-elle très largement ouverte ; je ne veux jamais te quitter et toujours rester en France.
Mme Clavière n’avait pas à s’opposer aux désirs de son fils ni à ceux d’Édouard.
Il fut décidé qu’André prendrait ses premières inscriptions et suivrait les cours de l’école de droit.
Quant à Édouard, qui était dans sa vingtième année, il allait, tout d’abord, satisfaire à la loi militaire en faisant son volontariat d’un an. Ensuite il entrerait comme élève dans l’atelier d’un de nos peintres célèbres.
II. ÉDOUARD ET ANDRÉ
À son tour, André avait fait son volontariat d’un an et, revenu à Paris, avait repris ses études de droit interrompues.
Édouard travaillait aussi avec ardeur et se préparait au prochain concours du prix de Rome. Obtenir le prix de Rome, c’était son rêve de tous les jours, de tous les instants. Certes, cette ambition était légitime : il était le meilleur élève de l’atelier de Détaille, et le maître, partageant son espoir, ne lui ménageait ni les conseils ni les encouragements.
Édouard avait pour la Dame en noir une reconnaissance qu’il poussait quelque peu à l’exagération ; mais d’une nature extrêmement délicate, par un sentiment de noble fierté, il souffrait de ce qu’elle avait fait et faisait encore pour lui, et il avait hâte de ne plus être à la charge de sa protectrice, de se suffire à lui-même.
Il vénérait Mme Clavière, qu’il élevait au-dessus de toutes les femmes ; il n’avait point perdu la douce habitude de l’appeler sa mère, de l’embrasser et de lui présenter son front, comme le faisait André ; cependant, malgré sa grande affection pour celle qui était sa seconde mère, il n’avait jamais osé la tutoyer, même dans son plus jeune âge, et Mme Clavière, de son côté, établissant ainsi, sans le vouloir sans doute, une différence entre ses deux enfants, ne tutoyait pas Édouard.
Ni ce dernier, ni André ne connaissaient le chiffre de la fortune de Mme Clavière. Elle vivait si simplement et dépensait si peu, en apparence, qu’ils pouvaient supposer qu’elle s’imposait des privations pour eux.
Mme Clavière restait fidèle à ses principes, au programme qu’elle s’était tracé pour l’éducation de son fils. Elle savait que, trop souvent, le jeune homme tourne mal quand la faiblesse de ses parents met à sa disposition des sommes relativement importantes ; il est alors plus facile aux entraînements pernicieux ; sachant qu’il n’a pas à avoir les soucis de l’existence, de l’avenir, il se dégoûte du travail, devient paresseux, oisif ; de là, il n’a plus qu’un pas à faire pour tomber dans la vie désordonnée, dans la débauche.
Mme Clavière voulait que son fils et Édouard dussent tout à eux-mêmes, à leurs efforts. Assurément, elle était disposée à les aider autant qu’il serait nécessaire ; mais c’était, avant tout, par le travail et la bonne conduite qu’ils devaient conquérir une position dans le monde.
Ils vivaient avec elle, auprès d’elle, car elle était venue habiter à Paris, dans un appartement qu’elle avait loué et meublé avenue de l’Opéra. Chacun avait sa chambre et les repas étaient pris en famille.
Les jeunes gens n’avaient donc rien ou presque rien à dépenser. Cependant ils recevaient l’un et l’autre cent francs par mois dont ils pouvaient disposer à leur fantaisie.
Dans le courant du mois, une partie de cet argent était rendue à Mme Clavière en bouquets.
On achetait quelques livres, quelques menus objets ; on prêtait à des camarades momentanément embarrassés, qui rendaient ou oubliaient de le faire ; on donnait à des pauvres. On trouve si aisément, à Paris, des misères à soulager !
Ils n’avaient pas à s’occuper de leurs habillements : ils commandaient et Mme Clavière payait.
Élevés comme ils l’étaient, honnêtement, ayant le respect d’eux-mêmes, sans mauvaises fréquentations, fuyant la contagion du mal, il leur arrivait souvent, à Édouard surtout, de ne pas avoir trouvé, dans le mois, à employer complètement leur argent de poche.
Toujours par ce même sentiment de délicatesse et de fierté, il semblait à Édouard qu’il n’avait pas le droit de dépenser cet argent qu’il n’avait pas gagné de ses mains.
Et quand, à ce sujet, la Dame en noir le grondait doucement, il rougissait comme un enfant qu’on réprimande. Mais il se gardait bien de parler de ses scrupules, car il sentait qu’ils n’étaient pas dépouillés d’orgueil.
Il n’osait pas repousser la main de sa mère adoptive quand elle lui donnait de l’argent ; il l’acceptait, les yeux baissés, se faisant violence et comme honteux.
Eh bien, oui, il souffrait de ce que Mme Clavière faisait pour lui, s’imaginant que les dépenses qu’il occasionnait étaient un tort fait à André.
Enfin, s’il avait le prix de Rome, ce serait fini, il ne serait plus une charge onéreuse pour Mme Clavière.
Il concourut.
Hélas ! ce fut un échec.
Ce prix, qu’il avait vaillamment disputé, qu’il espérait, sur lequel il comptait, ce prix fut donné à un autre, c’était cet autre qui irait à Rome à sa place et serait pensionnaire de la villa Médicis.
Ce fut un coup terrible, un douloureux désenchantement. Édouard tombait de toute la hauteur de ses jeunes illusions, et sa douleur était d’autant plus cruelle que jusqu’au dernier moment il avait pu se croire vainqueur. Toujours, en tout et partout, il faut compter avec les petites intrigues de la camaraderie, certaines influences occultes et par cela même plus puissantes. C’est ainsi, le favoritisme aura toujours ses élus.
Pendant plusieurs jours, Édouard fut en proie à un sombre désespoir. S’il n’avait pas eu l’affection de la Dame en noir et d’André pour le soutenir, le consoler, l’empêcher de s’abandonner à lui-même, il aurait été capable d’attenter à ses jours.
Il était découragé et ne voulait plus admettre qu’il eût du talent.
– Je croyais avoir quelque chose là, disait-il en se frappant le front, je me trompais ; ce n’était que de la présomption, la sottise d’une ambition ridicule ; ce que j’appelais ma vocation n’était qu’un rêve vaniteux. Et j’ai mis des années à faire quoi ? À gonfler une bulle de savon !
Il parlait d’abandonner complètement la peinture pour un autre métier, n’importe lequel ; il n’était bon qu’à faire un garçon épicier.
– J’ai vingt-quatre ans, disait-il amèrement, n’est-ce pas honteux, à mon âge, de ne pas savoir gagner le pain que je mange ?
On lui disait de reprendre courage, de se remettre au travail ; l’année prochaine il serait plus heureux au concours.
Il secouait tristement la tête. Sa confiance en lui-même venait d’être fortement ébranlée.
– Ah ! ma mère, disait-il à Mme Clavière, comme vous aviez raison quand vous me parliez des difficultés que je rencontrerais sur mon chemin ! C’était un avertissement que vous me donniez ; pourquoi n’ai-je pas écouté et compris ?
– En effet, mon ami, je vous ai parlé des difficultés que vous auriez à vaincre. Bravement vous m’avez répondu : Avec du courage et de la persévérance je les surmonterai.
– Alors, pauvre insensé, je ne doutais de rien ; maintenant le doute m’écrase.
– C’est du découragement cela. À votre âge, Édouard, on n’a pas le droit de manquer de courage. Le découragement n’appartient qu’aux âmes faibles, et la vôtre est vaillante.
Vous parlez d’abandonner la peinture, et pourquoi ? Parce que vous venez de subir un échec ? Mais cela arrive souvent dans la vie où les déceptions de toutes sortes sont si nombreuses ! Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas laisser la peinture : on ne déserte pas ! Reprenez confiance en vous-même, chassez le doute qui vous accable, et vaincu aujourd’hui, redressez-vous fièrement pour la lutte de demain. Enfin, mon ami, soyez fort et constamment prêt à briser les obstacles qui pourront encore se placer en travers de votre chemin. Car la vie est ainsi faite qu’elle est une lutte continuelle. Ce n’est jamais par une route facile et jonchée de fleurs que l’on arrive au but de ses désirs.
Demandez à ceux qui ont acquis la renommée s’ils n’ont pas eu leurs déboires, leurs souffrances morales ; ah ! mon ami, ils l’ont souvent chèrement payée, l’auréole de gloire qu’ils ont au front !
Quoi que vous en disiez, – mais c’est votre dépit qui parle, – vous avez du talent ; c’est indéniable, c’est reconnu. Eh bien, si vous voulez la conquérir, cette auréole de gloire qui illumine le front du grand artiste, continuez de travailler, travaillez toujours et soyez disposé à tous les sacrifices pour votre art, sacrifices parmi lesquels se trouvera plus d’une fois, sans doute, celui de votre amour-propre.
Ce fut ainsi que Mme Clavière, par des paroles de réconfortance et la persuasion, amena peu à peu Édouard à reprendre possession de lui-même. De nouveau il sentit vibrer dans son cœur le sentiment de sa valeur.
Un matin, Mme Clavière lui dit :
– Édouard, vous êtes tourmenté par un désir que vous ne me faites pas connaître.
– Que voulez-vous dire, ma mère ? balbutia-t-il.
– Je vous ai deviné, mon ami ; vous voudriez aller passer quelque temps en Italie pour y puiser des inspirations, et étudier ces grands maîtres de l’école italienne dont vous n’avez pu qu’admirer les chefs-d’œuvre lors de notre voyage.
– Je ne puis le nier, répondit-il fort troublé, je pense trop à ces merveilleuses peintures que j’ai vues en Italie.
– Et vous voudriez les revoir ?
– Oui, mais c’est encore une folie.
– Pourquoi ?
– Parce que c’est désirer l’impossible.
– Moins impossible que vous ne le pensez, mon ami ; nous avons parlé de cela, André et moi, et nous avons décidé que vous iriez compléter vos études en Italie. André croit que deux années vous suffiraient.
– Mais, ma mère, commença le jeune homme.
Puis, se reprenant :
– Non, non, fit-il avec une sorte de brusquerie, ne me parlez plus de cela ; vous avez déjà fait pour moi trop de sacrifices.
– Je ne les compte pas, répliqua la Dame en noir avec un accent de reproche qui fit venir des larmes aux yeux d’Édouard ; ah ! je sais bien que, dans votre fierté, il vous est pénible d’accepter ce que vous appelez mes bienfaits, quand je suis si heureuse de m’acquitter d’une dette sacrée que mon cœur a contractée. Eh bien, Édouard, cela me cause un véritable chagrin.
– Oh !
– Oui, parce que j’ai fait de vous mon fils et que vous ne me considérez pas, ainsi que je le voudrais, comme votre mère.
– Ma mère ! ma mère ! s’écria-t-il vivement ému.
Il saisit une des mains de Mme Clavière et, prêt à sangloter, la porta à ses lèvres.
– Édouard, allez-vous être enfin raisonnable ?
– Mon Dieu, mais je n’aurai pas assez de toute ma vie pour vous prouver ma reconnaissance et la grandeur de mon affection.
– Oui, mon ami, vous m’aimez.
– Comme j’aurais aimé ma mère.
– Donc, c’est convenu, reprit Mme Clavière, après un court silence, vous irez en Italie, et comme il ne me plairait pas que vous fissiez là-bas une trop mauvaise figure, vous voudrez bien recevoir de votre mère adoptive une pension mensuelle de cinq cents francs.
Le jeune homme regarda la Dame en noir avec une sorte d’ahurissement et comme s’il n’avait pas entendu.
– J’ai dit, Édouard, que votre pension serait de cinq cents francs par mois.
– Oh ! je ne peux pas accepter, je ne peux pas… Six mille francs par an ! C’est trop d’argent.
– Édouard, vous voulez donc absolument me faire de la peine ?
– Je ne puis pourtant pas accepter… Oh ! vous et André gênés à cause de moi !
Mme Clavière eut un de ses ineffables sourires.
– Rassurez-vous, dit-elle, la gêne n’entrera pas ici ; d’ailleurs vous savez bien que je ne fais jamais plus que je ne peux. Pour vous et André j’ai fait des économies, et il m’est agréable, aujourd’hui, de mettre à votre disposition la moitié de ces économies. Eh bien, avez-vous encore quelque chose à objecter ?
Édouard tomba à genoux devant Mme Clavière et sanglota. Quinze jours après, il partait pour l’Italie où il devait rester deux ans.
Il avait retardé son départ de quelques jours afin d’applaudir à un nouveau succès d’André, qui venait de passer brillamment ses examens de licencié.
Pendant qu’André préparait sa thèse pour le doctorat, Édouard travaillait à Rome, à Florence et dans les autres principales villes d’Italie. Il avait déjà envoyé deux jolis petits tableaux à Mme Clavière, qui les avait mis dans son salon, en belles places. Elle les montrait à ses amis, tout heureuse, avec le sentiment d’orgueil d’une véritable mère.
Une semaine ne se passait jamais sans qu’on eût reçu une lettre d’Édouard ; sachant qu’il ferait plaisir à Mme Clavière et à André, il leur faisait connaître l’emploi de son temps ; de sorte que chacune de ses lettres était comme un journal de la semaine, et il parlait longuement de ses études, de ses excursions artistiques, de ses projets d’avenir.
– Le voilà tout à fait remonté, disait André à sa mère.
– Oui, répondait-elle, mais il n’est pas encore suffisamment armé contre les déceptions ; avec sa nature sensible et confiante, il faudrait bien peu pour qu’il se laissât saisir de nouveau par le découragement.
Chacun à son tour, Mme Clavière et André répondaient à Édouard. Et, des deux côtés, les lettres étaient également impatiemment attendues.
Après sa thèse, qui fut très remarquée et qui lui valut de nombreuses et vives félicitations, André fut reçu docteur en droit. Il n’avait que vingt-trois ans.
André, qui avait été un joli enfant, était maintenant, dans toute l’acception du mot, un très beau jeune homme.
Il avait la parfaite distinction de sa mère et quelque chose de sa grâce adorable, sans avoir pour cela rien d’efféminé.
Il était grand, bien fait ; et sa taille svelte, élégante, ajoutait encore à sa distinction.
Ses cheveux épais, bien plantés, laissant le front largement découvert, étaient d’un beau châtain clair. Sa fine moustache était de même nuance, mais peut-être un peu plus foncée.
Les yeux, presque bleus, ressemblaient beaucoup à ceux de Mme Clavière ; les cils étaient longs, serrés, soyeux, et les sourcils bien marqués.
Le regard, très doux, ne manquait cependant ni de fermeté, ni d’énergie ; on sentait que sous ce front de jeune homme il y avait une volonté.
Mais la douceur n’était pas seulement dans le regard, elle était dans la physionomie tout entière, dont l’ensemble exprimait la bienveillance et la bonté.
Ainsi que l’avait si vivement souhaité sa mère, André avait les sentiments élevés, et était généreux et bon comme celui dont il portait le nom.
Si André avait beaucoup de sa mère, on ne pouvait pas dire cependant qu’il lui ressemblait. C’était par le cœur que la ressemblance entre eux était absolue.
À qui le jeune homme ressemblait-il ?
Souvent, très souvent, à mesure qu’il avait grandi, Marie, en le regardant, se l’était demandé avec une certaine anxiété.
Elle avait remarqué qu’il avait dans les manières, dans son allure et ses mouvements de tête un peu des airs du comte de Rosamont et aussi quelque chose dans les traits du visage ; mais c’était si peu accentué, si vague, si insaisissable…
Elle s’était rassurée, en se disant :
– Non, il ne lui ressemble pas. Et si un jour le hasard ou la fatalité les met en présence l’un de l’autre, le comte ne reconnaîtra pas son fils. Et d’ailleurs, il y a longtemps qu’il ne pense plus à Marie Sorel, et il a certainement oublié le nom d’André Clavière.
Donc, André était docteur en droit. Plusieurs carrières s’ouvraient devant lui ; laquelle allait-il choisir ? En étudiant il n’avait fait que préparer l’avenir. Il entrait sérieusement dans la vie, et il lui fallait maintenant marcher à la conquête d’une position.
– Eh bien, André, lui demanda sa mère, que vas-tu faire ? Et comme il ne se pressait pas de répondre :
– Vas-tu te faire inscrire au tableau des avocats ? ajouta-t-elle.
– Je crois ne pas avoir ce qu’il faut pour faire un avocat.
– Te plaît-il d’entrer dans la magistrature ?
– Heu ! la magistrature…
– Je comprends, il ne te sourit pas plus d’être magistrat qu’avocat. Alors, voyons, quelles sont tes idées ?
– Eh bien, mère chérie, ce qui me plairait le plus…
– Achève.
– Ce serait, si c’est possible, d’être sous-préfet.
Mme Clavière regarda fixement son fils, et, souriant :
– Un jour, devant toi, assez étourdiment, Mlle Henriette de Mégrigny, a dit qu’elle serait heureuse d’avoir pour mari un jeune sous-préfet ; je parierais que c’est elle qui t’a suggéré cette idée ?
– Je ne le nie pas.
– André, est-ce que tu aimes Mlle de Mégrigny ?
Le jeune homme devint très rouge.
– Je n’ai aimé que toi jusqu’à présent, chère mère, et je n’aime encore que toi, répondit-il ; il me serait donc bien difficile de dire si l’amitié que j’ai pour Mlle de Mégrigny a quelque ressemblance avec l’amour.
– Mais elle te plaît.
– Oui, beaucoup ; c’est assez naturel, je la connais depuis son enfance et elle a toujours été très gentille avec moi. Et puis, elle est si douce, si bonne, si charmante !
– Oui, elle a de brillantes qualités.
– Mais rassure-toi, chère mère, je n’ai pas eu encore beaucoup le temps de laisser parler mon cœur, et je n’en suis pas encore au premier chapitre d’un joli roman d’amour. D’ailleurs, je sais que Mlle de Mégrigny a une très grosse dot, un million, ai-je entendu dire : cela suffirait pour me retenir si je me sentais trop vivement entraîné vers elle.
– Mon Dieu, fit négligemment Marie, je ne crois pas que la dot de Mlle de Mégrigny pourrait sérieusement se dresser devant toi comme un obstacle.
– Je t’assure, maman, qu’il me répugnerait fort d’être enrichi par une femme.
– Ah !
– Je me connais, je ne ferai jamais ce que l’on appelle un beau mariage. Mais en vérité, continua-t-il en riant, nous parlons pour ne rien dire, nous avons le temps de penser à mon mariage.
– Le moment de te marier arrivera vite, mon ami.
– Va, je ne me presserai point ; je suis si tranquille, si heureux auprès de toi !
– Tu dis cela aujourd’hui ; avant un an, peut-être, tu penseras autrement.
– Maman, répliqua-t-il vivement, je te jure que si je devais me séparer de toi, je ne me marierais jamais !
– Ne parlons plus de cela, André.
– Ah ! te voilà tout attristée et prête à pleurer.
– Je suis toujours très émue, tu le sais bien, chaque fois qu’il est question de ton avenir.
– Mais tu ne peux rien voir dans mon avenir qui puisse t’effrayer.
– Sans doute ; mais, vois-tu, une mère a toujours des craintes.
– Maman, tu m’aimes trop !
– Tu trouves ? eh bien, je voudrais pouvoir t’aimer encore davantage.
– Oh ! ma mère adorée !
Et, câlin, comme quand il était enfant, il laissa aller doucement sa tête sur le sein de sa mère.
Il y eut quelques instants de silence.
– Tu disais donc, reprit Mme Clavière, que tu voudrais être sous-préfet.
– Oui, car je crois pouvoir faire mon chemin dans cette branche de l’administration.
– As-tu suffisamment consulté tes forces ?
– Je saurai me rendre digne de la confiance qu’on aura mise en moi.
– Oh ! je ne doute ni de tes aptitudes, ni de ton dévouement à la chose publique ; tu auras à cœur de bien faire, je le sais ; mais, mon ami, tu es bien jeune.
André répondit en souriant par ces paroles que Corneille a mises dans la bouche de Cid :
… Pour les âmes bien nées
La valeur n’attend pas le nombre des années.
– Oui, oui, fit Mme Clavière, tu as en toi toutes les généreuses ardeurs de l’amoureux de Chimène.
– Ma seule crainte, en effet, reprit André, est que le ministre ne me trouve trop jeune pour me confier une sous-préfecture.
– Cela est sûr. Enfin, nous verrons. Dans tous les cas, et le plus promptement possible, nos bons amis, MM. Philippe Beaugrand et Edmond Joubert feront les démarches nécessaires.
– Le ministre présentera certainement des objections ; mais chaudement recommandé par M. Joubert, un sénateur, et par M. Beaugrand, un député, il finira par me nommer.
– Je l’espère, puisque c’est ton désir et que ton idée est là. M. Joubert connaît particulièrement plusieurs ministres, et le ministre de l’intérieur est un ami intime de M. Beaugrand. Tu ne peux pas te présenter sous de meilleurs auspices.
Quelques jours après, M. Beaugrand parla du jeune docteur en droit au ministre qui, après avoir écouté attentivement, s’écria :
– Mais, mon cher député, votre protégé est encore un enfant !
– Oui, il est jeune, ce qui, entre nous, n’est pas un bien grand défaut ; mais il est mûri par le travail et la réflexion et est, de plus, très sérieux.
– Eh bien, mon cher, amenez-le-moi un de ces matins ; je serai content de le voir, ce garçon-là.
La chose était en bon chemin.
André fut présenté au ministre, qui lui fit un fort aimable accueil et lui dit en le quittant :
– C’est bien, monsieur Clavière, on ne vous oubliera pas, et si cela arrivait, M. Beaugrand me rafraîchirait la mémoire.