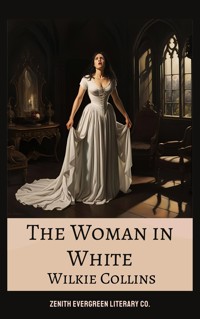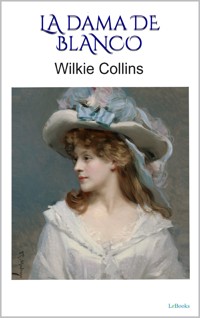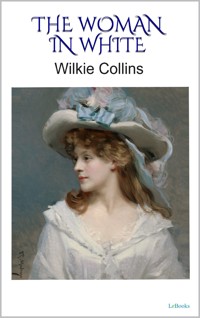Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce que peut supporter la patience d'une femme, ce que peuvent accomplir le courage et la constance d'un homme, cette histoire le dira."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1393
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il y a quelques années, je me trouvai faire partie de l’auditoire assemblé pour assister aux débats d’une affaire criminelle qui se jugeait à Londres.
Pendant que j’écoutais la procédure, laquelle n’avait aucune importance en elle-même, et ne m’a fourni aucun des personnages ou des incidents qu’on trouvera dans les pages ci-après, je fus frappé de la manière dramatique dont se déroulait l’histoire du crime alors soumis aux investigations de la magistrature, grâce aux dépositions successives des témoins entendus tour à tour. À mesure que chacun d’eux se levait pour fournir son fragment de relation personnelle, à mesure que, d’un bout à l’autre de l’instruction, chaque anneau séparé venait former avec les autres une chaîne continue d’irréfragable évidence, je sentais que mon attention était de plus en plus captivée ; je voyais qu’il en était de même chez les personnes qui m’entouraient ; et ce phénomène prenait une intensité toujours croissante, à mesure que la chaîne s’allongeait, à mesure qu’elle se tendait, à mesure qu’elle se rapprochait de ce qui, dans tout récit, est le point culminant. – Certainement, pensai-je, une série d’évènements romanesques se prêterait fort bien à une exposition comme celle-ci ; certainement, par les mêmes moyens que je vois employer ici, on ferait passer dans l’esprit du lecteur cette conviction, cette foi que je vois se produire grâce à la succession des témoignages individuels, si variés de forme, et pourtant si strictement « unifiés » par leur marche constante vers le même but. Plus j’y pensais, et plus un essai de ce genre m’apparaissait comme devant réussir. Aussi, quand le procès fut terminé, je rentrai chez moi bien déterminé à tenter l’aventure.
Mais quand il fallut donner une forme définie à la pensée qui m’avait préoccupé, je m’aperçus que la chose n’était point aussi facile que je l’avais crue. Elle offrait de sérieuses difficultés littéraires avec lesquelles, alors, mon expérience de romancier ne m’avait pas encore mis à même de lutter victorieusement. Je résolus d’attendre que j’eusse acquis, à un degré supérieur, la pratique de mon art ; d’attendre que le temps et le hasard vinssent m’offrir une chance nouvelle.
Voici comment cette chance m’arriva.
Dans le cours de l’année 1859, M. Charles Dickens lança le journal hebdomadaire qu’il a baptisé « All the year round », et qu’il inaugura par un roman de lui (« A Tale of two Cities »). Lorsque la publication de cette œuvre (par livraisons hebdomadaires) eut été complétée, je fus invité à écrire le roman qui devait immédiatement lui succéder dans les colonnes du nouveau « périodique. »
Lorsque j’eus accepté la responsabilité de m’adresser à un des plus nombreux auditoires que l’Angleterre puisse offrir, après que le plus grand romancier de notre pays venait de le tenir sous le charme de son talent, je ressentis une anxiété assez naturelle en me demandant si je me montrerais digne d’une telle marque de confiance. Et, à ce moment critique, l’idée que j’avais ajournée quelques années auparavant m’étant revenue en tête, je résolus, cette fois, de m’en débarrasser en la réalisant. Toutes les facilités désirables m’étaient offertes ; on me laissait maître de la longueur à donner à mon œuvre ; on ne limitait en rien le choix du sujet à traiter : la plus entière indépendance, quant à la forme que je voudrais lui donner, m’était garantie contre toute intervention quelconque. Ce fut sous ces favorables auspices que, pour la seconde fois, je me mis à ce travail déjà tenté vainement. En d’autres termes, je me donnai pour tâche de faire raconter mon roman par les personnages du roman eux-mêmes (comme les témoins que j’avais entendus au tribunal), c’est-à-dire successivement par chacun d’eux, et en les plaçant dans les situations diverses que la suite des évènements leur aurait faites, de manière à ce que tous prissent, tour à tour, la suite du récit, et progressivement le conduisissent à son terme.
Si le résultat de ce travail, ainsi modifié par les circonstances, ne m’avait fait aboutir à rien de plus qu’à une certaine nouveauté de pur agencement, je n’aurais pas imaginé d’en parler ici. Pour un si mince résultat, la moindre attention eût été de trop. Mais, à mesure que j’avançais dans mon travail, je découvris que la substance même du roman, aussi bien que sa forme littéraire, tirait profit des nécessités nouvelles auxquelles je m’étais astreint de gaieté de cœur. L’exécution de mon plan me forçait à faire progresser sans relâche, simultanément et constamment, le récit pris en bloc ; elle m’obligeait à établir dans mon esprit une conception parfaitement nette des personnages avant de me hasarder à les placer dans la situation que, d’avance, je leur avais assignée ; et quand ils entraient en scène, elle leur fournissait une nouvelle occasion de se manifester, par l’intermédiaire de ce témoignage écrit qu’ils étaient censés fournir à une sorte d’enquête, et qui, en même temps, constituait la progression naturelle du récit. Tels étaient les avantages réels de l’expérience que je tentais dans ce roman ; elle me plaçait sous le joug le plus rigoureux de la discipline littéraire. Mon livre et moi ne pouvions qu’y gagner.
Maintenant que j’ai brièvement indiqué les circonstances auxquelles la « Femme en blanc » doit d’avoir vu le jour, il serait, je pense, inutile d’arrêter le lecteur par des remarques préliminaires sur le but dramatique vers lequel je tendais en récrivant, ou sur les problèmes du caractère humain que, soit dans la conception primitive du livre, soit dans ses développements, je me suis proposé de résoudre. À ce double point de vue, le livre lui-même, – nonobstant ses défauts et ses lacunes – est assez intelligible pour n’avoir pas besoin de commentaires. Le peu de mots qui me restent à dire n’aura donc trait qu’à la manière dont ce roman a été reçu déjà, soit en Angleterre, soit en Amérique.
Avant que la publication périodique de la « Woman in White » (à Londres et à New-York, simultanément) se fût encore étendue à un grand nombre de semaines, la nouveauté du plan sur lequel je travaillais s’était fait reconnaître et avait fixé l’attention. Après l’apparition de chaque numéro du journal, il m’arrivait de tous côtés des témoignages écrits de la curiosité, de l’intérêt que mes lecteurs voulaient bien m’accorder, soit en Angleterre, soit au Canada, et jusque dans ces « Backwood-settlements, » ces germes de villages futurs, déposés sur l’extrême limite de la civilisation américaine ; à plus forte raison dans les grandes cités de ce qui était, hier encore, la République des « États-Unis… » Les personnages, – quels que soient les défauts que la critique leur puisse d’ailleurs reprocher, – avaient la bonne fortune de produire, sur le grand nombre des lecteurs, la même impression que de vivantes réalités. Les deux, « rôles de femmes, » par exemple « (Laura et miss Halcombe), » s’étaient fait de si chauds amis que, lorsqu’une crise du roman parut les menacer l’une et l’autre de quelque sinistre aventure, je reçus plusieurs lettres écrites sur le ton le plus sérieux, pour me supplier de « leur sauver la vie ! »
Miss Halcombe, en particulier, fut tellement prise en faveur qu’on me mit en demeure, – ceci plus d’une fois, – de déclarer si ce caractère était peint d’après nature ; le cas échéant, on voulait savoir si le modèle vivant d’après lequel j’avais travaillé, consentirait à écouter les sollicitations de différents célibataires qui, parfaitement convaincus d’avoir en elle une femme excellente, se proposaient de lui demander sa main !
Pour une autre catégorie de lecteurs, « le Secret » qui, dans ce récit, se rattache à l’existence de « sir Percival Glyde » devint, à la fin, l’objet d’une curiosité exaspérée, qui donna lieu à divers paris dont on me constituait l’arbitre. Mais pas un des parieurs – et en dehors d’eux, pas un de mes lecteurs – n’arriva, que je sache, à deviner ce que pouvait être ce secret, – avant que le moment fût arrivé où j’avais arrêté d’avance que la découverte pourrait en être pressentie.
En ce qui concerne le « comte Fosco », d’innocents gentlemen, par douzaines, qui avaient le malheur d’être gras à l’excès, furent dénoncés tout à coup comme m’ayant fourni les éléments de ce portrait ; et, dans les rares occasions où ma voix essaya de dominer le tumulte des hypothèses dont je parle, j’eus beau déclarer « qu’aucun romancier, se limitant à un seul modèle, ne saurait espérer de faire vivre un personnage de sa création » ; j’eus beau affirmer « que des centaines d’individus, dont pas un ne s’en doute, avaient tour à tour posé pour le comte Fosco, comme, au reste, pour les autres personnages du livre » ; personne ne m’en voulut croire. Les « scélérats maigres » (on me donnait ce renseignement) sont sans doute assez communs ; mais un « scélérat gras » était, dans le roman pris en général, une si frappante exception aux règles de la poétique établie, que je n’avais absolument pas pu rencontrer, dans la vie réelle, plus d’un type de cette espèce. Libre à moi sans doute, de nier le fait ; mais le comte avait été reconnu, bien vivant et bien portant, par des témoins dignes de foi, soit à Londres, soit à Paris, et il était inutile de pousser le débat plus loin.
En supposant réellement qu’il existe, je le prie d’accepter toutes mes excuses, avec la formelle assurance que si je l’ai fait ressemblant, c’est bien par hasard. Vint un moment où le bruit courut que je m’étais perdu moi-même dans le labyrinthe de mon roman ; que je ne savais comment l’achever ; et que j’avais offert une récompense honnête à quiconque, pour ceci, voudrait me prêter assistance. L’achèvement du récit (dans le journal) fut le coup de grâce de ces agréables rumeurs. Sa seconde publication, sous forme de livre, lui procura, tant en Angleterre qu’en Amérique, un nouveau public, peut-être plus nombreux encore que le premier. Édition sur édition se suivirent rapidement. Une traduction allemande, imprimée à Leipzig, fut parfaitement accueillie des lecteurs d’Outre-Rhin. Et maintenant (grâce à la précieuse assistance de mon ami, M. Forgues) la « Woman in white » va reparaître sous une forme nouvelle. Elle va se faire écouter à Paris avec l’excellente recommandation de S.A. le duc d’Aumale, venue si à propos et donnée avec tant de libéralité
Telle est, simplement esquissée, l’histoire de ce roman. Je l’ai contée sans aucune réserve, par pure reconnaissance pour le généreux accueil déjà fait à mon livre, et aussi parce que, tout naturellement, je désire prouver aux lecteurs français que je ne me présente pas témérairement à eux, auteur étranger d’un livre étranger, sans épreuve préalable pour le livre et pour l’auteur. J’ai écrit en toute franchise ce bout de préface ; et maintenant qu’elle est à peu près terminée, je ne veux pas dissimuler que je vais suivre d’un œil inquiet l’impression que la « Woman in White » pourra produire sur les compatriotes de Balzac, de Victor Hugo, de George Sand, de Soulié, d’Eugène Sue et de Dumas. Si on estimait que ce récit peut le moins du monde acquitter la dette que j’ai contractée, soit comme lecteur, soit comme écrivain, envers les romanciers français, il aurait rempli à mes yeux la plus récente, mais non la moindre des espérances que j’avais naguère fondées sur lui.
Harley-Street, London, juin, 1861.
WILKIE COLLINS.
Ce que peut supporter la patience d’une femme, ce que peuvent accomplir le courage et la constance d’un homme, cette histoire le dira.
Si tout évènement qui prête aux soupçons pouvait être éclairci par les engins compliqués de la loi, et si ces instruments réguliers pouvaient être mis en jeu pour conduire l’enquête jusqu’à son terme, grâce à l’influence lubricante de l’huile d’or, employée avec modération, les incidents racontés dans les pages qui vont suivre auraient déjà été signalés à l’attention publique, volontiers éveillée par un débat devant les tribunaux.
Mais la loi, dans certaines situations inévitables, est d’avance et demeure au service des bourses bien garnies, et voilà comment c’est ici que, pour la première fois, sera contée cette histoire. Telle que le juge l’eût entendue, telle le lecteur l’apprendra. De l’exposition au dénouement, aucune circonstance essentielle ne sera rapportée d’après un simple ouï-dire. Lorsque celui qui écrit cette espèce d’introduction (il se nomme Walter Hartright) sera plus intimement en jeu que tout autre personnage dans les évènements qu’il s’agit de faire connaître, il les relatera en son nom. Dès qu’il cessera de pouvoir parler avec cette certitude, il abandonnera son rôle de narrateur, et sa tâche sera continuée (du point où il l’aura laissée à celui où il la pourra reprendre) par d’autres personnages aussi étroitement impliqués dans les faits à rapporter, et pouvant fournir sur ces faits un témoignage aussi précis, aussi positif que le sien l’avait été jusque-là. Ainsi, et de même que toute offense aux lois est racontée en cours de justice par plusieurs témoins, le présent récit émanera de plusieurs plumes ; et cela, dans le même but, à savoir : que la vérité soit toujours présentée sous son aspect le plus clair, le plus intelligible, et qu’une série d’évènements, formant un tout, soit éclairée du jour le plus vif, les personnes qui s’y sont trouvées le plus étroitement mêlées fournissant, l’une après l’autre, à mesure que chaque épisode successif se présente, le fidèle récit de la part qu’elles y ont eue. Écoutez donc tout d’abord Walter Hartright, professeur de dessin, âgé de vingt-huit ans.
Nous voici au dernier jour de juillet. Les longues chaleurs de l’été tiraient à leur fin ; et fatigués de nos pèlerinages sur le pavé de Londres, nous commencions tous à rêver la nuée voyageuse qui passe sur les champs de blé, la brise d’automne courant sur le rivage marin.
En ce qui me concerne, moi, pauvre hère, l’été près de finir me laissait assez peu valide, médiocrement gai, puis, enfin, s’il faut tout dire, aussi dépourvu d’argent que de forces physiques et de ressort moral. Pendant l’année qui venait de s’écouler, je n’avais pas, avec autant de prudence qu’à l’ordinaire, ménagé les ressources que mon art m’avait procurées ; aussi, mon défaut d’ordre ne me laissait plus d’autre alternative que de partager économiquement mon automne entre le « cottage » de ma mère, à Hampstead, et mon pauvre logement en ville.
La soirée, je m’en souviens, était calme et couverte ; l’atmosphère de Londres était plus lourde et le commerce des rues moins bruyant que jamais. Le pouls imperceptible qui fait circuler la vie dans nos veines et celui qui court dans les puissantes artères de cette cité, vaste cœur de tout un monde, s’affaiblissaient à l’unisson, de plus en plus alanguis, à mesure que baissait le soleil. Je m’arrachai au livre sur lequel s’endormait mon attention distraite, et, quittant mon humble domicile, j’allai, dans les faubourgs, au-devant de l’air frais que la nuit amène. C’était justement une de ces soirées que, chaque semaine, je passais d’habitude avec ma mère et ma sœur. Aussi tournai-je mes pas vers le nord, dans la direction de Hampstead.
Il me faut mentionner ici, pour la clarté du récit où je m’engage, que mon père, à l’époque où je me reporte, était déjà mort depuis quelques années. Des cinq enfants qu’il avait laissés, ma sœur Sarah et moi restions seuls. Mon père avait exercé, avant moi, la profession de maître de dessin, et son travail assidu la lui avait rendue lucrative. La tendresse inquiète et scrupuleuse dont il entourait les êtres qui dépendaient de lui, lui avait inspiré, dès les premiers temps de son mariage, l’idée de consacrer à faire assurer sa vie une bien plus forte somme qu’il n’est ordinaire de mettre en réserve pour cet objet. Aussi, grâce à sa prudence et à son abnégation, également admirables, ma mère et ma sœur étaient restées, après sa mort, aussi indépendantes d’autrui qu’elles l’avaient été durant sa vie. J’héritai naturellement de ses relations et de sa clientèle, et j’avais tout lieu de me sentir reconnaissant envers lui pour l’avenir de bien-être qui, dès mon début, s’offrait à moi.
Les paisibles lueurs du crépuscule tremblaient encore à la cime des coteaux chargés de bruyères, et la perspective de Londres, que mon regard avait d’abord embrassée d’en haut, venait de s’engouffrer dans les profonds abîmes d’une obscurité nuageuse, lorsque je me trouvai debout devant la porte du « cottage » maternel. À peine avais-je tiré le cordon de la sonnette, que cette porte s’ouvrit brusquement. Un digne ami à moi, Italien d’origine, le professeur Pesca, m’apparut au lieu de la femme de ménage, et s’élança joyeusement au-devant de moi, psalmodiant, de sa voie aiguë et avec un accent étranger, notre « hurrah » britannique.
Pour son propre compte et, s’il m’est permis de l’ajouter, pour le mien, le professeur a droit à une présentation dans toutes les règles. Le hasard a fait de lui le point de départ de l’étrange chronique de famille qu’on verra se dérouler en ces pages.
C’était chez certains grands personnages, où il enseignait sa langue et où je professais le dessin, que nous avions fait connaissance, mon ami l’Italien et moi. Tout ce que je savais encore de sa vie passée, c’est qu’il avait exercé un emploi quelconque à l’université de Padoue ; qu’il avait quitté l’Italie pour des raisons politiques auxquelles il ne faisait jamais la moindre allusion ; et que, depuis bien des années, il était honorablement établi à Londres comme professeur de langues.
Sans qu’on pût précisément le regarder comme un nain, – car il était parfaitement bien fait de la tête aux pieds, – Pesca est, je crois, le plus petit être humain que j’aie jamais vu ailleurs que sur des tréteaux de foire. Remarquable, n’importe où, par l’étrangeté de ses dehors, il se distinguait encore du commun des hommes par l’inoffensive bizarrerie de son caractère. L’idée dominante de sa vie paraissait être l’obligation où il se croyait de témoigner sa reconnaissance au pays qui lui avait procuré un asile et des moyens de subsister, en faisant tout ce qui dépendait de lui pour devenir aussi Anglais que possible.
Outre l’hommage qu’il rendait à la nation, prise en bloc, par son invariable habitude de traîner avec lui un parapluie, d’avoir des guêtres aux pieds et un chapeau blanc sur la tête, le professeur aspirait à rendre ses habitudes et ses plaisirs britanniques comme son costume. Constatant que, comme nation, les Anglais se distinguent par un vif amour des exercices athlétiques, notre petit homme, dans l’innocence de son cœur, s’associait impromptu à tous nos « sports » et passe-temps britanniques, aussi souvent que l’occasion s’en présentait, fermement convaincu qu’il pouvait adopter notre goût national pour ces fatigants plaisirs, par un simple effort de sa volonté, tout comme il avait adopté nos guêtres et notre chapeau blanc, également nationaux.
Je l’avais vu risquer témérairement ses membres dans une chasse au renard et dans une partie de « cricket » ; bientôt après, sous mes yeux, il aventura sa vie, tout aussi aveuglément, au bord de la mer, près de Brighton.
Nous nous étions rencontrés là par hasard, et prenions ensemble notre bain. Si nous nous fussions livrés à un exercice plus spécial à mes compatriotes, j’aurais naturellement eu l’œil sur Pesca ; mais comme, généralement parlant, les étrangers sont aussi aptes que les Anglais à se tirer d’affaire dans l’eau, il ne me vint pas à l’idée que le talent de la natation comptait parmi ces mâles exercices que le professeur se croyait en état de pratiquer sans noviciat préalable. Peu après avoir quitté le rivage, m’apercevant que je n’étais pas devancé, je fis halte, et me retournai pour voir ce que devenait mon ami.
À mon grand étonnement et à ma grande épouvante je n’aperçus entre moi et la grève que deux petits bras blancs qui s’agitèrent un instant à la surface du flot pour disparaître ensuite tout à coup. Lorsque je plongeai après Pesca, le pauvre petit homme gisait paisiblement au fond de l’eau, replié sur lui-même, et beaucoup plus petit, en apparence, que jamais il ne m’avait semblé. Pendant les quelques minutes que j’employai à le ramener, le grand air lui rendit sa connaissance, et, avec mon secours, il put gravir les degrés du quai. À mesure que la vie lui revenait, ses merveilleuses illusions au sujet de l’art du nageur semblaient lui revenir aussi. Dès que le claquement de ses dents lui permit de reprendre la parole, il me dit, avec un vague sourire, « que sans doute une crampe lui avait joué ce tour-là. »
Tout à fait remis, et quand il fut revenu me trouver sur le rivage, sa nature méridionale, expansive et chaude, fit tout à coup irruption à travers les barrières de notre étiquette anglaise. Il m’accabla des témoignages de l’affection la plus désordonnée, – s’écria passionnément, avec toute l’exagération italienne, que dorénavant sa vie était à ma disposition, – et déclara qu’il ne connaîtrait jamais de bonheur que s’il trouvait une occasion de me prouver sa reconnaissance par quelque service dont, à mon tour, je serais tenu de me souvenir jusqu’à ma dernière pensée.
Je fis mon possible pour arrêter le débordement de ses larmes et de ses protestations, en m’obstinant à traiter toute cette aventure comme un bon sujet de plaisanterie ; et je réussis enfin (du moins me le figurais-je), à diminuer l’écrasant fardeau de reconnaissance que Pesca se voulait mettre sur les épaules. Je ne prévis guère alors, – je ne prévis guère ensuite, notre voyage de plaisir achevé, – que l’occasion de me servir, si ardemment désirée par mon reconnaissant compagnon, allait bientôt se présenter ; – qu’il la saisirait à l’instant même ; – et qu’en agissant de la sorte, il modifierait, du tout au tout, mon existence entière et moi-même.
Pourtant, rien de plus certain. Si je n’avais point plongé après le professeur Pesca, étendu sous l’eau parmi les cailloux et les coquillages, je ne me serais jamais trouvé, selon toute probabilité humaine, mêlé aux évènements dont ces pages renferment le récit ; – jamais peut-être je n’aurais même entendu le nom de la femme qui a vécu dans toutes mes pensées, qui s’est emparée de toutes mes facultés, et sous la dominante influence de qui je marche maintenant vers l’unique but de ma vie.
La physionomie et l’attitude de Pesca, le soir où nous nous trouvâmes face à face devant la porte de ma mère, suffisait amplement à me faire savoir qu’il était arrivé quelque chose d’extraordinaire. Inutile, d’ailleurs, de lui demander des explications immédiates. Je pus simplement conjecturer, tandis qu’il m’entraînait par les deux mains à l’intérieur de la maison, que (fort au courant de mes habitudes) il était venu là pour s’assurer une rencontre avec moi, ce soir-là même, et qu’il avait à me communiquer quelques nouvelles particulièrement agréables.
Nous dévalâmes tous deux dans le salon d’une façon essentiellement contraire au cérémonial usité en pareil cas. Ma mère, assise près de la porte ouverte, s’éventait en riant. Pesca jouissait auprès d’elle d’une faveur toute particulière, et l’excellente femme lui passait les plus fantasques allures qu’il pût se permettre. Chère et bonne mère ! depuis le moment où elle s’était aperçue que le petit professeur m’était réellement attaché, elle lui avait, sans arrière-pensée, ouvert son cœur, et acceptait pour bonnes, sans même essayer de les comprendre, toutes ses étrangetés énigmatiques.
Ma sœur Sarah, qui avait pour elle sa jeunesse, se montrait pourtant, – phénomène singulier ! – beaucoup moins complaisante. Elle rendait pleine justice à l’excellent cœur de Pesca, mais elle ne l’acceptait pas en bloc, comme faisait ma mère pour l’amour de moi. Ses notions insulaires sur les convenances étaient en perpétuelle insurrection contre le mépris dans lequel, par tempérament, Pesca tenait certains dehors ; aussi se montrait-elle toujours plus ou moins surprise de voir sa maman si familière avec le bizarre petit étranger. Ce n’est pas seulement à ma sœur, mais à bien d’autres encore, que je dois de savoir que nos jeunes contemporains n’ont ni la cordialité ni l’élan de la génération qui les a précédés. Il m’arrive constamment de voir de vieilles gens excités, montés par la perspective de quelque plaisir prévu, que l’impassible sérénité de leurs petits-enfants laisse arriver sans s’en émouvoir le moins du monde. Sommes-nous bien sûrs d’être maintenant d’aussi « vrais » petits garçons, d’aussi « vraies » petites filles que nos aînés le furent à leur époque ? Les grands progrès de l’éducation moderne n’ont-ils pas pris une allure trop rapide ? et serions-nous, par hasard, en ces temps si fiers d’eux-mêmes, un tout petit brin trop bien élevés ?
Sans vouloir trancher ces questions, je puis au moins me rappeler que je ne vis jamais ma mère et ma sœur causant ensemble avec Pesca sans trouver que, de ces deux femmes, la première était incontestablement la plus jeune. En cette occasion, par exemple, tandis que ma mère riait de bon cœur en nous voyant tomber pêle-mêle, comme deux écoliers, dans son salon brusquement envahi, Sarah, mécontente et troublée, ramassait à terre les fragments brisés d’une tasse que le professeur avait fait tomber en se précipitant au-devant de moi.
– Je ne sais vraiment pas ce qui serait arrivé, Walter, dit ma mère, si vous aviez encore tardé longtemps. Pesca était presque fou d’impatience ; j’étais, moi, presque folle de curiosité. Le professeur nous apporte de merveilleuses nouvelles qui vous intéressent, à ce qu’il dit, et il a eu la cruauté de ne vouloir nous en rien laisser deviner jusqu’à ce que son ami Walter fût arrivé pour les entendre…
– Quel ennui !… une douzaine dépareillée ! grommelait Sarah, toujours tristement penchée sur les ruines de son petit bol.
Pendant ces discours, Pesca, que son agitation joyeuse avait empêché de constater les dégâts infligés par lui à la porcelaine du ménage maternel, attirait péniblement vers l’autre bout de la pièce un énorme fauteuil confortable qu’il comptait faire servir, maintenant qu’il avait un public, à ses manifestations oratoires. Quand il l’eut convenablement installé, le dossier tourné vers nous, il s’agenouilla dans cette chaire improvisée, et, non sans émotion, apostropha l’assistance, composée de trois personnes.
– Mes chers bons, commença Pesca (il disait toujours « chers bons » pour « dignes amis »), veuillez maintenant m’écouter. Le temps est venu… – je vais vous donner une bonne nouvelle ; – je parle enfin !
– « Hear ! hear ! » dit ma mère, entrant à pleines voiles dans la fiction parlementaire.
– Vous allez voir, maman, dit tout bas Sarah, qu’il va démembrer le meilleur de vos fauteuils.
– Je remonte dans le passé ; je m’adresse au plus noble des êtres créés, continua Pesca, qui, par-dessus la balustrade de sa chaire, dirigeait vers moi, sujet indigne, sa véhémente allocution. Quand j’étais étendu mort au fond de la mer (par suite d’une crampe), qui est venu me chercher ? qui m’a tiré en haut ? et qu’ai-je dit quand ma vie et mes habits me furent rendus ?…
– Beaucoup plus qu’il n’en fallait, à coup sûr, interrompis-je du ton le plus bourru que je sus prendre. En effet, pour peu qu’on encourageât le professeur à traiter ce sujet, il fallait s’attendre à le voir finir par un déluge de larmes.
– J’ai dit alors, continua Pesca, que ma vie appartenait pour jamais à mon cher ami Walter ; – je l’ai dit, et cela est. J’ai dit que désormais, pour être heureux, il me fallait trouver l’occasion de faire quelque chose d’utile à Walter ; – aussi n’ai-je jamais été en paix avec moi-même jusqu’à la présente journée, bénie entre toutes. Et maintenant, s’écria le petit enthousiaste de sa voix la plus aiguë, le bonheur me sort par tous les pores ; car, sur ma foi, sur mon âme, sur mon honneur, ce quelque chose, enfin, est trouvé ! Tout ce qui me reste à dire, maintenant, c’est : – « Right-all-right ! »
Peut-être est-il nécessaire d’expliquer ici que Pesca se piquait d’être parfaitement Anglais dans son langage tout comme dans sa toilette, ses manières et ses divertissements. Ayant accroché au passage quelques-unes de ces expressions qui reviennent sans cesse dans nos entretiens familiers, il en émaillait sa conversation à tout propos, de façon à prouver que, s’il en goûtait la sonorité spéciale, il en ignorait assez généralement la portée idiomatique. En effet, au moyen de répétitions qu’il inventait, il faisait, de ces expressions bien connues, autant de composés hybrides qui semblaient se résoudre en une syllabe unique, indéfiniment prolongée.
– Parmi les grandes maisons de Londres où j’enseigne ma langue natale, – dit le professeur, abordant, sans plus de préface, l’explication qu’il nous avait fait attendre si longtemps, – il en est une particulièrement grande, dans cette vaste place, appelée Portland… – Vous savez tous où elle est ?… Oui, oui ! « Course of course !… » – Cette belle maison, mes chers bons, sert de résidence à une belle famille. Une maman, blonde et grasse ; trois jeunes « misses, » grasses et blondes ; deux jeunes « misters, » blonds et gras ; enfin un papa, le plus gras et le plus blond de tous, lequel est un négociant de conséquence, qui a de l’or par-dessus la tête, – bel homme autrefois, mais qui, attendu son front dénudé, qu’un double menton accompagne, n’est plus, de nos jours, un homme tout à fait beau. Or, voyez un peu !… j’enseigne aux jeunes « misses » les sublimités de Dante, et, – « my soul-bless-my-soul ! » – le langage humain ne saurait dire à quel point les sublimités de Dante embarrassent ces trois jolies têtes. Mais, peu importe, – « all in good time ! » – et plus j’ai de leçons, mieux vont les choses… Et, voyez maintenant !… Figurez-vous qu’aujourd’hui même je donne leur leçon, comme d’habitude, aux jeunes « misses. » Nous voilà, tous les quatre, descendus ensemble dans l’Enfer de Dante. Au septième cercle – mais n’importe ; tous les cercles se valent pour ces trois jeunes « misses, » blondes et grasses, – au septième cercle, néanmoins, mes élèves se trouvent rudement empêtrées ; et moi, pour les tirer de là, de réciter, de commenter, de chauffer jusqu’au rouge mon inutile enthousiasme, lorsque des bottes viennent à craquer dans le corridor, et apparaît le papa, cousu d’or, ce négociant de conséquence, à la tête nue, au menton double. – Ah ! mes chers bons, je serre notre affaire, à présent, de plus près que vous ne pensez ! N’ai-je point épuisé votre patience ? ou vous êtes-vous déjà dit à vous-mêmes : – « Deuce what the deuce ! » Pesca, ce soir, n’est pas à court d’haleine…
Nous déclarâmes son récit palpitant d’intérêt. Le professeur continua :
– Dans sa main, le papa cousu d’or tient une lettre ; et, après s’être excusé de nous déranger, dans nos régions infernales, en nous rappelant aux vulgarités domestiques, il s’adresse aux trois jeunes « misses. » Comme tous les exordes anglais de ma connaissance, le sien débute par une majuscule : – Oh ! ma chère… dit le négociant de conséquence, je viens de recevoir une lettre de mon ami M*** – (le nom ne me revient pas, mais peu importe, nous le retrouverons bien) : – right-all-right !… Ainsi dit le papa, et il ajoute : – Mon ami me demande de lui recommander un maître de dessin qu’il puisse faire venir chez lui, à la campagne… « My-soul-bless-my-soul !… » Lorsque j’entendis le papa cousu d’or prononcer ces paroles, si j’avais été de taille, je lui aurais jeté les bras autour du cou et je l’eusse étreint sur mon cœur !… Vu l’état des choses, je me contentai de bondir sur mon fauteuil. J’étais sur les épines, et mon âme brûlait de s’épancher ; mais je réfrénai ma langue, et laissai le papa continuer. – Peut-être connaissez-vous, dit cet excellent homme d’argent, qui pliait et fripait entre ses doigts dorés la lettre de son ami – peut-être connaissez-vous, chères, un maître de dessin digne d’être recommandé par moi ?… – Les trois jeunes misses commencent par se regarder l’une l’autre, et répondent ensuite (non sans débuter par l’O majuscule indispensable) : « Oh ! dear no, papa !… mais voici M. Pesca… » Dès qu’il est question de moi, je n’y tiens plus. Votre souvenir, chers bons, me monte à la tête comme un flot de sang ; je m’élance, comme si une broche, tout à coup sortie du sol, avait traversé le fond de mon fauteuil ; – je m’adresse au négociant de conséquence et je lui dis (c’est la phrase anglaise) : – Cher monsieur, « I have the man ! » le premier professeur du monde !… recommandez-le, dès ce soir, par la poste, et demain, par le chemin de fer, expédiez-le, « bag and baggage ! » (encore une phrase anglaise – eh ?) – Doucement, dit le papa ; est-ce un étranger ou un Anglais ? – Anglais, répondis-je, Anglais jusqu’à la moelle des os. – Respectable ? dit le papa. – Monsieur, dis-je à mon tour (car cette dernière question me blesse, et je renonce à toute familiarité vis-à-vis de lui), monsieur !… l’immortelle flamme du génie brûle dans la poitrine de cet Anglais, et, qui plus est, elle brûlait déjà dans la poitrine de son père ! – Laissons cela ! reprend ce papa cousu d’or, mais barbare, – laissons de côté son génie, monsieur Pesca ; le génie n’est pas admis dans ce pays, s’il n’est accompagné d’une respectabilité suffisante ; – alors nous sommes très charmés, très charmés vraiment de lui faire accueil… Votre ami peut-il produire ses attestations ?… Se présenterait-il, au besoin, pourvu de lettres garantissant sa responsabilité morale ? – Avec un geste négligent : – Des lettres ? dis-je ; ha ! « my-soul-bless-my-soul ! » Je le crois bien !… Vous faut-il des volumes de lettres ? des portefeuilles d’attestations ?… – Une ou deux suffiront, réplique cet homme, bouffi de flegme et de monnaie. Qu’il me les envoie avec son nom et son adresse !… Puis… Doucement, doucement, monsieur Pesca !… avant de courir ainsi trouver votre ami, peut-être serait-il bon de prendre un billet. – Un billet… de banque ? m’écriai-je indigné. Pas de billet de banque, s’il vous plaît, que mon brave Anglais ne l’ait gagné d’abord. – Un billet de banque ? reprend le papa fort surpris. Qui a parlé de billets de banque ? Le billet que je veux dire est une note, un mémorandum de ce qu’il doit faire et de ce qu’il doit gagner. Continuez votre leçon, monsieur Pesca, et je vais extraire pour vous la lettre de mon ami… – Voilà mon homme d’argent et de négoce qui s’asseoit devant sa plume, son encre et son papier, tandis que, suivi de mes trois jeunes misses, je me replonge dans l’Enfer de Dante. En dix minutes, la note est rédigée, et les bottes du papa s’en vont, craquant par les corridors. À partir de ce moment, sur ma foi, sur mon âme, sur mon honneur, je ne me connais plus ! L’éblouissante pensée que j’ai enfin pris la balle au bond, et que ma dette envers le plus cher de mes amis peut être déjà considérée comme payée, me monte à la tête et m’enivre… – Comment je tire les jeunes misses et moi-même de nos régions infernales : comment je dépêche ensuite mes autres affaires ; comment j’avale, sans trop m’en douter, mon petit repas du soir, un habitant de la lune vous le dira aussi bien que moi. L’important, c’est que me voici, ayant en main la note du négociant de conséquence, le cœur plein de vie, chaud comme le feu, plus heureux qu’un roi !… Ah ! ah ! ah ! « Right-right-right-all-right ! »
Ici, le professeur brandit sur sa tête le mémorandum dont il venait de parler, et termina son long et rapide récit par un de ces « cheers » anglais que parodiait si plaisamment son « soprano » d’Italie.
Ma mère, dès qu’il eut fini, se leva, les joues animées et les yeux brillants, elle saisit chaleureusement les deux mains du petit homme.
– Cher et bon Pesca, lui dit-elle, je n’ai jamais douté de votre sincère affection pour Walter, mais j’en suis maintenant plus persuadée que jamais.
– Il est certain que, pour le compte de Walter, nous sommes très obligés au professeur Pesca, crut devoir ajouter Sarah, et tout en parlant ainsi, elle se levait à demi, comme pour s’approcher à son tour du fauteuil qui avait servi de tribune ; mais remarquant que Pesca, dans son extase, baisait les mains de ma mère, elle prit un air sérieux et se rassit :
– Puisque ce petit homme si familier traite ainsi ma mère, que me fera-t-il donc « à moi ? »
La vérité se lit quelquefois sur les visages ; et sans nul doute, telle était la pensée de Sarah quand elle retomba sur son siège.
Bien que touché des sentiments qui avaient dicté la conduite de Pesca, je n’éprouvais pas, devant la perspective maintenant ouverte devant moi, le plaisir qu’elle eût dû me procurer. Aussi, quand le professeur en eût fini avec les mains de ma mère, et lorsque je l’eus chaudement remercié de son intervention en ma faveur, je demandai qu’on me permît de jeter un coup d’œil sur la note que son respectable patron avait dressée pour m’être soumise.
Pesca me tendit le papier, non sans un geste de main tout à fait triomphal.
– Lisez !… dit le petit homme avec majesté ; l’écrit du papa cousu d’or s’explique, je vous le garantis, avec la clarté de cent trompettes…
Les conditions, effectivement, étaient exposées d’une manière nette, précise, intelligible. La note m’informait :
« Premièrement. » – Que Frederick Fairlie, Esq. de Limmeridge-House, Cumberland, désirait s’assurer les services d’un professeur de dessin, versé dans son art, pour une période de quatre mois, garantie de part et d’autre.
« Secondement. » – Que ce professeur aurait à remplir une double mission. Il surveillerait les progrès de deux jeunes dames dans l’art de peindre à l’aquarelle ; il consacrerait ensuite les heures de loisir que lui laisserait le temps pris par les leçons, à réparer et classer une précieuse collection de dessins qu’on avait laissée, depuis longtemps, dans un complet abandon.
« Troisièmement. » – Que le salaire offert à la personne disposée à se charger de ces soins, et capable de les remplir convenablement, serait de quatre guinées par semaine ; qu’elle résiderait à Limmeridge-House ; et qu’elle y serait traitée sur le pied d’un « gentleman. »
« Quatrièmement, » et enfin. – Que personne ne devait songer à se proposer pour cet emploi sans pouvoir fournir les meilleurs et les plus sûrs témoignages, sous le double rapport du talent et de la moralité. Les preuves fournies seraient contrôlées par l’ami que M. Fairlie avait à Londres, et auquel tous pouvoirs étaient donnés pour conclure les arrangements nécessaires. Ces instructions étaient suivies du nom et de l’adresse de ce négociant de Portland-Place, chez lequel Pesca professait l’italien ; – et c’est ainsi que finissait la note ou « mémorandum. »
L’engagement qui m’était ainsi offert avait, certes, ses côtés attrayants. Selon toute apparence, mon emploi serait à la fois facile et agréable ; on me le proposait en automne, c’est-à-dire à ce moment de l’année où j’avais le moins d’occupations ; le salaire, si j’en jugeais par mon expérience personnelle, était d’une libéralité surprenante. Je me disais tout ceci, je sentais que je devais m’estimer heureux si je parvenais à m’assurer cette mission de confiance, – et pourtant, à peine avais-je lu le « mémorandum, » que je sentis en moi une inexplicable répugnance à faire un pas de plus dans cette voie. Jamais, à aucune époque de mon passé professionnel, je n’avais vu mon devoir et mes penchants se mettre en lutte d’une manière aussi pénible et aussi difficile à expliquer.
– Oh ! Walter, votre père n’a jamais eu pareille chance ! me dit ma mère en me rendant la note qu’elle venait de parcourir à son tour.
– Se lier avec des gens si distingués ! fit remarquer Sarah, se redressant sur sa chaise, et se trouver avec eux, tout d’abord, dans de telles conditions d’égalité !…
– Sans doute, sans doute ; les conditions, à tous égards, sont assez séduisantes, répliquai-je avec impatience. Mais, avant d’envoyer mes « attestations », comme ils disent, je voudrais un peu réfléchir.
– Réfléchir ! s’écria ma mère. Y pensez-vous, mon enfant ?
– Réfléchir ! répéta ma sœur, faisant écho en de telles circonstances, voilà quelque chose de bizarre !
– Réfléchir ! s’écria le professeur, comme s’il eût fait sa partie dans un « canon… » Réfléchir à quoi ? répondez ! Ne vous plaigniez-vous pas dernièrement de votre santé ?… Ne réclamiez-vous pas à grands cris l’air de la campagne ? Eh bien ! voici dans votre main un papier qui vous offre, à pleine poitrine et pour quatre mois, ces brises rafraîchissantes dont un souffle, disiez-vous, suffirait pour vous ranimer. Est-ce vrai, cela ? voyons, répondez ! Puis, – vous avez besoin d’argent. Eh bien ! quatre belles guinées par semaine, n’est-ce donc rien ? « My-soul-bless-my-soul ! » qu’on « me » les donne seulement, – et mes bottes craqueront comme celles du papa cousu d’or, toutes fières d’être chaussées par un homme si puissamment riche. Quatre guinées chaque semaine, et, par-dessus le marché, la jolie compagnie de deux jeunes « misses ; » mieux encore votre lit, votre déjeuner, votre dîner, vos thés, vos « lunches, » vos amples rasades de bière écumante, tout ce dont vous vous gorgez, vous autres Anglais, tout cela pour rien ! – Oh ! Walter, mon cher bon ! – « deuce-what-the-deuce ! » – pour la première fois de ma vie vous m’abasourdissez, sur ma parole !…
Ni la surprise que, bien évidemment, ma conduite causait à ma mère, ni la fervente énumération que Pesca venait de consacrer aux avantages de mon futur emploi, ne purent en rien ébranler la répugnance déraisonnable que me causait l’idée d’aller à Limmeridge-House. Quand j’eus mis en avant toutes les mesquines objections que je pus trouver contre le voyage du Cumberland, et quand, une à une, je les eus vu battre en brèche de la façon la plus victorieuse, j’essayai d’élever un dernier obstacle en demandant ce que deviendraient mes élèves de Londres, tandis que j’enseignerais aux jeunes pupilles de M. Fairlie le dessin d’après nature. On me répondit, avec raison, que le plus grand nombre d’entre eux allait me quitter pour les excursions d’automne ; ceux qui resteraient à Londres, en bien petit nombre, pourraient être confiés à un de mes confrères, auquel, en des circonstances identiques, j’avais rendu le même service que je réclamerais aujourd’hui de son obligeance. Ma sœur me rappela que ce jeune « gentleman » s’était mis expressément à ma disposition pour la saison actuelle, si j’avais fantaisie de quitter la ville. Ma mère me somma sérieusement de ne pas souffrir qu’un vain caprice se mît en travers de mes intérêts et des soins réclamés par mon état de santé ; Pesca, enfin, du ton le plus pathétique, me supplia de ne pas le blesser au cœur en repoussant le premier témoignage de reconnaissance qu’eût pu m’offrir l’ami dont j’avais sauvé la vie.
Ces remontrances, évidemment inspirées par l’affection la plus sincère, auraient influencé l’homme le moins facile à émouvoir. Aussi, sans pouvoir dompter tout à fait mes perverses antipathies, je me trouvai assez vertueux pour en rougir de bon cœur, et je cédai finalement à tout ce qu’on demandait de moi.
Le reste de la soirée fut assez gaiement consacré à mille plaisanteries sur la vie que j’allais mener avec les deux « ladies » du Cumberland. Pesca, que notre « grog » national mettait en verve, revendiqua ses lettres de grande naturalisation comme Anglais, en entassant rapidement une longue série de « speeches : » tantôt proposant la santé de ma mère, tantôt la santé de ma sœur, ma propre santé, les santés, en masse, de M. Fairlie et des deux jeunes « misses ; » puis, avec émotion, il se remercia lui-même, immédiatement, au nom de toutes les personnes qu’il avait honorées de ces « toasts ».
– Un secret, Walter, me dit à l’oreille mon petit ami, quand nous nous en retournions ensemble, bras dessus bras dessous. En songeant à quel point je me suis vu éloquent, je sens l’ambition déborder dans mon âme. Un de ces jours, vous me verrez faire partie de votre illustre Chambre des communes… « Honourable » Pesca, M. P !…
Le lendemain matin, j’envoyai au patron du professeur, dans Portland-Place, les attestations écrites qu’il avait réclamées. Trois jours s’écoulèrent sans que j’entendisse parler de quoi que ce fût, et j’en conclus, avec une secrète satisfaction, que mes preuves n’avaient point semblé assez catégoriques. Le quatrième jour, cependant, une réponse arriva. Elle annonçait que mes services étaient acceptés par M. Fairlie, et me mettait en demeure de partir immédiatement pour le Cumberland. Le « post-scriptum » renfermait, dans le plus grand détail, les instructions nécessaires au voyage que j’allais entreprendre.
Je m’arrangeai, toujours un peu à contrecœur, pour quitter Londres le lendemain de bonne heure. Dans l’après-midi, Pesca, se rendant à un dîner, passa chez moi pour me dire adieu.
– Ce qui, en votre absence, séchera mes pleurs, disait le professeur d’un ton gai, c’est la pensée que ma main, cette main providentielle, a donné la première impulsion à votre fortune en ce bas-monde… Allez, mon ami !… vous connaissez le proverbe anglais… « Dans le Cumberland, on profite du soleil pour faire ses foins… « Au nom du ciel, ne l’oubliez pas ! »… Épousez une des deux jeunes « misses ; » devenez « l’honourable » Hartright, M. P., et quand vous serez au sommet de l’échelle, souvenez-vous que Pesca, resté en bas, a réalisé pour vous ce beau rêve…
Je tâchai de rire avec mon petit ami de cette plaisanterie qui assaisonnait ses adieux ; mais, bien malgré moi, je ne pouvais m’égayer. Je ne sais quelle pénible émotion balançait chez moi l’effet discordant de ses légères paroles.
Lorsque je me retrouvai seul, il ne me restait plus qu’à partir pour le « cottage » de Hampstead, où je devais dire adieu à ma mère et à Sarah.
La chaleur, tout le jour, avait été presque écrasante ; la soirée, maintenant, était encore lourde et sans air. Ma mère et ma sœur m’avaient tant de lois répété leurs derniers conseils, et tant de fois supplié « d’attendre encore cinq minutes, » qu’il était près de minuit quand la domestique ferma derrière moi la porte du jardin. Je fis quelques pas sur la route qui me ramenait à Londres ; puis, pris d’hésitation, je m’arrêtai.
La lune, pleine et large, brillait dans l’azur profond d’un ciel sans étoiles, et le sol inégal des bruyères prenait, sous ses lueurs mystérieuses, un aspect assez sauvage pour qu’on se pût croire bien loin de la grande ville couchée pourtant au pied de ces coteaux déserts. L’idée de me replonger, plus tôt qu’il ne le fallait absolument, au sein de l’étouffante obscurité que j’allais retrouver à Londres n’avait pour moi aucun attrait. M’aller mettre au lit dans ma petite chambre privée d’air, ou bien me soumettre à quelque procédé de suffocation graduelle, me semblait, agité comme je l’étais de corps et d’âme, une seule et même chose. Je résolus de retourner en flânant, et par le plus long chemin que je pourrais prendre, vers mon odieux domicile ; de suivre à loisir les sentiers sinueux que je voyais se dessiner en blanc parmi les bruyères désertes, et de rentrer à Londres par son faubourg le moins encombré, en prenant d’abord Finchley-Road, pour me retrouver ensuite, aux fraîcheurs matinales, dans le voisinage de Regent’s Park.
Je cheminai donc lentement, absorbé dans le calme divin du tableau qui m’était offert, et admirant les douces alternatives de lumière et d’ombre que, de tous côtés, les flexions du sol inégal multipliaient sous mes yeux. Aussi longtemps que dura ce charmant début de ma promenade nocturne, mon âme s’abandonna, presque passive, aux impressions que ces grands aspects produisaient en elle ; c’est à peine si je pensais à quoi que ce fût ; – mes pensées, du moins, semblaient s’effacer sous l’énergie de mes sensations.
Mais quand j’eus quitté les bruyères et pris le chemin de traverses où mes yeux trouvaient beaucoup moins de pâture, les idées que me suggérait naturellement la modification prochaine de mes habitudes et de mes travaux, reprirent de plus en plus leurs droits à mon attention exclusive. Lorsque j’arrivai à l’extrémité du chemin, j’étais de nouveau complètement perdu dans les fantasques évocations qui me montraient tour à tour Limmeridge-House, M. Fairlie, et les deux jeunes personnes dont j’allais former le talent d’aquarellistes.
Je me trouvais maintenant parvenu à ce point spécial de mon trajet où quatre chemins se rencontrent : – celui de Hampstead par lequel je m’en revenais ; celui qui mène à Finchley ; celui qui court dans la direction du West-End ; enfin, celui qui ramène à Londres. J’avais machinalement pris cette dernière direction, et marchais lentement le long du grand chemin solitaire, – perdu, je m’en souviens, dans de vaines conjectures sur le genre de beauté de ces jeunes « ladies » du Cumberland, – lorsque, en une seconde, tout le sang de mes veines s’arrêta brusquement au contact léger et soudain d’une main qui, par derrière, se posait sur mon épaule.
À l’instant même, je me retournai, les doigts crispés autour de la poignée de ma canne.
Là, au milieu de cette grande route, large et lumineuse, – là, comme si elle venait de jaillir de terre ou de tomber du ciel, – se tenait, debout, une femme, seule, et, de la tête aux pieds, vêtue de blanc ; sa figure, penchée de mon côté, semblait m’adresser une question solennelle, et, au moment où je me retournai, sa main s’étendit vers le nuage noir qui planait sur Londres.
J’étais trop saisi par la soudaineté de cette apparition extraordinaire, dans le silence de la nuit et en cet endroit isolé, pour lui adresser la moindre question. L’inconnue parla donc la première.
– Est-ce là le chemin de Londres ? dit-elle.
Je l’examinais avec attention pendant qu’elle me demandait cet étrange renseignement. Il était près d’une heure. Tout ce que je pouvais discerner au clair de lune était une figure jeune, sans fraîcheur, aux contours effilés ; de grands yeux sérieux, exprimant par leur fixité une attention extraordinaire ; des lèvres frémissantes, aux mouvements indécis ; et des cheveux blonds, d’une nuance vague, entre le fauve et le brun. Il n’y avait dans ses façons rien d’égaré, rien d’immodeste : elles étaient paisibles et contenues, un peu mélancoliques peut-être et légèrement soupçonneuses : ce n’étaient pas exactement celles d’une « lady ; » d’un autre côté, ce n’étaient pas celles d’une femme appartenant à la caste inférieure. La voix, si peu que je l’eusse entendue, m’avait frappé par ses accents singulièrement calmes, et, pour ainsi dire, mécaniques ; le débit était d’une rapidité remarquable. Cette femme tenait dans sa main un petit sac ; et son costume – chapeau blanc, châle blanc, robe blanche, – n’était certainement pas, pour autant que je pusse conjecturer, taillé dans des étoffes très fines ou très coûteuses. Sa taille était mince et un peu au-dessus de la moyenne ; sa tenue et ses gestes étaient exempts de tout ce qui eût pu la rendre suspecte. Voilà tout ce qu’il me fut donné de remarquer à la clarté douteuse qui nous entourait, et dans l’état de perplexité où m’avait jeté cette rencontre bizarre. Ce que pouvait être cette femme, et par quel hasard elle se trouvait sur la grande route à une heure après minuit, autant d’énigmes insolubles pour moi. La seule chose dont je me sentisse bien assuré, c’est que le mortel le plus grossier n’eût pu se méprendre sur les motifs qu’elle pouvait avoir de s’adresser à lui ; – même à cette heure suspecte, même dans cet endroit désert.
– M’avez-vous entendue ? reprit-elle avec son débit calme et rapide, et sans la moindre nuance de mécontentement ou d’inquiétude. Je vous ai demandé si c’était là le chemin de Londres.
– Oui, répondis-je, c’est là le chemin : il conduit à Saint-John’s Wood et à Regent’s Park. Veuillez m’excuser de ne vous avoir pas répondu plus tôt. J’étais un peu troublé de votre soudaine apparition sur la route, et, même à présent, je ne puis encore m’en rendre bien compte.
– Vous ne me soupçonnez d’aucun méfait, n’est-ce pas ?… Je n’ai rien fait de mal… Un accident m’est arrivé… Je suis fort à plaindre de me trouver ici, à pareille heure, et toute seule… Pourquoi me soupçonneriez-vous d’avoir fait le mal ?
Elle s’exprimait avec une ardeur, une agitation hors de propos, s’écartait de moi tout en parlant. Je fis, pour la rassurer, tout mon possible.
– Ne supposez pas, je vous prie, que j’incline le moins du monde à vous soupçonner, lui dis-je ; mon seul désir est de vous être utile, si je le puis ; je m’étonnais seulement de votre apparition sur la route, parce que, l’instant d’avant, il me semblait n’y avoir vu personne…
Se détournant, elle me montra, au point de jonction des deux chemins de Londres et de Hampslead, un endroit où la haie était rompue.
– Je vous ai entendu venir, me dit-elle, et je me suis cachée là pour savoir à quel homme j’avais affaire avant de me risquer à parler. Mes doutes et mes craintes duraient encore quand vous êtes passé, ce qui m’a réduite à me glisser sur vos traces et à vous toucher le bras…
Se glisser après moi et me toucher… Pourquoi ne m’appeler point ? Chose étrange, à tout le moins.
– Puis-je me fier à vous ? demanda-t-elle. Vous ne me jugerez point mal, parce qu’un accident m’est arrivé…
Confuse, elle s’arrêta ; d’une main, son sac passait dans l’autre ; elle poussait des soupirs pleins d’amertume. L’isolement de cette femme, dénuée de tout appui, m’alla au cœur. L’élan naturel qui me poussait à la secourir, à la protéger, l’emporta bientôt sur les froids conseils de la prudence mondaine que, dans de si étranges circonstances, un homme plus âgé, plus sage, plus réfléchi aurait uniquement consultée.
– Pour tout dessein légitime, lui dis-je, vous pouvez vous fier à moi. S’il vous est pénible de m’expliquer votre singulière situation, ne revenons plus sur ce sujet. Je n’ai le droit de vous demander aucun éclaircissement. Dites-moi comment je puis vous aider ; ce qui dépendra de moi, je le ferai.
– Vous êtes bien bon, et je suis bien heureuse de vous avoir rencontré…
En prononçant ces paroles, sa voix tremblait légèrement, et j’y retrouvai, pour la première fois, quelques nuances de ces accents féminins qui trouvent si aisément un écho dans tous les cœurs, mais il n’y avait pas une larme dans ces grands yeux, fixement attentifs, qu’elle tenait arrêtés sur moi.
– C’est la seconde fois seulement que je viens à Londres, continua-t-elle, parlant de plus en plus vite, et ce côté de la ville m’est tout à fait inconnu. Puis-je me procurer un cabriolet, une voiture, n’importe laquelle ? Est-il trop tard ? Je ne sais. Si vous pouviez me conduire jusqu’à un cabriolet, – me promettre tout simplement de ne pas vous mêler de mes affaires, et me laisser vous quitter où et quand il me plaira ; – j’ai une amie à Londres qui sera charmée de me recevoir ; c’est là tout ce qu’il me faut. – Voudrez-vous me faire cette promesse ?…
Elle regardait avec inquiétude, parlant ainsi, le chemin qu’elle avait suivi et celui qu’elle allait parcourir ; son sac, de plus belle, passait d’une de ses mains dans l’autre : elle répétait ces mois : Promettez-vous ?… et me regardait en face, obstinément, avec une crainte suppliante et une confusion qui faisaient mal à voir.
Que faire ? J’avais là, complètement à ma merci, une personne inconnue, – cette inconnue était une femme sans ressources et sans protection. Pas une maison dans le voisinage, pas un passant à qui je pusse demander conseil ; d’autre part, je ne me connaissais pas au monde un seul droit qui m’investit sur elle d’un contrôle quelconque, alors même que j’aurais su comment exercer ce contrôle. Les évènements survenus depuis projettent leur ombre sur le papier même où je trace ces lignes, et ils m’ont appris à me méfier de moi. Cependant, dirai-je encore, que faire en pareille passe ?
Je ne me charge pas de l’apprendre à ceux qui ne le savent point, mais voici ce que je fis. Je lâchai, par quelques questions, de gagner du temps.
– Êtes-vous bien sûre que votre amie de Londres voudra vous recueillir à cette heure indue ?
– Parfaitement sûre. Dites simplement que vous me laisserez vous quitter où et quand il me plaira ; dites que vous ne vous mêlerez pas, malgré moi, de ce qui me concerne !… Voulez-vous me promettre cela ?… Et comme, pour la troisième fois, elle répétait ces paroles, elle se rapprocha de moi et posa sa main sur ma poitrine, tout à coup, avec un geste à la fois doux et furtif. – Main frêle, main glacée (je la sentis en l’écartant), même en cette nuit brûlante. N’oubliez pas que j’étais jeune ; n’oubliez pas que cette main, posée si près de mon cœur, était celle d’une femme.
– Promettez-vous ?
– Oui…
Une parole bien simple ! Ce mot familier qui passe, à chaque heure du jour, sur les lèvres de tout le monde. Et pourtant, mon Dieu ! je tremble maintenant, rien qu’à le voir écrit devant moi…
Nous nous dirigeâmes vers Londres, et, à cette heure paisible, la première du jour nouveau, – nous marchâmes côte à côte, moi et cette femme dont le nom, le passé, le caractère, les projets, dont la présence même à mes côtés, en ce moment, étaient pour moi autant de mystères impénétrables. Il me semblait rêver. Étais-je bien Walter Hartright ? Cette route, était-ce bien la même, si « passante », si vulgairement hantée, où, les dimanches, viennent bayer les bourgeois en fête ? Était-il bien vrai qu’une heure auparavant je venais de quitter la paisible et décente atmosphère du « cottage » maternel ? J’étais, en vérité, trop étonné de moi-même, – et trop dominé par un sentiment de vague remords, – pour oser, pendant les premières minutes, adresser la parole à mon étrange compagne. Ce fut elle encore qui, la première, rompit le silence.
– J’ai une question à vous faire, dit-elle tout à coup : connaissez-vous, à Londres, beaucoup de monde ?
– Oui, beaucoup.
– Beaucoup de nobles ?… beaucoup de gens titrés ?…
Cette question bizarre était évidemment dictée par je ne sais quel soupçon. J’hésitai avant d’y répondre.
– Quelques-uns, dis-je, après un instant de silence.
– Beaucoup ?… – Elle suspendit ici sa phrase et promena sur mon visage un regard scrutateur. – Beaucoup de gens ayant le rang de « baronet ?… »
Trop étonné pour répondre, je la questionnai à mon tour.
– Pourquoi me demandez-vous ceci ?
– Parce que, dans mon intérêt, j’espère qu’un certain « baronet » vous est inconnu.
– Voulez-vous me dire son nom ?
– Je ne puis… Je n’ose… Je ne m’appartiens plus, quand je le prononce.
– En ce moment, elle parlait haut et presque sur le ton de la menace, levant vers le ciel sa main fermée et l’agitant par un geste passionne ; puis, subitement, elle sembla reprendre possession d’elle-même, et réfrénant les éclats de sa voix, elle ajouta presque bas :
– Nommez-moi tous ceux que vous connaissez !
Je ne pouvais guère me refuser à une curiosité si insignifiante, et je lui livrai trois noms. Les deux premiers étaient ceux de deux chefs de famille dont j’avais les filles pour élèves ; le troisième, celui d’un jeune célibataire qui naguère m’avait emmené à bord de son yacht pour me faire faire quelques esquisses.
– Ah ! dit-elle avec un soupir de soulagement, vous ne le connaissez pas… Vous-même, êtes-vous noble ?… êtes-vous titré ?
– Il s’en faut… Je ne suis qu’un pauvre professeur de dessin.
Au moment où mes lèvres articulaient cette réponse, peut-être avec quelque amertume, elle prit mon bras, par une de ces brusques inspirations qui lui étaient propres.
– Il n’est pas noble !… pas titré ! se redisait-elle. Dieu soit loué ! je puis me fier à lui…
J’étais parvenu jusqu’ici, par considération pour ma compagne, à maîtriser ma curiosité ; mais, cette fois, je n’y tins plus.
– Je crains que vous n’ayez de graves motifs de plainte contre quelque personnage noble et titré, lui dis-je. Je crains que ce « baronet, » dont vous ne voulez pas me révéler le nom, n’ait eu envers vous quelques torts graves. Serait-ce lui, par hasard, qui vous oblige à vous trouver ici, la nuit, dans un si grand embarras ?
– Ne me faites pas de question ! ne me forcez point à parler de ceci ! répondit-elle. Je ne suis pas encore en état… J’ai été cruellement traitée, trompée cruellement…
Vous mettrez le comble à vos bontés, si vous vouliez marcher un peu plus vite et ne plus m’adresser la parole… Ce qui m’importe, maintenant, c’est de me calmer, si toutefois je le puis…
Nous doublâmes donc le pas, et pendant une demi-heure, tout au moins, pas une parole ne fut échangée entre nous. De temps en temps, toute autre question m’étant interdite, j’interrogeais son visage par quelques regards jetés à la dérobée. Il n’avait pas changé d’expression : les lèvres étaient toujours serrées fortement l’une contre l’autre ; le front avait gardé ses plis attristés, le regard, à la fois ardent et vague, se portait toujours droit en avant. Nous avions gagné les premières maisons du faubourg et nous approchions du nouveau collège Wesleyen, quand ses traits rigides se détendirent un peu, et alors elle reprit d’elle-même la conversation interrompue.
– Habitez-vous Londres ? dit-elle.
– Oui, répondis-je, et au même moment, l’idée me vint qu’elle pouvait avoir formé le projet de recourir à moi pour quelque assistance ou quelques conseils ; il fallait, en ce cas, lui épargner un désappointement possible, en l’avertissant que j’allais sous peu m’absenter de chez moi. Aussi ajoutai-je immédiatement : – Demain, par exemple, je quitterai Londres pour quelque temps. Je vais à la campagne.
– Où ? demanda-t-elle : au nord ou au midi ?
– Au nord ; dans le Cumberland.
– Le Cumberland !… répéta-t-elle avec une sorte d’onction… Ah ! je voudrais bien y aller, moi aussi. J’ai passé dans le Cumberland de bien heureuses années…
J’essayai, une fois encore, de soulever le voile étendu entre cette femme et moi.
– Peut-être êtes-vous née, lui dis-je, dans la belle région des Lacs ?
– Non, répondit-elle, mon pays natal est le Hampshire ; mais autrefois, j’ai passé quelque temps dans une des écoles du Cumberland… Les Lacs, dites-vous ?… Je ne me souviens d’aucun lac. C’est le village de Limmeridge, c’est Limmeridge-House que j’aimerais à voir.
À mon tour, maintenant, de rester tout à coup sur place. Au moment où ma curiosité était poussée jusqu’au paroxysme, cette allusion fortuite au séjour habité par M. Fairlie, se rencontrant sur les lèvres de mon étrange compagne, venait me frapper comme un coup de massue.
– Est-ce que vous avez entendu crier après nous ? me demanda-t-elle, jetant ses regards dans toutes les directions, quand elle me vit faire halte.
– Non, non !… j’ai seulement été frappé par ce nom de Limmeridge-House. Il y a quelques jours à peine, certaines gens du Cumberland le mentionnaient devant moi.