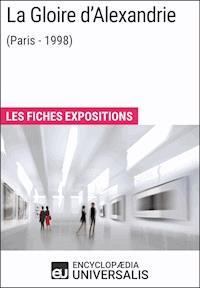
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
L'exposition La Gloire d'Alexandrie a mis, du 7 mai au 26 juillet 1998, Paris à l'heure de la métropole de l'Égypte gréco-romaine. Des objets spectaculaires, comme la statue colossale d'un roi Ptolémée, reconstituée à partir d'éléments trouvés dans les fouilles sous-marines du phare, ou...
À PROPOS DE L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 33
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341009584
© Encyclopædia Universalis France, 2016. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Bluraz/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Les grandes expositions sont l’occasion de faire le point sur l’œuvre d’un artiste, sur une démarche esthétique ou sur un moment-clé de l’histoire des cultures. Elles attirent un large public et marquent de leur empreinte l’histoire de la réception des œuvres d’art.
Sur le modèle des fiches de lecture, les fiches exposition d’Encyclopaedia Universalis associent un compte rendu de l’événement avec un article de fond sur le thème central de chaque exposition retenue : - pour connaître et comprendre les œuvres et leur contexte, les apprécier plus finement et pouvoir en parler en connaissance de cause ; - pour se faire son propre jugement sous la conduite de guides à la compétence incontestée.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
La Gloire d’Alexandrie (Paris - 1998)
L’exposition La Gloire d’Alexandrie a mis, du 7 mai au 26 juillet 1998, Paris à l’heure de la métropole de l’Égypte gréco-romaine. Des objets spectaculaires, comme la statue colossale d’un roi Ptolémée, reconstituée à partir d’éléments trouvés dans les fouilles sous-marines du phare, ou la mosaïque du « chien penaud », qui ornait sans doute une salle de banquet des palais royaux et que les travaux pour la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie ont permis de redécouvrir, rythmaient un ensemble très varié. La juxtaposition, parfois la fusion d’éléments grecs et égyptiens, tantôt mises en valeur par un art d’une facture très sûre, tantôt animées par la foi d’un artisanat populaire, ont fait le charme d’objets bien éclairés, les salles baignant dans la pénombre que l’on attribue aux temples pharaoniques.
Par-delà le plaisir de la visite, l’exposition est venue à un moment où le développement des recherches amène à regarder l’alexandrinisme d’un nouvel œil. Alexandrie avait tous les atouts pour être un des grands sites où le XIXe siècle a redécouvert l’Antiquité. Le déclin de la ville à la fin du Moyen Âge et surtout la décision de ses maîtres turcs de l’installer sur l’isthme qui s’est construit petit à petit à partir de la chaussée unissant l’île de Pharos à la terre ferme, laissaient d’innombrables vestiges appartenant aussi bien à la ville d’Alexandre qu’à celle des premiers patriarches chrétiens. L’opération la plus importante avait été, au XVe siècle, la construction, au-dessus des soubassements du phare ruiné par les tremblements de terre, d’un fort par le sultan mameluk Qaïtbay. Les savants de l’expédition de Bonaparte sont donc en 1798 les témoins d’un monde prêt à resurgir. Cela ne se fit pas, parce que l’Égypte pharaonique eut la priorité et surtout parce que le prodigieux essor de la ville cosmopolite du XIXe siècle le recouvrit et le détruisit en partie. Dès lors, il n’était plus guère possible que de dresser le plan des rues antiques et de sauvegarder quelques nécropoles. Le musée gréco-romain, aménagé au début du XXe siècle, accumulait des collections aussi riches qu’hétéroclites dans une ville dont l’Antiquité avait été bannie.
Le renouveau vint de l’évolution de l’enquête archéologique, de plus en plus méthodique et ample, de la volonté des autorités égyptiennes désireuses de susciter un mouvement touristique, et d’initiatives individuelles, au premier chef, celle de Jean-Yves Empereur, commissaire de l’exposition, qui consacre ses efforts à fouiller le phare et des maisons antiques, là où c’est possible, c’est-à-dire là où des constructions modernes légères, sans fondation, sont détruites pour laisser la place à des grands immeubles, qui détruiront irrémédiablement les niveaux antiques du sous-sol. Le fouilleur doit intervenir entre les deux phases, recueillir ce qui peut l’être, reconnaître, photographier, dessiner le reste.





























