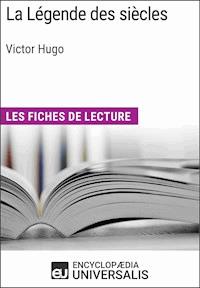
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
« Ego Hugo » : la célèbre devise ne pouvait mieux convenir qu’à l’auteur de
La Légende des siècles, œuvre « cathédrale » s’il en fut, entreprise prométhéenne et sublime poème de l’humanité pour les uns, sommet de l’emphase mégalomaniaque et du mauvais goût pour les autres, livre unique en tout cas, sans précédent ni descendance, connu de tous pour quelques vers, voire quelques textes, récités par des générations d’écoliers (« La Conscience », « Booz endormi », « Les Pauvres Gens », « Après la bataille », « Le Crapaud »...), et ignoré par pans entiers, réputés illisibles.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur La Légende des siècles de Victor Hugo
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852294349
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Monticello/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici La Légende des siècles, Victor Hugo (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LA LÉGENDE DES SIÈCLES, Victor Hugo (Fiche de lecture)
« Ego Hugo » : la célèbre devise ne pouvait mieux convenir qu’à l’auteur de La Légende des siècles, œuvre « cathédrale » s’il en fut, entreprise prométhéenne et sublime poème de l’humanité pour les uns, sommet de l’emphase mégalomaniaque et du mauvais goût pour les autres, livre unique en tout cas, sans précédent ni descendance, connu de tous pour quelques vers, voire quelques textes, récités par des générations d’écoliers (« La Conscience », « Booz endormi », « Les Pauvres Gens », « Après la bataille », « Le Crapaud »...), et ignoré par pans entiers, réputés illisibles.
• Un monument composite
Ce livre « total », étrange et monstrueux, a pourtant une histoire. La Légende des siècles s’est écrite sur une vingtaine d’années, et a connu trois états de publication. La première « série », en 1859 (Hugo est alors en exil), porte encore en sous-titre « Les Petites Épopées », titre plus modeste envisagé d’abord. En 1877 (le poète est rentré triomphalement en France en 1870), la deuxième série accentue l’orientation philosophique du recueil. Enfin, en 1883 (Hugo mourra deux ans plus tard), une dernière série ajoute quelques pièces, avant que l’édition définitive ne refonde l’ensemble en un ouvrage monumental, somme toute assez peu structuré, dont les différentes strates correspondent à des moments particuliers et de l’histoire du XIXe siècle, et de la biographie de l’auteur.
Ainsi assemblé, le recueil se compose de soixante et un chapitres. Après un poème liminaire, « La vision d’où est sorti ce livre », écrit dès 1857 mais ajouté seulement à la deuxième série, et un hymne à la Terre, est retracée l’histoire de l’Humanité, depuis la faute originelle (« D’Ève à Jésus ») jusqu’à la rédemption future (« Hors des temps »). Aux récits bibliques, qui inspirent quelques-unes des pièces les plus célèbres (« La Conscience », « Booz endormi »), succèdent la mythologie et l’histoire gréco-romaine, cette dernière à peine effleurée. En revanche, Hugo, en bon romantique, consacre aux temps troublés du Moyen Âge pas moins de douze chapitres. La Renaissance est surtout illustrée par un long poème, « Le Satyre », synthèse de la doctrine philosophique et esthétique de l’auteur. Après l’intermède des « Idylles », qui ressuscitent vingt-deux grandes figures littéraires, d’Orphée à Chénier, viennent les « Temps présents » : Révolution, guerres napoléoniennes, hommage au peuple. Enfin, le recueil s’achève sur la promesse d’un avenir radieux (« Vingtième Siècle », « Hors des temps »).
Encore convient-il d’ajouter, pour mieux saisir l’ampleur de l’ambition hugolienne, que La Légende des siècles était, dès l’origine, indissociable de deux autres ouvrages destinés à former avec elle un vaste tryptique, et que l’écrivain n’achèvera jamais : La Fin de Satan et Dieu.
• L’épopée humaine écroulée
On tient généralement La Légende des siècles pour une épopée. Or, s’il y a bien dans le recueil un souffle, une tonalité épiques, la possibilité même d’une épopée moderne s’avère, aux yeux de Hugo, problématique : « Ce livre, c’est le reste effrayant de Babel/ C’est la lugubre Tour des Choses, l’édifice/ Du bien, du mal, des pleurs, du deuil, du sacrifice,/ Fier jadis, dominant les lointains horizons,/ Aujourd’hui n’ayant plus que de hideux tronçons,/ Épars, couchés, perdus dans l’obscure vallée ;/ C’est l’épopée humaine, âpre, immense – écroulée. » (« La vision d’où est sorti ce livre »).
En lisant ces vers, on comprend mieux le titre initial, « Les Petites Épopées », sorte d’oxymore (comment une épopée peut-elle être petite ?) qui dit assez que l’œuvre ne saurait être, à l’image d’une histoire fragmentée, atomisée (« Au lieu d’un continent c’était un archipel »), qu’une juxtaposition de récits, sans véritable architecture. « Épopée humaine », La Légende des siècles sera donc aussi une épopée « écroulée » !
Ces 61 chapitres offrent pourtant une unité et un sens, à la fois politique, religieux, et philosophique. Le Victor Hugo de 1859, converti à l’idéal républicain, joint désormais sa voix à celle des prophètes du Progrès. À travers l’évocation de l’éternel combat du Bien et du Mal (avec son cortège d’antithèses chères au poète : liberté/servitude, lumière/ténèbres, faibles/puissants...), lutte à la fois cosmique, mythique et proprement humaine, se dégage en effet la vision messianique d’une humanité bientôt délivrée de ses liens, et délivrée par sa part la plus humble : « les petits », « les pauvres gens ». La Légende des siècles devient alors une sorte d’Apocalypse, annonçant, après le combat final avec le démon – ici, la tyrannie –, l’éternelle félicité. Une apocalypse dont le saint Jean serait Hugo lui-même, poète-prophète, poète-mage, poète-voyant (« J’eus un rêve : le mur des siècles m’apparut »), qui va puiser aux sources les plus diverses, et mobiliser les registres littéraires les plus variés pour peindre cette fresque gigantesque. Le paradoxe d’une somme éclatée se retrouve alors dans l’écriture hugolienne : si la poésie de La Légende des siècles est bien une « poésie totale », c’est précisément dans la mesure où elle est monstrueuse et protéiforme, tour à tour épique, lyrique, satirique. C’est aussi pourquoi nulle part peut-être plus qu’ici le vers hugolien n’a trouvé à donner la mesure de sa richesse, de sa souplesse et de sa variété.
Guy BELZANE
Études
P. ALBOUY, La Création mythologique chez Victor Hugo, José Corti, Paris, 1963P. LAFORGUE, Victor Hugo et « La Légende des siècles », coll. Modernités, Paradigme, Orléans, 1997C. MILLET, Victor Hugo : « La Légende des siècles », coll. Études littéraires, P.U.F., Paris, 1995J. SEEBACHER & A. UBERSFELD dir., Hugo le fabuleux, actes du colloque de Cerisy-la-Salle, Seghers, Paris, 1985.HUGO VICTOR (1802-1885)
Roman, critique, voyages, histoire dialoguent dans l’œuvre de Victor Hugo avec le lyrisme, l’épopée, le théâtre en un ensemble dont le « poète » a souvent proposé des articulations historiques, géographiques ou idéologiques plutôt qu’une périodisation. En règle générale, l’œuvre en prose a pour fonction de recueillir les éléments les plus secrets de l’œuvre poétique, de les composer en architectures prospectives ; plus neuve et plus audacieuse ainsi, elle peut servir de préface à toute la création hugolienne. Elle se distribue pourtant en trois masses : la mort de Léopoldine, en 1843, entre l’Académie (1841) et la Chambre des pairs (1845), marque une première rupture ; vers 1866-1868, c’est le tournant proprement historique et politique. Chacune de ces masses est caractérisée par la présence de romans ou quasi-romans (Han d’Islande, Bug-Jargal, Le Dernier Jour d’un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, pour la première ; Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, pour la deuxième ; L’Homme qui rit et Quatrevingt-Treize, pour la troisième), de textes mêlés d’histoire, de politique et de voyages (pour l’essentiel, respectivement : Le Rhin ; Choses vues et Paris ; Actes et Paroles et Histoire d’un crime) et enfin d’essais critiques, qui se fondent avec l’histoire militante dans la troisième période, en une vue rétrospective qu’annonçaient déjà Littérature et philosophie mêlées dans la première période et la somme du William Shakespeare dans la deuxième. La poétique de l’œuvre en prose s’inscrit donc dans un espace à quatre dimensions : le romanesque, le voyage, la politique, la réflexion critique sur le génie. À côté de l’évolution biographique et historique, c’est le William Shakespeare qui forme le centre de gravité du colosse. Poète usé par l’école de la IIIe République et la pratique des morceaux choisis, dramaturge qu’on croit mort avec le théâtre romantique en 1843 (échec des Burgraves





























