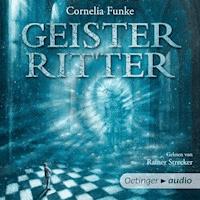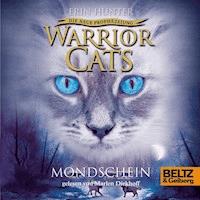Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Léger Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
L’actualité récente manifeste que la liberté d’enseignement est un problème en France: polémiques concernant un ministre de l’éducation et le collège Stanislas, financement des établissements sous contrat, interdiction de l’école à la maison, multiples obstacles pour les établissements indépendants en sont autant de signes.
Le contrat d’association (loi Debré 1959) était censé mettre un terme à la guerre scolaire et assurer la liberté en la matière. Or depuis les années 2000 un nombre significatif d’établissements hors contrat ouvrent donnant une nouvelle actualité à la question.
Cet ouvrage explore les fondements historiques, philosophiques, théologiques et anthropologiques de ce sujet en donnant aussi la parole à ses acteurs majeurs; responsables de l’enseignement catholique, fondateurs d’établissements indépendants et associations les soutenant, associations familiales, enseignants.
La confrontation de l’étude des fondements du système scolaire français et des entretiens avec ces témoins, révèle que la contestation de l’état éducateur est à la source de la question de la liberté d’enseignement.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pierre-Henri Beugras, chef d'établissement honoraire de l'enseignement catholique, auteur essayiste. Docteur en sciences sociales mention sciences de l’éducation. Professeur de philosophie, chargé d’enseignement et intervenant à la Faculté d’éducation de l’Institut Catholique de Paris. Rédacteur en chef de la revue de Formation chrétienne Résurrection. Éducateur et enseignant dans un établissement hors contrat en début de carrière. Depuis quarante trois ans au sein de l’enseignement catholique comme enseignant en Philosophie, cadre éducatif, adjoint en pastoral scolaire et vingt et un an comme chef d’établissement.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 804
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Pierre-Henri Beugras
La liberté d’enseignementen France
Entre association et indépendance
Table of Contents
Couverture
Page de titre
Préface
Avertissement
Introduction
Liberté d’enseignement en France, entre association et indépendance
D’où vient cette question ?
Objet et contexte
À quoi sert l’école ?
Contestation de l’État éducateur comme contestation de l’idéologie dominante
Association et, ou, indépendance : neutralité de l’État ?
L’indépendance scolaire : empire de l’éphémère et atomisation sociale
Partie I
Fondements théoriques de la liberté d’enseignement en France
CHAPITRE I
Les sources du système scolaire français contemporain
Les origines
L’émergence d’un système scolaire
L’aube des temps modernes : les collèges
L’école française de spiritualité et la révolution lassallienne
La Révolution française entre enseignement et d’un système scolaire à l’autre
L’école, la nation française et l’universalisme
Les ferments de l’indépendance, de la guerre scolaire et de la revendication de la liberté d’enseignement
Des fondements des monopoles scolaires aux fondements de l’indépendance
Au cœur de la guerre scolaire, l’école nouvelle incarnation de la liberté d’enseignement
CHAPITRE II
La liberté d’enseignement et l’État éducateur : courants anthropologiques et politiques en jeux
Y a-t-il une anthropologie chrétienne ? Est-ce là le fondement de l’Enseignement catholique en France ?
De la faculté des chrétiens à agir autrement : l’exemple de la contre-réforme catholique et de l’école française de spiritualité, une évolution éducative humaniste et sociale
Rousseau, une anthropologie de l’innocence
Une anthropologie pour un homme nouveau, auteur par l’école d’une société nouvelle
Réponses anthropologiques de l’Église à la tourmente moderniste, l’école catholique école libre ?
Y a-t-il encore aujourd’hui une anthropologie dominante ? L’apparente défaite de la raison et ses conséquences
CHAPITRE III
Le contrat d’association : libertés, contraintes, crises et perspectives
Causes et fonctionnements d’une association
Les conditions du contrat
L’association et le caractère propre
Le tournant de 1984, l’échec du « grand Service Public Unifié et Laïque de l’Éducation Nationale » (SPULEN)
Les accords Lang-Cloupet (1992-1993) et la loi Censi (2005), titularisation et fracture
Le caractère propre et l’identité des établissements en question
Reprise : la liberté contre la massification ?
PARTIE II
Enquête et analyse d’entretiens
Introduction à l’enquête et entretiens semi-dirigés sur la liberté d’enseignement en France entre association ou indépendance
CHAPITRE I
Ce que disent des acteurs majeurs de l’enseignement indépendant hors contrat
Vision du système éducatif d’Anne Coffinier
Éric Mestrallet, et les écoles Espérance banlieue
CHAPITRE II
Analyses d’entretien
Paul Andréo
À quoi sert l’école ?
Pourquoi Saint John Perse plutôt qu’une autre école ?
Hiérarchie entre les structures à rôle éducatif : famille, école, structures religieuses. Quel rôle pour l’État en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner, qu’est-ce que transmettre ?
Le but de l’enseignement est-il l’émancipation ou l’unité sociale ? Dans quelle mesure ces deux éléments sont-ils compatibles ?
Qui a autorité pour déterminer ce qu’il faut transmettre ? L’autorité académique ? L’université ? Les chercheurs ? L’État ? L’autorité politique ?
Y a-t-il un avenir pour les établissements indépendants ?
Claire Coppin
À quoi sert l’école ?
Pourquoi votre école plutôt qu’une autre ?
L’école s’appelle Saint Tarcissius et Collège de la Trinité ; qu’est-ce que cet aspect catholique exprimé dans le nom a d’original par rapport à d’autres établissements catholiques ?
Quelle est la proportion de catholiques ?
Quelle hiérarchie faites-vous entre les différentes structures éducatives : famille, école, État, structures religieuses ?
Quel est selon vous, le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner, qu’est-ce que transmettre ? Quelle différence faites-vous entre les deux ?
L’enseignement a-t-il comme but l’émancipation des personnes ou l’unité sociale ? Dans quelle mesure les deux sont compatibles ?
Qui a autorité pour déterminer ce qu’il faut transmettre ? Autorité académique ? université, chercheurs ? Autorité politique ? Autre instance ?
Virginie Wallyn
Pourquoi aller dans ce futur établissement plutôt qu’un autre ?
Quelle hiérarchie faites-vous entre ces différentes structures éducatives : famille, école, État, structures religieuses ? Quel est, selon vous, le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Selon vous, qu’est-ce qu’enseigner, qu’est-ce que transmettre ? Quelle distinction faites-vous entre les deux ?
Selon vous, l’enseignement a-t-il comme but l’émancipation des personnes ou l’unité sociale ? Dans quelle mesure les deux sont-ils ou non compatibles ?
Qui a autorité pour déterminer ce qu’il faut transmettre ? L’autorité académique, l’université, les chercheurs, l’autorité politique ?
En guise de conclusion
Anne Coffinier
La conception de l’école d’Anne Coffinier
Les causes de l’émergence d’établissements indépendants selon Anne Coffinier
Les évolutions sociétales peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants ?
Quelle hiérarchie entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif éventuel : la famille – l’école – l’État – les structures religieuses ? Quel est le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner, qu’est-ce que transmettre, qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faire entre ces notions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux sont-ils, ou non, compatibles ou subordonnées l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement et comment transmettre ? l’autorité académique ? l’Université ? les sociétés savantes ? les chercheurs ? l’autorité politique ? une autre instance ?
Comment définir la liberté d’enseignement, son champ, ses limites ?
Quel système scolaire pour demain ?
Guy Berger
L’école catholique et son association avec l’État, l’innovation scolaire, le bien public et l’indépendance.
Le rôle de l’État dans l’éducation et l’enseignement ?
Valentin Rebeix
À quoi sert l’école ?
Comment définir la liberté d’enseigner, son champ et ses limites ?
Quel est le meilleur système scolaire ? Un système unifié laïque de l’Éducation nationale ? Un enseignement public laïque, un enseignement sous contrat d’association avec l’État et à la marge quelques établissements indépendants ? Des établissements indépendants et si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins éducatifs, quelques établissements publics ?
Pourquoi les écoles indépendantes se développent ? Qu’ont-elles que les autres n’ont pas ? Pourquoi votre école plutôt qu’une autre ? Doit-on, pour être libre, être indépendant ?
Les évolutions sociétales, écologie, LGBT+, transhumanisme, immigration de masse, Gender, réaction chrétienne, etc., peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants ?
Quelle hiérarchie entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif éventuel : la famille ? l’école ? l’État ? les structures religieuses ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faire entre ces notions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure ces buts sont compatibles ou subordonnés l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement et comment le transmettre ? L’autorité académique ? l’Université ? les sociétés savantes ou les chercheurs ? l’autorité politique ? une autre instance, qui pourrait être l’établissement scolaire lui-même ?
Quel système scolaire pour demain ? Que serait l’école idéale ?
Bruno Chanel
À quoi sert l’école ?
Pourquoi les écoles indépendantes se développent ? Doit-on pour être libre être indépendant de toute structure y compris de l’Église ?
Les évolutions sociétales (immigration, écologie, mouvance LGBT+, etc.) peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants ?
Quelle hiérarchie entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif : la famille, l’école, l’État, les structures religieuses ? Quel est le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faire entre ces trois notions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux sont-ils compatibles, ou subordonnés l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer les contenus de l’enseignement et comment transmettre ? l’autorité académique ? l’Université ? Les sociétés savantes ou chercheurs ? l’autorité politique ? une autre instance ?
Comment définir la liberté d’enseigner, son champ, ses buts ?
Quel système scolaire pour demain ?
Père Jean-Bernard Plessy
À quoi sert l’école ?
Comment définir la liberté d’enseigner, son champ, ses limites ?
Quel serait le meilleur système scolaire : un enseignement public laïque de l’Éducation nationale, un Enseignement public laïque et un Enseignement sous contrat d’association avec l’État et à la marge quelques établissements indépendants ? ou des établissements indépendants et, si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins, quelques établissements publics ?
Pourquoi les établissements indépendants se développent-ils ? Qu’ont-ils que les autres n’auraient pas ? Dans quelle mesure les évolutions sociétales (écologie, LGBT, transhumanisme, immigration, théorie du genre…) y sont pour quelque chose ? Doit-on pour être libre, être indépendant ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelles distinctions faire entre ces notions ?
L’école a-t-elle pour but la construction et l’émancipation des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux sont-elles ou non compatibles, ou subordonnées l’une à l’autre ?
Quelle hiérarchie faire entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif éventuel : la famille, l’école, l’État, les structures religieuses ou autres ? Quel est selon vous le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement et comment le transmettre. L’autorité académique ? L’Université ? Les sociétés savantes ? Les chercheurs ? L’autorité politique ? Une autre instance ?
Peut-on penser que les accords Cloupet-Lang et la loi Censi ont mis l’Enseignement catholique sous tutelle de l’État ?
Comment voyez-vous le système scolaire de demain ?
M. Gérald Omnes
À quoi sert l’école, pas seulement l’école catholique ?
Comment définir la liberté d’enseigner, son champ, ses limites ?
Quel est le meilleur système scolaire et pourquoi ? Un système unifié laïque de l’Éducation nationale ? Un enseignement public laïque, un Enseignement sous contrat d’association avec l’État et à la marge quelques établissements indépendants ? Des établissements indépendants et si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins éducatifs, quelques établissements publics ?
Pourquoi les écoles indépendantes se développent-elles ? (200 ouvertures en septembre 2020) Qu’auraient-elles que les autres n’ont pas ? Doit-on, pour être libre, être indépendant ?
Les évolutions sociétales, écologie, LGBT+, radicalisation islamique, transhumanisme, théorie du genre, féminisme, réaction chrétienne aux évolutions précédemment citées peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence des établissements indépendants ? Si oui, lequel ?
Quelle différence faire entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif ? La famille, l’école, l’État, les structures religieuses ? Quel est le rôle de l’État en matière d’éducation ? Faut-il qu’il y ait un État éducateur ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faites-vous entre ces notions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux buts sont compatibles ou subordonnés l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement ? L’autorité académique ? L’Université ? Les sociétés savantes ou les chercheurs ? L’autorité politique ? Une autre instance, par exemple les établissements eux-mêmes ?
Quel système scolaire pour demain ?
François de Chaillé
À quoi sert l’école ?
Comment définir la liberté d’enseignement, son champ et ses limites ?
Quel serait le meilleur système scolaire ? Un système unifié laïque de l’Éducation nationale ? Un enseignement public laïque, un enseignement sous contrat d’association avec l’État et à la marge quelques établissements indépendants ? Des établissements indépendants et si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins éducatifs, quelques établissements publics ?
Pourquoi les écoles indépendantes se développent-elles ? Cela a-t-il un rapport avec les développements de la loi Debré 59, avec les accords Cloupet-Lang et la loi Censi ? Qu’auraient ces écoles indépendantes que les autres n’auraient pas ? Doit-on pour être libre, être indépendant ?
Les évolutions sociétales, écologie, LGBT, transhumanisme, radicalisation islamiste, Gender, réaction chrétienne à ces évolutions, immigration de masses, peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants ? Si oui, lequel ?
Quelle hiérarchie faire entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif éventuel ? La famille ? L’école ? L’État ? Les structures religieuses ? D’autres structures ? Quel rôle pour l’état en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelles distinctions faire entre ces notions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation, la construction de la personne ou la socialisation ? Dans quelle mesure ces buts sont compatibles ou subordonnés l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement et comment le transmettre ? L’autorité académique ? L’Université ? Les sociétés savantes ou les chercheurs ? L’autorité politique ? Une autre instance (l’établissement scolaire par exemple) ?
Quel système scolaire pour demain ?
Olivier Thomas
Présentation
À quoi sert l’école ?
Comment définir la liberté d’enseigner, son champ et ses limites ?
Quel est le meilleur système scolaire et pourquoi ? Un système unifié laïque de l’Éducation nationale ? Un enseignement public laïque, un Enseignement sous contrat d’association avec l’État et à la marge quelques établissements indépendants ? Des établissements indépendants, et si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins éducatifs quelques établissements publics ?
Les établissements indépendants se développent un peu partout. Qu’auraient ces établissements que les autres n’auraient pas ? Doit-on pour être libre être indépendant ?
Les évolutions sociétales : écologie, LGBT+, le transhumanisme, la radicalisation islamiste, le Genre, les réactions chrétiennes à ces évolutions peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants, et si oui, pourquoi ?
Quelle hiérarchie faire entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif éventuel : la famille, l’école, l’État, les structures religieuses, d’autres structures (ex : le scoutisme). Quel est selon vous le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faites-vous entre ces notions ?
La transmission des valeurs au sens large est-elle devenue plus complexe, voire déficiente du côté des familles ? L’école ne devrait-elle pas se substituer à celle-ci ?
Les associations familiales peuvent-elles aider les familles dans ce sens ? Ont-elles les bénévoles nécessaires à ce genre de missions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation de la personne ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux sont-ils ou non compatibles, ou subordonnées l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement et comment le transmettre ? L’autorité académique ? L’Université ? Les sociétés savantes ou les chercheurs ? L’autorité politique ? Une autre instance ?
Quel système scolaire pour demain ?
Éric Mestrallet
Présentation
Quelle relation existe-t-il entre la fondation pour l’école et la fondation Espérance banlieue ?
Qu’est-ce qui définit les établissements Espérance banlieue, les lignes fortes des projets d’établissements ? Pourquoi aller dans ces écoles plutôt que dans d’autres écoles, plutôt que dans celles formant le maillage de l’Enseignement public ou sous contrat ? Quelles sont les motivations des parents qui y inscrivent leurs enfants ?
Au sens large, à quoi sert l’école ?
Comment définir la liberté d’enseignement, son champ et ses limites ?
Quel est le meilleur système scolaire ? Un système unifié laïque de l’Éducation nationale ? Un système public laïque, un Enseignement sous contrat et à la marge quelques établissements indépendants ? Des établissements indépendants et si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins éducatifs quelques établissements publics ?
Pourquoi les écoles indépendantes se développent-elles ? Le contrat est-il trop rigide ? L’indépendance est-elle nécessaire pour répondre aux besoins éducatifs ?
Les évolutions sociétales, écologie, LGBT+, transhumanisme, radicalisation islamiste, Gender, réactions chrétiennes aux évolutions, etc., peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants ?
Quelle hiérarchie faire entre ces différentes structures sur leur rôle éducatif éventuel : la famille, l’école, l’État, les structures religieuses au sens large ? Quel est le rôle de l’État en matière d’éducation ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faire entre ces notions ?
L’école a-t-elle comme but l’émancipation des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux sont-elles ou non compatibles ou subordonnées l’une à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement et comment le transmettre ? : L’autorité académique, une autre instance, par exemple l’établissement scolaire lui-même ?
Quel système scolaire pour demain ?
Philippe Delorme
Présentation
À quoi sert l’école ?
Quelle définition de la liberté d’enseigner ou d’enseignement, son champ, ses limites ?
Quel est le meilleur système scolaire ? Un système unifié laïque de l’Éducation nationale ? Un Enseignement laïque, un Enseignement sous contrat d’association avec l’État et à la marge quelques établissements indépendants ? Des établissements indépendants et si ces derniers ne couvrent pas tous les besoins éducatifs quelques établissements publics ?
Pourquoi des écoles indépendantes se développent-elles ? Qu’ont-elles que les autres n’auraient pas ? Doit-on pour être libre être indépendant ?
Les évolutions sociétales, écologie, LGBT+, transhumanisme, radicalisation islamiste, Gender, réaction chrétienne à ces tendances… peuvent-elles avoir un lien avec l’émergence d’établissements indépendants ?
Quelle hiérarchie faire entre ces différentes structures dans leur rôle éducatif : la famille ; l’école ; l’État ; les structures religieuses ? Quel est le rôle de l’État en matière d’éducation ? Peut-on admettre la notion d’État éducateur ?
Qu’est-ce qu’enseigner ? Qu’est-ce que transmettre ? Qu’est-ce qu’éduquer ? Quelle distinction faire entre ces notions ?
L’école a-t-elle pour but l’émancipation et la construction des personnes ou la socialisation ? Dans quelle mesure les deux sont-ils compatibles ou subordonnés l’un à l’autre ?
Qui a autorité pour déterminer le contenu de l’enseignement, les programmes, la pédagogie, comment transmettre ? L’autorité académique ? L’Université ? Chercheurs et sociétés savantes ? Autorité politique ? Une autre instance ? Les établissements scolaires eux-mêmes ? Que penser du fait que l’Enseignement catholique ne développe plus de manuels et semble disparaître du champ de la recherche ?
Comment voyez-vous le système scolaire de demain ? Comment souhaiteriez-vous le voir évoluer ?
Les accords Lang-Cloupet et la loi Censi ne sont-ils pas contradictoires avec une autonomie des établissements notamment dans ses relations aux enseignants ?
Axes thématiques de l’ensemble des entretiens (QR code 14)
23 octobre 2021 Forum ouvert de l’association Créer son école
Une mosaïque d’établissements.
Différences, points communs et problématiques des établissements indépendants présents au forum.
Indépendance diversité et mutualisation fédération.
CHAPITRE III
Reprise, synthèse et analyse critique de l’enquête
Partie III
Synthèse
CHAPITRE I
Les fractures du système scolaire : massification, crise d’identité et liberté d’enseignement
De l’école de la République à l’Enseignement public
Fondements théoriques des fractures signifiées par les établissements indépendants hors contrat
Lutte entre l’académique et le pédagogique
Démocratisation ou massification ?
Échec scolaire, baisse du niveau et liberté d’enseignement
Reprise
CHAPITRE II
Crise d’identité de l’Enseignement catholique
Une identité de l’Enseignement catholique définie par son association nécessaire avec l’État pour assurer un service public
La mission enseignante de l’Église et l’Évangélisation, points de cristallisation d’une crise d’identité
L’Église entre association et indépendance
Le monde, l’eschatologie, l’éducation intégrale et la liberté d’enseignement
Reprise
Reprise finale
Conclusion
Situation
L’Enseignement catholique est-il toujours libre ?
Les établissements indépendants sont-ils la meilleure expression de la liberté d’enseignement ?
La République et l’État respectent-ils en France la liberté d’enseignement ?
Ouverture
Bibliographie
Liste des pages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Landmarks
Cover
Préface
Pour discuter ou pour entrer dans le débat auquel nous invite, voire même nous convoque, Pierre-Henri Beugras, il convient de se déplacer, de partir d’un lieu autre.
Commençons avec le discours d’Emmanuel Kant consacré à ses leçons de pédagogie données à l’université de Kônigsberg entre 1776 et 1787. Réunies dans l’ouvrage Réflexions sur l’éducation, l’extrait qui suit est destiné à rappeler les débats entre ceux qui se prétendent « réformateurs » et ceux qui se veulent « classiques ». « L’enfant doit être habitué à travailler. Et où donc le penchant au travail doit être cultivé, si ce n’est à l’école ? L’école est une culture par contrainte. Il est extrêmement mauvais d’habituer l’enfant à tout regarder comme un jeu. Il doit avoir du temps pour ses récréations ; mais il doit aussi y avoir pour lui le temps où il travaille. Et si l’enfant ne voit pas d’abord à quoi sert cette contrainte, il s’avisera plus tard de sa grande utilité. Vouloir toujours répondre aux questions de l’enfant : Pourquoi ceci ? À quoi bon cela ? serait d’une manière générale laisser sa curiosité prendre un mauvais pli. L’éducation doit comprendre la contrainte, mais elle ne doit pas pour autant devenir un esclavage. » Kant encourage une forme de « contrainte » à l’école. Cela a trait aussi bien à l’apprentissage qu’à la formation du caractère. Pour les anciens, l’école ne se réduisait ni au « skhole », soit les « loisirs », ni à la « schola » ; c’est-à-dire un lieu de loisir studieux ou un lieu d’étude. L’école est une chose sérieuse qui ne peut pas être laissée entre les mains de n’importe qui. En son temps, Kant s’occupera aussi de la formation de l’enseignant.
Laissons Emmanuel Kant et revenons en France avec la grande figure incontournable de l’école que représente Jules Ferry. S’il y a une figure moderne apparentée à l’école en France, c’est bien celle de Jules Ferry. Que sait-on de lui d’une manière populaire ? Que l’école, c’est le lieu de l’enseignement fondamental et traditionnel ; c’est-à-dire « lire, écrire et compter ».
Combien de débats entre les « réformateurs » et les « conservateurs », les « pédagogues » et les « anti-pédagogistes » cristallisés, par exemple, par la critique féroce de Marie-Claude Bartoli et Jean-Pierre Despin dans leur livre Le poisson rouge dans le perrier, dans lequel sont présentées avec ironie les attentes des pédagogues envers l’instituteur ou le professeur : « Qu’il persuade le bambin ou l’adolescent qu’il faut dire Bonjour à sa crémière ou qu’il faut dire du bien de Monsieur le prieur. »
Bien sûr, l’école est là pour enseigner les savoirs fondamentaux et, plus tard, les grands classiques. Philippe Nemo, dans son ouvrage Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry ? après une enquête menée à charge contre les réformateurs, tire cette conclusion : « Une école que l’on convoque à une autre tâche que la transmission des savoirs – le bonheur des enfants ou la révolution est une absurdité. Or, c’est bien ce que fait l’école publique française. » Philippe Nemo entend sauver l’école de Jules Ferry : L’école serait le lieu de l’enseignement et rien d’autre. Nous entendons la parole de Oliver Cromwell mettant en garde ses partisans « souvenez-vous que vous pouvez vous tromper ! ». Et si c’était vrai pour ceux qui, au nom de Jules Ferry, se tromperaient de cible ?
Vérifions en commençant avec le célèbre discours de Jules Ferry prononcé à Reims en 1882 lorsqu’il lance : « L’instituteur Prussien a fait la victoire de sa patrie, l’instituteur de la République préparera sa revanche ». Gambetta l’avait déjà affirmé : « Le vrai vainqueur à Sedan fut l’instituteur prussien, et c’est à l’instituteur français de gagner la prochaine guerre. »
Doit-on réduire l’école à ces deux schémas : apprendre la géométrie ou apprendre la stratégie de la guerre ? C’est possible. Veillons toutefois à entourer ce discours avec deux textes dans lesquels Jules Ferry traite du rôle de l’école dans la formation des maîtres d’école. Le 2 avril 1880, Jules Ferry s’adresse en ces termes aux directeurs des écoles normales : « Nous voulons que vous nous fassiez, non seulement des instituteurs, mais des éducateurs. »
Ainsi, est-il possible de mieux comprendre les propos de Jules Ferry dans sa célèbre Lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883, « mais, une fois que vous êtes ainsi, loyalement enfermés dans l’humble et sûre région de la morale usuelle, que vous demande-t-on, des discours, des dissertations savantes, de brillants exposés, un docte enseignement ? Non, la famille et la société vous demandent de les aider à bien élever leurs enfants, à en faire des honnêtes gens, c’est dire qu’elles attendent de vous non des paroles, mais des actes, non pas un enseignement de plus à inscrire au programme, mais un service tout pratique, que vous pouvez rendre au pays plutôt encore comme homme que professeur ». L’enjeu de l’école, c’est aussi bien la raison que le cœur, le savant que le citoyen.
Ajoutons quelques phrases tirées de cette lettre qui sont passées à la postérité : « J’ai promis la neutralité religieuse, je n’ai jamais promis la neutralité politique », « On a compté sur vous pour leur apprendre à bien vivre, par la manière même dont vous vivez avec eux et devant eux ». « Vous êtes l’auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille. » Ou encore : « Je serais heureux si j’avais contribué par cette lettre à vous montrer toute l’importance qu’y attache le gouvernement de la République, et, si je vous avais décidé à redoubler d’efforts pour préparer à notre pays une génération de bons citoyens. »
Il s’adresse également aux chefs d’établissement des écoles normales de la façon suivante : « Nous voulons des éducateurs ! Eh quoi ! Est-ce donc un rêve ambitieux ? Est-ce un rêve que nous faisons là ? Est-ce que l’on pourra dire éternellement que, pour être un éducateur, il faut revêtir un certain caractère, porter une certaine robe, et qu’il n’existe pas des éducateurs laïques ? Ah ! Messieurs, ce n’est pas possible ! » C’était aussi cela l’école laïque du « savoir lire, écrire et compter » selon Jules Ferry !
En ce qui concerne la laïcité, le véritable architecte de l’école de la République, Ferdinand Buisson son collaborateur le plus proche, confirme la mission de l’école avec ces mots « si par laïcité de l’enseignement primaire, il fallait entendre la réduction de cet enseignement à l’étude de la lecture et de l’écriture, de l’orthographe et de l’arithmétique, à des leçons de choses et à des leçons de mots [...] nous n’hésitons pas à dire que c’en serait fait de notre enseignement national. Ce serait ramener l’instituteur au rôle presque machinal de l’ancien magister… Il faut que l’instituteur ait le droit et le devoir de parler au cœur aussi bien qu’à l’esprit, de surveiller dans chaque enfant l’éducation de la conscience, au moins à l’égal de toute autre partie de son enseignement ».
Il demande aux enseignants de nourrir ce qu’il nommera le « sanctuaire » intérieur afin de se ressourcer, de nourrir son humanité en partage avec le vrai, le beau et le bien en vue du « bien commun ».
Pourquoi cet exposé préalable consacré aux débats scolaires ? Pour dire combien la question de l’école, qu’elle soit publique ou privée, constitue un enjeu important. Ce qui s’y joue, c’est l’avenir d’un peuple. En ce sens que s’il ne s’agissait que de questionner les savoirs « lire, écrire, compter », il serait alors difficile de comprendre pourquoi autant de personnes font le choix de prendre le risque de quitter le confort de la tutelle de l’État pour se lancer dans des aventures plus ou moins hasardeuses. Ne s’agit-il pas aussi d’une question existentielle sur l’humanité que nous souhaitons devenir ?
Nous saisissons alors toute la gravité de la question posée par Pierre-Henri Beugras : « Que signifient la création et le développement en France d’établissements des premier et second degrés indépendants, dits “hors contrat” pour l’Enseignement Catholique comme institution ? » Son enjeu est d’établir le champ possible de l’indépendance d’un établissement scolaire.
Selon Pierre-Henri Beugras, la notion d’indépendance se distingue de celle d’autonomie qui implique une liberté interne à un ensemble. Le terme « hors contrat » se bornerait à signaler une indépendance vis-à-vis de l’État qui n’impliquerait pas une indépendance vis-à-vis de l’Église.
Pierre-Henri Beugras veut comprendre ce qui fonde la nécessité d’une indépendance par rapport à l’État. Est-elle factuelle ou de principe ? Quel est son degré ? Quelle autonomie une école, qui se veut catholique, peut-elle avoir vis-à-vis de l’Église et des institutions de l’Enseignement Catholique voulues par elle ? L’objet de son investigation est l’analyse de la conjonction ou de la disjonction entre l’association avec l’État et la notion de caractère propre définissant l’identité scolaire. En quoi ces écoles « hors contrat » expriment une contestation d’un État éducateur installant « un nombre important d’élèves dans une situation de souffrance » car soumis à l’idéologie dominante du moment ?
Pierre-Henri Beugras est venu me rencontrer avec ce projet dans la perspective de conduire une enquête solide dans le cadre d’un processus doctoral. J’ai donc assumé la responsabilité et le grand plaisir d’être son directeur de thèse.
Certains étudiants font cheminer : on ressent la force de l’intelligence, la robustesse de l’expérience, l’immensité de la culture. On touche du doigt le fait qu’il y aura toujours des chemins de traverse et des choses à savoir. On touche au « drame », selon Guy Berger, de l’étendue de notre inconnaissance qui se déploie fièrement devant nous chaque fois que nous avançons dans l’appropriation des savoirs.
Ainsi donc, nous avons Pierre-Henri Beugras, élève de l’enseignement catholique sous contrat, remercié à la fin de la classe de 6e, à la grande stupeur de ses parents ! et Pierre-Henri Beugras devenu professeur de philosophie, chef d’établissement et aujourd’hui, docteur d’une thèse intitulée « Liberté d’enseignement en France, entre associations et indépendance ».
Ma prise de parole s’inscrit dans le « Il était une fois » d’une thèse qui s’est écrite dans un récit où chacune et chacun veut avoir raison. Il y a l’entêtement de l’histoire, mais aussi l’audace du récit. L’histoire se doit de s’écrire avec les preuves ; c’est-à-dire avec ce qui a été médiatisé.
Un historien est un « rat de bibliothèque » qui a la prétention de reconstruire une époque à travers les documents, la confrontation des trouvailles. Le récit prétend, chemin faisant, avec ces « va-et-vient », révéler le sens caché des choses, l’intention que seul le sujet détient. Jusque-là, si l’histoire l’emporte sur le récit dans la recherche de la vérité, c’est le récit qui détient les ailes du sens pour voyager dans les contrées inconnues de la mémoire. Si l’histoire révèle l’engagement, le récit témoigne de l’implication. Parfois, les deux se mêlent et tiennent le même discours qui peut se démontrer et s’argumenter, croiser le logos et le pathos, l’opinion et l’enquête. Nous faisons avec ce que les autres nous donnent. C’est à nous de débattre avec et contre.
Son enquête est provocatrice en s’interrogeant sur le bien-fondé du contrat d’association, en laissant s’exprimer, dans une forme d’égalité de traitement, des avis opposés. L’investigation de Pierre-Henri Beugras se déroule dans une interrogation : Pourquoi ce contrat qui permet l’existence matérielle de l’enseignement catholique en assurant aussi sa liberté d’enseignement n’arrive-t-il pas à absorber les établissements indépendants dont au contraire il observe l’accroissement ? Qu’est-ce qui s’est passé et qu’est-ce qui se passe pour que cette situation persiste et même se développe ? À quoi sert l’école ?
Certains pourront relever des failles historiques ou s’émouvoir sur la portée éthique. Son style peut paraître affirmatif – soutenant un propos tenu par un autre – et même ouvrir à des malentendus. Tel est le destin d’un ouvrage : être discuté et disputé !
Du lieu où je suis, je peux affirmer qu’il s’est comporté en véritable chercheur. Je l’ai vu se déplacer, sans compromis, afin d’être dans un « dire vrai » sur un discours qui pourrait paraître à charge.
Comme le dirait l’historien Antoine Prost dans Éducation, Société et Politiques : « Je ne prétends donc pas écrire une histoire neutre, qui renverrait dos à dos des acteurs dont les uns avaient raison, à mes yeux, et les autres tort. La recherche d’une objectivité aseptisée ne conduit qu’à des textes incolores, inodores et sans saveur. Plus grave : dénués de sens, donc de portée. Il est sans intérêt d’écrire une histoire insignifiante. Je n’ai donc pas cherché à dissimuler les partis que j’ai pris, mais à les argumenter objectivement, à les fonder sur une analyse des faits menée sans complaisance. Je m’efforce de n’avancer mes idées qu’étayées d’un sérieux appareil factuel. Et, je serai comblé si le lecteur qui ne partage pas mes positions estimait avoir cependant appris quelque chose à me lire. »
La lecture de cet ouvrage permet de s’ouvrir à l’« epoché » pour laisser s’exprimer ce qui pourrait nous gêner dans notre éthos. Ce chercheur ne cherche pas à défendre une cause mais bien plutôt à mener une enquête qui soit la plus juste et la plus ajustée possible et ce, même si, cela met en difficulté ses choix personnels. Il n’est donc pas exclu que le lecteur puisse en sortir avec un certain malaise. C’est ainsi.
Nous souhaitons affirmer que cette contribution est pertinente, tout à la fois, sur le plan intellectuel et social sur le monde que nous souhaitons transmettre aux nouvelles générations.
La question aujourd’hui se pose avec l’anthropocène, l’accélération, le mépris social, la violence de toute sorte, l’errance dans un monde « troué » de partout.
Quelle école pour répondre aux crises sociales, anthropologiques, spirituelles et politiques dans ce que le Pape François nomme un « changement d’époque » ? À quel pacte éducatif sommes-nous convoqués ? Telles sont les questions sous-jacentes ou tangibles avec cet heureux ouvrage ! Qu’ajouter ? Sinon « Tolle lege ».
Augustin Mutuale
Doyen de la faculté d’éducation de l’institut catholique de Paris.
Docteur en philosophie et en sciences de l’éducation.
Avertissement
AVERTISSEMENT : certains documents cités dans l’essai sont accessibles par QR Codes qui sont répertoriés à la table des matières p. 481
Introduction
Liberté d’enseignement en France, entre association et indépendance
D’où vient cette question ?
Élève de l’Enseignement catholique sous contrat, j’en fus remercié à la fin de la classe de Sixième à la grande stupeur de mes parents.
Pourtant aucune transgression grave du règlement ni sérieux problème de niveau ne justifiaient cette mesure. Il fut seulement dit à mes parents : « Il sera mieux dans un établissement de taille plus modeste et aux effectifs plus légers. Il y sera mieux compris. » Je quittai ainsi, comme élève, l’Enseignement catholique avec un profond sentiment d’injustice et la ferme résolution de prendre plus tard une revanche sur lui. J’ai donc fini avec succès mes études secondaires dans un petit établissement familial laïque hors contrat, dans lequel la reconnaissance que j’ai eue à son égard m’a conduit à y travailler au début de ma carrière.
La revanche préparée et attendue a consisté pour moi à devenir professeur de philosophie dans l’établissement catholique le plus élitiste du centre de Paris. Évoluant entre des fonctions d’enseignement, d’éducation, de pastorale, de responsable de niveau et d’internat, j’ai suivi une formation pour devenir chef d’établissement, ce que je suis depuis une vingtaine d’années.
Une conviction m’a suivi durant ces années : le système scolaire tel qu’il se présente à nous est inadapté pour toute sorte d’élèves, et bien au-delà de ceux en situation de handicap. Ce système, je l’ai ressenti en tant qu’élève, enseignant, cadre éducatif et chef d’établissement, comme conformiste sans imagination et s’appliquant à brider au maximum toute initiative qu’il ne peut pas censurer. Bien sûr je parle ici du système, pas des nombreux enseignants et éducateurs qui par toute la force de leur être font grandir les personnes et les émancipent.
Ayant pour ce qui me concerne toujours vécu la liberté à l’occasion de mes différents états de vie dans l’enseignement, c’est celle-ci qui m’a conduit à poser la question de la liberté d’enseignement. Cette question s’est d’autant plus imposée à moi que j’ai constaté à quel point la phrase de Dostoïevski « l’homme a peur d’être libre » était particulièrement vraie dans ce domaine. J’ai observé professionnellement l’énorme différence entre les acteurs de l’enseignement qui osent et ceux qui n’osent pas. Ceci m’a conduit à m’intéresser aux fondateurs d’écoles, qui, quoi qu’ils fassent, font partie selon moi des audacieux, même lorsqu’ils échouent, à l’image de Pestalozzi dont les échecs de ses fondations éducatives accompagnés de réflexion et analyses pédagogiques ont engendré l’éducation nouvelle. La présence d’établissements indépendants, dits hors contrat, manifeste au moins le refus d’un système monolithique et la survivance de l’esprit libre.
Alors que l’Enseignement public et celui sous contrat couvrent d’un maillage serré d’établissements tout le territoire, pourquoi existe-t-il près de cinq mille établissements hors contrat indépendants en France ? Pourquoi après l’établissement du contrat d’association subsistent-ils et se développent-ils à raison de plus d’une centaine d’ouvertures par an depuis quelques années ? Ne serait-ce pas, comme ce fut mon cas il y a de nombreuses années, parce que beaucoup ne trouvent pas leur place dans le système, ou plus radicalement parce qu’il n’est pas bon ?
Voilà comment ces questions auxquelles j’ai tenté de répondre concrètement dans l’exercice de mon métier sont devenues aujourd’hui pour moi l’objet d’une recherche.
Objet et contexte
Qui mieux que Socrate peut symboliser l’Enseignement libre ? En parcourant les rues et les places d’Athènes, il enseignait à ceux qui acceptaient ses questions et entraient en dialogue avec lui. Pas de murs d’écoles, pas de rangs, pas de programmes, pas d’évaluation, seule la recherche d’une vérité cachée en nous tous et qui peut se révéler à l’occasion d’une rencontre. Cette liberté et cette indépendance ont coûté la vie à Socrate. Son attitude était subversive et ne pouvait être tolérée par le pouvoir en place. Son questionnement mettait en cause l’autorité des maîtres sophistes et l’idéologie dominante. Nous pouvons nous interroger ici : existe-t-il une idéologie dominante, un système éducatif et un pouvoir en place qui auraient pu tolérer Socrate en quelque époque et lieu que ce soit, alors que son art du dialogue et de la maïeutique semble fonder toute pédagogie ?
Cette interrogation sur la liberté d’enseignement, nous la poserons à la France contemporaine à travers son histoire et particulièrement son histoire éducative et ses courants philosophiques et politiques. En effet, toute intention éducative procède d’une certaine vision de l’homme (anthropologie) et de l’organisation sociale, puisqu’il s’agit avec chaque enfant de le faire accéder à l’humanité qui sommeille en lui et de découvrir l’autre et la complexité de la mise en relation sans laquelle il ne peut être lui-même et y avoir de société.
La liberté d’enseignement a valeur constitutionnelle dans la cinquième République. Ce principe est rattaché à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et au principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977. Cependant cette liberté, pourtant dite fondamentale, n’a pas toujours existé et a toujours été discutée voire contestée. L’Église, avant de perdre son monopole d’enseignement avec la chute de l’Ancien Régime, l’a longtemps refusée et comme l’exprime Choukri Ben Ayed dans l’ouvrage collectif qu’il a dirigé L’école démocratique vers un renoncement politique : « Le libre choix de l’école a longtemps été considéré comme incompatible avec le projet de l’école républicaine » (C. Ben Ayed, 2010, p. 123).
L’Église catholique exerçait un quasi-monopole de l’enseignement pour transmettre ce qu’elle considère comme la vérité universelle de la Foi chrétienne destinée à tous les hommes, la République issue de la Révolution veut ou voulait l’exercer pour instaurer un nouvel ordre social lui aussi à visée universelle. La République née de la Révolution ne se voit pas comme un régime à côté d’autres également légitimes mais comme la première étape d’une harmonie universelle dont elle a mission de la faire advenir partout. Le « nouveau régime » se pense comme une rupture historique universelle marquée notamment par l’adoption d’un nouveau calendrier. Ce nouveau régime se pense comme une étape vers une fin de l’histoire accomplissant le projet de Saint-Just, « le bonheur est une idée neuve en Europe » (Discours du 3 mars 1794. Rapport à la convention). Cette « idée neuve » anticipe la philosophie de l’histoire hégélienne qui peut être vue comme une sécularisation de l’économie du salut chrétienne. Le processus dialectique pensé à travers les vicissitudes de l’histoire comme la genèse de la réalisation de l’absolu peut être conçu comme l’écho abstrait de la fulgurante intuition de Saint-Just. Cette revendication d’un droit universel au bonheur pour tous préfigure de donner à la République et l’état la mission d’y parvenir en configurant la société à ce but ce qui induit d’en faire celui de l’école. Le bonheur doit se répandre par la République révolutionnaire qui définit désormais l’identité française. Ainsi tout autre régime est une entrave à ce projet, tout autre régime renvoie à l’oppression qui caractérise « l’Ancien Régime ».
C’est bien une mission salvatrice que s’octroie la jeune République donnant les fondements d’une transposition de ce qui anime l’enseignement de l’Église pour celui d’une nouvelle école. Il ne s’agit pas seulement d’accepter ou d’adhérer à la République, il faut avoir Foi en elle. Avec les idéologues, de Condorcet à Destutt de Tracy il s’agit de gagner l’hégémonie culturelle pour supplanter celle de l’Église. L’hégémonie culturelle est un concept d’Antonio Gramsci lui permettant d’analyser l’échec de la révolution prolétarienne dans les sociétés industrielles occidentales du fait de la domination de la culture bourgeoise en leur sein. Ainsi la culture chrétienne, catholique particulièrement, encore hégémonique au temps de la Révolution peut empêcher la pérennité d’un nouveau régime issu de celle-ci. La prise de pouvoir serait un phénomène éphémère si le rationalisme athée ou anti-déiste ne devenait pas rapidement la nouvelle idéologie dominante ou culture hégémonique. L’Église promettait le bonheur dans l’au-delà, la République doit le faire advenir ici-bas par la Foi et l’action de tous les citoyens guidés par la raison et certains que la science finira par résoudre les problèmes fondamentaux de l’humanité : pauvreté, maladies, injustices, inégalités, etc.
Deux structures monopolistiques : la République et l’Église vont ainsi entrer en lutte. Pour cette dernière, deux phases sont à distinguer : celle où elle espère retrouver son monopole, celle ou ayant plus ou moins admis qu’elle l’a perdu, elle tentera d’empêcher la République de l’obtenir en revendiquant la liberté d’enseignement en poussant en avant la famille contre l’État. L’Église s’est ainsi tardivement « convertie » à la liberté d’enseignement revendiquée contre elle au début de la Révolution.
Comme le dit Guy Berger (QR code 5) : « Il ne faut pas oublier que l’Église n’a découvert la famille que très tard. Dans les Évangiles, il s’agit de quitter son père et sa mère, de se séparer de sa famille. C’est justement dans sa lutte contre la République que l’Église va faire monter au créneau la vérité des familles. »
Les établissements dépendaient donc de l’Église, puis de l’État pas question de liberté d’enseignement ou d’indépendance.
À quoi sert l’école ?
Cette question est importante à poser dans la mesure où sa réponse nous semble évidente. Nous n’imaginons pas un monde sans école et nous considérons comme une évidence que les enfants s’y rendent très jeunes et en groupe.
Socialisation et formation sont, sans confusion et sans séparation, le but de l’école et chacun en mesure l’importance et admet en conséquence son caractère obligatoire. À l’occasion des entretiens semi-dirigés, tous les protagonistes ont admis ces deux buts quelle que soit la hiérarchie établie entre eux à l’exception d’Anne Coffinier dont le point de vue sur l’institution scolaire est plus nuancé quant à son caractère obligatoire. Étant dans ce domaine très libérale, voire libertaire, elle va jusqu’au bout de cette logique en contestant l’obligation d’intégrer le système scolaire tel qu’il est et plus précisément la forme scolaire actuelle.
Dès lors l’association du mot liberté à celle d’enseignement pose question : sur quoi serait fondée cette liberté ? Pourquoi la revendiquer ? En effet, cela implique que l’enseignement pourrait ne pas être libre. Il en est de même pour la notion d’indépendance : de quoi ou de qui s’agit-il d’être indépendant ? Si l’enseignement n’est pas indépendant de qui ou de quoi dépend-il donc ?
Les systèmes scolaires apparaissent dans des sociétés ayant atteint un niveau élevé d’organisation politique, religieuse, sociale et économique. Toute société configure son système éducatif en vue de sa préservation, formant sa jeunesse pour parvenir à cette fin, des cités grecques à Rome en passant par Charlemagne et l’Église et enfin la République. De façon générale les systèmes scolaires poursuivent donc l’objectif de conformer leurs élèves à la société telle qu’on imagine qu’elle est et pour se faire à son idéologie dominante. Il ne faut pas confondre idéologie dominante et opinion majoritaire. L’opinion majoritaire représente les convictions des individus non remises en question, l’idéologie dominante se manifeste comme une remise en cause de ces dernières, une contestation par l’élite pensante de ce qui est communément admis, elle est « l’opinion majoritaire » de l’élite culturelle, économique et dirigeante. Le bienfait de l’école obligatoire n’est pas d’abord une opinion majoritaire mais une philosophie politique promue par un petit nombre. Le courant spirituel français du xviie siècle nommé par l’abbé Henri Bremond dans les années 1920 « école française de spiritualité » ne représente pas dans ses grandes lignes une opinion majoritaire de l’époque. Saint Vincent de Paul et ses petites écoles ouvertes aux enfants des paysans mais surtout aux garçons et aux filles, les écoles primaires de Saint Jean-Baptiste de La Salle remplissant un rôle social, le christocentrisme de Bérulle, l’humanisme de Saint François de Sales et son attention toute particulière aux droits des enfants et à la condition féminine, ont pu choquer et être combattus en leurs temps. Cependant ce courant devient l’idéologie religieuse dominante de ce temps. Quoi qu’il en soit, la construction de la personne, son épanouissement, son émancipation ou libération des conditionnements qui pèsent sur elle ne sont pas de manière générale le but assigné à un système scolaire. Au contraire, les systèmes scolaires se présentent par certains de leurs aspects comme des mécanismes d’asservissement visant à étouffer les velléités de rébellion à former des citoyens aptes à devenir les unités d’une armée pour la guerre ou pour la productivité économique. La ressemblance architecturale des bâtiments scolaires avec les casernes, notamment au xixe siècle, les rangs, l’organisation même des salles de classe manifestent une sorte de volonté de dressage, de conditionnement à une forme servile d’obéissance.
Cependant par son essence, une société démocratique devrait engendrer un système éducatif émancipateur plutôt que conformateur. Une société libre devrait permettre à l’individu de devenir une personne libre à l’esprit critique aiguisé fondant sur celui-ci des idées étayées par la raison et perçues comme provisoires et devant toujours passer l’épreuve du doute. Pourtant l’enseignement des sophistes à Athènes la démocratique fut conformateur. Ceux-ci avaient compris comment détourner l’esprit démocratique par un usage de la rhétorique, l’art de bien parler, fondé sur l’apparence et la flatterie. Ainsi eux et leurs élèves s’appropriaient la réalité du pouvoir dévoyant la démocratie en tyrannie de l’opinion. À l’inverse Socrate introduisit une subversion philosophique en usant du questionnement et du dialogue pour faire accoucher l’esprit de la vérité. Dans Le Ménon, Socrate humilie celui-ci après lui avoir démontrer son incapacité à définir la vertu pour savoir si elle peut être enseignée : « J’ai discouru mille fois sur la vertu et me voilà incapable de dire un mot sur elle » (Platon, 1991). Non seulement Ménon doit se résigner à son ignorance mais Socrate lui montre comment sa méthode de la maïeutique permet à son esclave ignorant les mathématiques de comprendre la règle de duplication du carré. Ainsi il dévalue l’enseignement des sophistes (le sophiste Gorgias était le maître de Ménon) et démontre que tout homme quelle que soit sa condition peut accéder à la vérité. L’enseignement de Socrate sort des murs des écoles sophistes, l’enseignement du Christ sort des synagogues et lui aussi montre à qui veut le suivre qu’il est possible de comprendre intérieurement ce que les scribes et les docteurs de la loi ignorent du sens de la parole. Ces subversions pédagogiques conduisent leurs auteurs au rejet et à la condamnation à mort. Socrate introduit une subversion philosophique qui l’entraîne à être rejeté et mis à mort. D’une autre façon l’enseignement du Christ est institutionnellement rejeté, ce rejet le conduisant aussi à la mort.
On pourrait en déduire que tout système d’enseignement est inféodé à un ordre social et politique et qu’il ne saurait tolérer la liberté ou l’indépendance, Socrate et le Christ étant, par leur condamnation à mort, les symboles du rejet d’un enseignement émancipateur.
Ainsi l’école peut être considérée dans son ensemble, plus comme un outil de conditionnement que d’épanouissement. Dans cette perspective l’enseignement se voit assigner une fin étrangère à la recherche et dirigée vers l’utilité sociale politique, économique voire aussi religieuse. Quant à lui, l’enseignant, est plus un instructeur qu’un maître de sagesse. Si l’enseignement de Socrate est gratuit, ce n’est pas le cas des enseignements des systèmes scolaires qui sont évidemment rémunérés. L’instance qui les paie n’a-t-elle pas, par nature, barre sur le contenu et la forme de leur enseignement ? En France, le Trésor Public rémunère l’écrasante majorité des enseignants, et s’ils ne dépendaient pas de l’État, ils dépendraient de la puissance financière qui les rémunérerait. Ainsi l’enseignement de masse ne peut se soustraire à la puissance d’un État qui l’a lui-même suscité et peut seul le faire vivre.
L’alternative à cette puissance est celle des grands groupes industriels mais surtout financiers. L’intérêt que porte la fondation Bettencourt à « la Fondation pour l’école » en est un signe.
Plus que jamais, l’école est un enjeu de lutte de pouvoir et la notion de liberté très éloignée d’elle. La revendication d’un enseignement libre se présente donc surtout comme une opposition à un pouvoir dominant les esprits. Mais cette revendication ne cache-t-elle pas seulement le désir de dominer à son tour les esprits par une autre idéologie qui aspire à devenir dominante à son tour ?
Contestation de l’État éducateur comme contestation de l’idéologie dominante
« À une Foi s’est opposée une autre Foi, à un dogme un autre dogme. Devant le catholicisme s’est dressé le rationalisme » (Georges Dupeux, 1970, p. 478). Destutt de Tracy, figure des idéologues (philosophes français 1800-1830) évoque avec la République un changement « d’ère ». Ainsi ce qui échoit au système scolaire est de transmettre l’événement révolutionnaire comme un point d’infléchissement de l’histoire universelle. Sloterdijk dira « le hiatus révolutionnaire déchira le lien conventionnel entre les époques » (Peter Sloterdijk, 2016, p. 16). Ainsi il n’a jamais été question pour l’école de la République d’être neutre mais de construire une société entièrement nouvelle mais surtout non redevable à un héritage du passé. Ainsi le souci premier n’est pas d’améliorer l’instruction pour l’épanouissement de la personne mais d’en faire l’outil de réalisation d’un nouveau monde. Voltaire lui-même disait dans sa lettre à Damilavile que le peuple devait être guidé non instruit : « Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas instruit, quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. » Cependant comme le souligne Guy Berger (QR code 5) est introduite avec Condorcet l’idée que le savoir est un bien public. Ce qu’il faut en premier lieu c’est une école publique non pas une école de la République. Cette intuition de Condorcet dissocie l’école d’une finalité politique autre que le droit de chacun de recevoir une instruction. Cependant l’enjeu de pouvoir sur les consciences que représente un système scolaire est une tentation trop grande pour le nouveau régime qu’est la République pour qui le rationalisme doit se substituer à la religion comme fondement de la morale et de la société. Au-delà de cette perspective philosophique l’école de la République naissante se donne un but politique et militaire de Napoléon à Jules Ferry. Il s’agit de développer un patriotisme mobilisateur et de former une armée de métier compétente apte à intégrer une conscription des citoyens. La finalité des lycées napoléoniens est clairement liée à la constitution d’un corps d’officiers bien formés et d’ingénieurs développant un armement moderne. L’école de Jules Ferry forme des citoyens patriotes dans des bâtiments ressemblant à des casernes et avec une discipline d’inspiration militaire.
Cette pente d’un État éducateur faisant du système scolaire un outil politique militaire et économique sera toujours contestée d’une manière ou d’une autre. Un élément significatif de cette contestation s’exprimera avec le courant de l’éducation nouvelle de la fin du xixe siècle à l’entre-deux-guerres avec l’enfant placé au centre de l’action éducative et une participation active de ceux-ci à leur propre formation.
À l’issue de la seconde guerre mondiale, c’est le marxisme qui devient l’idéologie dominante du système scolaire. Cette pente idéologique fut initiée par deux intellectuels liés au parti communiste français, Langevin et Wallon à qui fut demandé en 1944 un projet de réforme de l’enseignement et du système éducatif français. La perspective politique change pour mettre l’égalité des chances comme but du système. Cependant, là encore, le but politique semble mettre l’enfant et la personne au second plan. Il en sera de même dans la seconde moitié du xxe siècle avec Bourdieu et Passeron et le constructivisme. L’analyse de ces deux auteurs du système de reproduction des inégalités sociales par le système scolaire continue de donner à l’école le but politique de la réalisation de l’égalité sociale. Face à cette quasi-permanence d’une instrumentalisation politique du système scolaire s’exprime à l’inverse une quasi permanence de la contestation de l’état éducateur.
Anne Coffinier dans un article intitulé Pour une société plus humaine (Anne Coffinier, 2014, p. 53-93) désigne Bourdieu comme la référence sur laquelle s’appuierait l’Éducation nationale pour « casser les mécanismes de reproduction sociale que l’école est supposée favoriser » auquel s’ajoute l’introduction massive du numérique dans le mécanisme d’apprentissage ce qui conduit selon elle à une déculturation des élèves entre autres par la technique. Ce processus fait entrer les enfants dans une rupture avec leur héritage familial et les conduit à une souffrance identitaire. Pour Anne Coffinier la pente actuelle de « l’État éducateur » préfigure le transhumanisme fondé par Julian Huxley, premier directeur de l’Unesco de 1946 à 1948, et dénoncé par son frère Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Julian Huxley définit ainsi le transhumanisme : « La race humaine si elle le souhaite se dépassera elle-même […] en sa totalité, en tant qu’humanité. Il nous faut un nom pour cette Foi nouvelle. Peut-être transhumanisme serait approprié » (Julian Huxley, 1968, p. 255). Le transhumanisme n’est pas un simple courant idéologique comme ce fut le cas autrefois avec le marxisme, mais une modification potentielle de l’espèce humaine grâce à l’eugénisme. Le problème n’est pas ici de réfuter la pertinence d’une anthropologie par une autre plus pertinente, mais d’empêcher que l’homme s’érige en démiurge de sa propre évolution par une synthèse des progrès de l’intelligence artificielle et de la génétique. Cette perspective supprimerait à terme toute question scolaire, l’homme étant à l’avance parfaitement adapté génétiquement à la société.
Cette pente contemporaine également scientiste consiste à médicaliser toute problématique éducative. L’attrait pour les neurosciences est un signe de ce phénomène. Les techniques de soin et d’amélioration des situations de handicap peuvent se transformer en projet politique d’augmentation de l’humain.
Pour résister à cette mainmise idéologique constante de l’État sur le système scolaire il faut donc, selon Anne Coffinier, en finir avec l’État éducateur et qu’il se borne à vérifier que chaque enfant reçoive la formation conforme à ses besoins et aux vœux de sa famille. Il n’a pas vocation à imposer une approche unique de l’éducation à la totalité des citoyens. Au contraire, il devrait se borner à ne créer des établissements que dans la mesure où les établissements indépendants ne couvriraient pas la totalité du besoin scolaire. On peut voir ainsi les établissements indépendants comme la manifestation d’une résistance à l’État éducateur mais surtout à l’idéologie dominante du moment.
Un autre type de contestation de l’État éducateur part de l’idée que le caractère unifié d’un système éducatif place un nombre important d’élèves dans une situation de souffrance.
L’idée de massification est exprimée par Liliane Lurçat, docteur en psychologie et lettres, dans son article de 1998 Vers une école totalitaire (L. Lurçat, 1998, p. 65-73). Elle considère que nous avons affaire à une forme scolaire monolithique soumise aux idéologies définies comme la forme abstraite de la pensée dominante. Cette massification de l’enfance conduit Liliane Lurçat à dénoncer un refus de la singularité de la personne au nom des déterminismes sociaux. L’absence de prise en compte de cette singularité engendre une situation de souffrance psychologique chronique des élèves. L’école est alors un lieu étranger à l’élève où, au mieux il s’ennuie plus ou moins, et au pire qu’il rejette.
La volonté répétée d’assigner à l’école le but de « faire des citoyens » peut être contradictoire avec l’émancipation de la personne. Philippe Meirieu dans Le choix d’éduquer (P. Meirieu, 2018) voit les forces sociales du moment « se disputer le droit d’assujettir les enfants » alors qu’il définit le pédagogue comme l’éducateur qui se donne pour fin l’émancipation des personnes. Ainsi les établissements indépendants se créent pour échapper à la logique générée par un système monolithique incapable de prendre en compte l’écoute de la famille et les besoins spécifiques de la personne de l’élève. Le phénomène peut donc s’analyser comme une contestation de la philosophie de l’État éducateur. Un nombre significatif de parents veulent soustraire leurs enfants à l’instrumentalisation politique du système scolaire qu’ils jugent prégnante. Au mieux, ils considèrent que celle-ci détourne la pédagogie du souci de l’unicité de l’enfant et du chemin particulier à trouver pour son éducation, au pire qu’elle est source de maltraitance pour














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)