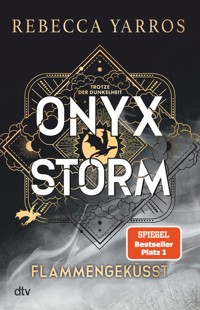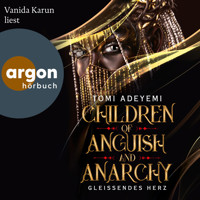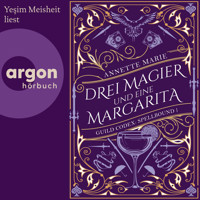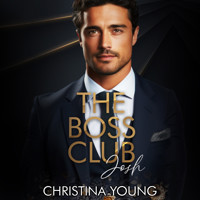Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Extrait : "Rechercher avec trop de subtilité les idées morales qui ont présidé à ces créations poétiques, dont nous essayons l'analyse, ce serait sans doute en altérer le naturel et s'égarer dans le labyrinthe d'une métaphysique bizarre, et en dehors du sujet. Tel n'est pas notre but ; nous voulons laisser, à ces inspirations des temps anciens, l'élan et la libre allure de leur naïveté."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À M. ANDRÉ POTTIER,
CONSERVATEUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE ROUEN.
C’est à vous, Maître, qui dispensez à tous, avec tant de libéralité, vos fécondes lumières et votre bienveillante assistance, c’est à vous qu’appartient la Dédicace de ce modeste Ouvrage, entrepris d’après vos conseils, accompli sous votre direction. Si quelque succès doit récompenser mes efforts, avant tout il sera le vôtre : qu’il vous revienne tout entier. À vos soins assidus d’autres eussent sans doute répondu par plus de talent, nul n’eût répondu par plus de reconnaissance.
Amélie BOSQUET.
Depuis que la curiosité et le goût du public se sont dirigés vers l’histoire particulière des provinces ; depuis que l’on a compris qu’il y avait là, concernant les hommes et les choses, une mine d’observations et de connaissances nouvelles à exploiter, la vogue s’est emparée surtout des ouvrages qui se rattachent à la Normandie et à la Bretagne, deux provinces qui, en dépit des divisions administratives, semblent former encore, chacune à part, un tout homogène. Cette faveur était méritée sans doute, car, s’il doit se trouver, dans quelques-unes de nos annales locales, des faits mémorables, des personnages imposants, des incidents singuliers et poétiques, c’est surtout dans l’histoire des provinces dont la nationalité énergique a résisté à tous les changements, à toutes les révolutions qu’amènent la marche des évènements et le cours des siècles. Dans la persuasion où nous étions donc que, cette fois, la prédilection du public était déterminée par des motifs sérieux, et qui devaient en assurer la continuité, nous avons tenté, d’après l’avis et les inspirations d’un guide en qui nous avons toute confiance, de concourir, par une œuvre modeste, à ces laborieuses et patriotiques études, entreprises de toutes parts autour de nous. Le but proposé à nos efforts était de rassembler et de décrire ces antiques et persévérantes traditions qui sont une des richesses les plus poétiques de notre province. Ce sujet n’avait été traité jusqu’alors qu’accidentellement et d’une manière tout épisodique ; la recherche des faits véritables et le dépouillement des archives historiques ayant suffi pour absorber les préoccupations de nos savants compatriotes.
Cependant, la matière qui s’offrait à notre étude était si vaste, qu’il eût fallu des labeurs de Bénédictin pour l’épuiser. En effet, si nous nous fussions mise en peine de recueillir tous les récits traditionnels qui ont cours dans nos campagnes, chaque village eût pu nous fournir assez de documents pour remplir un volume. Aussi n’était-ce pas de cette manière que nous devions chercher à compléter notre œuvre ; mais, comme ces innombrables historiettes ne sont, en définitive, que des variantes, plus ou moins piquantes, de certains thèmes superstitieux faciles à développer, nous avons pu nous contenter d’exposer au lecteur ces données fondamentales, en y ajoutant d’assez nombreux spécimens des fabuleux récits qui s’y rattachent, pour que l’idée dominante en soit aisément appréciée. Toutefois, comme notre ouvrage admet plusieurs divisions indépendantes les unes des autres, il est peut-être à propos d’expliquer ici en quoi consistent ces différentes parties, afin que nos lecteurs puissent se former, dès l’abord, une idée exacte du développement de notre sujet.
Les trois premiers chapitres de ce livre sont consacrés à l’histoire de trois ducs fabuleux auxquels nos premiers chroniqueurs ont donné place dans les annales normandes, et dont le souvenir, maintenu par cette autorité, est demeuré longtemps populaire dans notre province.
Dans les chapitres subséquents, nous nous sommes occupées, en particulier, de chacune des superstitions qui ont cours dans notre contrée, et nous avons reproduit quelques-uns des contes suggérés par ces merveilleuses croyances, en apportant le plus grand soin à ne pas dénaturer, par de faux embellissements, les incidents traditionnels dont il était fort important, en effet, de conserver l’authenticité. Une autre section de notre ouvrage comprend un certain nombre de légendes religieuses, et le choix que nous en avons fait, au milieu des immenses recueils de nos agiographes, a été motivé par des raisons que nous expliquerons en leur lieu. Viennent ensuite toutes les versions singulières, toutes les opinions controuvées qui se sont répandues à propos de l’origine de nos villes normandes ; toutes les particularités étranges ou miraculeuses qui se rattachent à l’histoire des personnages célèbres de notre province. Nous terminons, enfin, par un certain nombre de traditions romanesques ou merveilleuses, qui se distinguent par un intérêt spécial de localité, et qui n’ont plus, par conséquent, de rapport direct avec les croyances communes à toute la contrée.
Malgré l’étendue de ce sujet, malgré les considérations sérieuses qu’il devait nécessiter, nous nous sommes hasardées à l’explorer, parce que, à quelques égards du moins, nous n’étions pas inexpérimentées sur ce terrain. Nos relations, nos habitudes, notre éducation même, nous avaient prédisposée déjà à traiter ce genre d’ouvrage, car nous avons toujours vécu près du peuple ; de bonne heure, tous les vieux contes que le peuple se plaît à redire, nous ont été familiers ; nous les avons aimés, nous y avons cru, et si, depuis longtemps, notre raison s’est affranchie de cette crédulité, notre imagination se remet facilement sous le joug. Cependant, il nous restait à compléter, par quelques études scientifiques, nos connaissances sur cette matière ; mais c’est de ce côté surtout que nous avons à nous féliciter d’avoir été parfaitement secondée. Le zélé Conservateur de la Bibliothèque publique de Rouen, à qui ses fonctions fournissent des occasions journalières d’utiliser, au profit de chacun, les ressources de son savoir aussi étendu que diversifié, a dirigé et facilité nos recherches, encouragé nos efforts, surveillé les progrès de notre travail, avec tout le discernement scrupuleux du critique et le dévouement inépuisable de l’ami. Quelques personnes, à qui nous sommes heureuses de pouvoir témoigner hautement ici notre reconnaissance, entre autres M. A. Canel et M. Fallue, tous deux auteurs de plusieurs ouvrages normands fort estimés, et M. Thinon, avocat, ont recueilli à notre intention, avec une complaisance toute spontanée, plusieurs renseignements locaux et des traditions inédites qui ne peuvent manquer d’ajouter à l’intérêt de notre recueil.
Avec le concours de circonstances aussi favorables, il semble qu’il nous restait peu de chose à faire pour atteindre au succès, et cependant, combien sommes-nous encore incertaines d’avoir pu le mériter. Nous apprécions, aujourd’hui, par nous-même, que si de bons matériaux sont indispensables pour faire un bon ouvrage, ils n’y suffisent pas toujours, et que si d’intelligents conseils peuvent ajouter beaucoup à la perfection d’une œuvre, ils ne sauraient en changer la valeur intrinsèque. Il y a, en effet, trois qualités principales de l’écrivain, qui, au-dessus d’une certaine limite peu difficile à atteindre, deviennent presque incommunicables ; c’est la pensée, le style et le goût.
Nous devons encore un témoignage de reconnaissance aux artistes qui ont contribué au modeste ornement de ce volume. Nos lecteurs apprendront avec intérêt que la plupart des lettres ornées qui décorent le commencement des chapitres, ont été dessinées par notre regrettable compatriote, M. E.-H. Langlois. M. G. Morin, directeur de l’École municipale de peinture de Rouen, et M. A. Drouin, ont bien voulu compléter cette série intéressante et toute spéciale, dont le burin justement célèbre de M. Brevière a traduit avec bonheur la piquante originalité.
Nous n’aurions peut-être pas acquitté toutes les délicates obligations que nous avons contractées, si nous n’ajoutions ici un sincère remerciement à M. N. Periaux, pour les soins vigilants qu’il a apportés à surveiller l’exécution typographique de notre ouvrage. En province, la publication d’un livre d’une certaine étendue étant souvent considérée comme une laborieuse entreprise, notre peu d’expérience eût sans doute accru nos perplexités, si cet habile typographe, et M. A. Péron, son digne successeur, ne nous fussent venus puissamment en aide.
Le moment est opportun, il nous semble, pour réunir toutes les parties éparses de ce vaste historial qui embrasse, avec les récits fabuleux de la tradition, toutes les antiques et fausses croyances du peuple. À mesure, en effet, que l’esprit des masses secoue le joug des préjugés, et qu’il se débarrasse des vaines rêveries de la superstition, on met autant de soin à désapprendre, à oublier les enseignements traditionnels, qu’on en apportait naguère à les retenir et à les conserver. Bien plus, si vous interrogez présentement, sur cette matière, les habitants de nos campagnes, il s’en trouvera beaucoup, parmi eux, qui interpréteront votre innocente curiosité comme une mordante raillerie, et qui refuseront même, avec dédain, de vous communiquer quelques-uns de ces contes naïfs dont ils étaient jadis les infatigables propagateurs. C’est que le peuple, assez bon raisonneur déjà pour être frappé des erreurs de fait qui constituent toutes les croyances superstitieuses, n’est pas encore assez fort d’intelligence pour atteindre aux aperçus scientifiques et moraux qui se peuvent découvrir dans les antiques traditions, et qui en font un si curieux et si intéressant sujet d’examen.
Ce que nous venons de faire observer ici, à propos du peuple, nous le dirions volontiers du commun des lecteurs. Combien, en effet, se rencontre-t-il encore de bons esprits qui ne savent trop ce qu’ils doivent penser des superstitions populaires : tantôt les considérant seulement comme de bizarres imaginations, venues on ne sait d’où, ni comment, et dont la puérilité doit écarter, d’ailleurs, toute idée d’en faire l’objet d’une enquête sérieuse ; tantôt, au contraire, leur accordant assez d’autorité, non pour les admettre d’une manière absolue, mais pour reconnaître, au moins, en elles, les preuves confuses d’une action surnaturelle et mystérieuse, à laquelle on croit vaguement, sans se préoccuper de bien définir en vertu de quelle cause et par quels moyens elle a dû se produire.
D’où naît donc cette instabilité d’opinion, cette fluctuation de sentiment à propos d’une question qu’il semble, en quelque sorte, du devoir du bon sens d’approfondir, et sur laquelle un esprit judicieux doit se trouver en état d’établir une solution nettement motivée ? C’est que, toutes les fois que des personnes, exemptes d’une habituelle crédulité, se trouvent ramenées à l’examen de quelques faits qui se rattachent aux superstitions populaires, elles jugent ces faits isolément, et comme existant dans une complète indépendance de toute combinaison systématique ; c’est-à-dire qu’elles ne se mettent pas en peine de savoir si ces incidents merveilleux, qui appellent leur attention, ne se relient point à une quantité considérable d’autres fables qui ont de profondes ramifications dans le passé religieux des peuples. En un mot, c’est faute de bien connaître l’origine, la base, le mobile des croyances superstitieuses, que l’on se forme, au sujet des faits qui en dépendent, des opinions erronées : soit, ainsi que nous l’avons dit plus haut, qu’on les regarde comme des fantaisies insolites de l’imagination, n’ayant aucun point de ralliement et de contact avec la raison humaine ; soit qu’on les envisage comme des révélations presque insaisissables, comme des manifestations voilées d’un principe mystérieux : Dieu, Satan, l’âme, ou, dans un sens matériel et restreint, le principe vivifiant, c’est-à-dire la force agissante et secrète de la nature.
Dans le cours de l’ouvrage auquel ces pages servent d’introduction, nous avons essayé de déterminer l’origine particulière de chacune des superstitions dont nous avions à traiter : de la croyance aux fées, aux lutins, aux animaux fantastiques, etc. ; mais, afin que ces définitions spéciales trouvent l’esprit du lecteur bien préparé, il est bon de les faire précéder ici de quelques considérations d’une nature plus générale, ayant pour but la recherche des causes immédiates qui ont dû, dans tous les lieux, et à toutes les époques du passé, donner naissance à une croyance superstitieuse, contribuer à son développement, ou amener sa décadence.
Si l’on veut arriver à se former des idées exactes sur cette matière, il faut, avant tout, se pénétrer de cette observation : qu’aucune croyance superstitieuse n’est le fait de l’invention spontanée, ni d’un individu, ni même d’un peuple. Toutes, elles se sont développées à la suite d’un système religieux quelconque, dont elles sont le complément ou plutôt la déviation. Leur autorité s’est mesurée toujours d’après celle du dogme fondamental ; et, lorsque celui-ci est venu à s’écrouler, on a vu ces mystérieuses croyances disparaître et s’anéantir peu à peu, et les nombreux miracles, qui en étaient les manifestations sensibles, ont cessé de prendre place dans l’histoire des peuples.
Afin de mettre les faits en rapport avec nos assertions, examinons quelle a été la marche décroissante des préjugés superstitieux, aussi bien dans notre province que dans le reste de l’Europe. N’est-ce pas, parmi ces croyances et ces doctrines occultes, celles qui se rattachaient aux dogmes du paganisme, qui, les premières, ont succombé ? À la vérité, le peuple les a conservées dans sa mémoire, même jusqu’au temps présent ; mais, depuis de longs siècles déjà, il a cessé d’obéir à leur impulsion dans ses actes de piété et de conscience. Ainsi, à mesure que les idées chrétiennes ont pris un ascendant plus réel sur les esprits, le culte des monuments druidiques a été graduellement négligé, et l’influence miraculeuse que l’on attribuait à ces pierres sacrées, a été transportée à d’autres simulacres, dont le choix appartenait à une dévotion mieux éclairée sans doute, mais non absolument exempte d’erreur. De même, parmi les êtres surnaturels qui prétendaient, croyait-on, à régenter la race humaine, quels sont ceux qui ont acquis un empire plus étendu, qui ont le plus occasionné, par la foi qu’on leur ajoutait, de troubles funestes et d’épouvantables catastrophes ? N’est-ce pas la sombre phalange des démons armés de cornes et de griffes ? Il est même certain que, sans leur alliance intime avec l’enfer, les fées, les lutins, les sylphes, et toutes les divinités des bois et des eaux, que nous avaient léguées les mythologies païennes, se seraient dispersées sans retour devant les anathèmes du christianisme. Seul, le patronage de Satan les a sauvés, et c’est parce que ces dieux vaincus se sont transformés en démons, qu’ils sont demeurés si longtemps, pour la multitude, un objet de terreur et d’embûches. Enfin, pour compléter notre démonstration, envisageons ce qui subsiste encore de ces erreurs, à l’époque actuelle. Quelles sont les superstitions qui nous ramèneraient le plus facilement sous leur joug, et que notre esprit, dans ses accès de crédulité, admettrait de préférence ? Ce sont, sans doute, les fausses et mystérieuses doctrines qui tiennent de plus près au dogme chrétien, telles que les croyances relatives aux sortilèges et aux apparitions des morts. Pourquoi ? C’est qu’un peu de foi chrétienne habite encore parmi nous, et que la superstition est une conséquence presque inévitable de la foi.
Il résulte de ce rapide aperçu, et un examen plus approfondi le mettrait encore mieux en lumière : que les croyances superstitieuses, malgré leur excessive ténacité et leur étonnante persévérance, subissent sans cesse de notables modifications par l’influence du système religieux qui régit les esprits et les consciences. Or, la transformation des idées superstitieuses étant toujours accompagnée de celle des faits merveilleux qui sont dans leur dépendance, il faut en conclure, par une observation sagement sceptique, que la foi engendre les miracles bien plus souvent encore que les miracles n’engendrent la foi.
Toutefois, notre intention n’est pas de nier absolument qu’une action surnaturelle ne puisse mêler sa participation miraculeuse aux évènements de ce monde. À Dieu ne plaise que nous tranchions, de notre propre autorité, une question aussi élevée, aussi difficile à pénétrer, et qui attaque, jusque dans leurs fondements, toutes les religions établies. Mais aucun esprit sérieux ne refusera de convenir avec nous qu’il doit être, au moins, dans l’ordre de la Providence, que les véritables miracles soient d’une extrême rareté. Cependant, la masse des faits merveilleux, que les superstitions présentent à leur appui, est devenue incalculable ; de sorte que leur multiplicité est encore une des circonstances qui nuisent à leur vraisemblance. Il devient donc à peu près inutile, lorsque ces traditions ne reposent pas sur un fait physique parfaitement appréciable, de leur chercher une base de réalité positive ; tandis qu’il est facile d’expliquer par quelles dispositions inhérentes à l’esprit humain, et que peut seule combattre une raison très éclairée, tant de préjugés étranges arrivent à se produire dans le domaine de la foi, et par quelle force innée du sentiment populaire ils se maintiennent, se consolident et se perpétuent.
L’organisation intellectuelle de l’homme fut, sans doute, la même à tous les âges du monde. Rien ne porte à croire qu’elle soit susceptible d’éprouver ces changements essentiels qui amèneraient en elle d’éminents perfectionnements ou de profondes, altérations. Mais le jeu des facultés humaines, quoique dépendant toujours des mêmes organes, admet cependant une admirable diversité. Le mobile intellectuel et moral des opinions populaires peut donc subir des variations sensiblement marquées, suivant le progrès des siècles et de la civilisation. Ainsi, de nos jours, ce ne sont plus, ni les révélations prestigieuses de l’imagination, ni les inspirations entraînantes du sentiment, qui prédominent sur nos opinions et nos croyances. Loin de là, les idées abstraites sont les seules dont nous reconnaissions l’autorité. Il n’en a pas toujours été ainsi : pour préparer les masses à la perception de cet ordre supérieur d’idées, il n’a fallu rien moins que le rude exercice de la scolastique du Moyen Âge, auquel, à la vérité, la foule ne participait pas, mais qu’elle observait de loin, et dont elle acquérait, à son insu, les principes et l’expérience.
Cependant, cette incapacité primitive des masses à se pénétrer des idées dépourvues de toute enveloppe sensible, fut la cause déterminante de la plupart des inventions populaires. Quelque simples et faciles que fussent les déductions des systèmes religieux établis par ses législateurs et par ses prêtres, le peuple ne parvenait à se les assimiler qu’en les personnifiant sous mille formes plus ou moins ingénieuses, poétiques ou bizarres. C’est ainsi qu’ont pris naissance les divinités mythologiques, entre autres celles qui appartiennent à la Grèce et à la Scandinavie, et qui, nous étant aussi les mieux connues, peuvent nous expliquer, par le langage de leurs attributs, les idées particulières qu’elles étaient chargées de représenter.
La même opération de l’intelligence, ou plutôt de l’imagination, par laquelle le peuple personnifiait les systèmes, le conduisait ensuite à matérialiser les symboles. Ainsi, le symbole oral, au lieu d’être pris dans un sens figuré, se transformait en un récit merveilleux, mais supposé véridique, que la tradition propageait quelquefois sur tous les points de l’univers connu ; le symbole hiéroglyphique, cessant bientôt aussi d’être envisagé sous ses aperçus emblématiques, apparaissait tout simplement comme la représentation d’un être extraordinaire auquel la crédulité laissait prendre place dans la nomenclature des espèces animées. Ces observations sont basées sur les faits ; et si nos lecteurs veulent bien les conserver dans leur mémoire, ils auront occasion de les vérifier amplement, lorsque nous arriverons à traiter de l’origine des animaux fabuleux, et de certaines traditions analogues, dont plusieurs se rattachent au merveilleux chrétien.
Lorsqu’on étudie les superstitions anciennes, on est souvent frappé de l’identité fondamentale de certains traits fabuleux, et de la ressemblance caractéristique de quelques personnages divins, qui ne sont point originaires, cependant, des mêmes contrées, et qui n’appartiennent pas aux mêmes mythologies ; mais cette similitude s’explique facilement, si l’on considère que les différents systèmes du paganisme, d’où sont issus ces personnifications et ces symboles, ne sont pas séparés par de profondes démarcations, puisque tous consistent dans un panthéisme assez grossier. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que ces Dieux anciens se soient mutuellement acceptés, lorsqu’ils se sont rencontrés sur les mêmes points de territoire, ainsi que cela est arrivé lors de l’occupation des Gaules par les Romains. On comprendrait moins facilement comment les peuples convertis au Christianisme ont pu conserver si longtemps leurs traditions idolâtres, si l’expérience ne prouvait tous les jours que les attaques de la raison sont quasi imposantes contre cette force du préjugé, qui est toute de sentiment et d’habitude. Aussi, les premiers apôtres de l’Évangile, qui avaient la véritable intelligence de leur mission, se préoccupèrent bien moins, pour détacher les nations du culte païen, de nier l’existence des faux Dieux que de les vouer à l’exécration publique, en les représentant comme les principes instigateurs de l’erreur et du mal.
Au reste, cette propension d’une société nouvelle à accepter l’héritage superstitieux des peuples qui l’ont précédée ; à retenir les fantômes d’une religion tombée, pour les associer avec d’autres créations tirées de son propre culte, est-elle seulement le résultat de la faiblesse de l’esprit humain, un signe humiliant qui témoigne de son imperfection ? Ne doit-on pas y voir, plutôt, un trait caractéristique qui dénote combien sont universelles les facultés de l’âme ? N’y a-t-il pas là une sorte d’éclectisme d’imagination et de sentiment, qui précède, dans la vie des peuples, l’éclectisme de l’intelligence, degré suprême de la sagesse humaine ? En effet, dans l’impuissance où nous sommes de posséder la vérité autrement que par division et mélange, le vide de notre cœur, aussi bien que les profondeurs de notre pensée, doit être un asile ouvert à tous les Dieux bienfaisants et persécutés.
En même temps que, dans les époques anciennes, la crédulité dénaturait les faits de l’ordre intellectuel et moral, l’ignorance mésinterprétait ceux de l’ordre physique, et trouvait, par là, de nouvelles combinaisons pour agrandir la sphère du merveilleux. La partie descriptive des croyances superstitieuses s’est enrichie assurément de certaines observations tirées du monde matériel, et que le peu de lumières que l’on possédait alors sur les sciences naturelles, ne permettait pas de rattacher à de saines et judicieuses théories, mais dont on cherchait le point de ralliement dans les données mythologiques. Ainsi, tous les effets étranges et douloureux, produits par le cauchemar ou les hallucinations fiévreuses, sont parfaitement reconnaissables dans la description des circonstances miraculeuses qui, suivant le peuple, signalent les apparitions des morts et les visites des lutins ; ce sont des voix au timbre aigu, qui se font entendre pendant le sommeil, et qui provoquent un réveil subit ; c’est un poids oppressant qui brise la poitrine du dormeur, un lit qui se soulève et change de place, des meubles qui s’entrechoquent et se renversent, sans qu’il reste le lendemain cependant aucune trace de dégât ou de bouleversement. De même, dans toutes ces fascinations perfides dont les Fées et les Dames blanches entourent le voyageur solitaire qu’elles rencontrent sur la cime des monts, au milieu des vastes plaines, au bord des bois et des torrents, il y a une image très frappante du vertige physique et moral qui s’empare souvent de l’homme en présence de la nature. Mais, tous ces faux prestiges des sens et de l’imagination, dont nous avons appris à triompher si facilement à l’aide de quelques calmes insinuations de la raison, se trouvaient augmentés jadis par l’influence de la peur, cette émotion fatale que tout concourait, alors, à produire et à développer.
Si l’on se reporte, en effet, au milieu d’une civilisation imparfaite comme celle du Moyen Âge, il sera facile d’imaginer combien de piégés étaient dressés aux inquiétudes d’un esprit superstitieux. C’est que tout alors était dangers et confusion : quelque chose d’inextricable, qui embarrassait la sphère des idées, se présentait de même sur chaque point de la surface du monde matériel. Sans franchir les limites de notre province, croyez-vous que la Normandie offrît aux regards, comme maintenant, des plaines immenses, couvertes de moissons, parées çà et là de quelques riches bouquets de bois, et couronnées de collines aux pentes assouplies. Non ; même dans notre opulente patrie, la main laborieuse du défricheur n’avait pas encore arraché les ronces et les épines semées par la malédiction originelle. La misère du peuple ne traçait, sur cette terre fertile, qu’un sillon pénible et trop souvent dévasté. À côté des luttes du travail, se décelaient de toutes parts les détresses de l’impuissance, laissant à peine se manifester un rare et noble succès. Auprès de ces monuments de victoire du génie de l’époque : les châteaux, les églises, les monastères, il y avait des marais insalubres, des rivières débordées, des plaines incultes, des collines hérissées, et des forêts envahissantes ; tout cela, en quelques endroits, luxueux et paisible dans le laisser-aller de son indépendance sauvage, mais, en d’autres parties, attaqué, rompu, bouleversé, en un mot, offrant tous les stigmates d’une misère rebelle et tourmentée. Imaginez, de plus, au milieu des effondrements de cette terre en travail, les désastres de l’hiver et les embûches de la nuit, et vous comprendrez facilement combien, sous l’influence de telles circonstances, les évocations de la peur devaient être empreintes d’une puissante magie.
En effet, plusieurs superstitions, auxquelles a donné lieu l’observation de certains faits physiques et extraordinaires ou seulement inconnus, sont remarquables autant par la singularité et par l’éclat de leurs détails descriptifs, que par l’interprétation éminemment religieuse que nos pères ont tirée de ces problèmes de la nature. Nous citerons seulement, comme exemple, la superstition des chasses fantastiques, à laquelle nous avons consacré un des chapitres les plus étendus de cet ouvrage. C’est que le peuple, dont les facultés instinctives se développaient par le progrès naturel des siècles, aidé de l’influence civilisatrice du génie chrétien, était parvenu quelquefois à donner à ses inventions superstitieuses le double caractère d’une haute conception poétique : d’une part, comme nous l’avons dit, en revêtant les idées abstraites d’une image sensible qui les caractérisait ingénieusement, et les rendait plus frappantes et plus saisissables ; de l’autre, en découvrant, sous l’enveloppe des faits matériels, de délicates et mystérieuses analogies avec les mondes de la pensée et du sentiment.
Ce n’est donc pas, selon nous, par le prestige merveilleux qui s’y rattache, que les superstitions populaires sont vraiment dignes d’exciter l’attention et de provoquer l’intérêt, puisque ce prestige est d’autant plus près de se dissiper complètement, que l’on arrive à une connaissance plus exacte des véritables éléments dont se sont formées ces traditions miraculeuses ; mais, outre les curieuses recherches historiques auxquelles ces fables antiques doivent donner lieu, elles constituent aussi le thème le plus favorable qui puisse être soumis à l’observation, pour arriver à constater les tendances natives des facultés humaines. Comment, en effet, ces créations imaginaires que le peuple a sans cesse modifiées suivant ses idées dominantes ou sa fantaisie du moment, ne porteraient-elles pas l’empreinte profonde de son génie ? Or, qui dit le peuple, surtout à ces époques d’inspiration, dit aussi l’humanité, dans toute la franchise de ses sentiments innés et de ses instincts primitifs.
Que ceux, donc, d’entre nos lecteurs, qui se seraient sentis disposés jusqu’alors à accueillir avec dédain les récits traditionnels, s’efforcent de prêter, à ceux dont nous sommes l’humble et fidèle narratrice, une attention plus sympathique, et nous sommes persuadée qu’ils découvriront, dans ces fables qui ne semblent, au premier aspect, qu’un tissu d’inconséquences et de puérilités, bien des significations intéressantes, que nous-même n’avons pas prévues, et que nous n’aurions su signaler. Peut-être arriveront-ils à trouver enfin, dans ces inventions fabuleuses, matière à observations et à enseignements, aussi bien que dans les pages les plus véridiques de l’histoire. En effet, les émanations divines de nos âmes s’échappant pour ainsi dire à notre insu, tout ce qui nous touche en retient quelque chose, et notre liberté aveugle ignore toujours où nous avons le plus semé. C’est pourquoi il peut y avoir autant de l’esprit d’un siècle dans une humble légende, que dans ces évènements laborieux au service desquels une nation entière s’est efforcée d’employer toutes les ressources de son activité et de son génie.
Sur la Chronique romanesque des premiers ducs : Aubert, Robert-le-Diable et Richard Sans-Peur. – Tentatives essayées pour retrouver dans l’histoire les prototypes de ces héros fabuleux
« Combien que les Croniques de Normendie font mention que Rou fut le premier duc de Normendie, aucunes escriptures nous racontent qu’au temps du roy Pepin, père du roy Charlemaine, qui lors gouuernoit le pays de Neustrie, qui, à présent, est appelé Normendie, fut vng duc qui auoit à nom Aubert. Cestui Aubert auoit vng chastel auprès de Rouen, que len appelloit Tourinde, et est ledit mont où il seoit en commun langage (appelé) Turingue. »
Tel est le début d’une ancienne chronique normande ; et ce peu de lignes, si humbles de ton, et si complètement dépourvues de prétention scientifique, renferment tout ce que les investigations d’une critique laborieuse ont pu jusqu’alors nous apprendre de certain sur le plus ou le moins de réalité historique du duc Aubert et de ses descendants : Robert-le-Diable et Richard Sans-Peur.
Cependant, pour la plupart de ceux qui se sont enquis des premiers éléments de notre histoire, cette généalogie, si poétiquement fameuse, n’est autre chose qu’une superfétation romanesque de l’invention des Trouvères et des Chroniqueurs.
En effet, aucun des grands chroniqueurs de la première période : Dudon de Saint-Quentin, Guillaume de Jumiéges, Orderic Vital, Robert Wace, Henry de Huntington, Benoist de Sainte-More, n’a mentionné l’existence de ces ducs fabuleux. Ce n’est qu’à dater du XIVe siècle qu’on trouve leurs faits enregistrés au début des petites Chroniques de Normandie.
Mais, quelque fausse et controuvée que soit leur légende, tant par les faits que par la chronologie, Robert-le-Diable et Richard Sans-Peur n’en ont pas moins, dans l’opinion d’un grand nombre de nos critiques modernes, une sorte de réalité historique, en ce sens que l’on croit pouvoir retrouver leurs prototypes, comme celui de beaucoup d’autres héros de la romancerie, parmi les personnages de l’histoire.
Là gît cependant une énorme difficulté, sur laquelle les critiques n’ont pu encore s’entendre. Lorsqu’on veut attribuer une réalité historique à un héros fabuleux, il faut savoir indiquer son véridique représentant par un signalement irrécusable. On a souvent tenté de semblables démonstrations à propos de Robert-le-Diable, mais avec cette erreur de conclure d’une quasi vraisemblance à une certitude absolue ; aussi est-il arrivé que les plus spécieux résultats des divers examens ont été ironiquement annulés par le simple effet de leurs contrastes. Robert-le-Diable compte maintenant autant de prototypes, reconnus par de savantes autorités, qu’il a d’homonymes dans le lignage ducal de Normandie. Nous serions vraiment en peine d’appuyer les droits de l’un ou de l’autre concurrent, et nous nous verrions obliger d’avouer notre insuffisance pour prendre parti dans une question débattue avec un égal succès, en plusieurs sens contraires, si nous n’avions la ressource de nous en référer à une conclusion qui se déduit tout naturellement de ces divergences. C’est qu’il est plausible que certains types de la romancerie relèvent uniquement de l’invention du poète qui les mit en action, et n’offrent, en regard des figures historiques, que cette ressemblance indéfinie que l’idéal emprunte toujours à la réalité.
L’opinion que nous émettons ici a déjà été présentée avec tant d’esprit et de science, qu’il ne nous reste rien à tenter pour la faire prévaloir. Le dernier mot de la controverse est dit ; mais c’est une obligation de notre sujet de mettre sous les yeux du lecteur l’impartial résumé de cet important débat.
Nous allons donc rétablir, par leurs principaux points, les confrontations relatives à Robert-le-Diable, en y ajoutant les observations qui leur servent de contrepartie. À l’égard de Richard Sans-Peur, et quoiqu’il offre moins de prise à la discussion, nous aurons aussi quelques remarques à consigner, qui compléteront nos réflexions générales sur cette matière.
Mais il est urgent, avant tout, de dresser la généalogie de nos ducs fabuleux ; c’est un moyen d’intéresser le lecteur à la défense de leur chimérique personnalité. En constatant les alliances merveilleuses qu’ils ont contractées avec les races imaginaires de la romancerie, on sera moins empressé, peut-être, à tenter de replacer ces héros de la légende normande parmi les vivantes catégories de l’histoire.
C’est en l’année 751 que le duc Aubert tenait la Neustrie, comme vassal du roi Pépin. Il prit alors pour femme Inde, sœur du duc de Bourgogne, dont il eut un fils, Robert-le-Diable, célèbre par ses épouvantables méchancetés et ses crimes malicieux. Après le décès de sa femme Inde, le duc Aubert se remaria avec Berthe, une des nièces de Dolin de Mentuel, de Girard de Roussillon, et de Aymes de Dourdonne, extraits du noble lignage de Dolin de Mayence. Berthe donna au duc Aubert un second fils, Richard Sans-Peur, qui eut la survivance du duché de Normandie. Il fut l’un des douze pairs de France, si célèbres dans les annales romanesques du cycle Carlovingien.
Il existe une différence marquée entre cette généalogie, que nous trouvons consignée dans les anciennes chroniques, et celle que nos Trouvères ont adoptée dans le roman poétique de Richard Sans-Peur, si nous nous en rapportons aux versions manuscrites conservées jusqu’à nous, mais qui ne sont point, il y a lieu de le croire, la rédaction primitive. Richard Sans-Peur, disons-nous, est désigné, dans le roman qui porte son nom, comme le fils, et non comme le frère de Robert-le-Diable.
Peut-être ne faut-il pas prendre cette variante en trop grande considération ; il se pourrait qu’elle ne fût qu’une licence poétique due à quelque caprice d’auteur.
Le roman de Robert-le-Diable est entaché d’une faute d’un autre genre : il omet de mentionner le nom des ascendants de son héros. Ces capricieuses négligences de poète n’étaient sans doute que pour laisser le champ plus libre aux ingénieux paradoxes, aux spécieuses inductions, aux conjectures métaphoriques, qui sont les menus plaisirs de la science.
Nous avons dit que Robert-le-Diable comptait autant de prototypes supposés qu’il a d’homonymes dans la lignée des ducs de Normandie. Ces homonymes sont au nombre de trois : le premier en date est Rollon, qui reçut à son baptême le prénom chrétien de Robert. Entre la légende de Robert-le-Diable et l’histoire de Rollon-le-Pirate, se trouve un point de similitude remarquable : le fait d’une conversion religieuse, d’une transformation morale, accomplie avec un merveilleux héroïsme. De ce fait principal résulte, pour l’ensemble du rapprochement, un rapport de concordance qui disparaît bientôt à l’examen des détails ; car, dans les nombreuses aventures appartenant à l’histoire de l’un ou de l’autre personnage, il n’y a pas le moindre trait de ressemblance à noter. Aussi, quoique la plupart des critiques anglais se soient déclarés en sa faveur, Rollon est loin d’avoir obtenu un triomphe complet sur ses deux concurrents.
Robert I, ou le Magnifique, a pour lui la majorité des suffrages. Voyons cependant sur quoi se fondent des prétentions si facilement acceptées. Les exploits audacieux de Robert I, son caractère cruel et farouche, mais puissant dans tous les excès contraires, ses crimes sacrilèges, ses résipiscences superstitieuses couronnées par son pèlerinage en Terre-Sainte, et sa mort au retour, paraissent autant de signalements précieux auxquels on pourrait reconnaître, en effet, le véridique représentant de Robert-le-Diable. Malheureusement, cette confrontation ne saurait être complète, l’histoire nous refusant certains détails sur la jeunesse de Robert I, qui ont une trop grande importance dans la vie du fabuleux héros, et qui tiennent trop de place dans la légende, pour qu’il soit permis de les négliger comme une superfétation oiseuse.
C’est, d’ailleurs, à l’aide de ces premières données biographiques que l’on peut faire valoir les droits du troisième concurrent : Robert Courte-Heuse. Pour celui-ci, les turpitudes de sa jeunesse, ses impiétés filiales, sa révolte à main armée contre l’autorité de son père, en font bien le digne pendant de Robert-le-Diable, à la première époque de sa destinée maudite. Puis, aussi, la duchesse Inde personnifie, dans les anxiétés de son amour maternel, un caractère de douleur noble et religieuse, qui remet en mémoire la physionomie historique de la reine Mathilde. Mais la conclusion dégradante de l’histoire de Robert Courte-Heuse n’est point en rapport avec la brillante terminaison du roman qui relève Robert-le-Diable jusqu’à la sainteté.
Nous n’insisterons pas davantage sur les inexactitudes de ces divers parallèles, car ce sont leurs rapprochements même qui nous font considérer la personnification de Robert-le-Diable comme étant le moule d’un type général, plutôt que le calque d’un personnage isolé. On en pourrait dire autant de tous les héros de l’ancienne romancerie ; ils n’ont point de personnalité historique ; s’ils empruntent à l’histoire un nom fameux, ce nom perd sa signification, appliqué à un personnage dont le caractère est chimérique et les actions fabuleuses. C’est que les romanciers du Moyen Âge n’étaient pas des historiographes, mais des poètes. Ils connaissaient déjà ce secret de l’art, qui consiste à dissimuler les individus pour mieux représenter l’espèce, à déguiser la réalité des faits, afin de peindre plus largement la vérité des mœurs. Leur œuvre n’était donc pas un monument historique, mais un drame humanitaire, si l’on peut prêter à cette épithète un sens rétrospectif applicable à la société fractionnée sous le régime de la féodalité.
Pour achever cette démonstration, voyons quels nouveaux éclaircissements nous seront fournis au sujet de Richard Sans-Peur. Ici, du moins, nous ne serons pas embarrassés par la confusion des prototypes. La relation établie entre le Richard des romanciers, et Richard I, troisième duc de Normandie, date de trop loin pour qu’on tente de la détruire au profit d’un autre concurrent. Les chroniqueurs du douzième siècle, Wace, Henry de Huntington, Benoist de Sainte-More, etc., attribuent, en effet, à Richard I, les principaux faits merveilleux qui composèrent, dans la suite, le roman de Richard Sans-Peur. Où donc avaient-ils puisé ces fables ? Sans doute, elles étaient empruntées aux récits des Trouvères, puisqu’on ne les trouve pas chez les historiens antérieurs, en remontant jusqu’à Dudon de Saint-Quentin, qui fut presque contemporain de Richard I ; non plus que l’épithète de Sans-Peur, dont on ne paraît avoir qualifié ce duc que du moment qu’on l’a confondu avec un personnage fabuleux. Mais les Trouvères, en composant les fables dont se sont emparés les chroniqueurs, avaient-ils en vue quelque patron historique ? Nous ne pouvons encore admettre cette supposition à l’égard du roman de Richard Sans-Peur, car il ne s’y rencontre pas un seul fait relatif à l’histoire véridique de Richard I. Cependant, l’établissement du monastère de Fécamp y est mentionné ; mais ce détail, comme tous ceux qui ne tiennent point à la contexture du drame, est de peu de valeur, parce qu’il a pu se glisser aisément dans une des recompositions de l’œuvre primitive. Doit-on s’étonner, au reste, de voir les chroniqueurs du douzième siècle transposer, de leur plein droit, du roman dans l’histoire, quelques récits fabuleux, lorsque, deux siècles plus tard, les auteurs de la petite Chronique de Normandie, par une étourderie toute naïve, racontent ces mêmes faits en partie double, c’est-à-dire en les attribuant à la fois au fabuleux Richard Sans-Peur, fils du duc Aubert, et à son véridique homonyme Richard, fils de Guillaume Longue-Épée.
On prétendra peut-être que c’est faire remonter trop haut la rédaction primitive du roman de Richard Sans-Peur, que de la supposer antérieure au moins à la seconde moitié du douzième siècle. Cependant, cette opinion se justifie facilement, si l’on considère que, dès le commencement du treizième siècle, la légende de Richard Sans-Peur, enrichie de sa fausse chronologie, jouit déjà d’une assez grande popularité pour que les traditions étrangères se plaisent à s’y rallier et à se réclamer de sa parenté. Plusieurs romans du cycle Carlovingien : le Comte de Poitiers, les Quatre Fils Aymon, Garin-le-Loherain, citent Richard Sans-Peur comme un des douze pairs de France, et grand vassal tenant la Normandie au temps du roi Pépin.
Sans nous préoccuper davantage de ces recherches savantes et difficultueuses, pour ne rien négliger des particularités romanesques de la tradition, nous adopterons, dans l’analyse de la légende de Robert-le-Diable et de celle de Richard Sans-Peur, la chronologie fabuleuse que nous fournissent les chroniques normandes, dans toute la naïveté de leurs anachronismes.
Circonstances singulières de sa naissance. Sa cruauté se décèle dès l’enfance. Déportements et crimes de sa jeunesse ; conversion soudaine ; pénitence ; dénouements divers de la légende.
Rechercher avec trop de subtilité les idées morales qui ont présidé à ces créations poétiques, dont nous essayons l’analyse, ce serait sans doute en altérer le naturel et s’égarer dans le labyrinthe d’une métaphysique bizarre, et en dehors du sujet. Tel n’est pas notre but ; nous voulons laisser, à ces inspirations des temps anciens, l’élan et la libre allure de leur naïveté. Loin de nous, aussi, la prétention d’interpréter, dans un sens nouveau, des traditions aussi répandues que celle qui nous occupe en ce moment : le prototype de Robert-le-Diable est trop généralement compris, pour qu’il nous soit réservé de le mettre en évidence ; mais nous le commentons, à notre tour, afin de fortifier l’impression qu’il doit produire ; nous passons le crayon sur des lignes déjà tracées, pour leur prêter plus de relief et d’effet.
Cette fameuse légende de Robert-le-Diable nous a été léguée par le Moyen Âge, sous trois formes différentes : 1° comme récit historique, dans les premières pages des Chroniques de Normandie ; 2° comme poème, dans une composition intitulée : Li Romans de Robert-le-Diable, laquelle fut transformée, au XIVe siècle, en Dit ou Dité de Robert-le-Diable ; 3° comme drame, dans une ancienne moralité mystique, qualifiée : Miracle de Nostre-Dame de Robert-le-Diable. Ces trois compositions spéciales indiquent autant de versions différentes, nées de la fantaisie du poète, ou de la crédulité de l’historien. Notre récit analytique les adoptera tour-à-tour, selon qu’elles présenteront une signification plus originale ou plus frappante.
La naissance d’un héros aussi merveilleux que Robert ne pouvait manquer d’être caractérisée par quelques circonstances extraordinaires. Celles-ci nous sont expliquées par un récit qui paraphrase, d’une manière aussi singulière que naïve, cette plaintive exclamation de l’écriture sainte : l’homme né de la femme ! Voici le texte de la Chronique de Normandie : « Aduint que le duc par un jour de samedy venoit de chasser en la forest de Rouveray, et eut désir de coucher avec Inde sa femme, mais la dame voulut délayer la compaignie de son seigneur, lequel fut très fort embrasé de son amour. Et comme la dame n’osa désobéir à la volonté de son mary, par courroux lui dit que jà Dieu n’eust part à chose qu’ils fissent. Et ainsi d’iceluy duc la bonne dame conceut fruict. »
Ce fut après des douleurs qui, pour la violence et la durée, dépassèrent le cours ordinaire de la nature, que la duchesse Inde mit son enfant au monde. La malédiction sacrilège qu’elle avait prononcée sur lui commença, dès lors, à produire ses effets monstrueux ; aussi les détails de la première enfance de notre héros renchérissent-ils, en fait de puéril effrayant, sur les plus terribles contes de Croque-mitaine, sauf que, contrairement aux bonnes règles, c’est ici la scélératesse du marmot qui triomphe. Tous ceux qui s’approchent du jeune Robert sont en butte à sa sournoiserie : il bat ses nourrices, et leur mord le sein plus cruellement que ne le font les autres enfants ; les petits compagnons de ses jeux, il les accable d’outrages et leur fait endurer mille tortures.
La méchanceté grandit en s’exerçant : quand il a atteint l’âge de sept ans, pour se venger d’une réprimande que son maître d’école vient de lui adresser, il le surprend pendant son sommeil, et le tue d’un coup de couteau dans le ventre ! Ce ne sont encore là que les prémices de ses crimes : Robert parvient à la plénitude de sa jeunesse, et chacune de ses actions est un nouvel épisode de sa frénésie sanguinaire : il pille les églises, ravage les monastères, tue les maris, enlève les femmes, force jusqu’aux reclusages de filles, et, en un mot, commet tant de cruautés, que c’était merveille, dit la Chronique, que la terre ne fondait pas sous lui.
Les circonstances du récit qui précède semblent non moins extravagantes que monstrueuses : c’est qu’il y a toujours un conte de nourrice au berceau des destinées singulières. Cependant Robert, devenu homme, n’est plus déjà qu’une personnification vraie de la féodalité, dans toute l’indépendance de son caractère égoïste et féroce.
Comme toutes les choses inhérentes à la nature humaine, le mal est variable et multiforme ; aussi n’agit-il sur la vie des nations, et souvent sur celle des individus, que par phases accidentelles. Cela explique les différents degrés par lesquels la réprobation qu’il nous inspire s’atténue et en vient elle-même à se méconnaître : la haine épuisée dégénère en mépris ; l’indignation qui s’oublie, se réduit à la pitié ; bientôt le crime, en s’éloignant, prend, à nos regards désintéressés, l’aspect de la folie ; ce qui était un objet d’horreur devient un sujet de risée, et les fautes des pères sont un jouet pour l’esprit des générations nouvelles.
Voilà ce qui est arrivé pour la plupart de ces récits qui terrifiaient le Moyen Âge : nos mœurs adoucies et légalisées, notre caractère sobre et circonspect, ne peuvent en concevoir la réalité ; et cet horrible, grandi jusqu’au gigantesque, ne nous représentant que les proportions de l’absurde, nous faisons honneur à l’invention de toutes les monstruosités du vrai.
Pourtant, à travers les outrecuidances de ce merveilleux féroce, certains traits de mœurs saisissants, nous confirment un fond de réalité vivante ! Ainsi, le père et la mère de Robert se désespèrent d’avoir donné naissance à un tel fils ; mais, au milieu de sa douleur navrante, la bonne dame Inde s’avise, enfin, qu’il serait bon que Robert fût fait chevalier ; elle va trouver son seigneur, et lui dit que, par l’ordre de chevalerie, leur fils pourrait changer de conduite, et venir à résipiscence.
Si nous avons reconnu, dans les crimes de Robert, la peinture des excès de la féodalité, voici ce qui constate pour nous le mobile du progrès moral de cette puissance farouche. La chevalerie, c’est l’élément religieux introduit dans le matérialisme encore barbare de la vie suzeraine : brillante et laborieuse synthèse qui ne compléta point ses résultats, et ne fut, à vrai dire, qu’un acte de ferme propos, dont la civilisation trop faible ne put réaliser les promesses.
Cependant, Robert ne se prêta qu’avec répugnance à recevoir l’ordre de la chevalerie. La jeunesse n’est pas toujours d’accord avec les idées du progrès, si celui-ci ne favorise ses propres énergies. Notre héros ne trouva donc, dans cette cérémonie, qu’une occasion nouvelle de désordre et de cruautés. C’était protester à sa manière ! La veille des armes, au lieu de passer la nuit en prières, il s’en vint à un monastère de femmes, situé à une lieue de Rouen ; là, il choisit la plus belle d’entre ces religieuses, et, après l’avoir déshonorée, il lui trancha le sein, puis il s’en retourna fort tranquillement se recueillir en l’église de l’abbaye de Saint-Pierre, qui fut nommée plus tard Saint-Ouen de Rouen. Le lendemain, à la messe, le duc appela son fils, lui adressa une pieuse remontrance sur ses devoirs de chevalier, et lui donna l’accolade en le frappant du plat de son arme ; aussitôt, Robert, dont l’humeur sauvage mésinterprétait apparemment cette coutume, tira l’épée qu’on lui avait ceinte, et il en aurait frappé son père, si les barons qui étaient présents ne la lui eussent ôtée des mains.
Pour dernière scène de sa réception, Robert prit part à un tournoi, dans lequel il fut vainqueur des autres chevaliers ; mais, poussant le combat au sérieux, il voulait leur couper la tête à tous ; il en occit quelques-uns, et on eut beaucoup de peine à sauver les autres de sa fureur !
Après ces mutineries de fils de prince, Robert voulut jouer un personnage plus important ; il se choisit des compagnons d’armes, et alla s’établir avec eux dans le château de Thuringue, dont il fit le quartier général de ses brigandages. Ce château était situé près de Rouen, sur la colline qui domine le Val-d’Eauplet, baigné des flots de la Seine. Il ne reste aucune trace de l’antique repaire ; mais, au-dessus de la même colline, est maintenant assis ce doux refuge des pèlerins normands : la gracieuse église de Notre-Dame-de-Bonsecours.
Les excès de Robert se continuaient d’une manière effrayante ; enfin, le duc Aubert, poussé à bout par les plaintes qu’il entendait chaque jour, fit publier à son de trompe que quiconque occirait son fils Robert serait pardonné. Comme réponse à ce défi de la puissance paternelle, Robert fit crever les yeux aux messagers qui vinrent pour s’emparer de lui, et, dans ce piteux état, les renvoya à son père.
Cependant, le mal s’use à ses propres efforts ; le crime a d’horribles moments de dégoût et de lassitude. Dans une de ces alternatives où sa cruauté se dressait contre lui-même, Robert, emporté par je ne sais quel appel farouche de sa conscience, va trouver sa mère, qui habitait le château d’Arques, et, l’épée nue, prêt à frapper, il demande à celle dont il tient l’être un compte sanglant de la vie misérable qu’il a menée jusqu’alors.
Et si sa mère refuse de lui répondre, il fera boire dans sa cervelle son épée tranchante.
Cette scène, qui ne se trouve point dans la chronique, mais, seulement, dans le roman et dans le drame, est admirable de conception ; toutes les qualités dramatiques s’y rencontrent : énergie, vérité, profondeur. Robert, levant pour la seconde fois un glaive parricide, n’obéit plus ici à un instinct de fureur insensée. Au milieu de la tourmente d’une âme harassée de crimes et possédée encore de toutes les puissances du mal, n’est-ce pas un mouvement saisissant et juste que cette colère exaltée par le remords ? Ses excès même n’empêchent pas qu’elle ne relève le caractère de notre héros jusqu’à la vraisemblance morale ; plus encore, elle atteint au sublime du sentiment, car elle trahit le désespoir le mieux justifié qui se soit attaqué jamais à la fatalité des destinées humaines. En effet, si le ciel est, à son gré, ou sourd à nos plaintes, ou sensible à notre douleur, son impassibilité doit s’ébranler au moins à ce cri de la conscience violée : pourquoi suis-je si méchant ?
La duchesse Inde répond aux menaces de son fils en lui avouant quel anathème elle a prononcé sur sa naissance ! À la découverte de ce secret de malédiction, le courroux de Robert, naguère si bouillant, s’apaise, ou plutôt se fond dans une immense douleur. Et pourtant, loin de fuir, sa mère à ses pieds implore la mort en punition de sa faute.
Cette péripétie de notre légende est la dernière où la duchesse Inde joue un rôle ; mais l’on a pu remarquer déjà que le caractère de ce personnage est tracé avec beaucoup de naturel et d’intérêt : femme inconséquente, mère dévouée, Inde s’est approprié quelque chose de ces deux types divins, dont l’un résume la femme dans sa faiblesse, et l’autre dans sa gloire : Ève et Marie.
Cependant, Robert essaie de se relever de l’affaissement de son désespoir ; si la fatalité pèse sur lui, ce n’est pas, du moins ; la fatalité aveugle et implacable qui régnait sur le monde ancien ; à celle-ci, le christianisme a opposé une puissance toute salutaire : la grâce miséricordieuse !
Robert se résout donc à la pénitence, mais sa conversion est d’abord tout aussi insensée que ses crimes : notre héros débute, en effet, par un acte de prosélytisme suffisamment brutal ; il va trouver ses anciens complices, et les presse, à son exemple, d’abjurer leurs crimes et d’en implorer le pardon. Ceux-ci, peu préparés à entendre une semblable homélie de la bouche de Robert, lui répondent en le raillant, et en jurant de le surpasser encore en cruautés et en désordres. Robert, outré, les assomme alors les uns après les autres, avec une grosse massue qu’il tenait à la main. L’éloquence de notre héros n’était plus méconnaissable !
Le nouveau converti s’achemine vers Rome pour obtenir du pape l’absolution de ses péchés. Après qu’il s’est déclaré le fameux Robert-le-Diable, dont le surnom est en horreur dans tous les pays, le saint-père, émerveillé de ses dispositions repentantes, lui commande d’aller trouver un pieux ermite qui entendra sa confession et lui imposera la pénitence par laquelle il peut obtenir d’être déchargé de ses crimes et délivré des influences maudites qui le subjuguent. Robert obéit ; l’ermite, après avoir consulté le ciel, soumet le pardon de notre héros à trois conditions : il faut, premièrement, que Robert contrefasse le fou, et subisse toutes les avanies que cet état doit lui attirer ; secondement, qu’il demeure constamment muet ; troisièmement, qu’il ne prenne d’autre nourriture que celle qu’il pourra dérober aux chiens. Devant de telles exigences, le zèle de Robert ne se refroidit pas ; notre héros retourne à Rome, où il commence son rôle de fou, au milieu des clameurs et des provocations de la multitude.
Peu à peu le jeu devient cruel ; le peuple, qui a commencé par s’amuser des bouffonneries de Robert, finit par vouloir l’assommer, comme un enfant qui brise son jouet quand il en est las. Traqué de toutes parts, le pauvre pénitent se réfugie sous les degrés du palais de l’empereur. Ce prince, qui l’aperçoit, le prend sous sa protection, déclare qu’il sera son fou en titre, et préalablement commande qu’on lui donne à manger. Mais, aux termes de sa pénitence, Robert est obligé de refuser ce qui lui est offert ! Cependant, l’empereur s’avise de jeter un os de cerf à l’un de ses chiens ; aussitôt Robert se jette après le chien, l’attaque, le tiraille, et s’empare vaillamment de l’os, qu’il ronge avec une grande férocité d’appétit. Ce fameux débat achève de concilier à notre pénitent les bonnes grâces de l’empereur. Bien plus, soupçonnant quelque mystère, le prince veut qu’on dresse un lit pour son fou ; mais sa bonne volonté échoue encore une fois contre la muette résistance de Robert. Des bottes de paille sont offertes alors pour remplacer le lit ; notre héros s’étend dessus avec délices. L’empereur, qui commence à comprendre quelle sorte de régime est convenable à son hôte, recommande que la paille soit fraîchement entretenue, et que, pour l’avenir, la portion de ses chiens soit doublée. Une protection aussi spéciale n’a pas lieu de nous surprendre ; de tout temps, le ciel veille sur ses saints.
Le caractère de Robert converti n’est point entaché par la pénitence ravalante à laquelle il s’est soumis. En effet, ce n’est pas la faiblesse qui fait obédience en la personne de notre héros ; on le comprend au zèle héroïque avec lequel il accomplit sa tâche d’expiation. Cependant, il révèle encore, par là, sa nature ardente et fougueuse. Quand il abjure ses fautes, l’homme d’intelligence se domine, mais l’homme passionné se torture. De quelque côté que celui-ci se tourne, il semble qu’il ait toujours à exiger sa proie d’amour ou de haine. C’est pourquoi il faut, à sa conversion, l’enthousiasme et les douleurs du martyre, dût-il être lui-même son propre bourreau.
De même que dans le roman, la conversion de Robert-le-Diable est relatée dans la Chronique de Normandie, avec cette seule différence qu’ici tout l’honneur en est attribué à un ermite normand, qui a donné asile à notre héros après un jour de combat.
Le récit de la Chronique se tranche ensuite brusquement, en abandonnant Robert-le-Diable, devenu Robert-le-Saint, aux rigueurs d’une pénitence limitée à sept années. Inde meurt, consumée par les regrets de l’absence de son fils ; son existence est accomplie avec sa tâche de douleur maternelle.
Voilà un dénouement assez austère pour satisfaire à toutes les susceptibilités des convenances morales ! Cependant, quelques-uns de nos lecteurs, doués d’un cœur trop faible, d’une imagination trop inflammable, d’une sympathie trop facile à s’égarer, en sont venus peut-être à souhaiter une conclusion plus attrayante pour eux-mêmes, et en même temps plus avantageuse, humainement parlant, pour notre héros. Que ceux-là reprennent courage et sécurité, car, en résumant les faits du drame et du roman, nous allons trouver à répondre à leur intérêt, à satisfaire leurs dispositions bienveillantes. Grâces en soient rendues à nos trouvères normands ; préoccupés qu’ils étaient du souvenir des croisades et des expéditions en Italie, ils ont rehaussé ce conte austère et terrible par une terminaison tout éblouissante dans sa féerie orientale. Redisons, d’après eux, les incidents de la pénitence de notre héros.
L’empereur de Rome avait une fille renommée pour sa ravissante beauté ; mais, hélas ! muette de naissance. Cette jeune princesse vivait tristement, isolée et comme cloîtrée par son infirmité. Heureusement, il y a toujours quelques célestes visions pour les solitaires ! Comme elle habitait un appartement dont les fenêtres étaient situées sur le jardin du palais, la pauvre belle fille eut occasion d’examiner Robert, qui venait après chaque repas se désaltérer à la fontaine du jardin. C’était là un des rares moments où, se croyant libre de tous les regards, notre pénitent pouvait se reposer de son pénible rôle. La jeune princesse ne voyait plus alors Robert, tel qu’il était au milieu du monde, avili de dédains, souillé d’ignominies ; elle le contemplait à la face du ciel, beau de son courage et purifié de son repentir ! Les yeux sont les tyrans du cœur : regarder, c’est aimer ; aimer en silence, c’est aimer sans mesure : les paroles limitent toujours les sentiments. La fille de l’empereur aima donc Robert ; mais, pendant les premières alternatives de cette passion naissante, les Sarrasins viennent assiéger Rome ; les chrétiens, en alarmes, s’encouragent à la défense ; un combat se prépare.
Le jour où ce combat devait se livrer, Robert s’était rendu, suivant l’usage, à la fontaine du jardin ; là, il entendit une voix qui lui commandait de prendre part à la bataille, et en même temps se trouvèrent devant lui une armure blanche et un cheval blanc, dont on lui ordonnait de se servir. Robert obéit avec transport ; il court rejoindre les chrétiens, et leur prête un secours si merveilleux, qu’il parut bien que, sans sa coopération, l’empereur ne serait jamais parvenu à mettre en fuite ses ennemis. Puis, à la suite du combat, notre héros retourne à la fontaine, ôte son armure et reprend modestement ses habits de fou. Cependant, chacun se préoccupait de savoir quel était le chevalier aux armes blanches qui avait combattu si vaillamment. La fille de l’empereur seule, par privilège d’amante, avait été témoin du message céleste que Robert avait reçu. Elle tente, alors, d’instruire par signes, son père, de ce qui s’est passé ; mais il la traite de folle et la renvoie de sa présence : force est à la pauvre enfant de dissimuler encore son amour prêt à s’exalter.
Une seconde, une troisième invasion des Sarrasins ont lieu ; à chacune d’elles, Robert est appelé à combattre, et c’est toujours au milieu des mêmes circonstances merveilleuses que sa mission lui est révélée.
Il arrive aussi que l’intervention de Robert, de plus en plus efficace, sauve chaque fois l’empereur d’une ruine imminente. Ce prince, vivement reconnaissant, a recommandé à ses barons de mettre tout en œuvre pour découvrir quel est leur magnanime protecteur. Après la dernière attaque des Sarrasins, qui a été l’occasion d’une victoire décisive pour les troupes chrétiennes, les chevaliers de l’empereur se réunissent au nombre de trente dans un bois que Robert traversait pour retourner se désarmer à la fontaine. Ils veulent tenter de le surprendre. Dès qu’ils aperçoivent notre vaillant héros, ils s’écrient tout d’une voix : « Vassal, vous êtes pris ! »
Robert pique des deux, sans rien répondre. Ils s’élancent à sa poursuite, la lance baissée, prêts à frapper son cheval, s’ils peuvent l’atteindre. Mais Robert gagne de vitesse sur eux ; bientôt il les devance de si loin, qu’ils s’arrêtent découragés. Un seul de ces chevaliers, ayant pris un sentier détourné, parvient à rejoindre notre héros, et le frappe d’un coup de sa lance, dont il lui casse le fer dans la cuisse. Robert ne donne aucun signe de souffrance, et le chevalier se retire, persuadé, du moins, que cette blessure le lui fera reconnaître.
On instruit l’empereur de cet évènement. Aussitôt, ce prince fait publier, à son de trompe