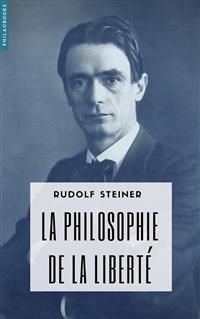
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les sujets qui ont été traités dans ce livre se ramènent à deux questions primordiales concernant la vie de l’âme humaine. La première est celle-ci : Est-il possible de se former de l’être humain une conception qui permette de fonder sur lui, comme sur un point d’appui inébranlable, les données diverses de l’expérience et de la science ? En effet, ces données nous donnent l’impression de ne point pouvoir se fonder sur elles-mêmes ; le doute et le jugement critique les relèguent dans le domaine de l’incertitude. Quant à la seconde question, nous la formulerons ainsi : L’homme, en sa qualité d’être volontaire, a-t-il le droit de s’attribuer la liberté, ou bien cette liberté n’est-elle qu’une pure illusion, due à ce que l’homme ignore les liens par lesquels la nécessité enchaîne sa volonté comme elle enchaîne tous les phénomènes naturels ? Rudolf Steiner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La philosophie de la liberté
Rudolf Steiner
Traduction parGermaine Claretie
Table des matières
Préface
I. LA SCIENCE DE LA LIBERTÉ
1. L’action humaine consciente
2. Le besoin organique de la connaissance
3. La pensée instrument de la conception du monde
4. Le monde comme perception
5. La connaissance du monde
6. L’individualité humaine
7. Y a-t-il des limites à la connaisance ?
II. LA RÉALITÉ DE LA LIBERTÉ
8. Les facteurs de la vie
9. L’idée de la liberté
10. La philosophie de la liberté et le monisme
11. La finalité dans l’univers et dans l’homme
12. L’imagination morale
13. La valeur de la vie
14. L’individualité et l’espèce
III. DERNIERS PROBLÈMES
15. Les conséquences du monisme
16. Premier supplément
17. Second supplément
Préface
PRÉFACE DE LA NOUVELLE ÉDITION (1918)
Les sujets qui ont été traités dans ce livre se ramènent à deux questions primordiales concernant la vie de l’âme humaine.
La première est celle-ci : Est-il possible de se former de l’être humain une conception qui permette de fonder sur lui, comme sur un point d’appui inébranlable, les données diverses de l’expérience et de la science ? En effet, ces données nous donnent l’impression de ne point pouvoir se fonder sur elles-mêmes ; le doute et le jugement critique les relèguent dans le domaine de l’incertitude. Quant à la seconde question, nous la formulerons ainsi : L’homme, en sa qualité d’être volontaire, a-t-il le droit de s’attribuer la liberté, ou bien cette liberté n’est-elle qu’une pure illusion, due à ce que l’homme ignore les liens par lesquels la nécessité enchaîne sa volonté comme elle enchaîne tous les phénomènes naturels ? Cette dernière question n’a pas été posée à la suite d’opérations logiques artificielles. Dans certaines conditions de la vie intérieure, elle se présente tout naturellement à l’esprit humain ; et l’on a le sentiment qu’il manquerait quelque chose au développement complet de l’âme s’il ne lui arrivait point une fois, au cours de sa vie, d’envisager avec le plus grand sérieux le dilemme que nous venons de poser : liberté ou détermination de la volonté humaine.
Il sera montré dans cet ouvrage que les expériences intérieures qui sont liées, pour l’être humain, à la seconde de ces questions, diffèrent selon la réponse qu’il a pu donner à la première. Nous tenterons de prouver qu’il existe une conception de la nature humaine selon laquelle on peut fonder sur cette nature, avec sûreté, tout le reste de nos connaissances ; et nous tenterons ensuite d’indiquer que cette conception-là permet de justifier entièrement l’idée de la liberté du vouloir humain, à condition seulement que l’on trouve l’accès du domaine de l’âme où cette libre volonté peut réellement s’épanouir.
La conception dont nous parlons, qui permet de répondre aux deux questions posées, se transforme dans l’âme qui l’acquiert en véritable force vivante. Elle ne fournit pas une réponse théorique que l’intelligence puisse simplement admettre, et la mémoire conserver. Une réponse de cette sorte ne serait, du point de vue de ce livre, qu’une apparence de réponse. Aussi n’a-t-on point émis ici des conclusions achevées et définitives ; mais on a montré le chemin expérimental d’un domaine intérieur où l’activité de l’âme humaine peut, à chaque fois qu’il en est besoin, trouver elle-même la solution renouvelée et revivifiée de ces problèmes. En effet, il suffit que nous ayons eu l’accès du domaine intérieur où ces deux questions se posent, pour que la véritable connaissance de ce domaine nous procure tous les éléments nécessaires à leur solution, et nous permette ensuite d’explorer l’ampleur et la profondeur des mystères de la vie, dans la mesure où notre désir et notre destinée nous invitent à le faire.
Il semble donc que l’on a défini, en cet ouvrage, une connaissance qui, par sa nature propre, et par l’étroite parenté la reliant à toute la vie de l’âme humaine, porte en elle-même sa légitimation et sa valeur.
C’est ainsi que je concevais le contenu de ce livre alors que je l’écrivis, il y a vingt-cinq ans. Et je ne puis aujourd’hui que répéter, en ce qui le concerne, les mêmes phrases. Au temps où je l’écrivis, je me fis une règle de ne rien dire qui ne fût en rapport étroit avec les deux questions fondamentales dont il traite. S’il est quelqu’un pour s’étonner de ce qu’on ne trouve encore, en ce livre, aucune allusion au domaine d’expérience spirituelle dont j’ai parlé dans mes ouvrages suivants, je le prierai de considérer que je ne voulais pas encore, en ce temps-là, décrire les résultats de l’expérience spirituelle, mais seulement établir les fondements sur lesquels cette expérience peut s’édifier. Cette « Philosophie de la Liberté » ne renferme aucun résultat spécial ni de l’expérience spirituelle, ni de l’expérience naturelle ; mais ce qu’elle renferme est, à mon avis, la première condition de la certitude que l’on tient à établir en ces deux ordres de science. Les exposés de ce livre peuvent parfaitement être admis par ceux qui, pour des raisons dont ils sont les seuls juges, ne veulent rien accepter du résultat de mes investigations spirituelles. Mais pour ceux qui se sentent attirés, au contraire, par ces investigations spirituelles, la tentative faite en cet ouvrage pourra également paraître d’une grande importance ; on a essayé d’y démontrer qu’un examen libre et sincère, s’appliquant uniquement aux deux questions que nous avons signalées ici comme étant la base de toute connaissance, fournit la certitude que la vie de l’homme plonge dans un véritable monde spirituel. Ce livre tente de légitimer la connaissance du domaine spirituel avant que l’on ait l’accès de ce domaine. Et cette légitimation a été faite de telle manière qu’on n’ait à aucun moment, en lisant ce livre, le besoin de justifier ce qui s’y trouve en y raccordant les expériences dont j’ai donné communication plus tard ; pour admettre ce qui est dit ici, il suffit que l’on puisse, ou que l’on veuille bien entrer dans la méthode même selon laquelle ces considérations ont été conçues.
Ce livre me paraît donc, d’un côté, occuper une place tout à fait à part de mes écrits de science spirituelle ; d’un autre côté, il leur est étroitement lié. Toutes ces raisons m’ont amené à publier maintenant, après vingt-cinq années, cette nouvelle édition dont le texte ne diffère presque pas de la première. J’ai seulement ajouté des appendices à certains de mes chapitres. Car la compréhension erronée de ce que j’avais écrit m’avait averti de la nécessité de ces explications supplémentaires. Je n’ai changé mon texte que lorsqu’il m’a semblé, aujourd’hui, avoir exprimé maladroitement ce que je voulais dire il y a un quart de siècle (il faudrait être bien mal intentionné pour déduire de ces corrections que j’aie altéré en quoi que ce soit mes convictions premières).
Cet ouvrage est épuisé depuis de nombreuses années. Quoique, comme il ressort de ce que je viens de dire, il me paraisse extrêmement utile d’exprimer aujourd’hui encore ce que j’ai dit il y a vingt-cinq ans de ces questions fondamentales, j’ai longtemps hésité à livrer au public cette nouvelle édition. Je me demandais constamment si je ne devais pas, dans tel ou tel passage, discuter les innombrables conceptions philosophiques qui sont apparues depuis la première édition de mon livre.
Mais, accaparé par mes recherches purement spirituelles, j’ai été empêché de le faire comme je l’aurais souhaité. D’ailleurs je me suis convaincu, par un examen aussi sérieux que possible des travaux philosophiques contemporains, que, si séduisante qu’eût été une telle discussion en soi, elle n’avait rien à faire avec les intentions véritables de ce livre. J’ai exposé, d’un point de vue analogue à celui de cette « Philosophie de la Liberté », tout ce qu’il m’a paru nécessaire de dire des tendances nouvelles de la philosophie on trouvera cet exposé dans le second volume de mes « Énigmes de la Philosophie ».
RUDOLF STEINER.
Avril 1918
Partie I
LA SCIENCE DE LA LIBERTÉ
1
L’action humaine consciente
L’homme, alors qu’il pense ou qu’il agit, peut-il être considéré comme un être spirituel libre ? Subit-il au contraire les lois inflexibles de la nécessité naturelle ? Plus que tout autre, ce problème a exercé la sagacité des penseurs. La liberté du vouloir humain a été, par les uns, passionnément défendue, par les autres, obstinément contestée. Certaines personnes, choquées dans leurs plus chères convictions morales, estiment qu’il faut être d’esprit borné pour mettre en doute cette liberté qui, d’après eux, se manifeste avec toute la force de l’évidence. Certains, au contraire, trouvent suprêmement anti-scientifique de supposer en faveur des actes humains une discontinuité de l’enchaînement naturel des effets et des causes. La liberté semble donc, aux premiers, le plus noble privilège de l’homme, — aux seconds, sa plus vaine illusion. Pour expliquer que l’acte libre de l’homme puisse s’insérer dans l’ordre de la nature, à laquelle l’homme lui-même appartient, les philosophes du libre-arbitre ont inventé des subtilités infinies. Leurs adversaires, avec non moins de peine, ont montré comment l’idée illusoire de la liberté avait pu germer dans la conscience humaine.
Il faudrait être bien dénué de réflexion pour ne pas se rendre compte que cette question philosophique est le pivot même de toutes nos conceptions morales, religieuses, scientifiques, bref, de toute notre existence. Et, parmi les symptômes les plus attristants de la mentalité contemporaine, il faut signaler le ton superficiel avec lequel David Frédéric Strauss, dans un ouvrage où il prétend fonder sur les données de la science moderne une « foi nouvelle », écrit ce qui suit : (David Frédéric Strauss, Der alte und neue Glaube) « Nous n’avons pas à envisager ici la question de la liberté de la volonté humaine. La prétendue liberté de choisir indifféremment entre des actions a toujours été considérée comme illusoire par toutes les philosophies dignes de ce nom. Mais la valeur morale des actions et des intentions humaines ne dépend aucunement de ce problème ». Si j’ai cité ce passage, ce n’est pas que j’attribue une importance spéciale au livre dont il est tiré, mais c’est que j’y trouve résumée en peu de mots l’opinion courante jusqu’à laquelle la plupart de nos contemporains savent s’élever en ce qui concerne ce problème capital. Pour peu qu’ils prétendent à une culture qui dépasse l’école primaire, ils savent que la liberté humaine ne saurait consister en un choix arbitraire entre deux actions également possibles. À tout acte de l’homme, leur a-t-on dit, il faut un mobile. C’est ce mobile qui, de plusieurs actions possibles, en fait choisir une seule.
Voilà ce qui paraît évident. Et cependant, c’est contre le dogme du libre-arbitre (entendu comme une faculté de choisir) que se dirigent, de nos jours encore, presque toutes les attaques des déterministes. Écoutons par exemple Herbert Spencer, dont les opinions se répandent actuellement de plus en plus : « Que chacun de nous puisse, à son choix, désirer ou ne pas désirer », comme il est en somme sous-entendu par le dogme de la libre volonté, c’est une chose que réfute aussi bien mon analyse de la conscience humaine, que les résultats de notre précédent chapitre (Herbert Spencer, Les Principes de la Psychologie). Ce point de départ est, en général, adopté par tous ceux qui combattent l’idée de liberté. Toutes leurs théories se trouvent d’ailleurs énoncées en germe chez Spinoza. Les déterministes n’ont guère fait que répéter inlassablement le très simple raisonnement de leur précurseur, mais en l’enveloppant de théories si compliquées qu’on n’aperçoit plus bien la simplicité de l’erreur initiale : Spinoza écrit, dans une lettre d’octobre ou novembre 1674 :
« Je nomme libre une chose qui n’existe et n’agit que par la nécessité de sa nature, et contrainte une chose qui reçoit d’une autre chose la détermination de son existence et de ses actions, et ceci d’une manière précise et fixe. Par exemple Dieu, quoique nécessaire, est libre, parce qu’il n’existe que par la nécessité de sa propre nature. Dieu se connaît librement, comme il connaît librement toute chose, parce qu’il s’ensuit seulement de la nécessité de sa nature qu’il connaisse toute chose. Vous voyez donc que je ne place pas la liberté dans une libre décision, mais dans une libre nécessité.
Mais descendons aux choses créées qui, toutes, sont déterminées, par des causes extérieures, à exister et à agir d’une manière précise et fixe. Pour bien, comprendre ce fait, nous allons envisager un exemple très simple. Une pierre reçoit, de la cause extérieure qui la heurte, une certaine quantité de mouvement, grâce à laquelle elle continue ensuite nécessairement à se mouvoir, quoique le heurt de la cause initiale ait cessé. Cette inertie de la pierre, qui lui fait poursuivre son mouvement, est contrainte plutôt que nécessaire, parce qu’on la définit par le heurt d’une cause extérieure. Ce qui est dit ici de la pierre vaut de toutes les choses en particulier, fussent-elles très composées et aptes à toutes sortes d’effets : toute chose est déterminée nécessairement, par une cause extérieure, à exister et à agir d’une manière précise et fixe. Admettez un instant, je vous prie, que la pierre, tandis qu’elle se meut, pense, et sache qu’elle s’efforce tant qu’elle peut de poursuivre son mouvement. Cette pierre qui n’est consciente que de son effort, et qui ne se comporte pas du tout avec indifférence, croira qu’elle est absolument libre et que si elle poursuit son mouvement, c’est exclusivement parce qu’elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous prétendent posséder, et qui consiste seulement en ceci que les hommes sont conscients de leurs désirs, mais qu’ils ignorent les causes qui les déterminent. Ainsi, l’enfant croit qu’il désire librement du lait, et le coléreux croit qu’il crie librement vengeance, et le peureux croit prendre librement la fuite. De même, l’ivrogne croit se décider librement à dire des choses qu’il ne dirait certainement pas volontiers s’il était dans son état normal, et comme ce préjugé est inné à tous les hommes, il est fort difficile de s’en libérer. Car, quoique l’expérience nous enseigne que les hommes sont très peu capables de modérer leurs désirs et que, lorsque des passions contraires les agitent, ils conçoivent le mieux et font le pire, il n’empêche qu’ils se tiennent pour des êtres libres, et ceci parce qu’ils ont des désirs plus forts les uns que les autres, et parce que maints de leurs désirs sont émoussés par le souvenir de quelque autre chose à laquelle on ne prend pas bien garde ».
Cette théorie est si précise et si simplement exposée qu’elle permet de toucher du doigt l’erreur fondamentale sur laquelle elle repose. Spinoza nous dit de même qu’une pierre, après avoir reçu un choc, accomplit nécessairement un certain mouvement, de même l’homme agit toujours sous la poussée d’un mobile qui le détermine. Mais parce qu’il prend conscience de son action, il s’en croit la libre cause, il ne voit pas la cause véritable, le mobile déterminant auquel sa volonté obéit. Tout ceci contient une faute de raisonnement facile à découvrir : Spinoza, comme tous ses successeurs, omet de dire que l’homme prend conscience non seulement de son action, mais aussi, souvent, des mobiles qui l’ont amenée. Nul ne prétend que le petit enfant soit libre lorsqu’il réclame son lait, ni l’ivrogne lorsqu’il prononce des paroles dont il aura à se repentir. Tous deux se soumettent aveuglément aux tendances qui se font valoir dans les profondeurs de leur organisme, et dont ils n’ont pas clairement notion. Mais faut-il jeter dans le même sac les actions de cette sorte et celles de l’homme pleinement conscient, qui connaît non seulement la chose qu’il fait, mais encore les raisons pour lesquelles il la fait ? Les actes des hommes sont-ils d’une seule et même espèce ? Celui du soldat sur le champ de bataille, celui du savant dans le laboratoire, celui de l’homme d’État au sein des inextricables complications diplomatiques, peuvent-ils être assimilés à celui de l’enfant qui réclame du lait ? Évidemment, lorsqu’on cherche la solution d’un problème, il est bon de le poser sous sa forme la plus élémentaire, mais le manque de discernement conduit aux confusions les plus graves, et, ici, il est capital de discerner entre l’homme qui connaît les mobiles de son acte et l’homme qui ne les connaît pas. Cette question qui s’impose, les déterministes ont omis de s’en soucier. Ils n’ont jamais cherché à savoir si un motif d’action, lorsqu’on le connaît et l’examine en toute lucidité, exerce la même contrainte que le phénomène organique sous l’influence duquel un enfant se met à réclamer du lait.
Éd. von Hartmann, dans sa « Phénoménologie de la conscience morale », écrit que le vouloir humain dépend de deux principaux facteurs : les motifs et le caractère. Tant que l’on croit tous les hommes semblables, ou qu’on leur attribue des différences de caractère insignifiantes, leur vouloir paraît déterminé du dehors, par les contingences extérieures. Mais, en réalité, l’homme placé devant une idée ou une représentation n’en fait un motif d’action que si cette idée, cette représentation, s’accordent avec son caractère et suscitent un désir en lui... cet homme alors croit que la détermination vient des profondeurs de son être, il s’imagine être libre des contingences extérieures. « Mais, dit Éd. von Hartmann, même lorsque nous transformons une idée ou représentation en un motif, nous ne saurions le faire arbitrairement, mais par la nécessité de notre idiosyncrasie ; par conséquent nous ne sommes absolument pas libres. » Ici encore, comme on le voit, l’auteur néglige de distinguer les mobiles d’action que l’on accepte après un lucide examen de ceux que l’on subit sans en avoir une claire connaissance.
Et ceci nous conduit au point de vue qui dorénavant sera le nôtre : a-t-on le droit de poser d’une manière unilatérale le problème de la liberté du vouloir humain ? Et si l’on n’a pas ce droit, à quel autre problème doit on le rattacher ?
Du moment que l’on admet une différence entre les motifs conscients et les impulsions inconscientes, une action change de valeur selon qu’elle est déterminée par ceux-là ou par celles-ci. Dès lors, il s’agit avant tout de bien définir cette différence, car elle seule nous permettra de poser le problème de la liberté sur ses véritables bases.
Connaître ses raisons d’agir, qu’entend-on par là ? Si les philosophes n’ont guère examiné cette face du problème, c’est que leur habitude est malheureusement de sectionner le tout indivisible qu’est l’être humain. D’un côté, ils posent l’être pensant. De l’autre, l’être agissant. Et ils éliminent celui qui importe avant tout l’être qui agit en connaissance de cause.
On a dit : « l’homme est libre lorsqu’il se soumet à sa raison plutôt qu’à ses impulsions animales » ; ou encore : « être libre, c’est pouvoir en toute occasion déterminer ses actes d’après des buts et des décisions raisonnables ».
Mais ces préceptes ne mènent à rien, car ce qu’il s’agit précisément de savoir, c’est si la raison, les buts et les décisions de l’homme exercent sur lui la même inévitable contrainte que les besoins instinctifs. Si la décision raisonnable surgit en moi sans ma collaboration, avec la même force tyrannique qu’une sensation de soif ou de faim, alors il faut bien que j’obéisse et ma liberté n’est qu’illusion.
Il y a encore une autre manière de voir, c’est celle-ci : « être libre, dit-on, ce n’est pas avoir la possibilité de vouloir ce que l’on veut, mais de faire ce que l’on veut ». Cette idée a été développée d’une manière frappante par le poète-philosophe Robert Hamerling (Atomistique de la volonté) :
« L’homme, certes, peut faire ce qu’il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu’il veut, car sa volonté est déterminée par des motifs.
Il ne peut vouloir ce qu’il veut, examinons cette proposition de plus près. A-t-elle un sens raisonnable ? La liberté de vouloir devrait donc consister à pouvoir vouloir une chose sans raison, sans motif ? Mais que signifie donc vouloir si ce n’est avoir une raison de faire ou de désirer ceci plutôt que cela ? Vouloir quelque chose sans raison, sans motif, cela signifierait vouloir quelque chose sans le vouloir. Au concept de volonté est indissolublement lié le concept de motif. Sans un motif déterminant, la volonté n’est qu’un pouvoir inutile. Il ne devient actif et réel que grâce au motif. Il est donc parfaitement exact que la volonté humaine n’est pas libre, en ce sens que sa direction est toujours déterminée par le motif le plus fort. Mais il faut concéder d’autre part qu’il est absurde d’opposer à cette non-liberté une liberté imaginaire qui consisterait à pouvoir vouloir ce qu’on ne veut pas ».
Hamerling, lui encore, parle de « motifs » en général, sans préciser s’il s’agit de motifs conscients ou inconscients. Or, dès l’instant qu’un motif exerce sur moi une pression invincible, peu importe que je puisse accomplir, ou non, ce que ce motif me prescrit : l’idée de liberté a perdu toute signification. Quelle importance cela peut-il avoir pour moi de pouvoir faire une chose ou non, si je suis obligé par le motif à la faire ? Ce qui importe, ce n’est pas de savoir si je puis réaliser ensuite ce que le motif m’a imposé, mais de savoir s’il n’existe que des motifs doués de cette autorité nécessaire et absolue. Si je suis obligé de vouloir quelque chose, il peut m’être extrêmement indifférent de le pouvoir aussi réaliser. Il peut même arriver que le motif imposé de la sorte par les circonstances et par mon caractère apparaisse tout à fait déraisonnable à l’examen de mon intelligence dans ce cas, je serai très heureux d’être empêché de faire ce que je veux !
Il ne s’agit pas de savoir si l’homme peut, ou ne peut pas, mettre ses desseins à exécution, mais de comprendre de quelle manière ces desseins naissent en lui.
Ce qui le différencie des autres créatures organisées, c’est son intelligence, sa faculté de penser. L’action, au contraire, lui est commune avec les autres organismes. Pour élucider le problème de la liberté, les savants modernes aiment à établir des analogies avec le règne animal. La science, à notre époque, se plaît à ce genre de comparaisons. Lorsqu’elle a trouvé parmi les gestes des animaux quelque chose qui ressemble à la conduite des hommes, elle se croit en possession des derniers secrets de la nature humaine. Or, cette attitude conduit à des malentendus dont la citation suivante donnera une idée (P. Rée, L’illusion de la liberté). « Il est facile d’expliquer pourquoi le mouvement d’une pierre nous semble nécessaire, et le vouloir d’un âne, non nécessaire. Les causes qui meuvent la pierre sont au dehors et bien visibles. Mais les causes par lesquelles un âne veut sont à l’intérieur de cette âne, et invisibles. Entre nous et le lieu de leur causalité se trouve le crâne de l’âne... on ne voit pas cette causalité et l’on imagine qu’elle n’existe pas. La volonté, dit-on, est cause que l’âne se retourne, et l’on croit qu’elle n’est conditionnée par rien, qu’elle est un commencement absolu. »
Ici encore, il est entièrement fait abstraction des actes dont la conscience humaine connaît les mobiles, car Rée déclare : « entre nous et le lieu de leur causalité, il y a le crâne de l’âne ». Qu’il existe des actions, non point de l’âne, mais de l’homme, où le motif devenu conscient s’interpose entre nous et l’action, Rée ne s’en doute pas. Il le prouve encore en écrivant, quelques pages plus loin : « Nous ne percevons pas les causes qui nécessitent notre volonté et c’est pourquoi nous croyons qu’elle n’est pas nécessitée ».
Mais assez de ces exemples. Ils démontrent qu’un grand nombre de penseurs attaquent la conception de la liberté sans même savoir ce qu’on entend par ce mot.
Il va de soi qu’une action n’est jamais libre tant que son auteur en ignore les causes. Mais que se passe-t-il lorsque ces causes sont au contraire connues ? Et ceci nous amène à nous demander : quelle est l’origine et la nature de la Pensée ? Tant que nous n’aurons pas bien compris ce qu’est l’activité pensante de l’âme, nous ignorerons ce que signifie « connaître » ou « savoir quelque chose », fût-ce une action. Au contraire, lorsque nous aurons établi ce qu’est la Pensée, le rôle qu’elle joue dans l’action humaine apparaîtra clairement. Hegel a dit : « C’est seulement avec la Pensée que l’âme (dont les animaux sont doués comme les hommes), s’élève au rang d’esprit ». Rien de plus juste, et c’est également la Pensée qui donne à l’action humaine son caractère propre.
Nous sommes bien éloignés de croire que tous nos actes découlent d’un froid calcul et nous ne tendons pas à définir comme proprement humaines les décisions issues du raisonnement abstrait. Cependant, dès que nous nous élevons au-dessus de la simple satisfaction des besoins physiques, nos motifs d’action sont toujours plus ou moins éclairés par notre pensée. L’amour, la pitié, le patriotisme, sont des motifs qui, certes, ne ressemblent pas à des concepts abstraits. Le cœur, le sentiment, y jouent le rôle principal. Mais le sentiment ne saurait créer à lui tout seul des motifs d’action. Il les présuppose et il les fait entrer dans sa sphère. La pitié, par exemple, ne peut s’emparer de mon cœur que lorsque j’ai eu la représentation d’une personne malheureuse. Le chemin du cœur passe par la tête... L’amour lui-même est bien loin de faire exception à cette loi. Dès qu’il cesse d’être la simple manifestation de l’instinct sexuel, il repose sur les représentations que l’on se fait de la personne aimée. Et, plus ces représentations paraissent idéales, plus l’amour s’exalte. La pensée, ici encore, précède le sentiment. Un dicton prétend que l’amour nous rend aveugle aux défauts de l’être aimé ; mais on peut intervertir les choses et dire au contraire que l’amour nous ouvre les yeux sur les qualités de cet être. Les hommes passent auprès de ces qualités sans les remarquer... un seul les aperçoit, et de là naît son amour. Si les autres n’ont point éprouvé cet amour, c’est qu’ils n’ont pas eu la même représentation.
Sous quelque face que l’on envisage le problème, on en revient toujours à se dire que l’action humaine ne peut être comprise sans qu’on ait établi d’abord l’origine et l’essence de la Pensée. Commençons donc par traiter ce chapitre essentiel.
2
Le besoin organique de la connaissance
En moi j’ai là deux âmes, je le sens,
Et l’une loin de l’autre voudrait être.
L’une à la terre avec passion se prend
Et s’y cramponne par tous ses organes ;
De sa poussière l’autre s’arrachant,
Monte aux régions où les ancêtres planent.
(Faust, I, 1112-1117). Trad. François Sabatier sur le mètre de l’original.
Ces vers de Goethe expriment un des caractères les plus profonds de la nature humaine. L’organisation de l’homme n’est pas simple. Ce que l’univers lui offre spontanément ne lui suffit pas. Il désire toujours plus. Autrement dit, parmi les besoins dont la Nature nous a doués, il en est un grand nombre qu’elle nous laisse le soin de satisfaire par nos propres moyens. Certes, ses dons sont abondants, mais nos ambitions les dépassent. Il semble que nous soyons nés pour désirer sans cesse. Un cas particulier de ce perpétuel désir, c’est notre soif de connaissance. Nous regardons un arbre à deux moments différents. Une fois, nous voyons ses branches au repos, l’autre fois, en mouvement. Cette observation est loin de nous satisfaire. Il nous faut savoir pourquoi l’arbre apparaît tantôt immobile et tantôt agité. Ainsi, à chaque regard que nous jetons dans la nature environnante, d’innombrables questions s’élèvent en nous. Chaque phénomène, en nous apparaissant, nous impose une tâche. Chaque expérience nous devient énigme. Nous voyons sortir de l’œuf un animal semblable à sa mère, et nous nous demandons la cause de cette ressemblance. Nous suivons, dans tout être vivant, les progrès de la croissance et du développement jusqu’à un certain degré de perfection, et nous nous demandons quelles sont les lois de ce progrès. Jamais nous ne nous estimons satisfaits par ce que la Nature déploie devant nos sens. En tout, nous cherchons à obtenir ce que nous appelons « l’explication » du phénomène.
Ce que nous exigeons des choses, étant infiniment plus vaste que ce qu’elles nous donnent immédiatement, crée dans notre être une division : nous prenons conscience de former un certain contraste avec le monde. Nous nous opposons à lui, en tant qu’êtres indépendants. L’univers nous apparaît dès lors dans sa polarité : Moi et le Monde.
Nous édifions donc une cloison entre le monde et nous, et ceci dès que notre conscience s’éveille. Néanmoins, nous ne perdons jamais le sentiment d’appartenir malgré tout à ce monde, de lui être liés, de demeurer non pas extérieurs à lui, mais englobés en lui.
Ce sentiment nous incite à résoudre l’opposition qui existe entre l’univers et nous. Jeter un pont sur cet abîme, c’est le but même de toutes les activités spirituelles de l’humanité. L’histoire de l’esprit humain ne relate, somme toute, que cette recherche constante d’unité. Elle est à la base de la religion, de l’art, de la science. Le croyant espère, grâce à la révélation divine, résoudre le problème que s’est posé son moi, que le monde des apparences ne contentait pas. L’artiste cherche à imprimer dans la matière les inspirations de ce moi ; il tente donc une réconciliation du monde extérieur et de son être intime. Lui non plus n’est pas satisfait par le monde des apparences et veut l’enrichir des formes que son moi recèle. Le penseur, de son côté, transformant les résultats de l’observation pure et simple, s’efforce de trouver les lois qui régissent les phénomènes. Lorsque du contenu du monde nous faisons le contenu de notre pensée, le pont est franchi, le rapport que nous avions brisé est rétabli. Mais nous verrons par la suite que ce but n’est réellement atteint que si le penseur conçoit sa tâche d’une manière plus profonde qu’on ne le fait généralement.
La situation que je viens d’exposer se manifeste nettement dans l’histoire de la philosophie. Nous y trouvons un perpétuel conflit entre la conception unitaire, ou monisme, et la théorie des deux mondes, ou dualisme.
Le dualisme envisage uniquement cette séparation que la conscience humaine a tracée entre le monde et le moi. C’est en vain qu’il s’efforce de réconcilier ces deux termes opposés, qu’il les appelle « esprit et matière », « sujet et objet », ou « pensée et phénomène ». Il pressent qu’un rapport existe entre les deux sphères, mais il demeure incapable de le définir. L’homme, alors qu’il se sent un moi, ne peut faire autrement que de ranger ce moi du côté de l’esprit. Puis, opposant à ce moi le monde extérieur, il implique en ce dernier l’ensemble des perceptions sensibles, c’est-à-dire le monde matériel. Par là l’homme s’introduit lui-même dans l’opposition entre l’esprit et la matière, et il y est d’autant plus obligé que son propre corps appartient évidemment au monde matériel. Ainsi, le moi est partie intégrante du monde spirituel, tandis que les choses et les phénomènes matériels, perçus par les sens, constituent le monde. Toutes les énigmes qui concernent l’esprit et la matière se retrouvent donc dans l’énigme fondamentale de la nature humaine.
Le monisme au contraire ne considère que l’unité, et s’efforce de nier ou d’atténuer toute opposition. Or, aucune de ces deux conceptions ne rend bien compte des faits. Le dualisme envisage l’esprit (moi) et la matière (monde) comme deux entités profondément différentes, et, ce faisant, il se condamne à ne point expliquer leurs actions réciproques. Comment l’esprit saura-t-il ce qui se passe dans la matière, si celle-ci lui est absolument étrangère ? Comment arrivera-t-il à exercer sur elle une influence, c’est-à-dire à réaliser des intentions ? En réponse à ces questions, on a échafaudé les hypothèses les plus habiles et les plus insensées.
Le monisme, d’ailleurs, se trouve jusqu’à présent tout aussi embarrassé. Il a essayé de s’en tirer par trois méthodes : ou bien il nie l’esprit, et se nomme matérialisme, ou bien il nie la matière et devient spiritualisme ; ou encore il affirme que la matière et l’esprit sont indissolublement liés jusque dans le plus petit atome et que, ne se séparant jamais, ils apparaissent tout naturellement unis jusque dans l’homme.
Le matérialisme ne pourra jamais fournir une explication rationnelle du monde. Car toute explication commence par ce fait qu’on conçoit des idées sur les phénomènes. Le matérialisme lui-même part d’idées sur la matière, d’idées sur les phénomènes matériels. Il se trouve donc devant un double ordre de faits : d’une part, le monde matériel, d’autre part, les idées que l’on se fait de lui. Or, il cherche à expliquer ces dernières comme des phénomènes purement matériels, estimant que la pensée se produit dans le cerveau comme la digestion dans l’appareil digestif. C’est attribuer à la matière, en plus de ses facultés mécaniques et organiques, celle de penser lorsque certaines conditions sont remplies. Mais, ce faisant, on déplace le problème : l’homme, au lieu de s’attribuer à lui-même la faculté pensante, en doue la matière, et le voici revenu à son point de départ : comment la matière est-elle amenée à penser sur elle-même ? pourquoi n’est-elle pas simplement satisfaite d’elle-même et de son existence ? Le matérialisme a détourné son regard du vrai sujet, du moi pensant, et il est arrivé devant une fiction nébuleuse, indéterminée. Là, la première énigme est revenue se poser à lui, car le problème, loin d’avoir été résolu, avait été seulement transposé.
Quant au pur spiritualiste, il nie que la matière ait une existence indépendante, et l’envisage comme un produit de l’esprit. Appliquée au problème de la nature humaine, cette conception aboutit à une impasse. En effet, avec un moi relégué de la sorte du côté de l’esprit, le monde sensible n’a plus aucun lien. Pour ce monde sensible, en fait, il n’y a pas de chemin d’accès spirituel vers ce moi ; il lui faut se manifester par l’intermédiaire de phénomènes matériels. Or, ces phénomènes matériels, comment le moi les trouvera-t-il en lui, qui est d’essence purement spirituelle ? Comment ce qu’il élabore de sa propre activité spirituelle, contiendra-t-il le monde de la matière ? En vérité, ce moi devra renoncer à connaître l’univers s’il ne se rattache pas à lui par des liens non spirituels. Et, de même, il ne pourra jamais agir s’il n’emploie pas des énergies et des substances non spirituelles. Il est constamment ramené à reconnaître l’existence objective du monde sensible.
Un penseur, en partant de l’idéalisme absolu, est arrivé à pousser le spiritualisme jusqu’à ses extrêmes limites : c’est J.-G. Fichte. Il a voulu déduire du moi tout l’édifice universel. Il a réussi à construire un magnifique tableau idéal du monde, mais en en retranchant toute réalité expérimentale. Pas plus que le matérialiste n’a le droit de contester l’existence de l’esprit, le spiritualiste ne peut décréter la suppression de la matière.





























