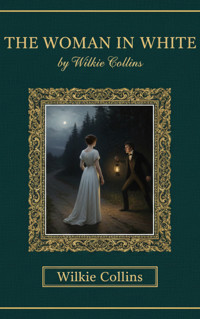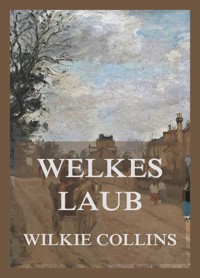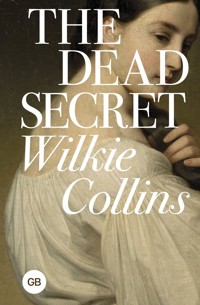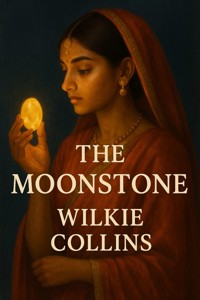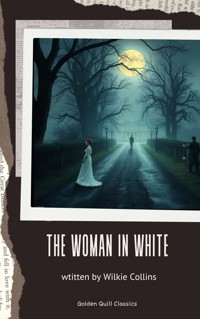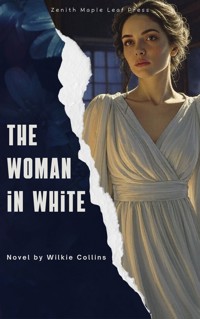Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
La Pierre de Lune est un diamant maudit, qui nuit à tous ses propriétaires successifs depuis son vol lors de la mise à sac d'un temple indien par l'armée anglaise. Offert à une jeune femme le jour de ses 18 ans, il disparaît au cours de la nuit suivante. Le voleur fait-il partie des invités ou bien est-ce un des mystérieux brahmanes vus à proximité de la maison ce jour-là? Un des meilleurs policiers britanniques est chargé de l'enquête. Au delà d'une enquête aux pistes nombreuses, menée dans un climat souvent angoissant, une des originalités de ce roman réside dans sa structure. En effet, l'enquête est décrite au travers des récits de différents protagonistes, permettant à l'auteur d'user de styles différents et rendant ainsi le livre vivant. T. S. Eliot considérait ce livre comme le chef d'oeuvre du roman policier de langue anglaise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Pierre de Lune
La Pierre de LunePROLOGUE L’ASSAUT DE SERINGAPATAM (1799) (Extrait de papiers de famille).L’HISTOIRE DU DIAMANT PREMIÈRE PÉRIODE PERTE DU DIAMANT (1848) SECONDE PÉRIODE LA DÉCOUVERTE DE LA VÉRITÉ (1848-1849)ÉPILOGUE LE DIAMANT RETROUVÉPage de copyrightLa Pierre de Lune
Wilkie Collins
PROLOGUE L’ASSAUT DE SERINGAPATAM (1799) (Extrait de papiers de famille).
J’adresse ces lignes écrites dans l’Inde à mes parents d’Angleterre.
Mon but est d’exposer le motif qui m’a fait refuser ma main et mon amitié à mon cousin John Herncastle. La réserve que j’ai gardée jusqu’ici sur ce chapitre a été mal interprétée par plusieurs membres de ma famille, à la bonne opinion desquels je tiens. Je les prie de suspendre leur jugement jusqu’à ce qu’ils aient lu ce récit, et je déclare, sur l’honneur, que ce que je vais écrire ne renferme que la plus stricte vérité.
Le différend entre mon cousin et moi s’éleva lors d’un grand événement militaire auquel nous prîmes part tous deux : l’assaut livré à Seringapatam par le général Baird, le 4 mai 1799.
Pour aider à l’intelligence de l’histoire, il faut que je me reporte à l’époque qui précéda l’assaut, et aux bruits qui couraient dans notre camp sur l’or et les joyaux entassés dans le palais de Seringapatam.
Une de ces légendes, et la plus bizarre d’entre elles, se rapportait à un diamant jaune, pierre précieuse et célèbre dans les annales de l’Inde. À en croire les plus anciennes traditions connues, ce diamant aurait été enchâssé dans le front de la divinité indienne aux quatre mains qui est l’emblème de la lune. Le nom de Pierre de Lune, sous lequel il continue à être désigné jusqu’à ce jour dans l’Inde, lui vient de sa nuance singulière et aussi de la croyance superstitieuse en vertu de laquelle, placé sous l’influence de la déesse dont il était l’ornement, il était censé pâlir et reprendre son éclat suivant la croissance et la décroissance de la lune.
J’ai entendu raconter qu’une semblable croyance existait en Grèce et à Rome ; toutefois, elle n’avait pas pour objet, comme dans l’Inde, un diamant consacré à un dieu, mais une pierre d’un ordre inférieur, dont la transparence et les divisions intérieures rappelant celles de la lune, étaient supposées en suivre les variations ; de là serait venu à cette espèce d’onyx son nom de Pierre de Lune, sous lequel elle reste connue des amateurs modernes.
Les aventures du diamant jaune commencent au XIe siècle de notre ère.
À cette époque, le conquérant mahométan, Mahmoud de Ghizni, arrive dans l’Inde, s’empare de la cité sainte de Somnauth, et dépouille de ses trésors le fameux temple qui avait été depuis des siècles le lieu de pèlerinage des Hindous et la merveille de l’Orient.
De toutes les divinités révérées dans le sanctuaire, le Dieu de la Lune échappa seul à la rapacité mahométane.
Sauvé par trois brahmines, le dieu qui portait le diamant jaune sur son front fut enlevé pendant la nuit et transporté dans la seconde des cités sacrées de l’Inde, la ville de Bénarès.
Là, le dieu placé dans une salle incrustée de pierres précieuses, abrité sous un toit supporté par des pilastres d’or reçut les adorations de ses fidèles.
Dans ce sanctuaire, la nuit même où il fut achevé, Vishnou apparut en songe aux trois brahmines.
Le dieu dirigea son souffle sur le diamant de l’idole sacrée, et les brahmines prosternés se voilèrent la face. Vishnou ordonna que désormais le diamant de la lune serait gardé jour et nuit, alternativement par trois prêtres jusqu’à la fin des siècles. Et les brahmines l’entendirent, et ils s’inclinèrent devant sa volonté suprême.
Le dieu prédit un désastre au mortel assez présomptueux pour porter ses mains sur le joyau sacré, ainsi qu’à tous ceux de sa maison et de son nom, qui hériteraient du fruit de ce sacrilège. Et les brahmines font inscrire l’arrêt divin en lettres d’or sur la porte de l’enceinte consacrée.
Les siècles suivirent les siècles, mais de génération en génération les successeurs des trois brahmines veillèrent nuit et jour sur l’inestimable diamant de la lune.
Nous arrivons ainsi au XVIIIe siècle, dont les premières années virent, le règne d’Aureng-Zeyb, empereur des Mongols ; il donna le signal de nouvelles rapines et de la destruction des temples dédiés au grand Brahma.
Le sanctuaire du dieu aux mains multiples fut souillé par le massacre des animaux sacrés ; les images des divinités furent brisées, et enfin le diamant tomba entre les mains d’un officier supérieur de l’armée du Moghol.
Impuissants à ressaisir leur trésor à main armée, les trois prêtres gardiens se déguisèrent pour le suivre et le surveiller à distance. Les générations se succédèrent, le guerrier sacrilège périt misérablement ; le diamant, portant toujours sa malédiction avec lui, passa d’un Infidèle à un autre ; mais les prêtres ne se départirent jamais de leur mission, guettant patiemment le jour où la volonté de Vishnou les ferait rentrer en possession de leur joyau sacré. Le XVIIIe siècle s’achevait lorsque les pérégrinations du diamant le mirent aux mains de Tippo, sultan de Seringapatam, qui le fit enchâsser au manche d’un poignard, et placer dans son arsenal, comme une de ses armes les plus précieuses.
En ce lieu même, demeure du sultan, les trois brahmines veillèrent sur la Pierre de la Lune. On racontait que trois officiers de la maison de Tippo, étrangers et inconnus, avaient gagné sa confiance, en se conformant aux apparences du rite mahométan, et que ces trois hommes n’étaient autres que les prêtres déguisés.
Ainsi chacun se contait dans le camp l’histoire fantastique du diamant ; elle ne fit d’impression sérieuse que sur mon cousin, qui était disposé à y croire par son amour du merveilleux.
La nuit même de l’assaut donné à Seringapatam, il s’emporta ridiculement contre moi et contre d’autres camarades, pour avoir traité le tout de fable ; une dispute fâcheuse s’ensuivit, et l’irascible caractère d’Herncastle lui fit perdre son bon sens.
Il débita mille fanfaronnades, et dit que si l’armée anglaise prenait la ville, nous verrions tous le diamant à son doigt. Un éclat de rire général salua cette déclaration, et l’affaire en resta là, du moins à ce que nous crûmes tous alors.
Arrivons au jour de l’assaut. Dès le commencement de l’action, mon cousin et moi fûmes séparés ; je ne le vis ni au passage de la rivière, ni lorsque le drapeau anglais fut planté sur la brèche, ni enfin au moment où, passant le fossé, nous entrâmes dans la ville, disputant chaque pouce de terrain à nos ennemis.
À la tombée de la nuit seulement, Herncastle et moi nous nous rencontrâmes après que, la place étant conquise par nos troupes, le général Baird eut trouvé lui-même le corps de Tippo sous un amas de morts et de mourants.
Nous faisions partie tous deux d’un détachement chargé par le général d’empêcher le pillage et les scènes de désordre inhérentes à la prise d’une ville ; les traînards du camp se livraient à de déplorables excès ; enfin, les soldats découvrirent malheureusement, par une porte non gardée, le chemin de la salle du Trésor, et, une fois qu’ils y eurent pénétré, s’y gorgèrent de joyaux et d’or.
Herncastle et moi nous nous trouvâmes réunis dans la cour extérieure du Trésor, cherchant à faire respecter la discipline par nos soldats. Je m’aperçus sur l’heure que la violence de mon cousin était encore surexcitée par les scènes de carnage que nous venions de traverser ; à mon avis, il était tout à fait incapable de remplir la mission qui nous avait été confiée.
Il y avait passablement de désordre et de confusion dans la salle du Trésor, toutefois je ne remarquai aucun acte de violence ; on eût pu dire que nos hommes pillaient avec la gaieté d’enfants en vacances. Ils échangeaient des jeux de mots, des plaisanteries, et l’histoire du fameux diamant revenait en scène sous forme de lazzis. « Qui a pu trouver la Pierre de Lune ? » Ce refrain était incessant et ne s’arrêtait parfois que pour redoubler sur d’autres points non encore explorés.
Pendant que j’essayais vainement de remettre un peu d’ordre parmi cette troupe surexcitée, j’entendis des cris effroyables s’élever de l’autre côté de la cour ; j’y courus, redoutant que les soldats n’eussent trouvé sur ce point un nouvel élément de destruction.
Je parvins à une porte ouverte, et vis les corps inanimés de deux Indiens que, à leur costume, je reconnus pour être des officiers du palais.
D’autres cris partant de l’intérieur, je me précipitai dans une pièce qui paraissait être un arsenal. Là, un autre Indien, mortellement blessé, s’affaissait aux pieds d’un homme dont je n’apercevais que le dos. Celui-ci se retourna en entendant mes pas, et je reconnus John Herncastle, une torche dans une main, et dans l’autre un poignard ruisselant de sang.
Une pierre, disposée en pommeau à l’extrémité de la poignée, étincelait de mille feux à la lueur de la torche. L’Indien mourant se soutint sur les genoux, désigna le poignard tenu par mon cousin, et dit en langue hindoue :
« Le diamant de la lune tirera vengeance de vous et des vôtres. »
En proférant cette dernière menace, l’Indien retomba mort. Les hommes qui m’avaient suivi, en traversant la cour, envahirent l’arsenal. Avant que j’eusse pu prendre un parti, Herncastle s’élança vers eux comme un fou furieux. « Dégagez la porte, me cria-t-il, et mettez-y une garde ! » Les soldats reculèrent devant sa torche et son poignard.
Abasourdi de cette singulière scène, je plaçai pourtant à la porte deux sentinelles éprouvées et prises parmi les soldats de mon propre détachement. Pendant tout le reste de cette terrible nuit, je ne revis plus mon parent.
Dès l’aube, comme le pillage continuait, le général Baird fit annoncer au son du tambour que tout voleur pris sur le fait serait pendu, quel que fût son grade.
Afin de mieux en faire ressortir l’importance, le prévôt de l’armée appuyait de sa présence cet ordre du jour.
Parmi la foule qui écoutait la proclamation, Herncastle et moi nous nous trouvâmes face à face.
Il me tendit la main, comme de coutume, en me disant :
« Bonjour ! »
J’attendis avant de la prendre, et lui dis :
« Donnez-moi donc d’abord quelques détails sur ce qui a causé la mort de l’Indien dans l’arsenal, et sur ce que signifiaient ses dernières paroles lorsqu’il désignait du geste le poignard que vous teniez à la main ?
– Je pense, répondit Herncastle, que la mort de l’Indien est due à une blessure mortelle. Quant à ses dernières paroles, je ne sais rien de plus que vous. »
Je le regardai fixement ; son exaltation de la veille avait disparu. Je voulus lui laisser encore une chance de s’ouvrir à moi. « Est-ce bien tout ce que vous avez à me dire ? » lui demandai-je. « Oui, c’est tout ! » fut sa réponse. Je lui tournai le dos, et jamais depuis nous ne nous sommes parlé.
Il est bien entendu que ce que j’écris ici sur mon cousin n’est destiné qu’à la famille, à moins que les circonstances n’en rendent la publication nécessaire. Herncastle n’a rien laissé échapper qui m’ait autorisé à instruire notre commandant des fortes préventions que j’avais conçues contre lui.
On l’a plaisanté plus d’une fois sur le diamant en lui rappelant ses fanfaronnades à ce sujet la veille de l’assaut ; mais la situation qu’il a vis-à-vis de moi, depuis la scène de l’arsenal, suffit à lui faire garder le silence. On assure qu’il demande à changer de régiment, dans le but avoué par lui de s’éloigner de moi.
Que ce bruit soit fondé ou non, je ne puis me résoudre à devenir son accusateur public, et chacun, je crois, appréciera mes motifs ; je n’ai que des présomptions contre lui ; je ne pourrais même affirmer qu’il a tué les deux premiers Indiens étendus à la porte, ni même le troisième dans l’arsenal, car je n’ai pas vu commettre le meurtre.
Il est trop vrai que j’entendis les paroles du mourant ; mais si mon cousin les attribuait au délire, comment pourrais-je contredire son assertion ? Je laisse donc nos parents communs se former une opinion d’après mon récit ; ils décideront si l’aversion que j’éprouve maintenant pour cet homme est bien ou mal fondée.
Bien que je n’attache aucune espèce d’importance à la fantastique légende du diamant, je dois avouer, avant de finir, que j’éprouve une frayeur superstitieuse à son sujet.
C’est chez moi une conviction ou une illusion, peu importe, que le crime entraîne avec lui son châtiment. Je me sens convaincu de la culpabilité d’Herncastle, et je reste persuadé qu’il regrettera pendant sa vie, s’il conserve le diamant, la part qu’il a prise dans cette mystérieuse transmission, et que d’autres subiront la fatalité attachée à la Pierre de Lune s’ils l’acceptent de sa main. Nous verrons.
L’HISTOIRE DU DIAMANT PREMIÈRE PÉRIODE PERTE DU DIAMANT (1848)
Ces événements sont relatés par Gabriel Betteredge, intendant au service de Julia, lady Verinder
CHAPITRE I
Dans la première partie de Robinson Crusoé, page 129, vous trouverez écrit :
« Alors je vis trop tard l’absurdité de tenter une entreprise avant d’en avoir calculé les charges et sans nous être rendu compte des moyens que nous avions de la mener à bonne fin. »
Pas plus tard qu’hier, j’ouvris mon Robinson Crusoé à cette place, et ce matin (21 mai 1850) le neveu de Milady, M. Franklin Blake, vint me trouver et eut avec moi la petite conversation qui suit :
« Betteredge, commença M. Franklin, je suis allé chez l’avocat pour traiter d’affaires de famille, et entre autres choses nous avons parlé de la perte du diamant indien, qui eut lieu dans la maison de ma tante, en Yorkshire, il va y avoir deux ans. M. Bruff pense, comme moi, que toute cette singulière histoire devrait, dans l’intérêt de la vérité, être mise par écrit, et que le plus tôt serait le mieux. »
N’apercevant pas encore son but, et pensant que, dans l’intérêt de la paix, il est toujours désirable de partager l’avis d’un avocat, je dis que je voyais comme lui. M. Franklin continua :
« Vous savez que, grâce à l’affaire du diamant, la réputation de plusieurs innocents a déjà souffert. Celle d’autres personnes peut dans l’avenir être de nouveau soupçonnée, faute d’un exposé des faits qui puisse éclairer l’intelligence de ceux qui viendront après nous. Enfin, Betteredge, je crois que M. Bruff et moi sommes tombés d’accord sur la meilleure manière de mettre la vérité en évidence. »
Tout cela pouvait les satisfaire infiniment, mais je ne découvrais pas en quoi cela me regardait.
M. Franklin reprit :
« Nous avons une série d’événements à raconter, et quelques-unes des personnes qui s’y trouvent mêlées sont en état d’en faire la narration. En partant de ce principe, nous avons songé que chacun de nous devrait écrire l’histoire de la Pierre de Lune en tant que nous y avons été mêlés, et rien de plus.
« Il faudrait montrer d’abord le diamant tombant entre les mains de mon oncle Herncastle lorsque, il y a cinquante ans, il servait dans l’armée des Indes.
« Je possède déjà une sorte de préface à notre récit : c’est un ancien papier de famille, où la rédaction des faits est certifiée par un témoin oculaire. Puis on raconterait comment le diamant arriva en la possession de ma tante, il y a deux ans, dans sa maison du Yorkshire, et comment il se fit que moins de douze heures après, la Pierre de Lune était perdue. Personne ne connaît aussi bien que vous, Betteredge, ce qui se passa dans la maison à cette époque. Nul n’est donc plus autorisé que vous à prendre la plume et à commencer notre récit. »
C’est ainsi que j’appris ce que j’avais à démêler dans l’affaire du diamant.
Si vous êtes curieux de savoir quel parti je pris à ce moment, je vous annoncerai que je fis ce que probablement vous auriez fait à ma place. Je me déclarai humblement incapable d’entreprendre la tâche requise, bien qu’au fond je fusse persuadé que je la remplirais fort bien si je laissais un libre essor à mes facultés personnelles. M. Franklin, j’imagine, dut lire sur mon visage mes sentiments intimes, car il refusa de croire à ma modestie et insista pour que je donnasse un libre cours à mon talent.
Deux heures se sont écoulées depuis que M. Franklin m’a quitté.
À peine a-t-il eu le dos tourné que je me suis assis à mon bureau, afin d’entreprendre ma narration.
Mais j’en suis encore là, bien perplexe, malgré mon intelligence naturelle ; je découvre ce qui apparut aux yeux de Robinson dans les lignes citées plus haut, c’est-à-dire la folie d’entreprendre une tâche avant de nous être bien rendu compte de ses difficultés !
Veuillez remarquer que j’ouvris le livre, par accident, à ce passage, et cela seulement la veille du jour où j’acceptai témérairement la difficile besogne que j’ai devant moi. Qu’est-ce qu’un pressentiment, si cela n’en est pas un ?
Je ne suis pas superstitieux, j’ai lu dans un temps une foule de livres, et je suis savant à ma façon. Bien qu’ayant dépassé soixante-dix ans, je possède une bonne mémoire et des jambes à l’avenant. Donc, ne regardez pas mon opinion comme celle d’un ignorant, lorsque je vous dirai qu’un livre comme celui de Robinson Crusoé est unique dans son genre, et que personne n’en écrira plus jamais un semblable. J’ai eu recours à ce livre depuis nombre d’années, en accompagnant sa lecture de la fumée de ma pipe, et j’y ai trouvé une consolation pour toutes les difficultés de cette existence mortelle. Lorsque mon esprit s’attriste : Robinson Crusoé ; ai-je besoin d’un conseil : encore Robinson. Autrefois, quand ma femme me tourmentait, maintenant, quand j’ai pris un petit verre de trop : toujours Crusoé. Le croiriez-vous ? j’ai usé six exemplaires de Robinson ; lors du dernier anniversaire de la naissance de Milady, elle daigna m’en offrir un septième ; prix : quatre shillings et six pence, un bel ouvrage relié en bleu, avec une gravure par-dessus le marché.
Tout ce bavardage n’avance pas l’histoire du diamant, N’est-il pas vrai ? J’ai l’air de divaguer. Allons, prenons une nouvelle feuille de papier, et commençons sérieusement en vous présentant nos respects.
CHAPITRE II
J’ai parlé précédemment de Milady. Le diamant n’eût jamais pu arriver dans notre maison où il fut perdu, si on n’en avait pas fait cadeau à la fille de Milady ; et la fille n’eût pas existé, si sa mère ne l’avait mise au monde, avec l’aide de Dieu, et beaucoup de peines et de soucis. Donc si nous débutons par parler de Milady, nous serons certains de faire remonter notre histoire assez loin, et c’est une rassurante consolation lorsqu’on est chargé d’une besogne comme la mienne.
Si vous avez quelque rapport avec le monde élégant, vous aurez entendu vanter les trois belles misses Herncastle : miss Adélaïde, miss Caroline et miss Julia ; celle-ci, la dernière des trois sœurs, était à mon avis la plus remarquable, et je pus en juger, comme vous le verrez.
J’entrai au service de leur père, le vieux lord ; il n’est pas mêlé à l’histoire du diamant, et Dieu en soit loué, car si son caractère était vif, son bavardage était intarissable au même degré ! J’entrai donc à l’âge de quinze ans dans la maison du vieux lord comme page attaché au service des trois jeunes demoiselles. Là, je vécus jusqu’au mariage de miss Julia avec sir John Verinder, homme excellent, mais demandant à être mené ; cela, soit dit entre nous, ne lui manqua pas ; et, qui plus est, il vécut heureux ainsi, y gagna d’engraisser et mourut satisfait ; cela dura à partir du jour du mariage jusqu’à celui où Milady reçut son dernier soupir et lui ferma les yeux.
J’ai oublié d’ajouter que je suivis la mariée sur les domaines de son époux. « Sir John, lui dit-elle, je ne puis me passer de Gabriel Betteredge. – Milady, repartit sir John, en ce cas, je ne saurais non plus vivre sans lui. » Ainsi agissait-il toujours avec elle, et c’est alors que j’entrai à son service. Du reste, il m’était indifférent d’être dans un lieu ou dans un autre, tant que je m’y trouvais avec ma maîtresse.
Voyant que Milady prenait intérêt à l’exploitation de ses biens et aux travaux du dehors, je m’y mis avec zèle, et cela d’autant plus aisément que je suis le septième enfant d’un petit fermier.
Lady Verinder me plaça sous les ordres du régisseur. Je fis de mon mieux, on fut content de moi et j’obtins de l’avancement en conséquence. Quelques années plus tard, un lundi, Milady disait : « Sir John, votre régisseur devient un vieil incapable, donnez-lui une bonne pension, et accordez sa place à Gabriel Betteredge. » Le mardi suivant, sir John répondait : « Chère lady Verinder, le régisseur a sa pension, et j’ai donné sa place à Betteredge. » Vous n’entendez que trop souvent parler de gens mariés qui vivent malheureux ensemble : voici un exemple du contraire ; qu’il serve d’avertissement à quelques-uns d’entre vous et d’encouragement aux autres.
Poursuivons notre récit :
On pourra me dire que rien ne manquait à mon existence.
Occupant un poste d’honorable confiance, vivant dans mon petit cottage, parcourant la propriété dans mes matinées, tenant mes comptes l’après-dînée, avec Robinson Crusoé et ma pipe le soir pour me distraire, que pouvais-je désirer de plus ? Qu’il vous plaise vous souvenir de ce qui manquait à Adam, seul dans le paradis terrestre ! et si vous approuvez Adam, ne me blâmez pas d’avoir cherché une compagne.
La femme sur laquelle se fixa mon choix était celle qui tenait mon petit ménage ; elle s’appelait Sélina Goby. D’après l’opinion de défunt William Cobbett sur les mérites d’une femme, celle-ci remplissait les principales conditions, elle jouissait d’un bon appétit et marchait avec une ferme allure ; mais j’avais, de plus, un motif tout personnel pour l’épouser. Sélina recevait de moi tant par semaine de gages, et je la nourrissais. Une fois devenue ma femme, elle ne me coûtait plus rien, et me rendait ses services gratuitement.
Tel fut le point de vue auquel je me plaçai : la considération de l’économie jointe à une pointe d’amour. Je soumis mon appréciation comme je la sentais à ma maîtresse.
« Je pense depuis un certain temps, lui dis-je, à Sélina Goby et décidément, Milady, je crois qu’il sera moins dispendieux pour moi de l’épouser que de la garder comme femme de ménage. » Lady Verinder éclata de rire, ne sachant ce qui la choquait le plus, ou de mes idées ou de ma manière de m’exprimer ; elle voulut bien me plaisanter comme ne peuvent se le permettre que les personnes de qualité. Je n’y compris qu’une chose, à savoir, que j’étais libre de suivre mon inspiration, et j’allai de ce pas me proposer à Sélina Goby. Que répondit Sélina ? Seigneur, comme vous connaissez peu les femmes si vous doutiez de sa réponse ! Naturellement elle dit oui.
Mais à mesure qu’approchait le moment où je devais me commander un habit neuf pour la cérémonie, le cœur commençait à me manquer ; j’ai du reste fait causer ou eu occasion d’observer bien des hommes sur le point de franchir ce pas, et tous m’ont déclaré que, huit jours avant, ils avaient désiré de se voir rendre leur liberté ! Moi, j’allai plus loin, et je fis un effort pour reprendre mon indépendance ; non pas certes sans compensation pour ma future, car rien n’est plus juste que la prévoyance de la loi anglaise qui offre des dommages-intérêts à la femme dont on veut se débarrasser.
Respectant donc les lois, et après entière réflexion, j’offris à Sélina Goby un lit de plumes et 50 shillings pour rompre le marché. Eh bien, non, elle fit la folie de refuser !
Le sort en était donc jeté ; j’achetai mon habit le meilleur marché possible, et me tirai de tout le reste le moins chèrement que je pus. Nous ne nous rendîmes pas fort malheureux ; mais nous n’étions pas non plus un ménage très-heureux. Tout cela se balançait ; par exemple, nous semblions toujours nous gêner mutuellement ; si l’un de nous montait, il rencontrait l’autre qui descendait, et toujours ainsi avec les meilleures intentions du monde ; c’est l’inconvénient de la vie des gens mariés.
Après cinq années de malentendus perpétuels, il plut à la Providence infinie de nous mettre d’accord en appelant ma femme dans un monde meilleur. Je restai avec ma fille Pénélope comme seule enfant.
Peu après, sir John mourût aussi, ne laissant à lady Verinder que sa fille miss Rachel. Je vous aurais bien mal fait connaître mon excellente maîtresse, si j’avais besoin de vous dire que ma Pénélope fut élevée sous sa surveillance, envoyée à l’école et enfin attachée au service de miss Rachel, lorsque son âge le lui permit.
Quant à moi, je continuai de remplir mon emploi de régisseur, d’année en année, jusqu’en 1847, époque à laquelle il se fit, à la Noël, un grand changement dans ma vie. Ce jour-là, Milady s’invita elle-même à prendre une tasse de thé seule avec moi dans mon cottage. Elle me fit remarquer qu’en calculant depuis l’année où j’avais commencé en qualité de page, du temps du vieux lord, son père, j’avais été plus de cinquante ans à son service, et elle me remit un beau gilet de laine, qu’elle avait tricoté elle-même, pour me tenir chaud pendant les froids piquants de l’hiver.
Je reçus ce présent magnifique, sans savoir comment remercier ma maîtresse de l’honneur qu’elle m’avait fait. À ma grande surprise, il se trouva pourtant que le gilet m’était offert non pour m’honorer, mais pour me séduire. Milady avait découvert que je devenais vieux avant que je l’eusse découvert moi-même, et elle était venue me voir pour m’enjôler, si le terme m’est permis, et me faire échanger mes durs travaux de régisseur qui me retenaient au dehors, contre les douces fonctions d’intendant qui m’assuraient mes aises à l’intérieur de la maison pour le reste de mes jours.
Je résistai aussi bien que je pus à l’indigne tentation de prendre mes invalides[1]. Par malheur, ma maîtresse connaissait mon côté faible ; elle me dit que c’était un service à lui rendre. La discussion se termina là-dessus. Je m’essuyai les yeux, comme une vieille bête, avec mon nouveau gilet de laine, et je dis que j’y réfléchirais.
Mais quand je me mis à y réfléchir, après le départ de Milady, mon esprit devint terriblement perplexe, et j’eus recours alors au remède qui m’a toujours réussi dans les cas douteux et critiques. J’allumai une pipe et j’ouvris mon Robinson Crusoé. Il n’y avait pas cinq minutes que je feuilletais ce livre extraordinaire, quand je tombai sur ce passage consolant (page 158) : « Nous aimons aujourd’hui ce que nous détestons demain. » Ce fut un trait de lumière pour moi. Aujourd’hui je voulais continuer d’être régisseur : demain, s’il fallait en croire le Robinson Crusoé, je serais tout autrement disposé. Je n’avais qu’à me transporter au lendemain, pendant que j’étais disposé à accepter le lendemain, et la chose fut faite. Mon esprit une fois soulagé de cette manière, je m’endormis ce soir-là avec la qualité de régisseur de lady Verinder, et je m’éveillai le lendemain matin avec la qualité d’intendant de lady Verinder. Tout alla à merveille, et cela grâce à Robinson Crusoé.
Ma fille Pénélope vient de regarder par-dessus mon épaule afin de lire ce que j’écris ; elle trouve le tout remarquablement rédigé et très-exact. Mais elle me soumet une observation juste. « On vous a demandé d’écrire l’histoire du Diamant, et c’est le seul point dont vous n’ayez pas parlé, vous n’avez fait encore que raconter votre propre histoire ! » C’est parfaitement vrai, et je ne puis m’expliquer comment je m’y suis pris pour cela. Je me demande si ceux qui font leur métier d’écrire des livres, se trouvent portés ainsi à faire l’histoire de leur vie ! en ce cas, je les plains. Voilà bien du papier de gâté, un début inutile, et qu’y faire pourtant, si ce n’est de vous prier, ami lecteur, de prendre patience, et pour moi d’aborder sérieusement mon sujet, bien que j’en sois à la troisième reprise ?
CHAPITRE III
La difficulté d’entrer en matière m’a amené d’abord et sans résultat à me gratter le front ; puis à consulter ma fille Pénélope ; de cet entretien il a surgi une idée nouvelle.
Pénélope pense que je devrais noter, jour par jour, ce qui s’est passé à la maison depuis le moment où nous apprîmes qu’on attendait une visite de M. Franklin Blake. Une fois que vous avez ainsi fixé votre mémoire avec une date, les événements viennent se grouper à cet appel avec une facilité merveilleuse. Mais comment retrouver toutes ces dates exactes ? Là, Pénélope offre de me les donner à l’aide de son journal qu’elle a appris à tenir régulièrement lorsqu’elle était à l’école. Là-dessus, je me proposais d’écrire l’histoire elle-même comme un extrait dudit journal ; mais elle rougit, prend un air offensé, et m’assure que ses souvenirs ne sont que pour elle seule, et que nul autre qu’elle n’y jettera les yeux ; je lui demande ce que cela signifie, elle me répond : « Bagatelle ! » et je traduis cela par amourettes de jeune fille.
Je commence donc, en suivant les indications de Pénélope ; je dirai que je fus appelé, le matin du 24 mai 1848, dans le boudoir de lady Verinder. – Gabriel, me dit Milady, voici des nouvelles qui vous surprendront : Franklin Blake est de retour de l’étranger. Il vient de passer quelque temps avec son père à Londres, et nous arrive demain pour jusqu’au mois prochain, afin de fêter le jour de naissance de Rachel.
Si j’eusse eu mon chapeau à la main, le respect seul m’eut empêché de le jeter au plafond. Je n’avais pas revu M. Franklin depuis son enfance, qu’il avait passée avec nous dans maison. Autant que je pouvais m’en souvenir, il était le plus charmant garçon qui eût jamais cassé une vitre, ou fouetté une toupie. Miss Rachel, qui était présente, et à laquelle je soumis ces remarques, me répondit que, quant à elle, il lui avait laissé le souvenir d’un tyran en herbe, qui torturait ses poupées, et n’épargnait ni le harnais ni le fouet aux petites filles devenues victimes de ses jeux.
« Je brûle d’indignation, fit en se résumant miss Rachel, et il me semble que j’ai encore une courbature lorsque je pense à Franklin Blake. »
Ceci admis, vous me demanderez peut-être comment il se fait que M. Blake eût passé toute sa jeunesse à l’étranger. Je vous dirai que son père avait eu le malheur d’être le légitime héritier d’un duché, et de ne pouvoir en fournir les preuves.
En deux mots, voici l’histoire.
La sœur aînée de Milady épousa M. Blake, également célèbre par sa fortune et son grand procès. Je ne pourrais jamais énumérer pendant combien d’années il fatigua les tribunaux anglais de ses tentatives pour déposséder le duc et se mettre en ses lieu et place ; que d’avocats il enrichit, et combien de disputes il occasionna parmi des gens inoffensifs d’ailleurs pour savoir s’il avait tort ou raison ! Sa femme mourut, puis deux de ses enfants sur trois qu’il avait, avant que les tribunaux se fussent décidés à ne plus prendre son argent et à le débouter de ses prétentions.
Enfin le duc alors en possession resta possesseur ! À dater de ce jour, M. Blake trouva que le seul moyen de témoigner son dédain pour un pays qui l’avait traité ainsi, était de le priver de l’honneur de contribuer à l’éducation de son fils. « Quelle confiance puis-je avoir dans les institutions de ma patrie, disait-il, après la manière dont les institutions de ma patrie se sont comportées envers moi ? » Ajoutez à cela que M. Blake ne pouvait souffrir la vue d’aucun enfant, y compris le sien, et vous comprendrez que dès lors il n’avait qu’un parti à prendre. M. Franklin nous fut enlevé et on l’envoya en Allemagne, pays dont les institutions et la supériorité intellectuelle offraient toutes garanties à son père ; remarquez que, pendant ce temps, M. Blake restait confortablement en Angleterre, pour augmenter le nombre des lumières du Parlement, et publier un mémoire contre la mise en possession du duc, mémoire qui est resté inachevé jusqu’à ce jour. Dieu merci, nous voilà au courant de l’affaire de M. Blake père, et nous pouvons arriver enfin à celle du Diamant.
Le diamant nous ramènera du reste à M. Franklin, qui fut la cause innocente de l’introduction de ce malheureux joyau dans la maison.
Notre cher garçon ne nous oubliait pas, malgré l’absence. Il écrivait de temps à autre, tantôt à Milady, tantôt à miss Rachel, et enfin à moi.
Nous avions fait ensemble une petite transaction par laquelle il m’avait emprunté une pelote de ficelle, un couteau à quatre lames, et sept shillings six pence, dont je n’ai jamais revu la couleur. Je dois avouer que toute sa correspondance avec moi roulait sur le désir de m’emprunter une somme plus forte. J’apprenais du reste par Milady comment il se conduisait sur le continent, à mesure qu’il prenait de l’âge et des forces.
Lorsque le séjour de l’Allemagne lui eut fourni tout ce qu’il pouvait apprendre, il tourna ses pas vers la France puis, se dirigeant sur l’Italie, il profita si bien de ces divers séjours qu’il devint une véritable merveille.
Il écrivait un peu, faisait un peu de peinture, chantait, jouait de divers instruments, et composait un peu de musique, je suppose, en empruntant légèrement au talent d’autrui, puisqu’il avait pris l’habitude des emprunts, même vis-à-vis de moi !
Il reçut à sa majorité la fortune de sa mère, sept cents livres de revenu, mais il la dissipa comme par enchantement. Il semblait que les poches de M. Franklin fussent à jour, car l’argent coulait à travers.
Par exemple, cette facilité de manières et de dépenses le faisait bien recevoir partout. Il vivait en tout lieu et nulle part, son adresse semblait être, comme il le disait fort bien : « Poste restante, Europe ; garder la lettre jusqu’à ce qu’on la réclame. » Deux fois, il se prépara à revenir en Angleterre, et les deux fois, des femmes peu recommandables (sauf votre respect) l’arrêtèrent en chemin.
La troisième fois fut la bonne, ainsi que vous l’apprend la conversation que Milady eut avec moi.
Le mardi 25 mai, nous devions enfin revoir notre jeune garçon devenu un homme fait. Il était d’un bon sang, courageux, et âgé, à mon compte, de vingt-cinq ans. Maintenant, je vous ai fait connaître M. Franklin Blake autant qu’il m’était connu à moi-même, avant le moment où il revint chez nous.
Le jeudi, il fit un admirable temps d’été, et Milady n’attendant M. Franklin que pour l’heure du dîner, partit avec miss Rachel pour aller goûter chez des amis du voisinage.
Après leur départ, je donnai un coup d’œil à la chambre qui avait été tenue prête pour notre hôte, et m’assurai que rien n’y manquait ; puis, comme je cumulais chez Milady les fonctions de sommelier avec celles d’intendant, et cela, sur ma demande instante, ne pouvant supporter de voir la cave du défunt sir John en d’autres mains que les miennes, je descendis prendre une bouteille de notre fameux bordeaux Latour, et la mis au soleil pour la réchauffer jusqu’au dîner. Cela fait, je me traitai comme le vieux bordeaux, et pensai à aller me reposer sur mon fauteuil dans la cour, lorsque mon attention fut attirée par un léger son de tambour, battant sur la terrasse, située devant l’appartement de Milady.
Je me dirigeai vers la terrasse, et j’aperçus trois Indiens reconnaissables à leur costume de mousseline blanche, occupés à examiner la maison. En m’approchant d’eux, je vis que les Indiens portaient à leur ceinture de très-petits tambours. Derrière eux se tenait un enfant délicat, dont les traits paraissaient ceux d’un Anglais, et qui portait un sac à la main.
Je jugeai que ces individus étaient des prestidigitateurs ambulants, et que le gamin tenait les objets du métier.
L’un de ces hommes se détacha du groupe et confirma mon opinion, en m’adressant la parole en anglais et avec les manières les meilleures. Il demanda l’autorisation de déployer son talent d’escamotage devant la maîtresse du logis.
Je suis loin d’être un vieillard morose, ennemi de la distraction ou plein de préjugés contre ceux qui ont le teint plus basané que le mien.
Pourtant, j’avoue ma faiblesse, lorsque toute l’argenterie d’une maison est étalée dans l’office, son souvenir se présente à moi très-vivement, à la vue d’étrangers inconnus, et dont les manières offrent l’apparence d’une si singulière supériorité ! Sous le coup de cette impression, je commençai par prier nos élégants escamoteurs de quitter les jardins, leur assurant que la dame était sortie. L’Indien m’honora d’un superbe salut, et disparut avec ses acolytes.
À mon tour, je regagnai ma chaise, m’assis au soleil, et tombai, sinon dans le sommeil, au moins dans un assoupissement qui y ressemblait fort. Je fus réveillé par ma fille Pénélope, qui accourait précipitamment vers moi comme si le feu était à la maison : devinez ce qui l’amenait ? Elle exigeait que les trois jongleurs indiens fussent immédiatement arrêtés, et cela parce qu’ils savaient de quelle personne nous attendions une visite, et qu’ils avaient l’air de machiner quelque chose contre M. Fr. Blake.
Pour le coup, le nom de M. Franklin acheva de secouer ma torpeur ; j’ouvris les yeux, et dis à ma fille de s’expliquer plus clairement.
Il ressortit ceci de son récit : Pénélope venait de quitter la maison du concierge où elle était à bavarder avec la fille de ce dernier. Ces deux jeunesses virent passer les Indiens suivis du petit garçon, après que je les eus renvoyés. S’étant mis en tête sans motif valable (sauf que l’enfant était joli et délicat) que le gamin était maltraité par ces étrangers, les jeunes filles s’étaient glissées le long de la haie qui nous sépare de la route, et avaient observé de là les allures des Indiens placés de l’autre côté du chemin. Elles avaient vu ces derniers se livrer aux tours les plus étranges.
D’abord, ils explorèrent la route afin de s’assurer qu’ils étaient bien seuls.
Cela fait, ils se retournèrent tous trois vers la maison, puis une sorte de discussion s’engagea entre eux, dans leur langue Ils semblèrent se consulter, hésiter, et enfin se tournèrent vers leur petit guide anglais, comme si lui seul pouvait les tirer d’embarras.
Alors l’Indien chef, qui parlait anglais, dit à l’enfant : « Étends la main. »
Ici, ma fille Pénélope affirma qu’en entendant ces terribles paroles, elle ne sut ce qui empêcha son cœur de bondir hors de sa poitrine ; je pensai à part moi que ce ne pouvait être que son corset ! Pourtant, je lui répliquai simplement : « Vous me faites frissonner. » Notez que toutes les femmes aiment ces petits compliments à sensation. – Eh bien, reprit-elle, lorsque l’Indien eut répété : « Étends la main, »l’enfant recula, secoua la tête, et dit qu’il n’aimait pas cela. Alors le jongleur lui demanda (sans aucune dureté) s’il aimerait mieux retourner à Londres, y être abandonné là où on l’avait recueilli, dormant sur un vieux panier dans le marché, en haillons et mourant de faim. Cela, paraît-il, trancha la difficulté, et le pauvre petit tendit sa main, quoique à regret. L’Indien, tirant une bouteille de ses vêtements, versa une sorte d’encre noire dans le creux de la main de l’enfant ; après quelques passes mystérieuses faites en l’air, il lui dit : « Regarde ; » le garçon devint immobile, et, raide comme une statue, regarda l’encre contenue dans sa main.
Jusqu’à présent, le tout me parut à moi une sorte de jonglerie avec perte de bonne encre, et le sommeil m’envahissait de nouveau, lorsque la suite du récit de Pénélope attira mon attention.
Les Indiens explorèrent encore une fois la route des yeux, puis, s’adressant à l’enfant, leur chef reprit : « Vois-tu le seigneur anglais qui vient de l’étranger ? » L’enfant répondit : « Je le vois. »
L’Indien demanda : « Est-ce sur le chemin de cette maison que voyagera aujourd’hui l’Anglais, et ne voyagera-il sur aucun autre ? »
Le garçon répond : « Oui, sur cette route et sur aucune autre. »
Alors l’Indien, après quelques moments de silence reprend : « Le seigneur anglais l’a-t-il sur lui ? » Après avoir à son tour laissé passer un instant, l’enfant dit : « Oui. »
Enfin le jongleur pose une troisième et dernière question : « Le voyageur anglais viendra-t-il ici aujourd’hui, et vers la chute du jour, comme il l’a promis ? »
L’enfant reprend : « Je ne puis le dire. »
L’Indien demande : « Et pourquoi ? »
Le petit ajoute : « Je suis fatigué, le brouillard s’élève dans ma tête, et me déroute ; je ne puis plus rien voir en ce moment. »
Ainsi finit cet interrogatoire mystérieux.
L’Indien parla à ses compagnons dans leur langue : il désignait le jeune garçon, et indiquait du geste la ville, où, comme nous le découvrîmes plus tard, ils étaient logés. Enfin, après quelques passes, il souffla sur le front de l’enfant, et celui-ci s’éveilla en sursaut. Ils s’acheminèrent ensuite tous ensemble vers la ville, et les jeunes filles ne les virent bientôt plus.
Toute chose contient, dit-on, sa moralité, pour peu qu’on se donne la peine de la chercher. Quelle était la morale de tout cela ?
Je pensai, premièrement, que le jongleur en chef avait entendu parler de l’arrivée de M. Franklin par les serviteurs du dehors, et qu’il cherchait à attraper de lui quelque argent.
Deuxièmement, que dans ce but, lui et ses acolytes, voulaient rôder sur le domaine, guetter le retour de Milady, et lui annoncer l’arrivée de M. Franklin, sous couleur de sorcellerie ; troisièmement, que Pénélope les avait surpris répétant leurs rôles pour la farce à jouer ; quatrièmement, que je ferais bien de veiller ce soir sur l’argenterie ; cinquièmement, que Pénélope ferait bien, elle aussi, de se calmer et de laisser son père se reposer au soleil.
Ces divers points de vue me semblaient tous rationnels mais si vous connaissez quelque chose à la manière de raisonner des jeunes femmes, vous ne serez pas surpris d’apprendre que Pénélope ne voulut accepter aucune de ces hypothèses. À en croire ma fille, la conclusion à tirer de l’incident était des plus graves.
Elle me ramena à la troisième question de l’Indien : « Le voyageur anglais l’a-t-il sur lui ? » Oh, mon père, dit Pénélope, joignant les mains, ne plaisantez pas là-dessus ! Que peut signifier l’a-t-il ?
– Ma chère enfant, nous le demanderons à M. Franklin lorsqu’il sera ici, si vous pouvez attendre jusqu’à son arrivée.
Je pris un air moqueur pour lui faire voir que je riais, mais Pénélope ne perdant pas son sérieux, commença à m’agacer les nerfs. – Que voulez-vous que M. Franklin en sache, au nom du bon Dieu, lui demandai-je ?
– Informez-vous-en auprès de lui, poursuivit Pénélope, et nous verrons s’il traitera mon récit de plaisanterie.
Sur ce dernier avertissement, ma fille me laissa à mes réflexions.
Je me proposais de questionner M. Franklin, rien que pour satisfaire Pénélope.
Je dirai plus tard le résultat de notre entretien ; mais comme je ne veux pas jouer avec votre légitime impatience, je vous préviens d’avance que vous ne trouverez pas l’ombre d’une plaisanterie dans la conversation que nous eûmes au sujet des jongleurs. À ma grande surprise, M. Franklin prit la chose comme Pénélope, très-sérieusement ; et vous jugerez jusqu’à quel point lorsque vous saurez que, selon lui, le mot l’a-t-il sur lui ? se rapportait à la Pierre de Lune !
CHAPITRE IV
Je regrette vraiment de vous retenir près d’un vieillard assoupi, d’un fauteuil et d’une cour située au soleil, tous objets, je le sais, de mince intérêt ; mais il faut procéder par ordre : résignez-vous donc à me suivre encore un peu jusqu’à l’arrivée de M. Franklin Blake, qui n’eut lieu que dans le courant de la soirée.
Avant que j’eusse eu le temps de reprendre ma sieste interrompue par Pénélope, un bruit de vaisselle dans l’office des domestiques m’avertit que leur dîner était servi. Mangeant à part dans ma chambre, je n’avais qu’à leur souhaiter un bon appétit, et je me disposai encore une fois au repos ; j’étendais mes jambes, lorsqu’une femme se jeta de nouveau sur moi ! Non pas ma fille cette fois, mais Nancy, la fille de cuisine. Elle dut me demander de la laisser passer, car je me trouvais placé sur son chemin ; je remarquai alors son air grognon, chose que, comme chef de la domesticité, j’ai pour principe de ne jamais tolérer sans en demander le motif.
– Qu’y a-t-il donc, Nancy, lui dis-je, et pourquoi tourner le dos au dîner ?
Nancy essaya de passer sans répondre, mais je me levai, et lui pris le bout de l’oreille ; c’est une bonne grosse fille, et j’ai adopté cette petite familiarité pour indiquer que je suis personnellement satisfait d’une des femmes de la maison.
– Qu’y a-t-il ? répétai-je.
– Rosanna est encore en retard, fut la réponse, et il faut que j’aille la chercher pour dîner, Tout le gros de l’ouvrage tombe sur mon dos dans cette maison ; laissez-moi aller, monsieur Betteredge.
La personne en question était notre seconde housemaid.
Elle m’inspirait une sorte de pitié (vous saurez tout à l’heure pourquoi) ; aussi voyant à l’air de Nancy que cette fille lui parlerait plus rudement qu’il n’était nécessaire, je pensai que, puisque je n’avais rien à faire moi-même, je pourrais bien aller quérir Rosanna et l’engager à être plus exacte. Je savais que, venant de moi, cette petite remontrance serait bien accueillie.
– Où est Rosanna ? demandai-je.
– Sur le sable, comme de coutume, sans doute, dit Nancy, en haussant les épaules.
« Elle a eu encore un de ses évanouissements ce matin, et a demandé à aller prendre l’air. On perd patience avec toutes ses grimaces. – Allez dîner, ma fille, lui dis-je, moi qui me sens de la patience, je vais aller voir après elle. »
Nancy, qui a un bel appétit, parut très-satisfaite. Lorsqu’elle est contente, elle devient vraiment agréable. Aussi la pris-je sous le menton ; ce n’est point un penchant immoral chez moi : affaire d’habitude.
Je pris ma canne et partis pour les bancs de sable.
Eh non, nous ne partons pas encore. Je regrette de vous retenir, mais il faut que vous entendiez l’histoire des sables, et celle de Rosanna, par la raison que l’une et l’autre se lient à celle du diamant.
En vérité, je fais de mon mieux pour avancer dans ma narration, et toujours je suis arrêté en chemin ! Mais les gens et les choses semblent surgir pour vous contrarier, tous veulent être pris en considération ; donc, armez-vous de patience, moi je me hâterai, et je vous promets que vous serez bientôt parvenu au plus épais du mystère.
Vous saurez que Rosanna était la seule servante nouvelle de la maison. Environ quatre mois avant les événements que je raconte, Milady étant à Londres alla visiter une maison de refuge, où l’on s’appliquait à moraliser les femmes sorties de prison, pour les empêcher de retomber dans leurs mauvaises habitudes.
La directrice voyant l’intérêt que Milady prenait à l’établissement, lui désigna une jeune fille du nom de Rosanna Spearman, et lui raconta une triste histoire, que je n’ai pas le courage de répéter ici, car je n’aime pas, ni vous non plus sans doute, à chercher les impressions pénibles sans nécessité.
Bref, Rosanna avait volé, et comme elle n’appartenait pas à cette classe d’escrocs qui montent des compagnies dans la cité pour pratiquer le vol sur une vaste échelle, la loi put l’atteindre, la mettre en prison et ensuite l’abandonner au diable, auquel elle échappa par le moyen du Refuge. Dans l’opinion de la directrice, en dépit de sa faute, cette fille était une nature exceptionnelle, et il ne lui fallait qu’une occasion pour se montrer digne de l’intérêt qu’une femme chrétienne lui témoignerait. Milady, qui était une parfaite chrétienne, dit à la directrice : « Cette occasion, je me charge de la fournir à Rosanna Spearman en l’engageant à mon service. » Une semaine plus tard, Rosanna entra dans notre maison comme seconde housemaid.
Personne ne sut un mot du passé de Rosanna, sauf miss Rachel et moi, Milady me faisant l’honneur de me consulter sur beaucoup de points, je le fus sur celui-ci. J’avais pris de feu sir John l’habitude d’acquiescer toujours à ce que faisait Milady, aussi n’eus-je pas de peine être de son avis au sujet de Rosanna Spearman.
Jamais personne n’eut une plus belle chance de réformer sa vie passée que cette pauvre fille. Aucun des domestiques ne pouvait la lui reprocher, puisque tous l’ignoraient. Elle touchait ses gages, avait la même liberté que ses compagnes, et souvent un petit mot d’encouragement de Milady, donné en particulier. En retour, je dois dire qu’elle sut reconnaître ces bons traitements. Bien que peu forte, et sujette aux évanouissements qui impatientaient Nancy, elle accomplissait sa tâche modestement et tranquillement, sans jamais se plaindre et avec tout le soin possible.
Malgré tout cela, elle ne put se faire bien voir des autres femmes de la maison, sauf de ma fille Pénélope, qui fut toujours bonne pour elle, quoique sans intimité.
Je ne sais vraiment ce qui offensait de sa part ses compagnes.
Elle n’était certes pas belle, et ne pouvait exciter leur jalousie : outre qu’elle était la plus laide d’entre elles toutes, elle avait une épaule plus forte que l’autre. Je crois que ce qui agaçait tant nos domestiques, c’était son silence et ses goûts de solitude.
Elle lisait et travaillait dans ses heures de loisir, alors que les autres bavardaient, et quand arrivait son tour de sortie, neuf fois sur dix, elle prenait tranquillement son chapeau et allait se promener seule.
Elle ne se disputait ni ne se piquait aisément ; mais elle se tenait à distance, obstinément, bien que sans hauteur. Ajoutez-y que, quoique sa mise fût celle d’une domestique, il y avait dans sa personne un je ne sais quoi de vraiment distingué ; cela tenait-il à sa voix ou à l’expression de sa figure ? Tout ce que je puis dire, c’est que toutes les femmes tombèrent sur elle dès le premier jour (fort injustement, à mon avis) et déclarèrent que Rosanna Spearman se donnait des airs ridicules.
Maintenant que je vous ai raconté l’histoire de Rosanna, je n’ai plus qu’à signaler une des nombreuses bizarreries de cette étrange fille : j’y viendrai après avoir dit quelques mots des sables.
Notre maison est située sur la côte du Yorkshire et tout près de la mer. Les belles promenades se rencontrent dans tous les sens, sauf dans un, et ce chemin-là, j’en conviens, est abominable. Il vous mène pendant un quart de mille, à travers une chétive plantation de sapins, au bord de la plus triste petite baie de la côte, que longent des rochers bas et solitaires.
Les bancs de sable descendent vers la mer, et se terminent par deux pointes de rochers qui s’avancent vis-à-vis l’une de l’autre, jusqu’à ce que vous les perdiez de vue dans l’eau. L’un de ces rocs se nomme la Pointe du Nord et l’autre la Pointe du Sud.
Entre les deux, changeant d’arrière à avant pendant de certains temps de l’année, se trouvent les plus terribles sables mouvants des rives du Yorkshire. À la marée descendante, il se passe dans ces profondeurs inconnues quelque chose d’étrange qui fait frémir et bouillonner tout le sable mouvant d’une façon curieuse à observer, et qui a donné à ce lieu, parmi les gens du pays, le nom de Sables-Tremblants. Un grand banc, à un demi-mille de distance, près de l’ouverture de la baie, brise la force de l’Océan arrivant du large. Hiver comme été, lorsque le flux couvre les sables mouvants, la mer semble arrêter ses vagues sur le banc, et l’eau envahit silencieusement les Sables-Tremblants, agitée seulement d’un long frémissement. Endroit triste et désert, je vous l’assure ! Aucune barque ne s’aventure près de là ; les enfants du hameau de pêcheurs, nommé le Cobb’s Hole, n’y viennent point jouer, et les oiseaux même du ciel semblent fuir les Sables-Tremblants.
Ce qui passe croyance, c’est qu’une jeune femme, ayant cent promenades agréables à sa disposition, et de la compagnie pour se distraire, préfère ce vilain trou, et vienne là lire et travailler toute seule.
Il n’en est pas moins vrai, expliquez-le comme vous pourrez, que cette jolie retraite était la promenade favorite de Rosanna, sauf lorsqu’elle allait jusqu’à Cobb’s Hole, pour y voir la seule amie qu’elle possédât dans le pays, et sur laquelle nous reviendrons plus tard.
Je me mis donc en marche pour rejoindre Rosanna dans le lieu présumé de sa retraite et pour l’envoyer dîner ; nous voici revenus, vous le voyez, au point de départ de mon histoire des Sables.
Je ne vis aucune trace de la jeune fille sous les sapins. Lorsque j’arrivai sur le rivage, je la trouvai couverte d’un grand manteau gris qu’elle portait toujours pour dissimuler, autant que possible, la difformité de son épaule, la tête coiffée de son petit chapeau de paille. Elle était seule, occupée à contempler les sables mouvants et la mer.
Elle tressaillit à mon approche et détourna la tête. Je la retournai de mon côté, n’admettant pas plus cette manière de ne pas me regarder en face, que la mauvaise humeur sans cause, et je vis qu’elle pleurait. Je tirai gracieusement de ma poche mon mouchoir, un des six foulards hors ligne que m’avait donnés Milady, et le tendis à Rosanna, en lui disant : « Asseyez-vous sur le sable près de moi, ma chère, séchez vos yeux d’abord, puis veuillez m’apprendre la cause de vos larmes. »
Quand vous serez arrivé à mon âge, vous verrez que de s’asseoir sur le bord du rivage est un travail plus long que vous ne le croyez maintenant. Pendant le temps que je mis à m’installer, Rosanna avait déjà essuyé ses yeux avec un vulgaire mouchoir de cotonnade ; elle semblait tranquille, mais malheureuse ; elle s’assit pourtant près de moi. Si vous voulez consoler une femme qui pleure, prenez-la sur vos genoux. Ce moyen ne manque presque jamais son effet. Je songeai bien à cette méthode, mais vrai, là, Rosanna n’était pas Nancy ! Je lui dis alors : « Voyons, mon enfant, pourquoi vous désolez-vous ainsi ? – Je pleure les années passées, monsieur Betteredge, repartit doucement Rosanna ; ma vie d’autrefois revient si souvent à ma mémoire ! – Allons, allons, ma bonne fille, repris-je, votre vie passée est effacée : pourquoi vous obstiner à y songer ? »
Elle prit un des revers de mon habit entre ses mains ; je suis un vieillard un peu négligé dans ma mise, et souvent je donne à boire ou à manger à mes vêtements. L’une ou l’autre des femmes nettoie mes taches ; or, justement la veille Rosanna s’était chargée d’enlever une tache de graisse avec une nouvelle composition trop vantée. La graisse avait disparu, mais la tache se voyait, bien que légère. Rosanna me la montra du doigt en secouant la tête. « La tache a été enlevée, dit-elle, mais la trace se voit, monsieur Betteredge ! »
Une remarque si concluante laissait peu de chose à répondre ; d’ailleurs mon silence s’augmentait en voyant l’expression des yeux bruns de Rosanna, le seul de ses traits qui fût réellement agréable ; leur regard me rendait indulgent envers cette pauvre créature, qui semblait se dire que ma vieillesse heureuse et l’estime qu’on m’accordait ne seraient jamais son lot. Me sentant peu habile à la consoler, je pris le parti de l’engager à venir dîner.
« Aidez-moi à me soulever, lui dis-je, vous êtes en retard pour le dîner, et j’étais venu pour vous chercher. – Vous, monsieur Betteredge, répondit-elle ! – On avait envoyé Nancy près de vous, répliquai-je, mais j’ai pensé, ma chère, que vous aimeriez peut-être mieux subir ma remontrance que la sienne. »
Au lieu de m’aider à me lever, la pauvre femme prit timidement ma main, et la pressa ; elle fit de son mieux pour ne pas pleurer, et y réussit, ce dont je lui sus gré. « Vous êtes bien bon, monsieur Betteredge, fit-elle ; je ne me soucie pas de dîner aujourd’hui, laissez-moi rester encore un moment ici. – Qu’est-ce qui vous plaît ici, demandai-je, et que trouvez-vous donc d’attrayant dans cet éternel but de promenade ? – Quelque chose m’attire là, dit Rosanna, désignant les sinuosités des Sables ; je tâche de m’en défendre, et je ne puis. Parfois, ajouta-t-elle à voix basse, et comme effrayée de ses pensées, parfois, monsieur Betteredge, je crois que ma tombe m’attend ici.
– Allez donc dîner, lui dis-je, c’est le rôti de mouton et le pudding qui vous attendent là-bas ; voilà les belles idées, Rosanna, qui sortent d’un estomac vide ! » Je parlais sévèrement, car je m’indignais, à mon âge, qu’une jeune femme de vingt-cinq ans parlât de sa fin comme prochaine !
Elle ne parut pas m’entendre ; sous l’empire d’une sorte de rêverie, Rosanna mit sa main sur mon épaule, et me contraignit à rester assis près d’elle.
« Je crois que ce lieu, poursuivit-elle, a une étrange influence sur moi. J’en rêve toutes les nuits ; j’y pense lorsque je travaille. Vous savez, monsieur Betteredge, si je suis reconnaissante envers Milady et envers vous, si j’ai cherché à me montrer digne de votre estime. Eh bien, je me demande si cette vie n’est pas trop douce, trop unie pour une femme comme moi, après tout ce que j’ai traversé !
« Je me sens plus isolée au milieu des domestiques, me sachant si différente d’eux, que lorsque je suis seule ici. Milady ne peut le deviner, la directrice du Refuge ne soupçonne pas tout ce que la vue d’honnêtes gens contient de reproches pour une créature tombée. Ne me grondez pas, là, vous serez bien bon. Je fais bien mon ouvrage, n’est-ce pas ? Je vous en prie, ne dites pas à Milady que je me déplais ici ; cela n’est pas. Mon esprit est troublé, voilà tout. »
Tout à coup sa main quitta mon épaule, et elle montra d’un geste rapide le sable mouvant. « Voyez, s’écria-t-elle, n’est-ce pas bien étrange ? J’ai vu cela cent fois, et le spectacle en est aussi nouveau pour moi qu’au premier jour ! »
Je regardai ce qu’elle me désignait.
La marée montait, et le sable commençait à frémir. Sa large et sombre étendue se souleva lentement, puis se rida et enfin se mit à trembler. « Savez-vous ce que cela me représente, dit Rosanna, qui me ressaisit par le bras ? Il me semble voir des milliers d’infortunés, suffoquant sous le sable, cherchant à remonter, et s’enfonçant de plus en plus dans l’abîme ! Jetez-y une pierre, monsieur Betteredge, jetez la et voyons le sable l’attirer, puis la couvrir, et l’étouffer ! »
En voilà un bavardage malsain pour l’esprit ! et tout cela, parce que l’estomac vide excitait le cerveau !
Dans l’intérêt même de cette pauvre enfant, je m’apprêtais à lui répondre d’une façon assez rude, lorsque je fus arrêté net par une voix qui m’appelait par mon nom à travers les Sables : « Betteredge, criait-on, où êtes-vous ? – Ici, » répondis-je, sans soupçonner qui me hélait.
Rosanna sauta sur ses pieds, et se mit à regarder du côté d’où partait l’appel.
Je me disposais à me lever aussi quand je fus frappé du changement soudain qui s’était opéré sur le visage de cette fille.
Son teint devint d’un rouge vif, que je ne lui avais jamais vu auparavant ; sa physionomie s’éclaira en quelque sorte d’une surprise inouïe. « Qui est-ce donc ? » dis-je. Rosanna répéta ma question, se parlant doucement à elle même : « Oh ! qui est-ce ? »
Je me retournai et je regardai derrière moi. J’aperçus, venant à nous à travers les collines, un jeune gentleman, aux yeux brillants, vêtu d’un costume de couleur fauve, une rose à la boutonnière, et avec un sourire qui eût dû désarmer les Sables-Tremblants eux-mêmes. Avant que je pusse me mettre debout, il se jeta sur le sable près de moi, me passa les bras autour du cou, et, selon la mode étrangère, me donna une embrassade à m’étouffer.
« Mon bon vieux Betteredge ! dit-il, je vous dois sept schillings six pence. »
« Savez-vous maintenant qui je suis ? »
Le bon Dieu nous bénisse ! c’était M. Franklin Blake que nous avions sous les yeux quatre heures plus tôt qu’on ne l’attendait !
Avant que j’eusse retrouvé la parole, je vis M. Franklin, avec l’apparence de la surprise, porter ses regards de moi sur Rosanna. Je suivis ses yeux à mon tour, et la considérai. Elle rougissait de plus en plus, sans doute depuis que M. Franklin l’envisageait : puis, tout à coup, elle se retourna et nous laissa là subitement, en proie à une émotion incompréhensible sans même faire la révérence au gentleman, ni m’adresser un mot. Cette manière insolite d’agir était bien extraordinaire chez elle, car j’ai rarement rencontré une servante plus convenable et plus polie.
« Singulière fille, dit M. Franklin, je ne sais ce qui lui a paru si bizarre en moi ! – Je suppose, monsieur, répliquai-je en faisant allusion à son éducation étrangère, que c’est le vernis des pays lointains ! »
Je note ici la question banale de M. Franklin ; et ma niaise réponse, comme pouvant servir de consolation à tous les gens sans esprit ; car j’ai remarqué qu’il y a une certaine satisfaction pour les gens inférieurs à voir qu’en beaucoup d’occasions leurs supérieurs ne déploient pas plus de finesse qu’eux ; or, ni M. Franklin, avec sa brillante éducation reçue à l’étranger, ni moi avec mon âge, mon expérience et mon esprit naturel, n’eûmes un soupçon de ce que signifiait la singulière attitude de Rosanna Spearman.
Nous ne songions plus à elle, pauvre fille, alors que son manteau gris avait à peine disparu derrière les sables. Que nous importe enfin ? direz-vous avec quelque raison. Continuez à me lire aussi patiemment que possible et peut-être vous plaindrez Rosanna Spearman, comme je la plaignis quand je découvris la vérité.
CHAPITRE V
Mon premier soin, dès que nous nous trouvâmes seuls, fut de chercher pour la troisième fois à me mettre sur mes pieds ; M. Franklin m’arrêta.
« Cet affreux site a au moins un avantage, dit-il, nous y sommes parfaitement seuls ; restez en place, Betteredge, j’ai à vous parler. » Pendant ce temps, je regardais l’homme que j’avais devant mes yeux, et je cherchais à retrouver en lui quelque trace de l’enfant que j’avais connu, mais l’homme fait me déroutait ; j’avais beau le considérer, je ne revoyais, pas plus les joues roses du gamin que sa petite jaquette. Son teint pâle, la barbe et les moustaches brunes qui couvraient la partie inférieure de son visage, excitaient ma surprise. Il avait des manières agréables, dégagées, mais qui ne pouvaient se comparer avec sa franche gaieté d’autrefois. Pour compléter ma déception, il promettait d’être grand, et n’avait pas tenu cet espoir. M. Blake était mince, bien fait, mais à peine au-dessus de la taille moyenne. En somme, les années qui s’étaient écoulées n’avaient rien laissé subsister de lui, sauf des yeux francs et brillants.
Ce trait me rendant notre bon garçon d’autrefois, je m’arrêtai dans mes investigations.
« Vous êtes le bienvenu dans la vieille demeure, monsieur Franklin, dis-je, et d’autant plus le bienvenu, que vous êtes arrivé quelques heures plus tôt que l’on ne vous attendait.
– J’avais une raison pour devancer le moment, reparut M. Franklin : je soupçonne, Betteredge, que j’ai été épié, puis suivi à Londres pendant trois ou quatre jours ; j’ai donc voyagé le matin au lieu de prendre le train de l’après-midi, parce que je tenais à dépister un certain étranger à la peau bistrée. »
Ces mots me frappèrent de surprise.
Les trois jongleurs, l’opinion émise par Pénélope qu’ils agissaient contre M. Franklin Blake, tous ces souvenirs passèrent devant moi avec la rapidité de l’éclair, et je m’écriai :
« Qui peut vous suivre, monsieur, et dans quel but ?
– Parlez-moi des trois Indiens qui sont venus ici aujourd’hui, dit M. Franklin sans relever ma question, il est plus que probable que mon étranger et vos trois jongleurs ne sont qu’une tête dans un même bonnet.
– Comment avez-vous appris l’existence des Indiens, monsieur ? » insistai-je.
J’entassais question sur question, ce qui est d’un homme mal élevé, mais, vous le savez, on pêche faute de savoir-vivre suffisant : donc, excusez-moi.
« J’ai vu Pénélope à la maison, me dit M. Franklin, et c’est d’elle que je tiens mes informations ; votre fille promettait d’être jolie, Betteredge, et elle a tenu parole ; elle a une charmante oreille et un petit pied. Tient-elle ces avantages extérieurs de Mrs Betteredge ?
– Défunte Mrs Betteredge possédait surtout des défauts, monsieur, répondis-je ; l’un des plus considérables (si vous me permettez de le signaler) était de ne jamais suivre une idée ; elle semblait plus tenir de la mouche que de la femme, et ne pouvait se fixer un seul instant.
– Comme ce caractère m’eût convenu ! repartit M. Franklin ; je ne puis non plus m’arrêter sur quelque point que ce soit ! Betteredge, vos facultés sont plus actives que jamais. Aussi votre fille me disait-elle, lorsque je lui demandais des détails sur les jongleurs : « Mon père vous les donnera, monsieur, car il raconte admirablement, et sa mémoire est surprenante pour son âge. » Ce sont les propres paroles de Pénélope, qui rougissait à ravir. Mon respect pour vous ne m’a pas empêché de…, enfin, passons ; je l’ai connue enfant, et elle ne s’en trouvera pas plus mal pour cela. Voyons, redevenons sérieux ; que faisaient ces Indiens ? »
Je me sentais assez mécontent de ma fille, non parce qu’elle s’était laissée embrasser par M. Franklin, ce n’était pas là une affaire, rien de plus naturel, mais je trouvais ridicule qu’elle se fût avisée de me mettre en demeure de raconter moi-même sa sotte histoire. Je ne pouvais maintenant y échapper. La gaieté de M. Franklin s’éteignit à mesure que mon récit se déroulait. Il fronçait les sourcils et tourmentait ses moustaches. Lorsque j’eus fini, il me fit répéter deux des questions que le chef des jongleurs avait posées au jeune garçon, comme s’il eût voulu les graver dans sa mémoire : « Est-ce sur cette route, et sur aucune autre, que le gentleman anglais doit voyager aujourd’hui ? Le gentleman l’a-t-il sur lui ? »
« Je soupçonne, poursuivit M. Franklin, tirant de sa poche un petit paquet cacheté, que l’a-t-il se rapporté à ceci, et ceci, Betteredge, signifie le fameux diamant de mon oncle Herncastle.
– Grand Dieu ! monsieur, m’écriai-je, comment vîntes-vous à être chargé du diamant du méchant colonel ?
– Par une clause de son testament, le méchant colonel a légué son diamant comme cadeau de jour de naissance à ma cousine Rachel, répondit M. Franklin, et mon père, en qualité d’exécuteur testamentaire du colonel, m’a donné la mission de l’apporter ici. »
Si la mer, qui alors caressait doucement les sables mouvants, se fût changée en terre ferme sous mes yeux, je ne crois pas que j’eusse éprouvé plus de surprise qu’en entendant M. Franklin.
« Le diamant du colonel laissé à miss Rachel ! dis-je, et votre père son exécuteur testamentaire ! Mais j’aurais parié qu’il n’eût pas voulu toucher le colonel avec des pincettes !
– L’expression est un peu forte, Betteredge ; qu’y avait-il à dire contre le colonel ? C’était un homme de votre temps et non du mien. Dites-moi ce que vous savez de lui ; moi, je vous conterai comment mon père devint son exécuteur testamentaire, et quelque chose de plus. J’ai fait à Londres des découvertes, au sujet de l’oncle Herncastle et de son diamant, qui ne sont pas belles à mes yeux, mais j’ai besoin de votre témoignage. Vous venez de le nommer « le méchant » colonel. Fouillez un peu votre mémoire, mon vieil ami, et dites-moi pourquoi ? »
Je vis qu’il parlait sérieusement, et je lui racontai ce que je savais.