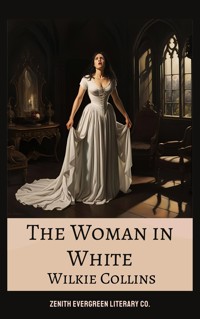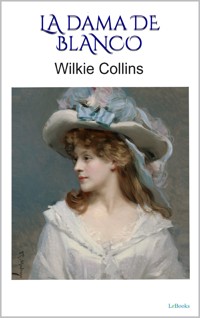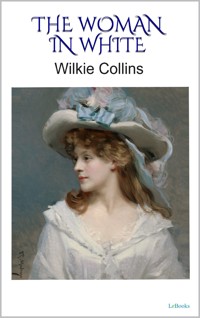Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Dans le train qui l'emmène en voyage de noces à Ramsgate, Valéria Woodville pense aux semaines qui ont précédé son mariage: sa rencontre avec Eustache, ses rapides fiançailles avec lui, l'inquiétude de son oncle pour ce projet de mariage faute d'informations sérieuses sur la situation personnelle d'Eustache, l'opposition de la mère d'Eustache à ce projet. Installés à Ramsgate, Valéria et Eustache rencontrent par hasard la mère de celui-ci. Quand il présente Valéria à sa mère, celle-ci se tourne alors vers lui avec mépris et indignation et lui déclare plaindre sa jeune épouse. Valéria va découvrir qu'Eustache ne lui a pas tout dit sur sa vie d'avant leur mariage. Elle n'aura de cesse de découvrir le secret qui entache le passé de son mari...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Piste du crime
La Piste du crimeAU LECTEUR.I. LA MÉPRISE DE LA FIANCÉE.II. LES PENSÉES DE LA MARIÉE.III. LA PLAGE DE RAMSGATE.IV. RETOUR AU LOGIS.V. LA DÉCOUVERTE DE L’HÔTESSE.VI. MA DÉCOUVERTE À MOI.VII. VISITE AU MAJOR.VIII. L’ADORATEUR DES FEMMES.IX. LA DÉFAITE DU MAJOR.X. LA PERQUISITION.XI. RETOUR À LA VIE.XII. LE VERDICT ÉCOSSAIS.XIII. RÉSOLUTION DU MARI.XIV. RÉPONSE DE LA FEMME.XV. LE PROCÈS. LES PRÉLIMINAIRES.XVI. PREMIÈRE QUESTION : – LA FEMME EST-ELLE MORTE EMPOISONNÉE ?XVII. SECONDE QUESTION : – QUI A ÉTÉ L’EMPOISONNEUR ?XVIII. TROISIÈME QUESTION – QUEL A ÉTÉ LE MOBILE DU CRIME ?XIX. LES TÉMOINS À DÉCHARGE.XX. LA FIN DU PROCÈSXXI. JE VOIS MA ROUTE.XXII. LE MAJOR FAIT DES DIFFICULTÉS.XXIII. MA BELLE-MÈRE SE RÉVÈLE SOUS UN JOUR INATTENDU.XXIV. MISERRIMUS DEXTER. – PREMIÈRE IMPRESSION.XXV. MISERRIMUS DEXTER. – DEUXIÈME IMPRESSION.XXVI. PLUS OBSTINÉE QUE JAMAIS.XXVII. M. DEXTER CHEZ LUI.XXVIII. DANS L’OBSCURITÉ.XXIX. LA LUMIÈRE SE FAIT.XXX. L’ACCUSATION DE MADAME BEAULY.XXXI. LA DÉFENSE DE MADAME BEAULY.XXXII. UN ÉCHANTILLON DE MA SAGESSE.XXXIII. UN ÉCHANTILLON DE MA FOLIE.XXXIV. GLENINCH.XXXV. LA PROPHÉTIE DE M. PLAYMORE.XXXVI. ARIEL.XXXVII. AU CHEVET DU BLESSÉXXXVIII. RETOUR.XXXIX. PRÈS DE RETOURNER CHEZ DEXTERXL. NÉMÉSIS APPARAÎT ENFIN !XLI. NOUVEL ASPECT DE M. PLAYMORE.XLII. NOUVELLES SURPRISES !XLIII. ENFIN !XLIV. NOTRE NOUVELLE LUNE DE MIEL.XLV. LE TAS D’ORDURES FOUILLÉ.XLVI. LA CRISE AJOURNÉE.XLVII. CONFESSION DE LA FEMME.XLVIII. QUE POURRAIS-JE FAIRE ENCORE ?XLIX. PASSÉ ET AVENIR ».L. LA FIN DE L’HISTOIRE.Page de copyrightLa Piste du crime
Wilkie Collins
AU LECTEUR.
En vous soumettant cet ouvrage je n’ai pas de Préface à écrire. Je veux seulement vous inviter à vous souvenir de certaines vérités reconnues qui parfois échappent à votre mémoire lorsque vous lisez un ouvrage de fiction. Soyez donc assez bon pour vous rappeler : 1° que les actions humaines ne sont pas invariablement régies par les lois de la pure raison ; 2° que nous n’avons nullement l’habitude de n’accorder notre amour qu’aux objets qui en sont les plus dignes selon l’opinion de nos amis ; 3° enfin que les personnages qui n’ont pas agi sous nos yeux et les événements qui ne sont pas arrivés à notre propre connaissance n’en peuvent pas moins être, malgré tout, des personnages naturels et des événements parfaitement probables. Ayant dit ce peu de mots, j’ai dit, pour le moment, tout ce qui me semble nécessaire pour recommander ce nouveau roman à votre approbation.
W. C.
Londres, 1er février 1875.
I. LA MÉPRISE DE LA FIANCÉE.
« … Car, dans les temps anciens, les saintes femmes qui croyaient en Dieu s’honoraient elles-mêmes en étant soumises à leur mari ; Sarah obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur ; et vous serez ses filles tant que votre conduite sera droite et que vous ne vous laisserez dominer par aucune crainte. »
Mon oncle Starkweather, terminant par ces paroles connues l’Office du Mariage selon le rite de l’Église d’Angleterre, ferma son livre, et, du haut de l’autel, fixa sur moi son regard avec toute la tendresse que pouvait exprimer sa large face colorée. En même temps, ma tante Starkweather, qui se tenait à côté de moi, me donna une forte tape sur l’épaule, et me dit :
« Valéria, vous êtes mariée ! »
Quelles étaient en ce moment mes pensées ? dans quelle rêverie étais-je plongée ? J’étais trop troublée pour m’en rendre compte. Je tressaillis, et je regardai celui qui était maintenant mon mari. Il me parut à peu près aussi troublé que moi. Je crois que la même idée nous était venue à tous deux dans le même instant. Était-il bien possible qu’en dépit de l’opposition de sa mère, nous fussions mari et femme ? Ma tante résolut la question par une seconde tape qu’elle me donna sur l’épaule.
« Prenez le bras de votre mari ! » me dit-elle tout bas, du ton d’une femme qui perd patience.
Je pris le bras de mon mari.
« Suivez votre oncle ! »
Serrant le bras de mon mari contre le mien, je suivis mon oncle et le vicaire qui l’avait assisté dans la célébration du mariage.
Les deux ecclésiastiques nous conduisirent dans la sacristie. L’église était située dans celui des tristes quartiers de Londres qui s’étend entre la Cité et le West End. Le jour était sombre ; l’atmosphère pesante et humide. Nous formions une mélancolique petite noce, bien digne de ce triste quartier et de ce sombre jour. Aucun parent ou ami de mon mari n’était présent ; sa famille, comme je l’ai déjà donné à entendre, désapprouvait ce mariage. Excepté mon oncle et ma tante, nul membre de la mienne ne m’accompagnait. J’avais perdu mon père et ma mère, et n’avais que bien peu d’amis. M. Benjamin, l’ancien et fidèle commis de mon père, avait assisté au mariage, pour régler la livraison, comme il disait. Il me connaissait depuis mon enfance, et, dans mon isolement, il avait été aussi bon pour moi qu’aurait pu l’être un père.
La dernière formalité à remplir consistait, comme de coutume, à signer sur le registre des mariages. Dans la confusion du moment et en l’absence de tout avertissement qui pût me guider, je commis une méprise : je signai de mon nom de femme, au lieu de signer de mon nom de fille.
« Ah ! c’est de fâcheux augure ! s’écria ma tante.
– Eh quoi ! reprit mon oncle de sa voix la plus joyeuse, vous avez déjà oublié votre nom propre ! Espérons que vous ne vous repentirez jamais d’y avoir renoncé si promptement ! signez de nouveau, Valéria !… signez comme il faut signer. »
Je biffai d’une main tremblante ma première signature et je la remplaçai par mon nom de fille, écrit dans ces caractères qui ne brillaient guère par l’élégance.
Quand ce fut le tour de mon mari, je remarquai, avec surprise, que sa main tremblait aussi et qu’il nous donna un bien pauvre spécimen de sa signature accoutumée.
Quand ma tante fut invitée à signer, elle fit ses réserves.
« Mauvais début ! répéta-t-elle, en indiquant de sa plume ma première signature. Je dis comme mon mari… j’espère qu’elle n’aura pas à regretter ce nom. »
Même alors, dans ces jours de mon ignorance et de ma candeur, cette boutade bizarre de l’esprit superstitieux de ma tante produisit un certain malaise dans mon âme. Ce fut une consolation pour moi de sentir la main de mon mari presser la mienne en ce moment, comme pour me rassurer, et je ne saurais dire combien je me sentis soulagée d’entendre la voix sympathique de mon oncle me souhaiter cordialement en se séparant de nous, une vie heureuse et prospère. L’excellent homme avait laissé momentanément son presbytère dans le Nord, qui était ma demeure depuis la mort de mes parents, uniquement pour venir officier à mon mariage ; et il avait décidé avec ma tante qu’ils prendraient pour y retourner le train de midi. Il me serra dans ses bras robustes et me donna un gros baiser, qui dut être certainement entendu par les badauds qui attendaient, à la porte de l’église, la sortie de la mariée et de son époux.
« Je vous souhaite santé et bonheur, ma chérie, du plus profond de mon cœur. Vous étiez d’âge à faire vous-même votre choix… et je puis, sans vous offenser, monsieur Woodville, puisque nous sommes encore des amis de date récente… demander à Dieu qu’il lui plaise, Valéria, de permettre que vous ayez fait un bon choix. Notre maison va être bien triste, sans vous. Mais je ne m’en plains pas, mon enfant. Au contraire, je m’en réjouis, si ce changement dans votre existence doit vous rendre plus heureuse. Allons ! allons ! ne pleurez pas, ou vous mettriez votre tante en colère… ce qui ne vaut rien à son âge. D’ailleurs, vos larmes gâteraient votre beauté. Essuyez-les, et regardez-vous dans cette glace, vous verrez que j’ai raison. Au revoir, ma fille… et que le Seigneur vous bénisse ! »
Il prit ma tante sous son bras, et tous deux sortirent précipitamment. Malgré mon profond amour pour mon mari, mon cœur saigna quand je vis s’éloigner ce fidèle ami, le protecteur de mes années de jeune fille.
Le vieux Benjamin vint ensuite prendre congé de moi.
« Je vous souhaite toutes sortes de bonheur, ma chère enfant ; ne m’oubliez pas. »
Il ne me dit rien de plus. Mais cela suffit pour rappeler à mon souvenir les jours que j’avais passés dans la maison paternelle. Benjamin dînait toujours avec nous, le dimanche, du vivant de mon père, et apportait toujours avec lui quelques petits présents pour l’enfant de son maître. J’étais bien près de gâter ma beauté, comme mon oncle venait de dire, quand je tendis ma joue au vieux bonhomme, et je l’entendis soupirer, comme si lui non plus n’augurait pas tout à fait bien de ma future existence.
La voix de mon mari me rappela à moi-même et tourna mon esprit vers de plus agréables pensées.
« Partons-nous, Valéria ? » me dit-il.
Je l’arrêtai encore une minute avant de sortir de la sacristie, pour suivre le conseil de mon oncle, en d’autres termes pour savoir comment je me trouverais en me regardant dans la glace placée sur la cheminée.
Qu’est-ce que me montre cette glace ?
Elle me montre une grande et svelte jeune femme de vingt-trois ans. Elle n’est pas du tout de ces personnes qui attirent l’attention dans les rues, vu qu’elle n’a ni les cheveux blonds ni les joues roses en si grande admiration chez mes chers compatriotes. Ses cheveux sont noirs, et arrangés encore, dans ces derniers jours, comme ils l’avaient été, il y a bien des années, pour plaire à son père, c’est-à-dire en larges bandeaux rejetés du front en arrière et réunis là en un seul nœud, comme ceux de la Vénus de Médicis, pour laisser mieux voir le cou. Son teint est mat et ne laisse apercevoir aucune coloration sur sa figure, excepté dans certains moments de violente agitation. Ses yeux sont d’un bleu si foncé qu’on croit généralement qu’ils sont noirs. Ses sourcils sont bien dessinés, mais trop noirs et trop fortement marqués. Son nez est bien près d’être aquilin, et considéré comme un peu trop large par les personnes difficiles à contenter en matière de nez. Sa bouche est le trait le plus parfait de son visage ; elle est très-délicatement modelée et peut exprimer une grande variété de sensations. Dans l’ensemble, sa figure est trop menue et trop allongée dans la partie inférieure ; trop large et trop basse, dans la région plus élevée des yeux et de la tête. Tout le portrait reflété dans la glace est celui d’une femme de quelque élégance, mais un peu trop pâle, un peu trop calme, un peu trop sérieuse, dans ses moments de silence et de repos ; en un mot une femme qui ne fait pas du premier coup impression sur l’observateur superficiel, mais qui gagne à la seconde ou à la troisième vue. Quant à son costume, il cache soigneusement, au lieu de le proclamer bien haut, qu’elle a été mariée le matin. Elle porte une tunique de cachemire gris, bordée de soie grise, et en dessous une jupe de même étoffe et de même couleur. Sur sa tête, un chapeau relevé par une ruche de mousseline blanche, avec une rose d’un rouge foncé, fait ressortir l’effet de l’ensemble de la toilette.
Ai-je réussi ou échoué dans ma description de ma propre personne, telle qu’elle m’est apparue dans la glace ? Ce n’est pas à moi de le dire. J’ai fait de mon mieux pour éviter ces deux écueils : la vanité de déprécier et la vanité de louer mon apparence extérieure. Du reste, que ce portrait soit bien ou mal tracé, j’en ai fini, Dieu merci !
Et qui voyais-je dans la glace, debout à côté de moi ?
Un homme dont la taille n’égale pas tout à fait la mienne, et qui a le désavantage de paraître un peu plus âgé qu’il ne l’est réellement. Son épaisse barbe châtain et ses longues moustaches sont prématurément mélangées de gris. Sa figure a le coloris et la vigueur qui manquent à la mienne. Il me regarde avec des yeux d’un brun clair, qui me paraissent les plus tendres et les plus charmants que j’aie jamais vus chez aucun homme. Son sourire est rare et doux ; ses façons, parfaitement calmes et réservées, ont cependant une force de persuasion latente qui gagne irrésistiblement le cœur des femmes. Il boite légèrement en marchant. Cela lui vient d’une blessure qu’il a reçue au service, dans l’Inde, il y a quelques années, et il porte une canne en bambou pour s’aider à marcher à la maison et au dehors. À part cette petite défectuosité, si tant est que c’en soit une, il n’est rien en lui qui manque d’élégance ou de jeunesse. Sa démarche a même une grâce non commune, du moins à mes yeux prévenus, et elle plaît mieux que la désinvolture des autres hommes. Enfin, et ceci répond à tout, je l’aime ! C’est par où je finirai le portrait de mon mari, tel que je le vis le jour de nos noces.
La glace m’avait dit tout ce que je voulais savoir. Nous sortîmes alors de la sacristie.
Le ciel, nuageux depuis le matin, s’est encore plus assombri, pendant que nous étions à l’église. La pluie commença à tomber abondamment. Les curieux, qui stationnent au dehors abrités de leurs parapluies, nous regardent avec des yeux médiocrement sympathiques quand nous traversons leurs rangs pour regagner en toute hâte notre voiture. Pas le moindre salut amical, pas le moindre rayon de soleil, pas la moindre fleur jetée sur notre passage ; point de grand déjeuner, point de discours joyeux, point de demoiselles d’honneur, point de bénédiction d’un père ou d’une mère ! Une triste noce… il faut en convenir… et, si ma tante a raison, un fâcheux commencement de notre nouvelle vie !
Un coupé avait été retenu pour nous au chemin de fer. L’homme préposé à l’ouverture des portières, ne perdant pas de vue son pourboire, avait eu le soin de baisser les stores de notre coupé, pour nous soustraire aux regards indiscrets. Après un temps qui nous parut d’une longueur infinie, le train se mit en marche. Mon mari m’enveloppa la taille d’un de ses bras.
« Enfin ! » murmura-t-il, en attachant sur moi un regard d’amour que nulle expression ne saurait rendre, et en me serrant tendrement sur son cœur.
Je lui passai aussi le bras autour du cou. Mon regard répondit à son regard. Nos lèvres se rencontrèrent dans le premier long baiser de la vie commune où nous entrions.
Oh ! quels souvenirs se réveillent en moi à l’instant où j’écris ces lignes ! Permettez-moi d’essuyer mes yeux et de replier mon papier jusqu’à demain.
II. LES PENSÉES DE LA MARIÉE.
Nous roulions sur les rails depuis un peu plus d’une heure, lorsqu’insensiblement un changement s’opéra en nous.
Toujours assis à côté l’un de l’autre, ma main dans la sienne, ma tête appuyée sur son épaule, nous tombâmes peu à peu dans un complet silence. Avions-nous déjà épuisé le mince mais éloquent vocabulaire de la langue de l’amour… ou avions-nous pris le parti, par un consentement tacite, après avoir savouré les joies de la passion qui parle, de savourer celles de la passion qui pense ? Je puis difficilement le dire. Je sais seulement qu’un moment vint où, sous l’effet d’une influence inexplicable, nos lèvres se fermèrent. Nous restâmes longtemps absorbés l’un et l’autre dans nos rêveries. Pensait-il exclusivement à moi dans ce moment… comme je pensais exclusivement à lui ? Avant la fin du voyage j’eus des doutes ; un peu plus tard, j’eus la certitude que ses pensées, errant loin de sa femme, s’étaient tournées vers les malheurs de sa vie passée.
Pour moi, le secret plaisir de n’occuper mon esprit que de lui, tandis que je le sentais à mes côtés avait par lui-même un indicible attrait.
Je rappelais dans mes souvenirs notre première rencontre dans le voisinage de la maison de mon oncle.
Le célèbre cours d’eau, si abondant en truites, de nos régions septentrionales, roulait ses flots écumeux et fumants à travers une ravine creusée dans les roches de ce sol marécageux. C’était pendant une après-midi sombre et agitée par le vent ; le soleil couchant était nuageux et déjà fort bas sur l’horizon, qu’il colorait de ses rouges rayons. Un pêcheur solitaire agitait au-dessus de l’eau sa ligne, armée d’un moucheron qui est l’appât dont la truite est avide ; il se tenait sur le rivage, au bord d’un tournant où l’eau, revenant sur elle-même, était tranquille et profonde, sous une levée de terre qui la surplombait. Une jeune fille, c’était moi, debout sur cette levée, invisible au pêcheur placé en contre-bas, attendait, avec une vive curiosité, le moment où elle verrait la truite s’élancer au-dessus de l’eau pour happer sa proie.
Ce moment vint, le poisson fit un bond et saisit le moucheron.
Alors se mettant à marcher, tantôt sur l’étroite bande de sable que l’eau effleurait au pied de la levée, tantôt, quand la rivière faisait un coude, dans l’eau même qui courait plus sombre sur son lit de roche, le pêcheur marchait de conserve avec la truite qui avait mordu à l’hameçon ; parfois laissant sa ligne suivre les mouvements de la truite ; la ramenant parfois à lui, et se jouant avec sa proie dans une lutte difficile et délicate. Je marchai, de mon côté, le long de la levée, pour ne pas perdre de vue ce combat de science et d’adresse entre l’homme et le poisson. J’avais assez longtemps vécu avec mon oncle pour partager un peu son enthousiasme pour les amusements de la campagne et spécialement pour la pêche à la ligne. Marchant du même pas que l’étranger, mes yeux attentivement fixés sur les mouvements de sa ligne, et sans prendre aucunement garde à la nature du sentier inégal que je suivais, je montai par hasard sur le rebord sablonneux de la levée ; le sable céda sous mes pieds, et je tombai dans l’eau, au même instant.
La hauteur d’où je tombais était insignifiante ; l’eau peu profonde ; le lit de la rivière, fort heureusement pour moi, était sablonneux. Excepté la peur que j’éprouvai et le bain que je pris, il ne résulta de ma chute aucun mal. Je me retrouvai bientôt debout, sur la terre ferme, toute honteuse de mon accident. Si peu qu’il eût duré, il avait donné pourtant à la truite le temps de s’échapper. Le pêcheur avait entendu le cri d’alarme que j’avais poussé instinctivement, et, jetant sa ligne sur le rivage, il était accouru à mon secours. Nous nous regardâmes pour la première fois, moi en haut sur la levée, et lui en bas les pieds dans l’eau. Nos yeux se rencontrèrent, et je crois vraiment que nos cœurs se rencontrèrent aussi, au même instant. Ce dont je suis certaine, c’est que nous oubliâmes, moi, la politesse d’une fille bien élevée, lui, celle d’un homme du monde ; nous nous regardâmes mutuellement en gardant un silence sauvage.
Je fus la première à le rompre. Que lui dis-je ?
Je lui dis quelque chose relativement à l’insignifiance de ma chute ; puis j’insistai pour qu’il allât essayer de rattraper son poisson.
Il le fit comme malgré lui, et, naturellement, il revint à moi les mains vides. Sachant combien mon oncle aurait été amèrement désappointé, dans une circonstance pareille, je m’excusai avec vivacité auprès du pêcheur, et, dans mon empressement à diminuer ses regrets, je m’offris même à lui indiquer un endroit un peu plus bas, dans la rivière, où il pourrait renouveler ses tentatives.
Il ne voulut pas en entendre parler, et me supplia de retourner chez moi pour changer mes vêtements mouillés. Je ne tenais nullement à prendre ce soin. Néanmoins, je cédai à sa prière, sans savoir pourquoi.
Il marcha à côté de moi. Mon chemin pour retourner au presbytère était aussi celui qui le ramenait à son auberge. Il était venu dans nos environs, me dit-il, plus pour goûter les charmes de la tranquillité et de la solitude que pour le plaisir de pêcher. Il m’avait aperçue une fois ou deux de la fenêtre de sa chambre. Il me demanda si je n’étais pas la fille du pasteur.
Je le tirai d’erreur. Je lui dis que le pasteur avait épousé la sœur de ma mère, et que sa femme et lui, depuis la mort de mes parents, m’en avaient tenu lieu. Il me demanda s’il pouvait prendre la liberté de se présenter chez le Docteur Starkweather, le lendemain, et me nomma un de ses amis, qu’il croyait être de la connaissance du Vicaire. Je l’invitai à nous visiter, comme si la maison de mon oncle avait été la mienne. J’étais dominée par le charme de ses yeux et de sa voix. Dans ma candeur d’enfant, je m’étais figuré mainte et mainte fois, avant ce temps, que j’étais bel et bien amoureuse. Mais jamais, en présence d’aucun autre homme, je n’avais senti rien de ce que je sentais en ce moment devant celui-ci. Il me sembla qu’il fit nuit subitement autour de moi, quand il me quitta. Je m’appuyai contre la porte du presbytère. Je ne pouvais pas respirer ; je ne pouvais pas penser ; mon cœur s’agitait, comme s’il eût voulu s’élancer hors de ma poitrine… et tout cela à cause d’un étranger ! J’en rougissais de honte ; mais, en dépit de tout, j’étais heureuse, bien heureuse !
Et maintenant, après que quelques semaines se sont écoulées depuis cette première rencontre, je l’ai là, près de moi ! Il est à moi pour la vie ! Je levai la tête de dessus son épaule pour le regarder. J’étais comme un enfant possesseur d’un nouveau jouet… j’avais besoin de m’assurer qu’il était bien réellement à moi.
Il ne bougeait pas de son coin. Était-il profondément enfoncé dans ses propres pensées ? Et était-ce moi qui étais le sujet de ses pensées ?
Je replaçai ma tête sur son épaule de façon à ne pas le déranger. Mes pensées se remirent à errer à l’aventure, et me rappelèrent un autre tableau de la galerie dorée du passé.
La scène se passe cette fois dans le jardin du presbytère. Il fait nuit. Nous nous sommes donné un rendez-vous secret. Nous marchons lentement, hors de la vue de la maison, tantôt sous le feuillage des bosquets, tantôt à ciel découvert, sur la pelouse où brille un charmant clair de lune.
Il y avait longtemps déjà que nous nous étions avoué notre mutuel amour, et que nous avions promis et juré d’être pour toujours l’un à l’autre. Déjà nos intérêts étaient communs ; déjà nous partagions les mêmes peines et les mêmes joies. J’étais allée cette nuit à sa rencontre, le cœur attristé, pour chercher un soulagement dans sa présence, un encouragement dans sa voix. Il remarqua que je soupirai, quand il me donna le bras, et il tourna gentiment ma tête vers le clair de lune, pour mieux voir les traces de ma douleur sur ma figure. Combien de fois avait-il lu mon bonheur de la même manière, dans les premiers temps de notre amour !
« Vous m’apportez de mauvaises nouvelles, mon ange, me dit-il, en écartant tendrement mes cheveux de mon front. Je vois des lignes là qui me disent que vous avez du chagrin. Peu s’en faut que je ne souhaite de vous aimer moins ardemment, Valéria.
– Pourquoi ?
– Je pourrais vous rendre votre liberté. Je n’aurais qu’à quitter ce pays, et votre oncle serait satisfait, et vous seriez délivrée de toutes les peines dont vous souffrez maintenant.
– Ne parlez pas ainsi, Eustache. Si vous voulez que j’oublie mes peines, dites-moi que vous m’aimez plus tendrement que jamais. »
Il me répondit par un baiser ; et, pendant un moment exquis, ce fut un profond oubli des rudes sentiers de la vie… une délicieuse absorption de nos deux âmes l’une dans l’autre. Je revins à la réalité, fortifiée et tranquille, récompensée par un autre baiser de toutes mes souffrances passées, prête à supporter avec résignation toutes celles qui pouvaient m’attendre dans l’avenir. Allumez l’amour dans le cœur d’une femme et il n’est rien qu’elle ne veuille tenter et souffrir.
« Ont-ils donc fait de nouvelles objections à notre mariage ? me demanda Eustache, tandis que nous nous promenions à pas lents.
– Non ; ils en ont fini avec les objections. Ils se sont souvenus enfin que j’étais majeure, et que je pouvais choisir mon mari moi-même. Mais ils ont insisté pour me faire renoncer à vous, Eustache. Ma tante, qui n’est pas sensible, a pleuré… pour la première fois depuis que je la connais. Mon oncle, qui m’a toujours témoigné de l’affection et de la bonté, s’est montré encore plus tendre et plus affectueux que jamais. Il m’a dit que si je persiste à devenir votre femme, il ne m’abandonnera pas, au jour de mes noces ; en quelque endroit que nous puissions nous marier, il sera là pour célébrer le service, et ma tante m’accompagnera à l’église. Mais il me conjure de réfléchir sérieusement à ce que je vais faire… de consentir à votre éloignement momentané, de consulter d’autres amis, si je ne suis pas satisfaite de son opinion. Oh ! mon bien-aimé, ils sont aussi désireux de nous séparer, que si vous étiez le pire des hommes au lieu d’en être le meilleur.
– Est-il survenu quelque incident, depuis hier, qui ait augmenté leur défiance à mon égard ?
– Oui.
– Quel est cet incident ?
– Vous vous rappelez que vous avez indiqué à mon oncle, comme pouvant le renseigner sur votre compte, un de vos amis, qui se trouve être l’un des siens.
– Oui. Le Major Fitz-David.
– Mon oncle a écrit à ce Major Fitz-David.
– Pourquoi ?… »
Eustache prononça ce mot d’un ton si absolument différent de celui qui lui était ordinaire, que j’en fus frappée d’étonnement.
« Vous ne serez pas fâché, Eustache, de ce que je vais vous dire, ajoutai-je. Mon oncle, à ce que j’ai compris, avait plusieurs motifs pour écrire au Major. L’un de ces motifs était de lui demander s’il connaissait l’adresse de votre mère. »
Eustache devint soudain muet.
Je m’arrêtai aussitôt, comprenant que je ne pouvais pas m’aventurer à en dire davantage, sans courir le risque de l’offenser.
Pour dire la vérité, sa conduite, quand il avait parlé pour la première fois de mariage à mon oncle, avait été, quant aux apparences, quelque peu légère et étrange. Le Vicaire l’avait naturellement questionné sur sa famille. Il avait répondu que son père était mort, et il n’avait consenti qu’avec quelque répugnance à annoncer à sa mère son mariage projeté. En nous apprenant qu’elle aussi vivait à la campagne, il était allé la voir, sans nous faire connaître plus précisément son adresse. Au bout de deux jours, il était revenu au presbytère avec une nouvelle fort surprenante. Sa mère, sans vouloir mettre en doute mon honorabilité ni celle de ma famille, désapprouvait si absolument le mariage projeté par son fils qu’elle-même et les membres de sa famille, qui partageaient tous sa manière de voir, se refuseraient à assister à la cérémonie, si M. Woodville persistait à tenir l’engagement qu’il avait pris avec la nièce du Docteur Starkweather. Sollicité d’expliquer cette réponse extraordinaire, Eustache nous avait dit que sa mère et ses sœurs tenaient à lui faire épouser une autre dame, et qu’elles étaient amèrement mortifiées et désappointées de voir qu’il eût fait choix d’une personne inconnue à sa famille. Cette explication était suffisante pour moi. Elle impliquait, en ce qui me concernait, un aveu de mon influence sur Eustache qu’une femme entend toujours avec plaisir. Mais elle ne satisfit ni mon oncle ni ma tante. Le Vicaire fit connaître à M. Woodville qu’il désirait écrire à sa mère ou l’aller voir, au sujet de son étrange réponse. Eustache refusa obstinément d’indiquer l’adresse de sa mère prétendant que l’intervention du pasteur serait absolument inutile. Mon oncle en conclut aussitôt que le mystère qu’on lui faisait de cette adresse cachait quelque chose de plus grave. Il refusa de favoriser les prétentions de M. Woodville à ma main, et il écrivit le même jour pour obtenir des renseignements à la personne que lui avait indiquée M. Woodville, et qu’il connaissait aussi… au Major Fitz-David.
Dans de telles circonstances, parler des motifs qu’avait eus mon oncle d’écrire au Major, c’était se hasarder sur un terrain délicat. Eustache me délivra de tout embarras en m’adressant une question à laquelle je pouvais facilement répondre.
« Votre oncle a-t-il reçu une réponse du Major Fitz-David ?… me demanda-t-il.
– Oui.
– Vous a-t-il été permis de la lire ?… »
Sa voix faiblit, en prononçant ces mots, et sa figure trahit une soudaine inquiétude, que je remarquai avec peine.
« J’ai apporté cette réponse avec moi pour vous la montrer, » dis-je.
Il arracha presque la lettre de ma main. Il me tourna le dos, pour la lire à la clarté de la lune. La lettre était assez courte pour être bientôt lue. J’aurais pu la dire par cœur à l’instant. Je puis la répéter maintenant.
« Cher Vicaire,
« M. Eustache Woodville vous dit exactement la vérité, en affirmant qu’il est gentleman de naissance et de situation, et qu’il a hérité, en vertu du testament de son père, d’une fortune indépendante de deux mille livres de revenu.
« Toujours à vous,
« LAWRENCE FITZ-DAVID. »
« Peut-on désirer une réponse plus nette que celle-là ? me dit Eustache en me rendant la lettre du Major.
– Si c’était moi qui eusse écrit pour demander des informations sur votre compte, répondis-je, elle m’aurait pleinement suffi.
– Mais elle n’a pas paru pleinement suffisante à votre oncle ?
– Non.
– Que lui reproche-t-il ?
– Pourquoi voulez-vous le savoir, mon bien aimé ?
– J’ai besoin de le savoir, Valéria. Entre nous, il ne doit pas y avoir de secret sur ce point. Votre oncle vous a-t-il dit quelque chose, en vous montrant la lettre du Major ?
– Oui.
– Quoi ?
– Il m’a dit que la lettre qu’il avait écrite au Major contenait trois pages, et m’a fait remarquer que la réponse du Major ne contenait qu’une seule phrase. Il a ajouté : – Je lui proposais d’aller le voir et de causer avec lui de cette affaire. Vous voyez qu’il ne fait aucune mention de ma proposition. Je lui demandais l’adresse de la mère de M. Woodville. Il passe sous silence cette demande, comme il a passé sous silence ma proposition. Il se renferme soigneusement dans la mention la plus brève de quelques simples faits. Rapportez-vous en à votre propre bon sens, Valéria. Cette sécheresse n’est-elle pas au moins singulière de la part d’un homme qui est gentleman par sa naissance et par son éducation, et qui de plus est un de mes amis ? »
Eustache m’arrêta ici.
« Avez-vous répondu à la question de votre oncle ? demanda-t-il.
– Non ; je lui ai dit seulement que je ne comprenais pas la conduite du Major.
– Et qu’est-ce que votre oncle a ajouté ensuite ? Si vous m’aimez, Valéria, dites-moi la vérité.
– Il a employé un langage très-sévère. Mais c’est un vieillard ; il ne faut pas vous en offenser.
– Je ne m’en offenserai pas. Qu’a-t-il dit ?
– Il m’a dit : – Remarquez bien mes paroles, Valéria ! Il y a là-dessous, par rapport à M. Woodville ou à sa famille, quelque secret sur lequel le Major n’est pas libre de s’expliquer. Bien interprétée, cette lettre est un avertissement. Montrez-la à M. Woodville, et rapportez-lui, si vous voulez, ce que je viens de vous dire… »
Eustache m’interrompit encore une fois.
« Vous êtes sûre que votre oncle a bien employé ces propres termes ? me demanda-t-il en examinant attentivement ma figure à la lueur de la lune.
– Parfaitement sûre. Mais moi, je ne pense pas comme mon oncle, croyez-le bien, je vous en prie. »
Il me pressa dans ses bras et fixa ses yeux sur les miens. Son regard m’effraya.
« Adieu. Valéria ! dit-il. Jugez-moi et pensez à moi avec indulgence, quand vous aurez épousé un homme plus heureux, ma bien-aimée. »
Il allait me quitter ! Je me cramponnai à lui, dans l’angoisse d’une terreur qui me saisit de la tête aux pieds.
« Que voulez-vous dire ? m’écriai-je aussitôt que je pus parler. Je suis à vous, à vous uniquement. Qu’ai-je dit, qu’ai-je fait, pour mériter que vous me teniez cet effrayant langage ?
– Il faut nous séparer, mon ange, répondit-il tristement. La faute n’en est pas à vous. C’est le malheur qui me poursuit. Chère Valéria, comment pourriez-vous épouser un homme qui est suspect à vos plus proches, à vos plus chers amis ! J’ai mené une triste existence. Je n’ai jamais rencontré dans aucune autre femme la douce sympathie, la conformité de sentiments que j’ai trouvées en vous. Oh ! il m’est bien cruel de me séparer de vous. Il est dur pour moi de retourner à ma vie solitaire. Mais il faut que je fasse ce sacrifice, ma chérie, pour l’amour de vous. Je ne sais pas plus que vous ce que contenait cette lettre. Votre oncle ne me croira pas, vos amis ne me croiront pas. Un dernier baiser, Valéria ! Pardonnez-moi de vous avoir aimée… passionnément, religieusement aimée. Pardonnez-moi… et laissez-moi m’éloigner. »
Je le retins avec l’énergie du désespoir ; ses regards me mettaient hors de moi, ses paroles me pénétraient d’une intolérable douleur.
« Allez où vous voudrez, dis-je, je vais avec vous. Amis… réputation… je ne m’inquiète de rien de ce que je perds ni de ce que je puis perdre… Ô Eustache, je ne suis qu’une femme… ne me rendez pas folle ! je ne puis vivre sans vous. Je dois, je veux être votre femme… »
Je ne pus en dire davantage. Mon angoisse et ma folie éclatèrent en sanglots et en larmes.
Il n’y résista pas. Il me calma en me parlant de sa plus douce voix ; il me rendit à moi-même par ses tendres caresses. Il attesta le ciel qui brillait sur nos têtes, qu’il me dévouerait sa vie entière. Il fit vœu… oh ! en quels termes solennels ! en quels termes éloquents !… qu’il n’aurait d’autre pensée, jour et nuit, que de se montrer digne d’un amour comme le mien. N’a-t-il pas noblement tenu son serment ? Nos fiançailles, dans cette nuit mémorable, n’ont-elles pas été suivies de notre union au pied de l’autel, de notre serment devant Dieu ? Ah ! quelle vie j’avais devant moi ! Quelle félicité au-dessus de toutes les félicités était alors la mienne !
Je relevai encore une fois ma tête appuyée sur sa poitrine, pour goûter les chères délices de le voir à côté de moi… lui, ma vie, mon amour, mon mari, mon trésor !
À peine ramenée de mes absorbants souvenirs du passé aux douces réalités du présent, je touchais sa joue de la mienne et je murmurais tout bas :
« Oh ! comme je vous aime !… comme je vous aime !… »
Mais, soudain, je redressai ma tête en tressaillant. Mon cœur cessa de battre. Je portai ma main à ma figure. Qu’est-ce que je sentais sur ma joue ?… Je n’avais pas pleuré !… J’étais si heureuse ! Qu’est-ce que je sentais sur ma joue ? Une larme !
Sa figure était tournée du côté opposé à la mienne. Je le forçai à la retourner de mon côté.
Je le regardai… et je vis que mon mari, le jour de nos noces, avait les yeux pleins de larmes.
III. LA PLAGE DE RAMSGATE.
Eustache réussit à calmer mes alarmes. Mais je ne saurais dire qu’il réussit à satisfaire aussi mon esprit.
Il avait pensé, me dit-il, au contraste entre sa vie passée et sa vie présente. D’amers souvenirs des années écoulées lui étaient revenus et l’avaient rempli de douloureuses craintes sur son impuissance à me rendre heureuse. Il s’était demandé s’il ne m’avait pas rencontrée trop tard ? s’il n’était pas déjà un homme aigri et fatigué par les désappointements et les désenchantements de son passé ? Ces souvenirs, pesant de plus en plus sur son âme, avaient rempli ses yeux des larmes que j’y avais surprises ; larmes qu’il me conjurait, au nom de mon amour pour lui, d’oublier pour toujours.
Je l’excusai, je le rassurai, je le ranimai. Mais il y eut des moments où le souvenir de ce que j’avais vu me troublait en secret, et où je me demandais si je possédais en réalité la pleine confiance de mon mari, comme il possédait la mienne.
Nous laissâmes le train à Ramsgate.
Cette ville d’eau, si fréquentée, était déserte ; la saison venait de finir. Nos projets de voyage, pendant notre lune de miel, comprenaient une excursion à travers la Méditerranée dans un yacht prêté à Eustache par un ami. Nous aimions tous deux la mer et nous étions également désireux, à cause des circonstances qui avaient accompagné notre mariage, d’éviter la rencontre de nos amis et de nos connaissances. En conséquence de ce projet, après la célébration tout intime de notre mariage à Londres, nous avions décidé, en donnant nos instructions au capitaine du yacht, qu’il irait nous rejoindre à Ramsgate. Nous pouvions, la saison des bains étant achevée, nous embarquer dans ce port bien plus incognito que dans toute autre station de yachts, située dans l’Île de Wight.
Trois jours se passèrent, jours de délicieuse solitude, d’exquise félicité, qui ne sauraient être oubliés de toute notre vie, que nous ne retrouverons jamais plus avant la fin !
De bonne heure, durant la matinée du quatrième jour, un peu avant le lever du soleil, il survint un incident, insignifiant en soi, mais que je remarquai néanmoins, parce qu’il me parut étrange, avec la connaissance que j’avais de moi-même.
Je me réveillai subitement, et sans savoir pourquoi, d’un profond sommeil, avec un malaise nerveux qui avait envahi toute ma personne et que je n’avais jamais ressenti jusque-là. Dans le temps passé au presbytère, ma réputation de parfaite dormeuse avait été le sujet de bien des innocentes plaisanteries. Du moment où je posais la tête sur mon oreiller, je n’avais jamais su ce que c’était que de me réveiller jusqu’à ce que la servante vînt frapper à ma porte. Dans toutes les saisons, à toutes les époques, mon sommeil avait toujours été le long et paisible repos d’un enfant.
Et, cette fois, je me réveillais, sans cause apparente, plusieurs heures avant mon heure habituelle. Je m’efforçai de me rendormir ; je n’y réussis pas. J’étais si agitée que je ne pus même rester au lit. Mon mari dormait profondément à côté de moi. Dans la crainte de troubler son sommeil, je me levai, et ne pris que ma robe de chambre et mes pantoufles.
J’allai à la fenêtre. Le soleil se levait sur la mer grise et calme. Pendant un moment, le spectacle majestueux que j’avais devant moi exerça une influence salutaire et calma l’irritation de mes nerfs. Mais bientôt cette irritation reprit le dessus. Je me mis à marcher sans bruit à travers la chambre, jusqu’à ce que je fusse fatiguée de la monotonie de cet exercice. Je pris un livre et le laissai presque aussitôt. Mon attention errait à l’aventure ; l’auteur fut impuissant à la fixer. Je me levai de ma chaise et regardai Eustache ; je l’admirais, je l’aimais dans son paisible sommeil. Je retournai à la fenêtre, et me rassasiai de la beauté du matin. Je m’assis devant la glace et me regardai. Combien je me trouvai l’air hagard, fatigué, évidemment à cause de ce réveil avant l’heure accoutumée ! Je me relevai encore, mais je ne savais plus que faire. Il me devint intolérable de me sentir plus longtemps confinée dans les quatre murs de la chambre. J’ouvris la porte qui conduisait dans le cabinet de toilette de mon mari, et j’y entrai, pour essayer si le changement de place me ferait quelque bien.
Le premier objet qui frappa mes yeux fut son nécessaire de voyage, laissé ouvert sur la toilette.
J’en tirai les flacons, les pots, les brosses, les peignes ; les couteaux et les ciseaux, qui étaient dans un compartiment, et les objets pour écrire qui étaient dans un autre. Je respirai les parfums et les pommades ; je nettoyai soigneusement les flacons au fur et à mesure que je les retirais du nécessaire. Peu à peu je le vidai complètement. Il était doublé en velours bleu. Dans un coin, je remarquai un petit ruban de soie bleue, libre par son extrémité visible. Le prenant entre l’index et le pouce, et le tirant à moi, je m’aperçus qu’il y avait un double fond dans le nécessaire, formant un compartiment secret pour des lettres et des papiers. Dans l’étrange situation d’esprit où j’étais… cédant à un caprice ou à un sentiment de curiosité… je retirai les papiers, comme j’avais retiré les autres objets contenus dans le nécessaire.
C’étaient quelques notes et billets acquittés, qui ne pouvaient m’offrir aucun intérêt, quelques lettres que je laissai naturellement de côté, après en avoir lu seulement l’adresse ; mais, en dessous, je vis une photographie, sur le dos de laquelle je lus ces mots :
À mon cherfils Eustache.
Sa mère ! la femme qui s’était si obstinément et si impitoyablement opposée à notre mariage !
Je m’empressai de retourner la photographie, n’attendant à trouver une physionomie sévère, bourrue, revêche. À ma grande surprise, la figure montrait les restes d’une grande beauté ; l’expression, quoique indiquant un caractère plein de fermeté, avait du charme, et était empreinte de tendresse et de bonté. Les cheveux gris étaient disposés en touffes de gentilles petites boucles à l’ancienne mode, de chaque côté de la tête, et ombragés par un chapeau de dentelle unie. À un coin de la bouche, on remarquait un signe, évidemment un grain de beauté, qui ajoutait au caractère de la figure. Je regardai avec attention ce portrait et le fixai dans ma mémoire. Cette femme, qui nous avait presque insultés, moi et les miens, était sans aucun doute, et autant que les apparences l’indiquaient, une personne vers laquelle on se sentait invinciblement attiré… une personne qu’on serait heureux et fier de connaître.
Je m’abandonnai à mes réflexions. La découverte de cette photographie me calma plus que n’aurait pu faire toute autre chose.
Le bruit d’une cloche, qui sonna au bas de l’escalier, m’avertit de la rapidité avec laquelle le temps s’était enfui. Je remis soigneusement en place tous les objets contenus dans le nécessaire, en commençant par la photographie, que je replaçai exactement comme je l’avais trouvée, et je m’en retournai dans la chambre à coucher. Tandis que je regardais mon mari dormant toujours de son calme sommeil, une question s’imposa à mon esprit. D’où sont venus, à cette charmante et gracieuse mère, la sévère résolution d’empêcher notre mariage et son impitoyable refus de l’approuver ?
Pouvais-je soumettre ouvertement cette question à Eustache, à son réveil ? Non ; je n’osai m’y aventurer. Il avait été tacitement entendu entre nous que nous ne parlerions jamais de sa mère… et d’ailleurs ne pouvait-il pas être mécontent que j’eusse ouvert le compartiment secret de son nécessaire ?
Après le déjeuner, nous eûmes enfin des nouvelles du yacht. Il était venu mouiller en sûreté dans l’intérieur du port, et le capitaine attendait à bord les ordres de mon mari.
Eustache ne me demanda pas de l’accompagner jusqu’au yacht : il lui fallait examiner l’inventaire du navire et décider quelques questions qui n’étaient pas de nature à intéresser une femme, relativement aux cartes, aux baromètres, aux provisions, et à l’eau. Il me pria de vouloir bien attendre son retour. Le temps était admirablement beau et la marée en son plein. Je me décidai pour une promenade sur la plage, et la maîtresse de notre hôtel, qui se trouvait en ce moment dans notre chambre, s’offrit à m’accompagner et à prendre soin de moi. Il fut convenu que nous nous promènerions, aussi loin que nous en aurions envie, dans la direction de Broadstairs, et qu’Eustache viendrait nous retrouver sur le rivage, quand il aurait fini ses arrangements à bord du yacht.
Au bout d’une demi-heure, l’hôtesse et moi, nous étions descendues sur la plage.
Le tableau, dans cette belle matinée d’automne, était admirable. La douce brise, le ciel éclatant, la mer calme et bleue, les rochers miroitant au soleil, les sables de couleur fauve, enfin le va-et-vient des navires qui sillonnaient la Manche… tout cela formait un spectacle merveilleux, tout cela me ravissait au point que, si j’avais été seule, j’aurais dansé de joie comme un enfant. La seule compensation qui diminuât mon plaisir était le parlage intarissable de l’hôtesse. C’était une femme empressée, d’un bon naturel, mais dont la tête était vide d’idées ; qui ne cessait pas de parler, que je l’écoutasse ou non ; et qui avait la manie de m’adresser la parole en m’appelant perpétuellement Madame Woodville.
Nous étions sur le rivage depuis plus d’une demi-heure, lorsque nous aperçûmes une dame qui marchait devant nous.
Précisément au moment où nous allions la dépasser, elle tira son mouchoir de sa poche et en fit sortir en même temps une lettre qui tomba, sans qu’elle s’en aperçût, sur le sable, presque à mes pieds. Je ramassai cette lettre et la présentai à la dame.
Elle se retourna pour me remercier. La vue de son visage me cloua sur place. Ce visage était le propre original de la photographie que j’avais trouvée, le matin même, dans le nécessaire de mon mari. C’était sa mère que j’avais devant moi. Je reconnus les jolies petites boucles de ses cheveux gris, la charmante expression de sa physionomie, le petit grain de beauté qui se laissait voir à l’un des coins de sa bouche. Il n’était pas possible de s’y méprendre. C’était bien la mère d’Eustache !
La vieille dame, naturellement, prit ma surprise pour de la timidité. Avec un tact parfait et un air plein de bonté, elle engagea la conversation avec moi, et je me mis à marcher à côté de celle qui avait si cruellement refusé de m’accueillir dans sa famille. Je me sentais, je l’avoue, fort mal à l’aise, ne sachant nullement, si je devais ou non, en l’absence de mon mari, prendre sur moi de faire connaître à sa mère qui j’étais.
Mais bientôt mon hôtesse, qui marchait de l’autre côté de la dame, trancha la question en m’adressant la parole avec son ton familier. Je venais de dire que je croyais que nous étions en ce moment près des petits bains de Broadstairs, le terme de notre promenade.
« Oh ! non, madame Woodville, dit ma babillarde hôtesse, nous n’en sommes pas aussi près que vous pensez. »
Je regardai avec un battement de cœur ma belle-mère.
À mon grand étonnement, elle n’eut pas le moins du monde l’air de me reconnaître. La vieille Mme Woodville continua à causer avec la jeune Mme Woodville aussi tranquillement que si elle n’avait jamais entendu de sa vie prononcer son nom.
Ma figure et ma contenance durent trahir jusqu’à un certain point mon agitation ; car Mme Woodville, ayant jeté par hasard les yeux sur moi en ce moment, tressaillit, et me dit avec bonté :
« Je crains que vous ne vous soyez fatiguée outre mesure. Vous êtes bien pâle… vous paraissez vous soutenir à peine. Venez vous asseoir là et prenez mon flacon de sels. »
J’eus à peine la force de la suivre jusqu’au pied de la falaise, où de grands quartiers de rochers tombés du sommet nous tinrent lieu de sièges. Je ne saisis que vaguement les longues effusions de tendre sollicitude auxquelles s’abandonna mon hôtesse avec une volubilité intarissable. Je pris, sans trop savoir ce que je faisais, le flacon que la mère de mon mari, après avoir entendu mon nom, m’offrit avec bienveillance, comme elle l’aurait offert à une étrangère.
S’il ne s’était agi que de moi, je crois que j’aurais provoqué sur-le-champ une explication. Mais je devais penser à Eustache. J’ignorais entièrement si les relations qui existaient entre sa mère et lui étaient hostiles ou amicales. Que pouvais-je faire ?
Pendant que toutes ces questions s’agitaient en moi, la vieille dame continuait à me parler avec la plus vive sympathie. Elle aussi, était fatiguée ; elle avait passé une mauvaise nuit, auprès du lit d’une proche parente qui habitait Ramsgate. Elle avait reçu, la veille seulement, un télégramme lui annonçant qu’une de ses sœurs était sérieusement malade. Quant à elle, elle était encore, grâce à Dieu, pleine d’activité et de force, et elle avait cru qu’il était de son devoir d’accourir aussitôt à Ramsgate. Vers le matin, l’état de la malade s’était amélioré.
« Le docteur m’a assuré, madame, qu’il n’y a aucun danger immédiat à redouter ; et j’ai pensé qu’un tour de promenade sur la plage, après une longue nuit passée auprès de la malade, ne pouvait que me faire du bien. »
J’entendis ces mots… j’en compris le sens… mais j’étais encore trop intimidée et trop bouleversée pour être en état de soutenir la conversation. L’hôtesse avait grande envie de le faire, aussi l’hôtesse fut-elle la première personne qui parla.
« Voici un gentleman qui vient de ce côté, dit-elle, en indiquant la direction de Ramsgate. Il ne vous serait pas possible de marcher ; voulez-vous que je le prie d’envoyer une chaise à porteurs à la brèche de la falaise ? »
Le gentleman continua d’avancer.
L’hôtesse et moi, nous le reconnûmes en même temps. C’était Eustache, venant au-devant de nous, comme il avait été convenu. L’hôtesse, ne pouvant contenir sa satisfaction en le voyant, s’écria :
« Oh ! madame Woodville ! voici M. Woodville en personne, n’est-ce pas heureux ? »
Je regardai encore ma belle-mère, et je vis que, cette fois encore, elle n’éprouva pas la moindre émotion en entendant de nouveau prononcer son nom. Ses yeux ne voyaient pas d’aussi loin que les nôtres : elle n’avait pas encore reconnu son fils. Pendant un court moment, Eustache s’arrêta, comme frappé de la foudre. Puis il s’avança… son visage coloré devint pâle d’une émotion contenue ; ses yeux se fixèrent sur sa mère.
« Vous ici !… lui dit-il.
– Comment vous portez-vous, Eustache ? dit-elle tranquillement. Aviez-vous donc appris aussi la maladie de votre tante ? Saviez-vous qu’elle était à Ramsgate ? »
Il ne répondit pas. L’hôtesse, tirant l’inévitable conclusion qui ressortait des mots qu’elle venait d’entendre, me regarda tour à tour, moi et ma belle-mère, dans un état d’étonnement qui paralysa sa langue. J’attendis, les yeux fixés sur mon mari, pour voir ce qu’il ferait. S’il avait tardé un moment de plus à me reconnaître, tout le reste de ma vie eût pu en être empoisonné.
Il ne tarda pas un moment. Il vint à moi et me prit par la main.
« Savez-vous qui est cette dame ? » dit-il à sa mère.
Celle-ci répondit en me regardant et en faisant avec la tête un signe gracieux d’affirmation.
« C’est une dame que j’ai rencontrée sur la plage, Eustache, et qui a eu l’obligeance de me rendre une lettre que j’avais laissé tomber. Je crois que j’ai entendu son nom. Et, se tournant vers l’hôtesse : N’avez-vous pas dit : Mme Woodville ? »
La main de mon mari serra involontairement la mienne, au point de me faire mal. Cependant, il n’hésita pas une seconde.
« Mère, dit-il avec le plus grand calme, cette dame est ma femme. »
Elle était jusqu’à ce moment restée assise. Elle se leva alors, lentement, et regarda son fils en silence. Puis l’expression première de surprise de son visage disparut et fut remplacée par le plus terrible regard d’indignation et de mépris que j’aie jamais vu éclater dans les yeux d’une femme.
« Je plains votre femme, » dit-elle.
Elle ne prononça que ces seuls mots. Elle leva la main en lui faisant signe de s’éloigner d’elle, et reprit d’un pas grave sa promenade solitaire.
IV. RETOUR AU LOGIS.
Laissés à nous-mêmes, nous restâmes un moment silencieux. Eustache parla le premier.
« Êtes-vous en état de marcher et de retourner à pied ? me dit-il, ou devons-nous aller jusqu’à Broadstairs, et revenir à Ramsgate par le chemin de fer ? »
Il me fit cette question aussi tranquillement que si rien de remarquable n’était arrivé. Mais ses yeux et ses lèvres le trahissaient et me disaient qu’il souffrait beaucoup intérieurement. La scène extraordinaire qui venait de se passer, au lieu de m’enlever le reste de mon courage, avait fortifié mes nerfs et m’avait rendu maîtresse de moi-même. J’aurais été plus ou moins qu’une femme, si mon amour-propre n’avait pas été surexcité au plus haut point, par l’attitude incompréhensible de la mère de mon mari, pendant que son fils me présentait à elle. Quel était le secret de son mépris pour lui et de sa pitié pour moi ? Qu’est-ce qui pouvait expliquer son incompréhensible indifférence, quand mon nom avait frappé deux fois son oreille ? Pourquoi nous avait-elle laissés, comme si la seule idée de rester dans notre compagnie lui eût été insupportable ? L’intérêt capital de ma vie était maintenant l’intérêt que j’avais à pénétrer ces mystères. Marcher ? J’éprouvais une si fiévreuse impatience de les connaître, qu’il me semblait que je serais allée au bout du monde, si j’avais pu seulement avoir mon mari à côté de moi, et le questionner pendant la route.
« Je suis tout à fait remise, lui dis-je. Retournons à pied, comme nous sommes venus. »
Eustache lança un regard à l’hôtesse. Elle le comprit.
« Je ne voudrais pas vous imposer ma compagnie, monsieur, lui dit-elle vivement. J’ai affaire à Broadstairs… et j’en suis si voisine ici, que je ferais bien d’y aller. Bonjour, madame Woodville. »
Elle prononça ce nom avec emphase, et l’accompagna, en s’éloignant, d’un coup d’œil significatif que, dans l’état de préoccupation où se trouvait mon esprit, je ne compris pas le moins du monde ; je n’avais ni le temps, ni l’envie de lui demander ce qu’il signifiait. Après avoir fait à Eustache une petite révérence assez raide, elle nous laissa, à son tour, en prenant d’un pas rapide le chemin de Broadstairs.
Enfin, nous étions seuls !
Je ne perdis pas de temps pour commencer mon enquête. Je ne prodiguai pas mes paroles en préliminaires superflus. La question que j’adressai à Eustache fut parfaitement nette et claire.
« Qu’est-ce que signifie la conduite de votre mère ? »
Au lieu de me répondre, il partit d’un éclat de rire… d’un éclat de rire bruyant, grossier, violent, si complètement différent de tous ceux auxquels je l’avais jamais vu se laisser aller, si étrangement contraire à ce que je connaissais de son caractère, que je demeurai immobile.
« Eustache ! lui dis-je, je ne vous reconnais pas. Vous m’effrayez presque. »
Il ne prit pas garde à ce que je lui disais. Il semblait poursuivre quelque idée plaisante qui venait de se réveiller dans son esprit.
« C’est de cette façon que m’aime ma mère ! s’écria-t-il avec l’air d’un homme irrésistiblement entraîné par une pensée qui s’est emparée de lui. Dites-moi tout ce que vous savez à ce propos, Valéria.
– Vous dire ce que je sais ? répétai-je. Après ce qui vient d’arriver, c’est certainement à vous qu’il appartient de m’éclairer.
– Vous ne voyez pas la plaisanterie ? dit-il.
– Non-seulement je ne vois pas la plaisanterie, mais je vois quelque chose, dans le langage et dans la conduite de votre mère, qui m’autorise à vous en demander une sérieuse explication.
– Ma chère Valéria ! si vous connaissiez ma mère aussi bien que je la connais, une sérieuse explication de sa conduite serait la dernière chose dans le monde que vous attendriez de moi. Prendre ma mère au sérieux !… Il éclata de rire encore une fois. Ma chérie ! vous ne savez pas combien vous m’amusez. »
Tout cela n’avait rien de naturel ; tout cela était forcé. Lui, le plus délicat, le plus distingué des hommes… lui, un gentleman dans la plus haute expression du mot… était en me parlant ainsi, lourd, bruyant, vulgaire ! Mon cœur fut soudainement saisi d’une terreur à laquelle, malgré tout mon amour pour lui, il me fut impossible de résister. Dans l’excès de mon chagrin et de mes alarmes, je me demandai si mon mari commençait à me tromper, à jouer… et à jouer mal, la comédie avec moi… après une semaine à peine de mariage !
J’essayai de gagner sa confiance d’une autre façon. Il était évidemment déterminé à me faire partager sa manière de voir. Je résolus, de mon côté, d’accepter son point de vue.
« Vous prétendez que je ne comprends pas votre mère, lui dis-je doucement. Voulez-vous m’aider à la comprendre ?
– Il n’est pas facile de vous aider à comprendre une femme qui ne se comprend pas elle-même, me répondit-il. Mais je vais essayer. La clef du caractère de ma pauvre mère est dans un seul mot : Excentricité. »
S’il avait cherché dans tout le dictionnaire le mot le moins propre à peindre la dame que j’avais rencontrée sur la grève, excentricité eût été ce mot. Un enfant qui aurait vu ce que j’avais vu, qui aurait entendu ce que j’avais entendu, aurait découvert qu’il se moquait… et se moquait grossièrement… de la vérité.
« Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, continua-t-il, et, si vous voulez comprendre ma mère, faites ce que je vous ai demandé de faire, il n’y a qu’une minute… dites-moi tout ce qui vient d’arriver. Comment en êtes-vous venue à lui parler, à entrer en conversation avec elle ?
– Votre mère vous l’a dit, Eustache. Je marchais derrière elle, quand elle a laissé tomber une lettre par hasard…
– Non par hasard, dit-il en m’interrompant, mais à dessein.
– Impossible ! m’écriai-je. Pourquoi aurait-elle laissé tomber cette lettre à dessein ?
– Usez de la clé de son caractère, ma chère. Excentricité ! Une manière bizarre employée par ma mère pour faire connaissance avec…
– Pour faire connaissance avec moi… ? Mais je viens de vous dire que je marchais derrière elle. Elle ne pouvait deviner ma présence avant que je lui eusse parlé la première.
– C’est une supposition, Valéria !
– C’est un fait certain !
– Pardonnez-moi… vous ne connaissez pas ma mère comme je la connais. »
Je commençai à perdre patience.
« Voulez-vous dire, repris je, que votre mère était sortie ce matin dans le dessein exprès de faire connaissance avec moi ?
– Je n’ai pas le moindre doute là-dessus, me répondit-il froidement.
– Pourquoi ne m’a-t-elle pas reconnue en entendant mon nom ? Deux fois l’hôtesse m’a appelée Mme Woodville, de manière à être parfaitement entendue par elle, et deux fois, je vous le jure sur l’honneur, ce nom n’a fait aucune impression sur elle. Son regard, le jeu de sa physionomie ont été ceux d’une personne qui aurait entendu son nom pour la première fois de sa vie.
– Jeu est le mot propre, dit-il. Les femmes de théâtre ne sont pas les seules qui puissent jouer la comédie. Le but de ma mère était de vous connaître complètement ; et, pour cela, d’empêcher que vous ne vous missiez sur vos gardes, c’est-à-dire de vous parler comme pouvait le faire une personne qui vous eût été étrangère. C’est bien là un trait digne de ma mère, que de prendre ce détour pour arriver à satisfaire sa curiosité à l’égard d’une belle-fille, dont elle a désapprouvé le mariage. Si je ne vous avais pas rejointes, comme je l’ai fait, elle vous aurait examinée et interrogée, en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne, et vous lui auriez répondu innocemment, dans la parfaite croyance que vous causiez avec une connaissance de hasard. Je reconnais bien là ma mère. Elle est votre ennemie, rappelez-vous-le… et non pas votre amie : elle n’est pas en quête de vos mérites, mais de vos défauts. Et vous vous étonnez que votre nom, quand elle l’a entendu, n’ait fait aucune impression sur elle ! Pauvre innocente ! Je puis vous dire ceci… vous n’avez vu ma mère dans son vrai caractère, que lorsque j’ai mis fin à la mystification, en vous présentant l’une à l’autre. »
Je le laissais aller, sans dire un mot. J’écoutais. Oh ! avec quel cœur rempli de tristesse ! avec quel désenchantement et quel désespoir, qui me déchiraient l’âme ! L’idole de mon culte, le compagnon, le guide, le protecteur de ma vie, était-il donc tombé si bas ? Pouvait-il s’avilir par une ruse aussi éhontée ?
Y avait-il un seul mot de vérité dans tout ce qu’il m’avait dit ? Oui ! si je n’avais pas découvert le portrait de sa mère, il est certain que je n’aurais pas connu, que je n’aurais pas même soupçonné qui était réellement la dame que je venais de rencontrer. À part cela, le reste n’était que mensonges… grossiers mensonges, qui ne permettaient de dire qu’une chose en sa faveur, c’est qu’il n’était pas accoutumé à la fausseté et à la tromperie. Bon Dieu !… s’il fallait en croire mon mari, sa mère nous aurait suivis à la piste à Londres, suivis à la piste à l’église, suivis à la piste à la station du chemin de fer, suivis à la piste à Ramsgate ! Affirmer qu’elle me connaissait de vue pour la femme d’Eustache, qu’elle m’attendait sur la grève, et qu’elle avait laissé tomber à dessein sa lettre, dans le but exprès de faire connaissance avec moi, c’était affirmer que chacune de ces monstrueuses improbabilités était un fait qui était réellement arrivé !
Je ne pouvais plus trouver un mot. Je marchais à côté d’Eustache en silence, pénétrée de la malheureuse conviction qu’il y avait un abîme, sous la forme d’un secret de famille, entre mon mari et moi. En esprit, sinon en fait, nous étions séparés l’un de l’autre… après une existence commune de seulement quatre jours !
« Valéria, me demanda-t-il, n’avez-vous rien à me dire ?
– Rien.
– Est-ce que vous n’êtes pas satisfaite de mes explications ? »
Je remarquai un léger tremblement dans sa voix, quand il m’adressa cette question. Le son en était, pour la première fois depuis que nous causions, devenu semblable à celui que mon expérience associait, en lui, à certains traits de son humeur que j’avais appris déjà à bien connaître. Parmi les milliers d’influences mystérieuses qu’un homme exerce sur la femme qui l’aime, je doute qu’il y en ait une plus irrésistible que l’influence de sa voix. Je ne suis pas de ces femmes qui versent des larmes si peu qu’elles y soient provoquées ; ce n’est pas, sans doute, dans mon tempérament. Mais quand je remarquai ce léger changement naturel dans le son de sa voix, mon esprit se reporta, je ne sais pourquoi, à ce jour heureux où, pour la première fois, je lui avais avoué que je l’aimais. J’éclatai en sanglots.
Il s’arrêta soudain et me prit par la main. Il essaya de regarder mon visage.
Mais je tins la tête baissée et mes yeux fixés sur le sol. J’étais honteuse de ma faiblesse et de mon défaut de courage. J’étais résolue à ne pas le regarder en face.
Durant l’instant de silence qui suivit, il tomba subitement à genoux devant moi, en poussant un cri de désespoir qui me déchira le cœur.
« Valéria ! s’écria-t-il, je suis un homme méprisable… un homme faux… un homme indigne de vous. Ne croyez pas un mot de ce que je viens de vous dire. Ce sont autant de mensonges, de lâches et détestables mensonges. Vous ne savez pas par quelles épreuves j’ai passé ; vous ne savez pas combien j’ai été torturé. Oh ! ma bien-aimée, ne me méprisez pas ! Il faut que j’aie été hors de moi-même quand je vous ai parlé comme je l’ai fait. Vous sembliez offensée ; je ne savais que faire. Je voulais vous épargner même un moment de peine. Je voulais en détourner votre pensée, et je l’ai tenté par ces mensonges. Pour l’amour de Dieu, ne me demandez pas de vous en dire davantage ! Mon amour ! mon ange ! il s’agit de quelque chose entre ma mère et moi, mais qui ne vous touche en rien. Je vous aime, je vous adore ; tout mon cœur, toute mon âme sont à vous. Que cela vous suffise ! Oubliez ce qui vient d’arriver. Vous ne reverrez plus jamais ma mère. Nous quitterons demain cette ville. Nous nous embarquerons sur le yacht. Qu’importe où nous vivions, pourvu que nous vivions l’un pour l’autre ! Pardonnez et oubliez ! Oh ! Valéria, Valéria, pardonnez et oubliez ! »
Une indicible douleur se peignait sur sa figure. Une indicible douleur se laissait sentir dans sa voix. Rappelez-vous cela ; et rappelez-vous que je l’aimais.