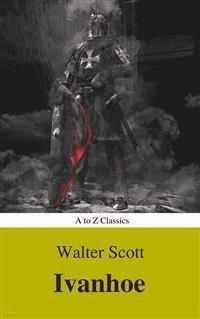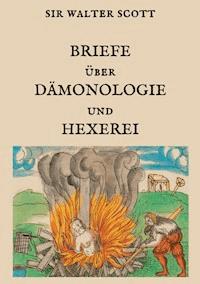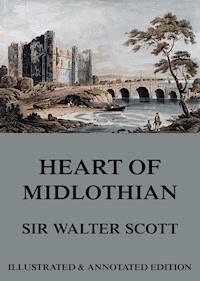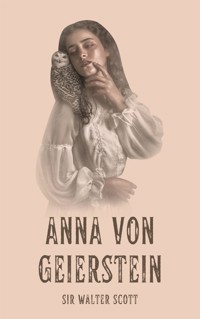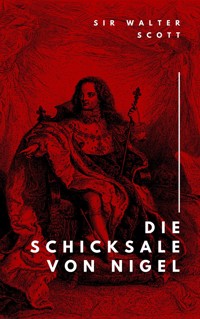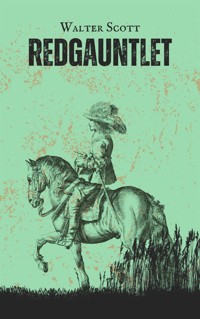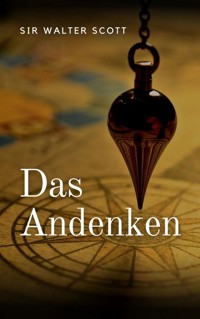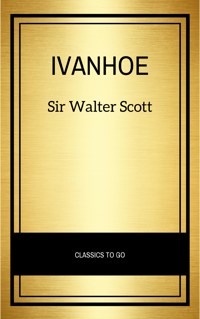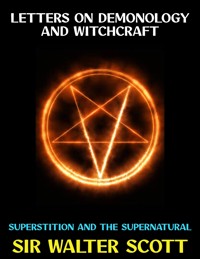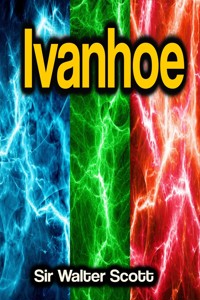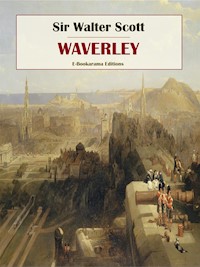Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Édimbourg, 14 Avril 1736. Le capitaine des gardes d'Édimbourg, John Porteous, ordonne de tirer sur la foule qui souhaite récupérer le corps d'un contrebandier qui vient d'être exécuté . Porteous a outrepassé sa mission, il ne devait veiller qu'à l'exécution de la sentence, le reste n'étant pas de son ressort. Pour cela, Porteous est arrêté et condamné à mort. Mais la reine Caroline ordonne un sursis de six semaines à l'exécution. Cette décision révolte la population d'Édimbourg qui se soulève et prend de force la prison d'Édimbourg. Et tandis que les émeutiers recherchent Porteous pour lui faire un sort, un des conspirateurs offre la liberté à une jeune prisonnière, Effie, dans l'attente de son procès pour infanticide. Celle-ci refuse, préférant la mort à l'honneur perdu. Elle ignore que sa soeur, Jeanie Deans, va se battre pour la sauver de cette accusation injuste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 934
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Prison d'Edinbourg
Chapitre 1 - SERVANT D’INTRODUCTION.Chapitre 2Chapitre 3Chapitre 4Chapitre 5Chapitre 6Chapitre 7Chapitre 8Chapitre 9Chapitre 10Chapitre 11Chapitre 12Chapitre 13Chapitre 14Chapitre 15Chapitre 16Chapitre 17Chapitre 18Chapitre 19Chapitre 20Chapitre 21Chapitre 22Chapitre 23Chapitre 24Chapitre 25Chapitre 26Chapitre 27Chapitre 28Chapitre 29Chapitre 30Chapitre 31Chapitre 32Chapitre 33Chapitre 34Chapitre 35Chapitre 36Chapitre 37Chapitre 38Chapitre 39Chapitre 40Chapitre 41Chapitre 42Chapitre 43Chapitre 44Chapitre 45Chapitre 46Chapitre 47Chapitre 48Chapitre 49Chapitre 50Chapitre 51Chapitre 52Page de copyrightChapitre 1 - SERVANT D’INTRODUCTION.
« Romantique Ashbourne, ainsi sur tes hauteurs
» Glisse la diligence avec six voyageurs. »
FRÈRE.
Le temps n’a nulle part apporté plus de changemens (nous suivons, selon notre habitude, le manuscrit de Pierre Pattieson) que dans les moyens de transport et de communication entre les différentes parties de l’Écosse. Il n’y a pas plus de vingt ou trente années, si l’on en croit plusieurs témoins respectables encore vivans, qu’une misérable petite carriole, faisant, avec beaucoup de peine, trente milles à la journée, portait les dépêches de la capitale de l’Écosse à son extrémité ; et l’Écosse n’était guère à cet égard plus mal servie que sa sœur plus opulente ne l’était il y a environ quatre-vingts ans. Fielding, dans son Tom-Jones, et Farquhar, dans une petite farce intitulée : the Stage-CoachBull and Mouth.
Mais ces carrosses antiques, lents et sûrs, ont maintenant entièrement disparu de l’une et de l’autre contrée : malles-postes et célérifères rivalisent de toutes parts, et traversent la Grande-Bretagne en tous les sens ; dans notre seul village, trois diligences en poste, quatre voitures avec leurs hommes armés, en casaque rouge, ébranlent les rues chaque jour, le disputent par leur magnificence et leur vacarme à l’invention de ce tyran fameux
Démens ! qui nimbos et non imitabile fulmen
Ære et cornipedum pulsu simulârat equorum.
Quelquefois même, pour compléter la ressemblance et pour corriger la présomption des postillons trop audacieux, la course rapide de ces impétueux rivaux de Salmonée est arrêtée par un événement non moins violent que celui qui causa la perte de leur prototype ; c’est alors que les voyageurs de l’inside et de l’outside
Le fier Skiddaw entend avec effroi
Du char roulant la course encor lointaine,
et peut-être les échos de Ben-Nevis s’éveilleront bientôt au son du cor, non de quelque Chef guerrier, mais d’un conducteur de malle-poste.
C’était un beau jour d’été, et notre petite école avait obtenu un demi-congé par l’intercession d’un inspecteur de joyeuse humeur
« – Les grands débats, la harangue populaire, – la réplique, les raisonnemens, la motion sage ou ingénieuse, – le rire de l’assemblée, – il me tarde de tout savoir ; je brûle de délivrer les disputeurs de leur prison de papier, et de leur rendre la voix et la parole. »
Tels étaient les sentimens qui m’agitaient tandis que j’avais les yeux fixés sur le chemin par où devait arriver la nouvelle diligence, connue sous le nom du Somerset, et qui, à dire vrai, ne m’est pas indifférente, même lorsqu’elle n’a rien de très intéressant à m’apporter. Le bruit lointain des roues vint frapper mon oreille au moment où j’atteignais le sommet de ce coteau appelé le Goslin-Brae, du haut duquel la vue domine toute la vallée qu’arrose le Gander. La voie publique qui aboutit à cette rivière, et la traverse sur un pont situé environ à un quart de mille du lieu où je me trouvais, se continue en partie au milieu d’un enclos planté d’arbres et en partie à travers une terre de dépaissance ; c’est un enfantillage peut-être ; – mais j’ai passé toute ma vie avec des enfans, pourquoi ne m’amuserais-je pas comme eux ? ainsi donc enfantillage soit ; mais je dois avouer que j’ai souvent pris le plus grand plaisir à observer l’approche de la voiture, d’aussi loin que les détours de la route me permettaient de l’apercevoir. La vue de l’équipage, son exiguïté apparente, qui contraste avec la rapidité de sa course, ses apparitions et ses disparitions successives, le bruit toujours croissant dont il est précédé, tout enfin pour le spectateur oisif qui n’a rien de mieux à faire, a je ne sais quel intérêt secret. On peut rire de moi comme de tant d’honnêtes bourgeois qui chaque jour attendent régulièrement à la fenêtre de leur maison de campagne le passage de la diligence ; mais n’importe, cet amusement en vaut bien un autre, et tel qui fait chorus avec les rieurs n’est peut-être pas fâché d’en jouir sans s’en vanter.
Cette fois cependant il était écrit que je n’aurais pas le plaisir de voir la voiture passer devant le gazon sur lequel j’étais assis, et d’entendre la voix enrouée du conducteur quand il laisserait glisser entre mes mains mon paquet sans arrêter la voiture un seul instant. J’avais vu la diligence descendre la côte qui conduit au pont, avec plus de rapidité que d’ordinaire ; elle brillait par intervalle au milieu du tourbillon de poussière qu’elle avait soulevé, et laissait derrière elle une longue traînée, semblable aux légers nuages, reste des brouillards d’une matinée de printemps. Mais je ne la vis pas reparaître sur l’autre rive après les trois minutes d’usage, qu’une observation répétée m’avait appris être le temps nécessaire pour traverser le pont et remonter la côte. Quand il se fut écoulé plus du double du temps, je commençai à concevoir quelque inquiétude, et je m’avançai rapidement ; arrivé en vue du pont, la cause du délai ne me fut que trop manifeste : le Somerset avait bien mérité son nom
Apparent rari nantes in gurgite vasto.
Je donnai mon petit coup de main là où il paraissait le plus nécessaire, et avec le secours d’une ou deux personnes de la compagnie, qui s’étaient échappées saines et sauves, nous vînmes facilement à bout de repêcher deux des pauvres voyageurs ; c’étaient deux gaillards actifs et courageux ; si ce n’eût été la longueur démesurée de leurs redingotes et l’ampleur également extraordinaire de leurs pantalons à la Wellington, ils n’auraient eu besoin du secours de personne. Le troisième était un vieillard infirme, et il eût infailliblement péri sans les efforts qu’on fît pour le sauver.
Lorsque nos deux gentlemen aux longues redingotes furent sortis de la rivière, et qu’ils eurent secoué leurs oreilles comme font les barbets, une violente altercation s’éleva entre eux et le cocher et le conducteur sur la cause de l’accident. Dans le cours de la dispute, je m’aperçus que mes nouvelles connaissances appartenaient au barreau, et que la subtilité habituelle de la chicane allait vraisemblablement rendre la partie inégale entre eux et les conducteurs de la voiture avec leur ton bourru et officiel.
La dispute se termina par l’assurance donnée aux voyageurs qu’ils seraient placés dans une lourde voiture qui devait passer par là dans moins d’une demi-heure, pourvu qu’elle ne fût pas pleine. Le hasard sembla favoriser cet arrangement, car lorsque le véhicule si désiré arriva, il n’y avait que deux places prises sur six. Les deux dames qu’on avait exhumées du fond de la voiture renversée furent admises sans difficulté ; mais les nouveaux voyageurs s’opposèrent formellement à l’admission des deux légistes, dont les vêtemens humides, assez semblables à des éponges trempées, paraissaient devoir rendre une partie de l’eau dont ils avaient été imbibés, à la grande incommodité de leurs compagnons de voyage. De l’autre côté, les légistes refusaient de monter sur l’impériale, alléguant qu’ils n’avaient pris cette place sur l’autre voiture que par goût, et qu’ils s’étaient réservé leur libre entrée dans l’intérieur, quand bon leur semblerait, ainsi que le portait spécialement leur contrat, auquel ils s’en référaient. Après une légère altercation, dans laquelle il fut dit quelques mots de l’édit nautæ, caupones, stabularii, la voiture se mit en marche, laissant là nos doctes voyageurs occupés de leurs actions en dommages-intérêts.
Ils me prièrent aussitôt de les guider au village voisin, et de leur indiquer la meilleure auberge ; sur les renseignemens que je leur donnai des ARMES DE WALLACE, ils déclarèrent qu’ils préféraient s’arrêter là plutôt que de passer outre, d’après l’indication de cet imprudent conducteur du Somerset. Tout ce dont ils avaient besoin était un commissionnaire pour porter leur bagage : on leur en trouva facilement un dans une cabane voisine, et ils allaient se mettre en route, quand ils trouvèrent qu’il y avait un autre voyageur dans le même embarras, c’était le vieillard infirme qui avait été précipité dans la rivière avec eux. Il avait été trop modeste, à ce qu’il paraît, pour élever quelque réclamation contre le cocher, en voyant le résultat de celles de ses deux compagnons plus hardis, et maintenant il restait en arrière avec un air d’inquiétude timide, laissant assez deviner qu’il était entièrement dépourvu de ces moyens de recommandation qui sont un passe-port indispensable pour recevoir l’hospitalité dans une auberge.
Je me hasardai à appeler l’attention de ces deux jeunes élégans, car ils paraissaient tels, sur la triste condition de leur compagnon de voyage ; ils reçurent cet avis de très bonne humeur.
– Eh bien, M. Dunover, dit l’un de nos jouvenceaux, vous ne pouvez pas rester ici sur le pavé ; venez, vous dînerez avec nous, Halkit et moi nous allons prendre une chaise de poste, et, à tout évènement, nous vous conduirons partout où il vous conviendra.
Le pauvre homme, car son costume et sa modestie disaient assez qu’il était pauvre, répondit par ce salut de reconnaissance qui, chez les Écossais, veut dire : c’est trop d’honneur que vous faites à un homme comme moi, et il suivit humblement ses joyeux protecteurs. Ils arrosaient la poussière de la route de l’eau qui découlait de leurs habits trempés, et offraient le bizarre et risible spectacle de trois personnes souffrant d’un excès d’humidité en plein midi, quand le soleil faisait éprouver à tout ce qui les entourait le tourment contraire de la sécheresse et de la chaleur. Ce ridicule fut observé par les jeunes gens eux-mêmes, et ils n’avaient pas fait quelques pas, que déjà il leur était échappé quelques plaisanteries passables sur leur situation.
– Nous n’avons pas à nous plaindre, comme Cowley, dit l’un d’eux, que la toison de Gédéon reste sèche tandis que tout est humide à l’entour : c’est le miracle renversé.
– Nous devons être reçus avec reconnaissance dans la ville : nous y apportons quelque chose dont les habitans paraissent avoir grand besoin, dit Halkit.
– Et nous le distribuons avec une générosité sans égale, répondit son compagnon ; nous ferons ici l’office de trois tombereaux d’arrosage sur leur route poudreuse.
– Nous leur amenons aussi, dit Halkit, un bon renfort de gens du métier, un agent d’affaires et un avocat.
– Et peut-être aussi un client, dit son compagnon en regardant derrière lui ; puis il ajouta en baissant la voix : le camarade a bien l’air de n’avoir que trop fréquenté cette compagnie dangereuse.
Et dans le fait, il n’était que trop vrai que l’humble compagnon de nos gais jouvenceaux avait la triste apparence d’un plaideur ruiné ; je ne pus m’empêcher de rire de l’allusion, quoique je prisse bien soin de cacher ma gaieté à celui qui en était l’objet.
Quand nous fûmes arrivés à l’auberge de WALLACE, le plus jeune de nos jeunes gens d’Édimbourg, qui était avocat plaidant, à ce que j’appris, insista pour que je prisse part à leur dîner ; leurs questions et leurs demandes mirent bientôt mon hôte et toute sa famille en mouvement pour leur offrir le meilleur repas que pouvaient fournir la cave et l’office et l’accommoder selon les règles de l’art culinaire, auquel nos deux amphitryons paraissaient n’être pas étrangers ; du reste, c’étaient deux jeunes gens qui, pleins de cette aimable gaieté que donnent leur âge et la bonne humeur, jouent un rôle assez fréquent dans la haute classe des hommes de loi d’Édimbourg, et qui ressemble assez à celui des jeunes Templiers
L’homme au teint pâle, qu’ils avaient eu la bonté d’admettre dans leur société, semblait n’être pas à sa place, et ne point partager leur bonne humeur. Il était assis sur le bord de sa chaise, à trois pieds de distance de la table, se tenant ainsi dans une situation très incommode pour porter les morceaux à la bouche, comme s’il eût voulu punir son audace de prendre part au repas de ses supérieurs. À la fin du dîner, il se refusa à toutes les instances qu’on lui fit de goûter le vin qui circulait à la ronde, demanda l’heure à laquelle la voiture devait se mettre en route, déclara qu’il voulait être prêt, de peur de la manquer, et sortit modestement de l’appartement.
– Jack, dit l’avocat à son compagnon, je me rappelle maintenant la figure de ce pauvre diable ; tu disais plus vrai que tu ne croyais : c’est réellement un de mes cliens, le pauvre homme !
– Le pauvre homme ! répondit Halkit, je suppose que vous voulez dire que c’est votre seul et unique client.
– Ce n’est pas ma faute, Jack, répondit l’autre, que j’appris se nommer Hardie ; vous devez me donner toutes vos affaires, et si vous n’en avez pas, monsieur qui est ici présent sait bien qu’on ne peut rien tirer de rien.
– Mais vous paraissez avoir converti quelque chose en rien dans l’affaire de ce brave homme, dit l’agent : il a l’air d’aller bientôt honorer de sa présence LE CŒUR DE MIDLOTHIAN. (The Heart of Mid-Lothian.)
– Vous vous trompez, car il ne fait que d’en sortir. – Mais les regards de monsieur demandent une explication. – Dites-moi, M. Pattieson, êtes-vous jamais allé à Édimbourg ?
Je répondis affirmativement.
– Alors vous devez avoir passé, ne serait-ce que par hasard, quoique probablement ce ne soit pas aussi souvent que je suis condamné à le faire, par une allée étroite située à l’extrémité nord-ouest de Parliament-Square, et qui traverse un antique édifice avec des tours et des grilles de fer.
Vieux monument qui réalise
Un dicton connu dans ce lieu,
Près de l’Église,
Et loin de Dieu.
– Et dont l’enseigne est l’Homme rouge, dit M. Halkit en interrompant l’avocat pour être de moitié dans l’énigme.
– C’est en somme, répondit celui-ci en interrompant à son tour son ami, une espèce de lieu où l’infortune est heureusement confondue avec le crime, et d’où tous ceux qui y sont enfermés désirent sortir.
– Et où aucun de ceux qui ont eu le bonheur d’en sortir ne désire rentrer, reprit son compagnon.
– J’entends, messieurs, répliquai-je, vous voulez dire la prison.
– La prison, ajouta le jeune avocat, – vous l’avez deviné : – c’est la vénérable Tolbooth elle-même ; – et permettez-moi de vous dire que vous nous avez des obligations pour la description courte et modeste que nous vous en avons donnée, car de quelque amplification que nous nous fussions servis pour embellir le sujet, vous étiez entièrement à notre discrétion, puisque les pères conscrits de notre ville ont décrété que le vénérable édifice ne resterait pas debout pour confirmer notre récit ou pour le démentir.
– Ainsi donc, répondis-je, la Tolbooth d’Édimbourg est appelée le Cœur de Midlothian.
– Tel est son nom, je vous assure.
– Je pense, ajoutai-je avec la défiance d’un inférieur qui laisse échapper à demi-voix un calembour en présence de son supérieur, je pense qu’on peut bien dire que le comté métropolitain a un triste cœur.
– Juste comme un gant, M. Pattieson, répliqua M. Hardie et un cœur fermé, un cœur dur. – À vous, Jack.
– Et un méchant cœur, un pauvre cœur, répondit Halkit, faisant de son mieux pour dire un bon mot.
– On pourrait dire aussi que c’est un cœur haut, un grand cœur, répondit l’avocat ; vous voyez que lorsqu’il s’agit de cœur, je puis vous en montrer.
– Je suis au bout de toutes mes pointes sur le cœur, dit le plus jeune de ces messieurs.
– Alors il faudra choisir un autre sujet, répondit son compagnon ; et, quant à la vieille Tolbooth condamnée, quelle pitié de ne pas lui rendre les mêmes honneurs qu’on a rendus à plusieurs de ses locataires ? Pourquoi Tolbooth n’aurait-elle pas aussi ses dernières exhortations, sa confession, ses prières des agonisans ? Ses vieilles pierres seront, à peu de chose près, aussi sensibles à cet honneur que maints pauvres diables pendus du côté de sa façade occidentale, tandis que les colporteurs criaient une confession dont jamais le patient n’avait entendu parler.
– J’ai bien peur, répondis-je, si toutefois il n’y a pas trop de présomption à donner mon opinion, que l’histoire de cet édifice ne fût un tissu de crimes et de douleurs.
– Non pas tout-à-fait, mon ami, dit Hardie ; une prison est un petit monde par elle-même : elle a ses affaires, ses chagrins, ses joies qui lui sont propres ; ses habitans quelquefois n’ont que peu de jours à vivre, mais il en est de même des soldats au service ; ils sont pauvres relativement au monde du dehors, mais il y a parmi eux des degrés de richesses et de pauvreté, et plusieurs d’entre eux jouissent d’une opulence relative ; ils n’ont pas grand espace pour se promener, mais la garnison d’un fort assiégé, l’équipage d’un navire en pleine mer, n’en ont pas davantage, et même à certains égards ils se trouvent dans une position plus avantageuse, car ils peuvent acheter de quoi dîner tant qu’ils ont de l’argent, et ils ne sont pas obligés de travailler, qu’ils aient de quoi manger ou non.
– Mais, répondis-je (non sans penser secrètement à ma tâche actuelle), quelle variété d’incidens pourrait-on trouver dans un ouvrage comme celui dont vous venez de parler ?
– Ils seraient à l’infini, répliqua le jeune avocat : tout ce qu’il y a de fautes, de crimes, d’impostures, de folies, d’infortunes inouïes, de revers propres à jeter de la variété sur le cours de la vie, serait retracé dans les derniers aveux de la Tolbooth, et je trouverai assez d’exemples pour rassasier l’insatiable appétit du public pour l’horrible et le merveilleux. Les romanciers sont obligés de se creuser le cerveau pour diversifier leurs contes, et après tout, à peine peuvent-ils esquisser un caractère ou une situation qui ne soient usés et déjà familiers au lecteur, de sorte que leurs dénouemens, leurs enlèvemens, les blessures mortelles, dont leur héros ne meurt jamais, les fièvres dévorantes, dont leur héroïne peut être toujours certaine de guérir, sont devenus un véritable lieu commun. Moi je me joins à mon honnête ami Crabbe ; j’ai un malheureux penchant à espérer quand il n’y a plus d’espoir, et je me fie toujours à la dernière planche qui doit soutenir le héros du roman au milieu de la tempête de l’adversité. À ces mots le jeune avocat se mit à déclamer avec emphase le passage suivant :
« J’ai eu jadis beaucoup de craintes (mais je n’en ai plus) lorsqu’une chaste beauté, trahie par quelque misérable, était enlevée avec tant de promptitude, qu’elle ne pouvait deviner par anticipation le sort cruel qui l’attendait. Aujourd’hui je ne m’effraie plus : – emprisonnez la belle dans des murs solides, creusez un fossé autour, mettez-y des serrures d’airain, des verrous de fer et des geôliers impitoyables ; qu’elle n’ait pas un sou dans sa bourse ; qu’elle éprouve les refus de tous ceux dont elle implorera la pitié ; que les fenêtres soient trop hautes pour oser les sauter ; que le secours soit si loin qu’on ne puisse entendre la voix qui l’appelle, quelque puissance secrète trouvera encore des moyens d’arracher sa proie au tyran déçu. »
Ce qui tue l’intérêt, dit-il en concluant, c’est la fin de l’incertitude ; – voilà ce qui fait qu’on ne lit plus de romans.
– Ô dieux, écoutez ! reprit son compagnon. Je vous assure, M. Pattieson, que vous n’avez qu’à faire une visite à ce docte gentleman,et vous êtes sûr de trouver sur sa table les nouveaux romans à la mode, proprement retranchés toutefois sous les Institutes de Stair, et un volume ouvert des Décisions de Morison.
– Je ne le nie pas, dit notre jeune jurisconsulte, et pourquoi le nierais-je, lorsqu’il est maintenant bien connu que ces Dalilas ont séduit nos plus fortes têtes ? Ne les trouve-t-on pas cachés parmi les mémoires de nos plus célèbres consultans ? et on les voit sortir de dessous, le coussin du fauteuil de nos juges ; nos anciens dans le barreau, et même sur les siéges de la magistrature, lisent des romans ; bien plus, si l’on ne les calomnie pas, plusieurs d’entre eux en ont composé par-dessus le marché. Je dirai seulement que je les lis par habitude et par indolence, et non que j’y prenne aucun intérêt ; comme le vieux Pistol en rongeant son poireau
– Vous pensez, demandai-je, que l’histoire de la prison d’Édimbourg pourrait fournir des matériaux pour des nouvelles intéressantes ?
– Certainement, mon cher monsieur, répondit Hardie, et une abondance prodigieuse ; – mais à propos, remplissez votre verre. – Cette prison n’a-t-elle pas été pendant plusieurs années le lieu où se réunissait le parlement d’Écosse ; n’a-t-elle pas servi d’asile au roi Jacques, quand la populace enflammée par un séditieux prédicateur se révolta contre lui, en criant : – L’épée du Seigneur et de Gédéon ! – que l’on nous amène ce misérable Aman ! – Depuis lors, que de cœurs ont palpité au sein de ses murailles, en entendant la cloche qui leur annonçait l’approche de l’heure fatale ; combien se sont laissé abattre par ce lugubre son, combien l’ont entendu avec une courageuse fierté et une mâle résignation ! – Combien ont dû leur consolation à la religion ; croyez-vous qu’il ne s’en est pas trouvé qui, jetant un regard sur ce qui les avait poussés au crime, pouvaient à peine comprendre qu’une aussi misérable tentation eût pu les détourner du sentier de la vertu ? Et ne s’en est-il pas peut-être rencontré d’autres qui, pleins du sentiment de leur innocence, étaient partagés entre l’indignation que leur causait un châtiment injuste, la conscience de leur innocence, et le désir inquiet de se venger ? Pouvez-vous supposer que des sentimens si profonds, si violens, pourraient être retracés sans exciter le plus puissant intérêt ? – Oh ! attendez que j’aie publié mon recueil de Causes célèbres de la Calédonie, et vous ne manquerez pas pour l’avenir de sujet de romans ou de tragédies. Le vrai triomphera des plus brillantes inventions d’une imagination ardente.
– Magna est veritas, et prœvalebit.
– Il me semble, répliquai-je, encouragé par l’affabilité de mon conteur, que l’intérêt dont vous parlez doit être plus faible dans la jurisprudence écossaise que dans celle de tout autre pays : la moralité générale du peuple, ses habitudes sobres et sages…
– Le préservent bien, dit l’avocat, d’un plus grand nombre de voleurs et de brigands de profession, mais non des sauvages et bizarres écarts des passions qui enfantent des crimes accompagnés des plus extraordinaires circonstances ; et ce sont précisément ceux dont le récit excite le plus vif intérêt. L’Angleterre est depuis très long-temps un pays civilisé : ses sujets sont très rigoureusement soumis à des lois appliquées avec impartialité ; le travail s’est divisé et réparti entre tous les sujets, et les voleurs forment dans la société une classe à part, qui se subdivise ensuite, suivant le genre d’escroquerie de chacun d’eux et leur mode d’opérer ; cette classe a ses habitudes et ses principes réguliers, que l’on peut calculer par anticipation à Bow-Street, Hatton-Garden, ou à Old-Bailey. – Ce royaume est comme une terre cultivée : le fermier sait que, malgré ses soins, un certain nombre d’herbes parasites doit croître avec son blé ; il peut vous les nommer et vous les désigner par avance. Mais l’Écosse est comme le sol de ses montagnes : le moraliste qui consulterait les archives de la jurisprudence criminelle, trouverait autant de faits encore inconnus dans l’histoire de l’esprit humain, qu’un botaniste découvrirait de fleurs nouvelles dans ses vallons et sur ses rochers.
– Et c’est là tout le fruit que vous avez retiré de la triple lecture des – Commentaires sur la jurisprudence criminelle d’Écosse ? – dit son compagnon. Je crois que son savant auteur pensait peu que les faits que son érudition et sa sagacité ont accumulés pour l’éclaircissement des doctrines légales, fourniraient un jour matière aux volumes en demi-reliure des cabinets de lecture.
– Je vous gage une bouteille de bordeaux, dit le jeune avocat, qu’ils ne perdent pas au change. Mais, comme on dit au barreau, je demande qu’on me laisse parler sans interruption. – J’en ai plus encore à dire sur mon recueil des Causes célèbres d’Écosse ; veuillez seulement vous rappeler le but et le motif qui ont fait concevoir et exécuter tant de crimes si extraordinaires et si audacieux, les longues dissensions civiles de l’Écosse, – la juridiction héréditaire qui jusqu’en 1748 confiait la recherche des crimes à des juges ignorans ou intéressés, – les habitudes des nobles, vivant toujours dans leurs manoirs solitaires, et nourrissant des passions haineuses comme un aliment nécessaire à leur activité ; – pour ne pas parler ici de cette aimable qualification nationale appelée perfervidum ingenium Scotorum, que nos légistes allèguent pour justifier la sévérité de quelques unes de leurs ordonnances. Quand je traiterai un sujet aussi mystérieux, aussi profond, aussi dangereux que celui qui naquit de telles circonstances, il n’est pas de lecteur qui ne sente son sang se glacer et ses cheveux se dresser sur la tête. – Mais chut ! voici notre hôte qui vient nous apporter des nouvelles ; je suppose que notre voiture est prête.
Il n’en était pas ainsi : – l’hôte annonça qu’on ne pouvait pas avoir de voiture, car sir Peter Plyem avait loué les deux paires de chevaux de mon hôte, et les avait conduits le matin même au bourg royal de Bubbleburgh, pour son affaire ; mais, comme Bubbleburgh n’est qu’un des cinq bourgs qui se réunissent pour nommer un membre du parlement, l’adversaire de sir Peter avait judicieusement profité de son départ pour intriguer dans Bitem, autre bourg royal, et qui, comme personne ne l’ignore, est situé au bout de l’avenue de sir Peter, et a été de temps immémorial sous l’influence de sir Peter et de ses ancêtres. Sir Peter était donc placé dans la situation d’un monarque ambitieux qui, après avoir fait une attaque sur le territoire ennemi, est rappelé subitement par une invasion sur ses domaines héréditaires. Il fut obligé de quitter Bubbleburgh à demi gagné pour retourner à Bitem à demi perdu, et les deux paires de chevaux qui l’avaient conduit à Bubbleburgh furent par lui retenues pour transporter son agent, son valet, son bouffon, son buveur, et les ramener à Bitem. Le motif de ce contre-temps, qui m’était assez indifférent, comme il l’est probablement au lecteur, suffit pour consoler mes compagnons. Comme les aigles, ils sentaient de loin le prochain combat ; ils commandèrent donc un magnum
Au milieu d’une très vive et très inintelligible discussion sur les prévôts, baillis, diacres-syndics, bourgs royaux, cours foncières, clercs-municipaux, bourgeois résidans et non résidans, l’avocat s’interrompit tout-à-coup : – Et ce pauvre Dunover, dit-il, il ne faut pas l’oublier. Aussitôt on dépêcha l’hôte à la recherche du pauvre honteux, avec une invitation très pressante pour le reste de la soirée. Je ne pus m’empêcher de demander à ces jeunes messieurs s’ils connaissaient le pauvre homme ; l’avocat mit la main à la poche pour prendre le mémoire sur lequel il avait réglé sa cause.
– Ce pauvre homme a eu recours, dit M. Hardie, à notre remedium miserabile, vulgairement appelé une cessio bonorum, une cession de biens. De même que plusieurs gens d’église ont douté de l’éternité des chatimens à venir, ainsi les avocats d’Écosse ont pensé que le crime de pauvreté était suffisamment expié par quelques jours d’emprisonnement. Au bout d’une détention d’un mois, comme vous devez le savoir, un pauvre diable a le droit, après en avoir obtenu permission de la cour suprême, en dressant un état de son actif et un exposé de sa perte, et en abandonnant tous ses biens à ses créanciers, de demander à être mis en liberté.
– J’avais entendu parler de cette loi pleine d’humanité, dis-je au jeune avocat.
– Oui, reprit Halkit, et le plus beau de l’histoire, c’est, comme on dit, qu’on peut faire cession quand les biens sont dépensés ; – mais pourquoi fouiller dans votre poche pour chercher ce mémoire unique, parmi de vieux billets de spectacle, des lettres de convocation à la faculté, des règlemens de la Conférence Spéculative, extraits des leçons, et autres objets qui remplissent la poche d’un jeune avocat, dans laquelle il y a un peu de tout, hors des lettres de change et des billets de banque ? – ne pouvez-vous pas nous exposer une cession de biens sans votre mémoire ?– on en fait tous les samedis ; la marche de ces affaires est régulière comme celle d’une horloge. – Toutes se ressemblent.
Cela n’a aucun rapport avec les infortunes que probablement le brave homme exposa si souvent aux juges, répondis-je.
– Il est vrai, répondit Halkit ; mais Hardie parle de jurisprudence criminelle, et cette affaire est purement civile. Je pourrais plaider moi-même sur une cession de biens sans être décoré du costume inspirateur de la toge et de la perruque à trois marteaux ; – mais écoutez : – mon client, ouvrier tisserand de son métier, avait gagné quelques écus ; il prit une ferme (il en est de l’art de conduire une ferme comme de celui de mener une voiture, c’est la nature qui le donne) : – les malheurs des derniers temps – l’engagèrent à signer des lettres de complaisance à un ami qui ne lui fit pas les fonds. – Sur ce, séquestre du propriétaire ; les créanciers acceptent un arrangement. – Notre homme ouvre une auberge. – Seconde faillite ; – il est emprisonné pour une dette de 10 guinées 7 shillings, 6 pence. Son passif était zéro, ses pertes zéro, son actif zéro, – le tout formant en sa faveur une balance égale à zéro : – partant nulle opposition, et messieurs de la cour nommèrent une commission pour recevoir son serment.
Hardie renonça alors à son inutile recherche, à laquelle il avait peut-être mis un peu d’affectation, et il nous fit le récit des malheurs de ce pauvre Dunover, avec un accent de compassion et de sensibilité dont il semblait avoir honte comme indigne du métier, et qui, malgré ses prétentions à l’esprit, lui faisait cependant honneur ; c’était une de ces histoires qui semblent prouver une espèce de fatalité attachée au sort du héros. Dunover était intelligent, industrieux et sans reproche, mais pauvre et timide ; après avoir tenté vainement tous les moyens à l’aide desquels d’autres acquièrent l’indépendance, à peine avait-il réussi à se procurer de quoi vivre. Un rayon d’espérance plutôt qu’un bonheur réel ayant brillé un moment à ses yeux, il avait ajouté le souci d’une femme et d’une famille à ceux qu’il avait déjà ; mais bientôt cette lueur de prospérité s’évanouit ; tout semblait le pousser vers le bord de l’abîme qui appelle tous les débiteurs insolvables. Après s’être accroché à toutes les branches, et après les avoir vues toutes se dérober à ses efforts, il était enfin tombé dans la prison fatale, d’où Hardie l’avait retiré en sa qualité d’avocat.
– Et je suppose, dit Halkit, que maintenant que vous avez mis ce pauvre diable à terre, vous le laisserez à demi nu sur le rivage, sauf à lui à s’en tirer comme il pourra : écoutez : – et il lui murmura quelques mots à l’oreille ; intéresser milord, fut tout ce que je pus entendre.
– C’est en vérité pessimi exempli, dit Hardie en souriant, que de s’intéresser à des cliens ruinés ; cependant je pensais à ce dont vous me parlez, pourvu que cela puisse se faire ; – mais chut, le voici qui vient.
L’histoire récente des infortunes du pauvre homme lui attira (je me plaisais à l’observer) le respect et l’attention des jeunes gens, qui le traitèrent avec une grande civilité, et lièrent insensiblement une conversation qui, à ma grande satisfaction, roula de nouveau sur les causes célèbres d’Écosse. Encouragé par la bonté qu’on lui témoignait, M. Dunover commença à contribuer aux amusemens de la soirée : une prison, comme tout autre lieu, a ses anciennes traditions qui ne sont connues que de ses habitans, et qui se transmettent successivement de détenus en détenus. Une de celles que Dunover raconta était intéressante, et servit d’éclaircissemens à quelques jugemens remarquables que Hardie savait sur le bout du doigt, et que son compagnon connaissait aussi parfaitement. Ce genre d’entretien remplit toute la soirée, jusqu’à ce que M. Dunover se retira pour aller se reposer ; et moi, de mon côté, je fis retraite pour aller mettre en note ce que j’avais appris, dans le dessein d’ajouter un nouveau conte à ceux dont je m’amusais à composer un recueil ; les deux jeunes gens firent venir des rôties, du negus au vin de Madère, avec un jeu de cartes, et commencèrent un piquet.
Le lendemain les voyageurs quittèrent Gander-Cleugh ; j’appris depuis par les papiers publics qu’ils avaient figuré l’un et l’autre dans le grand procès politique qui s’éleva entre Bubbleburgh et Bitem. Cette cause aurait pu être expédiée promptement ; cependant on croit qu’elle peut durer plus long-temps que la session du parlement à laquelle elle se rapporte. M. Halkit figura en qualité d’agent ou solliciteur, et M. Hardie débuta dans la cause de sir Peter Plyem avec un rare talent, de telle sorte que depuis il eut dans sa poche moins de billets de spectacle que de brefs
Chapitre 2
« Quiconque a vu Paris doit connaître la Grève,
» Ce fatal rendez-vous des braves malheureux,
» Où maint héros souvent à la potence achève
» De ses nobles exploits le cours aventureux.
» Ici le trépas brise une chaîne importune ;
» Du juge le bourreau complète les travaux ;
» L’écuyer du poète et celui des poteaux
» Viennent pour y fixer l’inconstante fortune. »
PRIOR.
Au temps jadis, l’Angleterre avait son Tyburn ; c’était au lieu qu’on appelle aujourd’hui Oxford-Road, que l’on conduisait en procession solennelle les victimes que la justice avait condamnées. À Édimbourg, une grande rue, ou, pour mieux dire, une place en forme de carré long, entourée de maisons fort élevées, et appelée Grassmarket, était consacrée au même usage lugubre. Le local étant d’une grande étendue, et pouvant contenir le nombre considérable de spectateurs qui ne manquent jamais de s’assembler en une telle occasion, n’était pas mal choisi. D’ailleurs, les maisons qui l’entouraient n’étaient, pour la plupart, habitées depuis bien long-temps que par le peuple, de manière que les gens du bon ton, à qui ce spectacle n’inspirait que du dégoût, ou qui en étaient trop vivement affectés, ne se trouvaient pas obligés d’y assister. L’architecture de ces maisons n’offre rien de remarquable ; cependant cette place a bien aussi son caractère de grandeur, étant dominée du côté du sud par le rocher escarpé sur lequel s’élève le château, et par les remparts et les tours couvertes de mousse de cette antique citadelle.
C’était sur cette esplanade que se faisaient encore les exécutions il y a environ vingt-cinq ans. Un gibet peint en noir, élevé à l’extrémité orientale de la place, annonçait au public le jour fatal. Cet instrument de sinistre augure était d’une grande hauteur, et entouré d’un échafaud sur lequel étaient appuyées deux échelles destinées au malheureux criminel et à l’exécuteur. Tout l’appareil était disposé avant l’aurore ; on eût dit que l’enfer l’avait fait sortir du sein de la terre pendant la nuit, et je me rappelle encore l’effroi avec lequel mes camarades et moi nous voyions ces funestes préparatifs lorsque nous traversions Grassmarket pour aller à l’école. Pendant la nuit qui suivait l’exécution, le gibet disparaissait, et on le replaçait dans l’asile obscur et silencieux où il était ordinairement déposé, c’est-à-dire sous les voûtes souterraines de Parliament-House, où se tenaient les cours de justice. Aujourd’hui les exécutions se font à Édimbourg de la même manière qu’à Londres
Le 7 septembre 1736, cet appareil sinistre était dressé sur la place dont nous venons de parler, et remplie de très bonne heure de différens groupes. Tous les regards se dirigeaient vers le gibet avec cet air de satisfaction et de vengeance si rare parmi la populace, dont le bon naturel oublie le plus souvent le crime du condamné, pour ne plus s’occuper que de son infortune. L’histoire du fait qui avait donné lieu à la condamnation du coupable dont le peuple attendait l’exécution est un peu longue ; mais il est nécessaire d’en tracer au moins les principaux détails, qui ne seront peut-être pas sans quelque intérêt, même pour ceux qui en ont déjà entendu parler. D’ailleurs, ils sont indispensables pour l’intelligence des évènemens subséquens.
Quoique la contrebande sape la base de tout gouvernement légitime en diminuant ses revenus, quoiqu’elle nuise au négociant honnête, et qu’elle corrompe souvent le cœur de ceux qui s’y livrent, elle n’est pourtant pas regardée sous un jour très odieux, ni par le peuple, ni même par les gens d’une condition plus relevée. Dans les comtés d’Écosse où elle a principalement lieu, les paysans les plus hardis et les plus intelligens s’en occupent très-activement, et souvent même sont secrètement favorisés par les fermiers et par les petits gentilshommes de campagne. Elle était presque générale en Écosse sous les règnes de George Ier et de George II ; le peuple n’étant pas accoutumé aux impôts, les regardait comme attentatoires à ses anciennes franchises, et ne se faisait pas scrupule d’en éluder le paiement par tous les moyens possibles.
Le comté de Fife, bordé par deux bras de mer au sud et au nord, et par la mer du côté de l’est, avec un grand nombre de petits ports, était un des cantons où la contrebande se faisait avec le plus de succès. Il s’y trouvait beaucoup de marins qui avaient été pirates ou boucaniers dans leur jeunesse ; on n’y manquait donc pas d’aventuriers entreprenans qui s’occupaient de ce commerce. Les officiers de la douane avaient surtout les yeux ouverts sur un nommé André Wilson, autrefois boulanger dans le village de Pathhead. C’était un homme vigoureux, doué d’autant de courage que d’adresse, connaissant parfaitement toute la côte, et capable de conduire les entreprises les plus hasardeuses. Il avait souvent réussi à mettre en défaut la vigilance et les poursuites des officiers du roi ; mais il fut surveillé de si près, qu’il se trouva ruiné par plusieurs saisies successives. Cet homme devint désespéré.
Il se regarda comme volé et pillé, et il se mit dans la tête qu’il avait le droit d’user de représailles s’il en trouvait l’occasion. Celle de faire le mal ne manque jamais de se présenter quand on la cherche. Wilson apprit un jour que le receveur des douanes de Kirkaldy était en tournée à Pittenweem et qu’il avait en sa possession une somme assez considérable des deniers publics. Cette somme ne dépassait pas la valeur des marchandises qui lui avaient été saisies, et il forma le projet de s’en emparer pour s’indemniser de ses pertes aux dépens du receveur et de la douane. Il s’associa un nommé Robertson et deux autres jeunes gens qui faisaient le même métier que lui, et parvint à leur faire envisager son entreprise sous le même jour qu’il la voyait lui-même. Ils épièrent les mouvemens du receveur, forcèrent la maison où il logeait, – et Wilson monta dans la chambre avec deux de ses complices, tandis que le quatrième, Robertson, restait à la porte, avec un grand coutelas à la main, pour empêcher qu’on ne vînt à son secours. Le douanier, croyant sa vie menacée, n’eut que le temps de se sauver en chemise par une fenêtre. Wilson ne trouva donc aucune difficulté à s’emparer de près de deux cents livres sterling appartenant au trésor public. Ce vol fut commis avec une singulière audace, car plusieurs personnes passaient en ce moment dans la rue. Mais Robertson leur disant que le bruit qu’elles entendaient venait d’une dispute entre le receveur et les gens de la maison, les honnêtes citoyens de Pittenweem ne se crurent pas appelés à se mêler des intérêts de l’officier de la douane, et, se contentant de ce récit superficiel de l’affaire, passèrent leur chemin comme le lévite de la parabole. L’alarme fut enfin donnée : un détachement de soldats fut appelé, se mit à la poursuite des voleurs, leur reprit le butin, et réussit à arrêter Wilson et Robertson, qui furent mis en jugement et condamnés à mort sur le témoignage d’un de leurs complices.
Bien des gens s’imaginaient qu’attendu que ces malheureux avaient envisagé sous un faux point de vue le crime qu’ils avaient commis, on ne les condamnerait pas à la peine capitale ; mais le gouvernement jugea qu’un exemple de sévérité était indispensable. Quand on ne put douter que la condamnation à mort ne dût être exécutée, des amis trouvèrent le moyen de faire passer une lime aux prisonniers. Ils scièrent un des barreaux de fer qui grillaient leur fenêtre, et ils se seraient échappés sans l’obstination de Wilson, dont le caractère était aussi opiniâtre que résolu. Son camarade Robertson, jeune homme d’une taille déliée, voulait passer le premier, et élargir la brèche à l’extérieur pour faciliter l’évasion de Wilson, qui était puissant et chargé d’embonpoint. Celui-ci n’y voulut jamais consentir, et s’engagea tellement entre les barreaux restans, qu’il lui devint impossible de sortir de la chambre et même d’y rentrer. Il en résulta que leur tentative d’évasion fut découverte, et que le geôlier prit des mesures pour qu’ils n’en pussent faire une seconde.
Robertson ne fit pas un reproche à son camarade, mais Wilson s’en faisait assez à lui-même. Il savait que sans lui Robertson n’aurait pas commis l’action pour laquelle ils avaient été condamnés à mort, et que sans lui il se serait bien certainement échappé de prison. Des esprits comme celui de Wilson, quoique plus souvent occupés de projets criminels, sont quelquefois susceptibles de générosité. Il ne s’occupa plus que des moyens de sauver la vie de son compagnon, sans songer un instant à la sienne. Le plan qu’il adopta pour y parvenir, et la manière dont il l’exécuta, furent vraiment extraordinaires.
Près de la Tolbooth ou prison municipale d’Édimbourg est une des trois églises qui forment aujourd’hui la division de la cathédrale de Saint-Gile, et qu’à cause de son voisinage on nomme l’église de la Tolbooth. C’était l’usage que le dimanche qui précédait le jour fixé pour l’exécution des criminels condamnés à mort, on les conduisît sous bonne escorte pour les faire assister aux prières publiques. On supposait que ces malheureux, quelque endurcis qu’ils fussent dans le crime, pouvaient se laisser attendrir en se trouvant pour la dernière fois réunis avec leurs semblables pour offrir leurs hommages à leur Créateur, et l’on croyait aussi que la vue de gens qui étaient si près de paraître devant le tribunal de la justice divine pouvait inspirer des réflexions salutaires au reste de l’auditoire ; mais cette coutume a cessé d’être observée depuis l’événement que nous allons rapporter.
Le ministre qui prêchait ce jour-là dans l’église de la Tolbooth venait de finir un discours pathétique, adressé en grande partie aux deux malheureux, Wilson et Robertson, qui étaient assis sans être chargés de fers dans un banc particulier, mais placés chacun entre deux soldats de la garde de la ville chargés de veiller sur eux. Il venait de leur rappeler que la prochaine assemblée où ils se trouveraient serait celle des justes ou des méchans, que les psaumes qu’ils entendaient aujourd’hui allaient dans deux jours être remplacés pour eux par d’éternels alléluia ou d’éternelles lamentations, et que cette terrible alternative dépendrait de l’état de leur âme au moment de paraître devant Dieu ; ils ne devaient pas se désespérer d’être appelés si soudainement, mais plutôt trouver dans leur malheur cette consolation, que tous ceux qui maintenant élevaient la voix ou fléchissaient le genou avec eux, étaient frappés de la même sentence d’une mort certaine, et qu’eux seuls avaient l’avantage d’en connaître le moment précis. « Ainsi donc, mes infortunés frères, ajouta le bon prédicateur d’une voix tremblante d’émotion, rachetez le temps qui vous est laissé, et souvenez-vous qu’avec la grâce de celui pour qui le temps et l’espace ne sont rien, le salut peut encore être assuré, même dans le court délai que vous accordent les lois de votre pays. »
On observa que Robertson versa quelques larmes ; mais Wilson semblait n’avoir pas complètement compris le sens de ces paroles, ou être distrait par une tout autre pensée. – Cette expression était si naturelle dans sa situation, que personne n’en conçut de soupçon, et personne n’en fut surpris.
Dès que le ministre eut prononcé la bénédiction d’usage, chacun se disposa à sortir de l’église, en jetant un regard de compassion sur les deux criminels, sans doute à cause des circonstances atténuantes de l’affaire. Ceux-ci se levèrent ainsi que les quatre soldats qui les gardaient. Mais tout-à-coup Wilson, qui, comme je l’ai déjà dit, était un homme vigoureux, saisit au collet deux des soldats, en s’écriant : – Cours vite, Geordy, cours ! et se jetant en même temps sur un troisième, il le retint par l’habit avec les dents. Robertson fut un instant immobile de surprise ; mais plusieurs autres voix ayant crié : – Courez ! courez ! il terrassa le quatrième soldat, s’élança hors du banc et se confondit dans la foule, où il ne se trouva personne qui voulût, en arrêtant un malheureux, le priver de la dernière chance qui lui restât pour échapper à la mort. Il sortit promptement de l’église, et toutes les perquisitions qu’on fit ensuite furent inutiles.
L’intrépidité généreuse que Wilson avait déployée en cette circonstance augmenta la compassion qu’il avait déjà inspirée. L’esprit public, quand il est sans préventions, se déclare ordinairement pour le parti du désintéressement et de l’humanité : on admira donc la conduite de Wilson, et l’on se réjouit de l’évasion de Robertson. Ce sentiment était si général, qu’un bruit vague se répandit dans la ville qu’on tenterait de sauver Wilson de vive force au moment de l’exécution. Les magistrats crurent de leur devoir de prendre des mesures pour assurer le respect dû aux lois, et ils firent mettre sous les armes une compagnie de la garde de la ville, commandée par le capitaine Porteous, homme dont le nom ne devint que trop fameux par les malheureux évènemens du jour et ceux qui en furent la suite. Il est peut-être nécessaire de dire un mot de sa personne et du corps qu’il commandait ; mais le sujet est assez important pour mériter un autre chapitre.
Chapitre 3
« Ô toi, grand Dieu de l’eau-de-vie,
» Qui gouvernes cette cité
» Où l’on a vu parfois notre peuple agité,
» Protège-nous, je t’en supplie,
» Contre ces noirs bandits qu’on appelle le gué. »
FERGUSSON. Les Jours de folie.
Le capitaine John Porteous, nom mémorable dans les traditions d’Édimbourg comme dans les registres du tribunal criminel de cette ville, était fils d’un artisan qui n’avait d’autres vues sur son fils que de lui faire apprendre son métier ; mais ce jeune homme avait autant de goût pour la dissipation que d’aversion pour l’ouvrage ; il s’enfuit de la maison paternelle, et s’engagea dans le corps écossais qui fut long-temps au service de la Hollande, et appelé le corps Scoto-Hollandais. Il y apprit la discipline militaire, et étant revenu dans sa patrie en 1715, après une vie errante et oisive, il fut chargé, par les magistrats d’Édimbourg, dans cette année de troubles, d’organiser la garde de la Cité, dont il fut ensuite nommé capitaine. Il ne méritait cette promotion que par ses connaissances militaires, par un caractère intrépide et déterminé, car il passait pour un homme de mauvaise conduite, un fils dénaturé et un mari brutal. Il se rendit pourtant utile dans sa place, et il était, par sa rudesse et sa sévérité, l’effroi des tapageurs et de tous ceux qui troublaient la tranquillité publique.
Le corps qu’il commandait, composé d’environ cent vingt hommes en uniforme, est ou plutôt était divisé en trois compagnies, armées, vêtues et organisées régulièrement. La plupart étaient d’anciens soldats qui s’enrôlaient dans cette troupe, parce que, les jours où ils n’étaient pas de service, ils pouvaient travailler dans quelque métier. Ils étaient chargés de maintenir l’ordre, de réprimer le vol dans les rues, et de faire la police dans toutes les occasions où l’on pouvait craindre quelque trouble. Le pauvre Fergusson, à qui sa vie irrégulière procurait parfois de désagréables rencontres avec ces conservateurs militaires du repos public, dont il fait mention si souvent, qu’on pourrait le surnommer leur poète lauréat, avertit ainsi ses lecteurs, sans doute d’après sa propre expérience :
Bonnes gens, sur les grands chemins
Évitez cette noire garde ;
Nulle part de pareils coquins
N’ont jamais porté la cocarde.
Dans le fait, les soldats de la Garde de la Ville, étant généralement, comme nous l’avons dit, des vétérans réformés qui avaient encore assez de force pour ce service municipal, et de plus presque tous nés dans les Highlands, ni leur naissance, ni leur éducation, ni leurs premières habitudes, ne les rendaient propres à endurer avec patience les insultes de la canaille ou les provocations des jeunes étudians et des débauchés de toute espèce, avec lesquels leur emploi les mettait tous les jours en contact ; au contraire, le caractère de ces vétérans était encore aigri par les nombreux affronts de la populace, et fréquemment il y avait des motifs pour leur adresser ces autres vers plus supplians du poète déjà cité :
Soldats, pour l’amour de vous-mêmes,
Pour l’Écosse, votre pays,
N’en venez plus à ces moyens extrêmes,
Épargnez le sang de ses fils ;
Laissez un peu dormir vos hallebardes ;
Épargnez-nous, valeureux gardes,
Laissez un peu reposer vos fusils.
Une escarmouche avec ces vétérans était un des divertisse mens favoris de la populace, les jours de fêtes ou de cérémonies publiques. Bien des gens qui liront peut-être ces pages pourront sans doute encore se rappeler qu’ils furent autrefois témoins de ces scènes. Mais ce corps vénérable peut être regardé maintenant comme n’existant plus. Il a disparu peu à peu, de même que les cent chevaliers du roi Lear. Les édits de chaque nouvelle série de magistrature, tels que ceux de Gonerille et de Regane, ont diminué cette troupe après une semblable question : – Qu’avons-nous besoin de cent vingt hommes ? – Qu’avons-nous besoin de cent ? – Qu’avons-nous besoin de quatre-vingts ? – Enfin, on en est presque venu à dire : Qu’avons-nous besoin d’un seul ? – On voit bien encore çà et là le spectre d’un montagnard à cheveux gris, aux traits altérés et à la taille courbée par l’âge, couvert d’un antique chapeau à cornes, bordé d’un ruban de fil blanc au lieu de galon d’argent ; son manteau, son justaucorps et ses hauts-de-chausses sont d’un rouge sale ; sa main flétrie soutient une arme des anciens temps, appelée hache de Lochaber, c’est-à-dire une longue perche terminée par un fer en forme de hache à croc. Tel est le fantôme qui se traîne, m’a-t-on dit, autour de la statue de Charles II, dans la place du Parlement, comme si l’image d’un Stuart était le dernier refuge de tout ce qui rappelle nos anciennes mœurs. Deux ou trois autres se glissent aussi, ajoute-t-on, près de la porte du corps-de-garde qui leur fut assigné dans les Luckenbooths, quand leur ancien abri de High-Street fut démoli ; mais le destin des manuscrits légués à des amis et à des exécuteurs testamentaires est si incertain, que ces fragmens des annales de la vieille garde urbaine d’Édimbourg, qui, avec son farouche et vaillant caporal John Dhu (le plus terrible visage que j’aie jamais vu), était, dans ma jeunesse, tour à tour la terreur et la dérision des pétulans écoliers de High-School, ne verront peut-être le jour que quand tout souvenir de l’institution sera effacé. Ils serviront tout au plus d’explication aux caricatures de Kay, par qui ont été conservés les traits de quelques uns de ses héros. Dans la génération précédente, lorsque les complots et l’activité des jacobites excitaient une perpétuelle alarme, les magistrats d’Édimbourg s’occupaient de l’entretien de ce corps, malgré les élémens dont nous avons dit qu’il était composé, avec plus de zèle qu’on n’y en a mis depuis que leur service le plus dangereux n’est plus que des escarmouches avec la canaille, chaque anniversaire de la naissance du roi. Alors aussi ils étaient l’objet de plus de haine, mais de moins de mépris.
Le capitaine John Porteous attachait beaucoup d’importance à l’honneur du corps qu’il commandait. Il se trouva très mortifié de l’affront dont Wilson avait couvert les soldats qui le gardaient, en facilitant l’évasion de Robertson, et il exprima de la manière la plus violente son ressentiment contre lui. Mais quand il entendit parler de la crainte qu’on ne tentât de le sauver au moment de l’exécution, sa fureur ne connut plus de bornes, et il s’emporta en menaces et en exécrations, dont malheureusement on ne se souvint que trop. Dans le fait, si d’un côté l’activité et la résolution de Porteous le rendaient propre à commander des gardes destinés à étouffer les mouvemens populaires, il semblait en même temps peu fait pour une charge si délicate, tant à cause de son tempérament impétueux et farouche, toujours prêt à en venir aux coups et à la violence, que de son caractère sans principes. Il était d’ailleurs trop disposé à considérer la populace (qui manquait rarement de le maltraiter lui et ses soldats) comme un ennemi contre lequel il était juste de chercher une occasion de représailles : mais comme il était le plus actif et le plus dévoué des capitaines de son corps, ce fut lui que les magistrats chargèrent de commander les soldats appelés à veiller à l’ordre public pendant l’exécution de Wilson. Il fut donc mis à la tête de toute la force disponible, c’est-à-dire de quatre-vingts hommes, pour garder les alentours de l’échafaud.
Les magistrats prirent encore d’autres précautions, qui blessèrent l’orgueil de Porteous : ils requirent un régiment d’infanterie régulière d’entrer dans la ville, et de se ranger en bataille, non sur le lieu de l’exécution, mais dans la principale rue, afin d’intimider la populace en déployant une force à laquelle on ne pouvait songer à résister. Considérant combien est déchu cet ancien corps municipal, on trouvera peut-être ridicule que son officier se montrât susceptible sur le point d’honneur ; cela fut cependant. Le capitaine Porteous ne put voir sans dépit une troupe de fusiliers gallois entrer dans une ville où aucun autre tambour que les siens n’avait le droit de battre sans la réquisition ou la permission des magistrats. Comme il ne pouvait faire tomber son humeur sur ceux-ci, sa rage contre le malheureux Wilson et tous ses partisans, et son désir de vengeance, ne firent qu’augmenter. Cette agitation intérieure opéra sur sa physionomie un changement dont s’aperçurent tous ceux qui le virent dans la matinée du jour de l’exécution de Wilson. Porteous était de moyenne taille, et bien fait ; il avait l’extérieur assez prévenant, la tournure militaire, et cependant un air de douceur ; son teint était basané, son visage marqué de quelques taches de petite vérole, ses yeux plutôt tendres que menaçans. Ce matin il semblait comme possédé de quelque mauvais génie : sa démarche était incertaine, sa voix rauque, sa figure pâle, ses yeux égarés, ses discours sans suite ; et bien des gens remarquèrent ensuite qu’il avait l’air fey, expression écossaise pour désigner un homme entraîné vers sa destinée par une nécessité irrésistible.
Il faut convenir qu’il commença l’exercice de ses fonctions par un trait d’une grande inhumanité, s’il n’a pas été exagéré par l’animosité qu’on a conservée contre sa mémoire. Lorsque Wilson lui fut livré par le geôlier pour être conduit au lieu de l’exécution, il ne se contenta pas des précautions qu’on prenait ordinairement pour empêcher le criminel de s’échapper ; il ordonna qu’on lui mît les fers aux mains. Cette précaution pouvait se justifier d’après le caractère et la force du coupable, et par la crainte qu’on avait que le peuple ne fît un mouvement pour le sauver. Mais les menottes qu’on lui apporta étant trop étroites pour les poignets d’un homme aussi puissant que Wilson, Porteous employa toutes ses forces pour les serrer, et ne parvint à les faire servir qu’en soumettant le malheureux condamné à une espèce de torture. Wilson se récria contre cette barbarie, et lui représenta que la douleur qu’il lui faisait souffrir l’empêchait de se livrer aux réflexions sérieuses qu’exigeait sa situation.
– C’est bon, c’est bon ! répondit le capitaine ; vos souffrances ne dureront pas long-temps.
– Vous êtes bien cruel, répondit Wilson ; vous ne savez pas si un jour vous n’aurez point à réclamer vous-même la pitié que vous me refusez. Que Dieu vous pardonne !
Ce peu de mots, qu’on répéta bien des fois par la suite, furent la seule conversation qui eut lieu entre le capitaine et son prisonnier pendant tout le chemin. Mais ils avaient été entendus ; ils se répandirent parmi le peuple, augmentèrent l’intérêt qu’on prenait à Wilson, et excitèrent une indignation générale contre Porteous, qui, remplissant toujours avec rigueur et dureté les fonctions dont il était chargé, s’était déjà attiré la haine universelle, quelquefois à juste titre, plus souvent par suite des préventions conçues contre lui pour des torts imaginaires.
Lorsque cette marche pénible fut terminée, et que Wilson, avec l’escorte qui le conduisait, fut arrivé au pied de l’échafaud, dans Grassmarket, aucun symptôme d’insurrection ne se manifesta. Le peuple voyait ce spectacle avec plus d’intérêt qu’à l’ordinaire ; on pouvait remarquer sur plusieurs visages cette expression farouche d’indignation qui devait animer les anciens Cameroniens témoins du supplice de leurs frères exécutés sur la même place en glorifiant le Covenant. Cependant on ne tenta aucune violence ; Wilson lui-même paraissait disposé à franchir au plus tôt l’espace qui séparait pour lui le temps de l’éternité. À peine les prières d’usage furent-elles finies, qu’il se soumit à son sort, et la sentence de la loi fut accomplie.
Il était suspendu au gibet depuis plus d’une demi-heure, et ne donnait plus depuis long-temps aucun signe de vie, quand tout-à-coup une agitation soudaine se manifesta parmi le peuple, comme s’il venait de recevoir une nouvelle impulsion. On jeta des pierres contre Porteous et ses soldats, dont quelques uns furent blessés, et la populace les entoura, avec des cris, des sifflets, des hurlemens et des exclamations. Au même instant un jeune homme, portant un bonnet de matelot qui lui couvrait la moitié du visage, s’élança sur l’échafaud, et coupa la corde à laquelle Wilson était encore suspendu. Plusieurs autres le suivirent, et s’emparèrent de son corps pour l’enterrer décemment, ou peut-être pour chercher à le rappeler à la vie. Cette espèce de rébellion contre l’autorité du capitaine Porteous le transporta d’une telle rage, qu’il oublia que, n’ayant été chargé que de veiller à l’exécution de la sentence, et cette sentence ayant été exécutée, il ne lui restait qu’à se retirer avec sa troupe, sans en venir à des hostilités contre le peuple. Aveuglé par la fureur, il commanda à ses soldats de faire feu, et saisissant le fusil de l’un d’eux, il leur donna en même temps l’ordre et l’exemple, et tua un homme sur la place. Une décharge générale s’ensuivit ; six ou sept hommes furent tués, et un grand nombre blessés plus ou moins dangereusement.
Après cet acte de violence, le capitaine donna ordre à sa troupe de se retirer vers le corps-de-garde dans High-Street, et comme la populace le suivait en lui jetant de la boue et des pierres, et en le chargeant d’exécrations, la troupe fit une seconde décharge qui dispersa la multitude. Il n’est pas bien certain qu’il eût donné l’ordre de faire feu une seconde fois ; mais on le supposa, et tout l’odieux en retomba encore sur lui. En arrivant au corps-de-garde, il renvoya ses soldats, et se rendit à l’Hôtel-de-Ville, pour faire aux magistrats le rapport des tristes évènemens du jour.
Il avait eu le temps de réfléchir chemin faisant sur sa conduite, et il avait probablement reconnu que rien ne pouvait la justifier. Il s’en convainquit encore mieux par l’accueil qu’il reçut des magistrats. Il nia qu’il eût donné l’ordre de faire feu, et qu’il eût tiré lui-même sur le peuple ; et pour prouver ce dernier point, il fit examiner son fusil qui était encore chargé ; on fit entrer un mouchoir blanc dans le canon, et on l’en retira sans qu’il fût noirci ; mais des témoins déposèrent qu’il avait tiré avec le fusil d’un soldat à qui il l’avait rendu ensuite, et tous les soldats déclarèrent qu’ils n’avaient pas fait feu sans ordre. Parmi les personnes tuées ou blessées, il s’en trouvait qui n’appartenaient pas aux derniers rangs du peuple ; car quelques soldats, par humanité, ayant voulu tirer par-dessus les têtes des mutins, leurs coups avaient porté dans les fenêtres du premier étage, où se trouvaient des citoyens paisibles ; les réclamations devinrent donc générales, et le capitaine Porteous fut renvoyé devant la haute cour de justice criminelle.
La fermentation était encore au plus haut degré quand le procès commença, et le jury eut la tâche difficile de prononcer dans une affaire où il s’agissait de la vie d’un homme, sur des témoignages entièrement contradictoires. Des témoins respectables déposaient qu’ils avaient entendu le capitaine donner à ses soldats l’ordre de faire feu, qu’ils l’avaient vu prendre le fusil d’un de ses soldats, et tirer sur un homme qu’ils avaient vu tomber ; d’autres attestaient qu’ils étaient placés de manière à pouvoir entendre et voir le capitaine, qu’ils ne l’avaient ni entendu donner l’ordre de faire feu, ni vu tirer lui-même, et que le premier coup avait été tiré par un soldat qui était à côté de lui. Une partie de sa défense roulait sur l’attitude menaçante de la populace, et sur ce point les dépositions ne variaient pas moins. Suivant les uns, l’insurrection avait pris un caractère alarmant qu’on ne pouvait trop tôt réprimer ; suivant les autres, ce n’était qu’un tumulte sans conséquence, tel qu’on en voyait tous les jours d’exécution, où l’exécuteur des hautes-œuvres et tous ceux qui étaient chargés de prêter main-forte à la justice, toujours assaillis par les cris et les imprécations de la populace, étaient même exposés à recevoir quelques coups de pierres. Le verdict des jurés prouve comment ils apprécièrent tous ces témoignages. Ils déclarèrent que le capitaine Porteous était convaincu d’avoir donné l’ordre de faire feu et tiré lui-même sur le peuple, mais qu’il avait été provoqué par les pierres lancées contre lui et sa troupe. Sur cette déclaration, les lords de la cour le condamnèrent à être pendu à un gibet sur la place ordinaire des exécutions, en arrêtant que tous ses biens-meubles seraient confisqués au profit du roi conformément aux lois d’Écosse, en cas de meurtre volontaire.
Chapitre 4
« L’heure est sonnée, où donc est le coupable ? »
KELPIE.
Le jour que le malheureux Porteous devait subir sa sentence, le lieu de l’exécution, quelque spacieux qu’il fût, était rempli au point qu’on y étouffait. Il n’existait pas une fenêtre qui ne fût garnie d’un triple rang de spectateurs, dans tous les bâtimens qui en forment la circonférence, et dans ceux de la rue étroite de Bow, par laquelle la procession fatale devait passer en descendant de High-Street. L’élévation et la forme antique de ces maisons, dont quelques unes, ayant appartenu aux Templiers et aux chevaliers de Saint-Jean, offraient encore sur leur façade et leurs pignons la croix de fer de ces ordres, ajoutaient un nouvel effet à une scène si frappante par elle-même. La place de Grassmarket ressemblait à un grand lac couvert de têtes humaines, au milieu duquel s’élevait le long poteau noir et sinistre d’où pendait la corde fatale. L’intérêt qu’inspire un objet est proportionné à l’usage qu’il doit avoir et aux idées qu’il rappelle : une pièce de bois élevée en l’air et un bout de corde, choses si simples en elles-mêmes, étaient en cette occasion les causes d’une espèce de terreur solennelle.