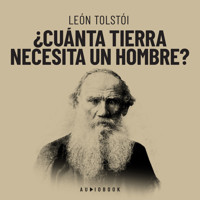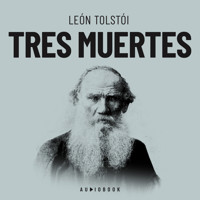1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La Sonate à Kreutzer est un roman philosophique et psychologique écrit par l'auteur russe Léon Tolstoï. L'œuvre met en lumière les thèmes de l'amour, du mariage, de la jalousie et de la moralité à travers l'histoire d'un homme tourmenté par sa relation avec sa femme. Tolstoï utilise un style narratif introspectif et moraliste pour explorer les conflits intérieurs et les dilemmes moraux de ses personnages. Ce roman s'inscrit dans le courant réaliste et moraliste de la littérature du XIXe siècle. Léon Tolstoï, célèbre écrivain, philosophe et réformateur social russe, a puisé dans sa vie personnelle et ses croyances morales pour écrire La Sonate à Kreutzer. Son expérience du mariage et son intérêt pour les questions éthiques et sociales transparaissent tout au long de l'œuvre. Tolstoï était également influencé par les idées philosophiques et religieuses de son époque, ce qui se reflète dans la profondeur des thèmes abordés dans son livre. Je recommande vivement La Sonate à Kreutzer à tous les lecteurs désireux d'explorer les questionnements existentiels et moraux de l'homme à travers une œuvre littéraire riche en symboles et en réflexions profondes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
La Sonate à Kreutzer
Table des matières
La Sonate à Kreutzer - Traduction par Isaac Pavlovsky et J.-H. Rosny aîné
Préface
J’ai reçu et je reçois encore de nombreuses lettres de personnes qui me sont inconnues et qui me demandent de leur expliquer en termes simples et clairs ce que je pense du sujet de mon récit intitulé la Sonate à Kreutzer. Je vais essayer de le faire. J’en pense ceci :
D’abord, je crois que dans notre société s’est formée une conviction stable et commune à toutes les classes, soutenue par la fausse science, que les relations sensuelles sont une chose nécessaire à la santé des hommes et par cela même excusables.
C’est pour cela que les célibataires s’adonnent à la débauche les uns devant les autres avec la conscience absolument tranquille. Certains parents, d’après le conseil des médecins, organisent la débauche pour leurs enfants, et les gouvernements dont l’unique raison d’être consiste à s’occuper du bien-être moral des citoyens sanctionnent la prostitution, c’est-à-dire régularisent toute une classe de femmes qui doivent périr corps et âme pour satisfaire les soi-disant exigences de la santé des citoyens, et je pense que c’est mal. C’est mal, parce qu’on ne peut admettre que pour la santé des uns il faille perdre les corps et les âmes d’autres, comme il ne peut pas être que pour la santé des uns il faille boire le sang des autres. Il ne faut pas céder à cette tromperie, et pour ne pas céder, il faut premièrement ne pas croire aux doctrines immorales, même si elles étaient confirmées par n’importe quelle science. Deuxièmement, il faut comprendre que c’est une lâcheté que l’entrée en relations sexuelles pour de l’argent ou gratis en s’affranchissant des conséquences, rejetant la responsabilité sur la femme ou aidant à sa perte, et c’est pourquoi les célibataires qui ne veulent pas vivre comme des lâches doivent s’abstenir à l’égard de toutes les femmes de la même façon dont ils s’abstiendraient s’il n’y avait autour d’eux d’autres femmes que leurs mères ou leurs sœurs. Et pour que les hommes puissent s’abstenir, ils doivent mener un genre de vie naturel, ne pas boire des alcools, ne pas se gaver, ne pas trop manger de viandes, ne pas éviter le travail – non pas la gymnastique, mais le travail qui fatigue et qui n’est pas un amusement. – La preuve que la continence est possible, et moins dangereuse et moins nuisible à la santé que l’incontinence, tout homme en trouvera autour de lui des centaines d’exemples. Ceci pour le primo, et secundo, je pense que dans notre société, grâce aux idées sur les relations amoureuses comme le bienfait poétique et sublime de la vie et comme condition nécessaire à la santé, l’infidélité conjugale est devenue dans toutes les classes de la société, et surtout chez les paysans, grâce au service militaire, l’acte le plus ordinaire, le plus agréable, qui enjolive la vie comme on voit cela dans les romans, nouvelles, opéras et tableaux. Je pense que ce n’est pas bien. Et comme cela ne résulte pas tant de cet instinct animal, qui naît dans l’homme pour continuer l’espèce, que de ce qu’on exalte cet instinct animal jusqu’au degré du style poétique ou de l’héroïsme, pour que cela cesse il faut que les idées sur l’amour et sur les relations corporelles se transforment, et que les hommes et les femmes soient élevés chez eux et par l’opinion publique de façon à ce qu’avant le mariage ils regardent l’amour et les relations sensuelles qui en sont la base, non pas comme un état poétique et surélevant, mais comme un état humiliant pour un homme, un état bestial. Ceci pour le secundo, et tertio, je pense que dans notre société, grâce aux idées fausses qui sont attachées à l’amour et aux relations sexuelles, la naissance des enfants a perdu son sens, et, au lieu d’être le but et la justification des relations conjugales, est devenue un empêchement pour la continuation agréable des relations amoureuses et qu’à cause de cela, en mariage et en dehors du mariage, grâce à l’immixtion immorale de la soi-disant science médicale, commence à se répandre l’emploi des moyens qui privent la femme de produire les enfants, ou bien c’est devenu une coutume (ce qui ne se voyait pas auparavant et ce qui ne se voit pas encore dans les familles patriarcales de paysans) de continuer des relations pendant la grossesse et l’allaitement.
Et ceci est très mauvais : c’est mauvais parce que ça détruit les forces physiques et surtout les forces morales de la femme, et il ne faut pas le faire, et pour ne pas le faire, il faut comprendre que l’abstinence, qui est la condition nécessaire de la dignité humaine dans le célibat, est encore plus obligatoire dans le mariage, et que la raison est donnée à l’homme non pas pour s’abaisser au-dessous du niveau de l’animal, mais pour se mettre au-dessus de lui. Quant à la destruction du fruit par la jouissance et la continuation des relations pendant la grossesse et l’allaitement, c’est dépasser l’animal dans l’animalité.
Ceci pour le tertio, et, quarto, je pense que dans notre société, où les enfants deviennent un empêchement à la jouissance, un accident malheureux ou une jouissance d’un autre genre quand on arrive à en avoir la quantité définie d’avance, ces enfants sont élevés, non pas en vue du but de la vie qu’ils ont à accomplir, mais en vue des plaisirs qu’ils peuvent offrir aux parents, et à cause de cela on les élève comme les enfants des animaux divers ; les soucis principaux des parents consistent non pas à les préparer à une activité digne d’un être humain, mais (et en ceci les parents sont soutenus par la fameuse science nommée médecine) à les gaver le mieux possible, augmenter la quantité de leur viande, augmenter leur taille, les faire propres, blancs, beaux. On les choie de toute façon ; on les lave, on les gave et on ne les fait pas travailler. Si cela ne se fait pas dans les classes inférieures, c’est par pure nécessité. Quant aux vues, elles y sont les mêmes ; et chez ces enfants trop nourris comme chez les animaux trop nourris, d’une façon extraordinairement hâtive apparaît une sensualité insurmontable torturante. Les vêtements, les lectures, les spectacles, les musiques, les danses, la nourriture sucrée, tout l’entourage de la vie depuis les vignettes jusqu’aux romans et poèmes, rallument plus encore cette sensualité, et grâce à cela les vices sensuels et la maladie deviennent des conditions ordinaires de l’âge adolescent chez les enfants des deux sexes et souvent persistent même à l’âge mûr – et ceci n’est pas bien. Il faut cesser d’élever des êtres humains comme des enfants d’animaux, et pour élever les enfants humains, il faut avoir d’autres buts qu’un corps joli et bien nourri !
Ceci pour le quarto. Cinquièmement, je pense que dans notre société, grâce à l’importance fausse qu’on attribue à l’amour sensuel, et cet état qui l’accompagne, les meilleures forces sont absorbées pendant la meilleure époque de la vie des hommes par le guet, la recherche et la possession de l’objet de l’amour, et pour l’obtenir on croit excusable même le mensonge. Pour les femmes et les jeunes filles, c’est la séduction et l’entraînement des hommes aux relations ou au mariage, et pour ce les femmes ne dédaignent pas les moyens les plus bas en imitant les modes des prostituées et en exposant des parties du corps qui provoquent la sensualité.
Et je crois que ce n’est pas bon. Ce n’est pas bon parce que arriver au but de jouir de l’amour physique, quelque poétisé soit-il, est un but animal, indigne d’un être humain, et a sa source dans cette conception de la vie brutale et animale que cette autre qu’on rencontre souvent au degré inférieur du développement, d’après laquelle une nourriture abondante et sucrée est représentée comme le plus grand bien-être et comme un but de l’activité humaine. Ce n’est pas bon et il ne faut pas le faire, et pour ne pas le faire, on doit comprendre que le but digne de l’homme, que ce soit le culte de l’humanité, de la patrie, de la science, de l’art, pour ne parler du culte de Dieu, quoi qu’il soit, si nous le croyons seulement digne d’un être humain, se trouve toujours en dehors des jouissances personnelles, et grâce à cela l’entrée, non seulement en relation amoureuse, mais même le mariage au point de vue chrétien, n’est pas rehaussement, mais chute, parce que l’état amoureux, et l’amour physique qui l’accompagne, malgré toutes les preuves du contraire en vers et en prose, ne correspond jamais à un but digne d’un homme, mais l’empêche toujours. Ceci pour le quinto.
Voilà à peu près l’essentiel de ce que j’ai pensé en concevant le sujet de ma nouvelle.
Mais, dira-t-on, si l’on admet que le célibat est préférable au mariage et que le but de l’Humanité est de tendre vers la chasteté, le genre humain périra, et si la conclusion de ces prémisses est que le genre humain s’éteindra, alors tout ce raisonnement n’est pas juste :
Mais ce raisonnement n’est pas à moi, ce n’est pas moi qui l’ai inventé. L’idée que l’homme doit tendre à la chasteté, et que le célibat est préférable au mariage, est une vérité découverte par le Christ, il y a dix-neuf cents ans, qui est écrite dans nos catéchismes et que nous confessons tous. Dans les Évangiles, il est dit clairement et sans moyen d’interprétation contradictoire que l’époux, celui qui connaîtra la vérité quand il est déjà marié, doit rester avec sa compagne, c’est-à-dire ne pas changer de femme et vivre plus chastement qu’il n’a vécu (Mathieu, Ve chapitre, 18e verset, XIXe chapitre, 8e verset) et que par conséquent le célibataire doit ne pas se marier du tout (Mathieu, XIXe chapitre, 10e et 11e versets) et que l’un, aussi bien que l’autre, en tendant vers la plus parfaite chasteté, commet un péché en regardant la femme comme un objet de jouissance (Mathieu, Ve chapitre, 28e et 29e versets). Voilà ce qu’a dit le Christ et de ceci même témoigne l’histoire de l’humanité et la conscience et la raison de chaque être humain individuellement. L’histoire nous montre un mouvement incessant et sans recul, depuis les temps les plus anciens, de l’incontinence vers la chasteté, de la confusion complète des sexes vers la polygamie et la polyandrie, et puis, de la polygamie vers la monogamie, de la monogamie incontinente vers la chasteté dans le mariage. Notre conscience confirme la même chose condamnant toujours l’incontinence en soi-même et dans les autres, et toujours approuvant la chasteté et mettant toujours plus haut l’appréciation morale d’un homme en raison de sa chasteté. La raison confirme la même chose en démontrant que la seule résolution non contraire au sentiment humain, la résolution de cette question que la terre ne soit pas trop peuplée, s’obtient seulement par la tension vers la chasteté qui est naturelle à l’homme, quoique contraire à l’animal. Et chose étonnante, le fait que les théories de Malthus existaient et existent, que la prostitution augmente de plus en plus (toute relation sexuelle sans enfantement, je ne puis la nommer que prostitution), que des millions d’enfants sont tués dans le sein de leurs mères, que d’autres millions meurent de faim, de misère, que des millions et des millions sont tués à la guerre, et que l’activité principale des États est dirigée à augmenter le plus possible la capacité de tuer les hommes, tout cela n’est pas dangereux pour le genre humain, mais dites seulement qu’il faut modérer ses passions et se contenir, et tout de suite le genre humain est en danger.
Il y a deux moyens d’indiquer le chemin à celui qui le cherche. Le premier consiste à dire : « Va vers cet arbre, de cet arbre vers un village, du village le long de la rivière, vers le tumulus, etc. »
L’autre consiste à indiquer la direction à celui qui cherche son chemin : « Va vers l’Est : le Soleil inatteignable ou une étoile t’indiqueront toujours une direction. »
Le premier moyen c’est le moyen des définitions religieuses, superficielles et temporaires.
L’autre est le moyen de la conscience intérieure d’une vérité éternelle et immuable.
Dans le premier cas on donne à l’homme certains signes d’actes qu’il doit ou qu’il ne doit pas faire, dans l’autre, on indique à l’homme un but éternel et inatteignable, mais dont il a conscience, et ce but donne une direction à toute son activité dans cette vie.
« Souviens-toi du Sabbat, circoncis-toi, ne bois pas de boissons fermentées, ne vole pas, donne la dîme aux pauvres, ne commets pas l’adultère, fais le signe de la croix, communie, etc. » Telles sont les doctrines extérieures des brahmes, des bouddhistes, des juifs, des musulmans et de notre Église qu’on appelle chrétienne.
« Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même ; comme vous voudriez que l’on agisse envers vous, agissez ainsi envers les autres. Aime ton ennemi. » Voilà la doctrine du Christ. Elle ne donne aucune indication d’acte, elle dit seulement l’idéal immuable que chaque homme voit dans son cœur aussitôt qu’il lui a été révélé. Pour celui qui confesse la doctrine extérieure, l’exécution exacte de la loi représente l’accomplissement de la perfection, et cet accomplissement arrête tout perfectionnement ultérieur.
Les Pharisiens remercient Dieu pour avoir tout accompli ; un adolescent riche a aussi tout accompli, et ils ne peuvent penser autrement. Ils n’ont pas devant eux de but vers lequel ils doivent tendre : mais pour celui qui confesse la doctrine du Christ, chaque degré de perfection atteint provoque le besoin de monter plus haut, d’où il découvre des degrés encore plus haut, et ainsi sans fin.
Le Chrétien se trouve toujours dans la situation du Publicain : il se sent toujours imparfait ; il voit devant lui le chemin qu’il doit suivre et qu’il n’a pas encore parcouru. L’homme qui confesse la loi superficielle est celui qui se trouve dans la lumière d’une lanterne attachée à un poteau, et il n’a plus où aller. L’homme qui confesse la doctrine de la conscience intérieure est semblable à celui qui porte devant lui la lanterne, sur une canne plus ou moins longue : la lumière est toujours devant lui, elle le stimule toujours à la suivre, et lui découvre toujours de nouveaux espaces éclairés qui l’attirent. On dit que l’Idéal de l’Humanité ne peut pas être la chasteté et le célibat, puisque la chasteté supprime celui qui tend à l’Idéal. On ne peut donner comme Idéal de l’Espèce humaine, sa propre suppression.
Mais l’Idéal n’est idéal que s’il est inatteignable, la possibilité de l’approcher est infinie. Ainsi est l’idéal chrétien, – la formation du royaume de Dieu, l’union de tous les vivants par l’amour. – L’idée de l’atteindre n’est pas compatible avec l’idée de la vie. Quelle vie est possible quand tous les vivants seront unis par l’amour en un seul ? Aucune ! L’idée de la vie est possible seulement dans l’effort vers l’idéal inatteignable. Mais si nous admettions même que l’Idéal chrétien de la chasteté s’est réalisé, alors nous serions arrivés à des affirmations très connues d’un côté par la religion, dont un des dogmes est la fin du monde, d’autre part, par la soi-disant science qui affirme le futur refroidissement du soleil, dont une des conséquences doit être la fin de l’espèce humaine. C’est pour cela seulement (nous autres chrétiens nous vivons dans cette contradiction effrayante, entre la réalité et notre conscience), que nous ne comprenons pas l’éternel idéal de la doctrine du Christ : les doctrines ecclésiastiques qui s’intitulent sans droit chrétiennes, ont changé cet idéal chrétien par des définitions extérieures. Elles l’ont fait à l’égard du culte, de la prédication, du pouvoir et de beaucoup d’autres choses. La même chose a été faite par l’Église pour le mariage. Le Christ, non seulement n’a jamais institué le mariage, mais, s’il faut absolument chercher des définitions extérieures, l’a nié plutôt. « Quitte ta femme et suis-moi », disait-il. Il a indiqué seulement, aux gens mariés comme aux célibataires, la tendance à la perfection qui implique la chasteté en mariage et en dehors du mariage. Quant aux Églises cherchant, malgré la doctrine du Christ, d’établir le mariage comme institution chrétienne, c’est-à-dire de définir les conditions extérieures où l’amour corporel peut soi-disant être sans péché et absolument légal, sans avoir établi de solides institutions extérieures, elles ont privé l’humanité de l’idéal conducteur du Christ. Il en est résulté que les gens de notre monde ont quitté une rive et n’ont pas abordé l’autre : ils ont perdu le véritable idéal de chasteté donné par le Christ, et c’est extérieurement seulement qu’ils ne croient pas au sacrement du mariage basé sur rien. De là ce phénomène, qui paraît d’abord étrange, que le principe de famille de la fidélité conjugale est plus solide chez les peuples qui reconnaissent des doctrines religieuses extérieures, chez le juif, chez le musulman, que chez le soi-disant chrétien. Ceux-là ont des définitions extérieures du mariage claires et précises, tandis que les chrétiens n’en ont aucune. Ce n’est que rarement qu’on fait faire par le clergé, pour une certaine petite partie des relations sexuelles qui se pratiquent en réalité, une certaine cérémonie nommée mariage ; mais, les hommes de notre société vivent pour le surplus en pleine débauche de polygamie et de polyandrie, sans se soumettre, dans leurs relations, à des règlements quelconques, et s’adonnent à cet égard à des vices sexuels convoités, et ils s’imaginent qu’ils vivent dans cette monogamie qu’ils confessent. De mariage chrétien il n’en saurait exister, ni de culte (Mathieu V, 5 à 12, et Jean IV, 21), ni de pasteurs, ni de pères de l’Église (Mathieu XXIII, 8 à 10), ni d’armée chrétienne, ni de tribunaux, ni d’États chrétiens. Et même c’est ainsi que cela s’est compris toujours par les véritables chrétiens des premiers âges et par les suivants. L’idéal du chrétien n’est pas le mariage, mais l’amour de Dieu et de son prochain, et voilà pourquoi, pour les chrétiens, les relations corporelles dans le mariage, non seulement ne peuvent être reconnues comme un état légal, juste et heureux, ainsi qu’on se l’imagine dans notre société, mais toujours une chute, une faiblesse, un péché. Le mariage chrétien n’exista jamais et ne peut être. Il existe seulement un point de vue chrétien sur le mariage. Ce point de vue est celui-ci : le chrétien, et je ne parle pas de celui qui croit l’être, parce qu’il est baptisé et communie chaque année, mais du chrétien qui se guide dans sa vie par la doctrine du Christ, ne peut envisager la relation sexuelle autrement que comme un péché, ainsi qu’il est dit par Mathieu (V, 28), – et le soi-disant rituel du mariage n’y peut changer la valeur d’un cheveu, – et jamais il ne désirera le mariage, mais cherchera toujours à l’esquiver. Mais si la vérité se révèle au chrétien dans le mariage, ou bien, s’il ne peut surmonter la faiblesse de l’amour, il entrera en relations sexuelles, sous les conditions du mariage religieux ou sans lui ; il ne peut pas faire autrement que de ne pas quitter sa femme (ou la femme son mari, s’il s’agit de la femme), il cherchera avec elle, avec la complice ou le complice de son péché, à s’en affranchir ; il tendra à la plus grande chasteté dans le mariage et vers l’idéal final, c’est-à-dire à remplacer l’amour corporel par des relations pures : voilà le point de vue chrétien pour le mariage, et il ne saurait y en avoir d’autre pour quiconque se guide, dans sa vie, par la doctrine du Christ. Pour beaucoup et beaucoup de personnes, les idées émises par moi paraîtront étranges et obscures, et même contradictoires, et elles le sont en réalité, mais pas entre elles : ces idées contredisent toute notre vie et, malgré nous, le doute nous vient sur la question de savoir qui a raison. Sont-ce les idées qui paraissent justes, ou la vie des millions de gens, la mienne entre autres ? C’est ce sentiment-là que j’ai éprouvé moi-même à un degré supérieur quand j’ai écrit ma nouvelle. Je ne m’attendais pas à ce que le cours de mes idées m’amenât où il m’a mené. J’étais terrifié par mes propres conclusions ; je voulais ne pas y croire, mais il m’a été impossible de me dérober à la raison et à la conscience, et, aussi étranges, aussi contradictoires que puissent paraître ces conclusions à toute l’organisation de notre vie, aussi contradictoires qu’elles soient à ce que j’ai pensé et dit auparavant, j’ai été obligé de les reconnaître.
Mais l’homme est faible ; il faut lui donner une tâche d’après sa force, dit-on. C’est la même chose que de dire : « Ma main est faible ; je ne puis pas tracer une ligne qui soit droite, c’est-à-dire la plus courte distance entre deux points », et voilà pourquoi, pour me rendre la tâche plus facile, je prendrai pour faire une ligne droite, comme échantillon, une ligne courbe ou brisée !
Plus ma main est faible, plus j’ai besoin d’un exemple parfait.
LÉON TOLSTOÏ.
Yasnaïa Poliana, 6 avril 1890.
I
Des voyageurs descendaient de notre wagon, d’autres y montaient à chaque arrêt du train. Trois personnes cependant restèrent, allant comme moi jusqu’à la station la plus lointaine : une dame ni jeune ni jolie, fumant des cigarettes, la figure amaigrie, coiffée d’une toque et vêtue d’un paletot mi-masculin ; puis son compagnon, un monsieur très loquace d’une quarantaine d’années, avec des bagages neufs et bien en ordre ; puis un monsieur se tenant à l’écart, de petite taille, très nerveux, entre les deux âges, aux yeux brillants, de couleur indécise, extrêmement attrayants, des yeux qui sautaient avec rapidité d’un objet à un autre. Ce monsieur, durant presque tout le trajet, ne lia conversation avec aucun voyageur, comme s’il fuyait soigneusement toute connaissance. Quand on lui adressait la parole, il répondait brièvement, d’une façon tranchante, et se mettait à regarder obstinément par la vitre du wagon.
Pourtant il me parut que la solitude lui pesait. Il semblait s’apercevoir que je le comprenais, et quand nos yeux se rencontraient, ce qui arrivait fréquemment, puisque nous étions assis presque vis-à-vis l’un de l’autre, il détournait la tête et évitait d’entrer en conversation avec moi comme avec les autres. À la tombée du soir, pendant l’arrêt dans une grande gare, le monsieur aux jolis bagages – un avocat comme j’appris depuis – descendit avec sa compagne pour boire du thé au buffet. Pendant leur absence, plusieurs nouveaux voyageurs entrèrent dans le wagon, parmi lesquels un grand vieillard rasé, ridé, un marchand évidemment, vêtu d’une large pelisse et coiffé d’une grande casquette. Ce marchand s’assit en face de la place vide de l’avocat et de sa compagne, et tout de suite entra en conversation avec un jeune homme qui semblait un employé de commerce, et qui venait également de monter. D’abord le commis avait dit que la place d’en face était occupée et le vieillard avait répondu qu’il descendait à la première station. De là partit leur conversation.
J’étais assis non loin de ces deux voyageurs, et comme le train était arrêté, je pouvais, quand d’autres ne parlaient pas, entendre des lambeaux de leur causerie.
Ils parlèrent d’abord de prix de marchandises, de commerce, ils nommèrent une personne qu’ils connaissaient tous deux, puis s’entretinrent de la foire de Nijni-Novgorod. Le commis se vanta de connaître des personnes qui y faisaient la noce, mais le vieillard ne le laissa pas poursuivre, et, l’interrompant, se mit à raconter des noces d’antan, à Kounavino, où il avait pris part. Il était évidemment fier de ces souvenirs, et croyait probablement que cela n’amoindrissait en rien la gravité qu’exprimaient sa figure et ses manières ; il racontait avec orgueil comment, étant saoul, il avait tiré à Kounavino une telle bordée qu’il ne pouvait la conter qu’à l’oreille de l’autre.
Le commis se mit à rire bruyamment. Le vieillard aussi riait en montrant deux longues dents jaunes. Leur causerie ne m’intéressant pas, je sortis du wagon pour me dégourdir les jambes. À la portière, je rencontrai l’avocat et sa dame :
– Vous n’avez plus le temps, me dit l’avocat, on va sonner le deuxième coup.
En effet, à peine eus-je atteint l’arrière du train que la sonnette retentit. Quand je rentrai, l’avocat causait avec animation avec sa compagne. Le marchand, assis en face d’eux, était taciturne.
– Et puis elle déclara carrément à son époux, dit l’avocat en souriant tandis que je passais auprès de lui, « qu’elle ne pouvait ni ne voulait vivre avec lui, parce que... »
Et il continua. Mais je n’entendis pas la suite de la phrase, distrait par le passage du conducteur et d’un nouveau voyageur. Quand le silence fut rétabli, j’entendis de nouveau la voix de l’avocat : la conversation passait d’un cas particulier à des considérations générales :
– Et après arrive la discorde, les difficultés d’argent, les disputes des deux parties, et les époux se séparent... Dans le bon vieux temps, cela n’arrivait guère... N’est-ce pas ? demanda l’avocat aux deux marchands, cherchant évidemment à les entraîner dans la conversation.
En ce moment le train s’ébranla et le vieillard, sans répondre, enleva sa casquette, se signa trois fois en chuchotant une prière. Quand il eut fini, il renfonça profondément sa coiffure et dit :
– Si, monsieur, cela arrivait également jadis, mais moins... Par le temps qui court, cela doit arriver plus souvent... On est devenu trop savant.
L’avocat répondit quelque chose au vieillard, mais le train augmentant toujours de vitesse, faisait un tel bruit de ferrailles sur les rails que je n’entendais plus distinctement. Comme je m’intéressais à ce que dirait le vieillard, je me rapprochai. Mon voisin, le monsieur nerveux, était évidemment intéressé aussi, et, sans changer de place, il prêta l’oreille.
– Mais quel mal y a-t-il dans l’instruction ? demanda la dame avec un sourire à peine perceptible. Vaudrait-il mieux se marier comme dans le vieux temps, quand les fiancés ne se voyaient même pas avant le mariage ? continua-t-elle, répondant, selon l’habitude de nos dames, non pas aux paroles de l’interlocuteur, mais aux paroles qu’elle croyait qu’il allait dire. Les femmes ne savaient pas si elles aimeraient ou seraient aimées, et elles se mariaient avec le premier venu et souffraient toute leur vie. Alors, d’après vous, c’était mieux ainsi ? poursuivit-elle en s’adressant évidemment à l’avocat et à moi ; et pas le moins du monde au vieillard.
– On est devenu trop savant ! répéta ce dernier, en regardant la dame avec mépris et en laissant sa question sans réponse.
– Je serais curieux de savoir comment vous expliquez la corrélation entre l’instruction et les dissentiments conjugaux ? dit l’avocat avec un léger sourire.
Le marchand voulut répondre quelque chose, mais la dame l’interrompit :
– Non, ces temps sont passés !
L’avocat lui coupa la parole :
– Laissez-lui exprimer sa pensée.
– Parce qu’il n’y a plus de crainte, reprit le vieux.
– Mais comment marier des gens qui ne s’aiment pas ? Il n’y a que les animaux qu’on peut accoupler au gré du propriétaire. Mais les gens ont des inclinations, des attachements..., s’empressa de dire la dame, en jetant un regard sur l’avocat, sur moi et même sur le commis qui, debout et accoudé sur le dossier de la banquette, écoutait la conversation en souriant.
– Vous avez tort de dire cela, madame, fit le vieux, les animaux, ce sont des bêtes, et l’homme a reçu la loi.
– Mais comment, cependant, vivre avec un homme, lorsqu’il n’y a pas d’amour ? dit la dame, évidemment aiguillonnée par la sympathie et l’attention générales.
– Avant, on ne distinguait pas comme cela, dit le vieux d’un ton grave, c’est maintenant seulement que c’est entré dans les mœurs. Aussitôt que la moindre chose arrive, la femme dit : « Je te lâche, je m’en vais de chez toi. » Même chez les moujicks, cette mode s’est acclimatée : « Tiens, dit-elle, voilà tes chemises et tes caleçons, je m’en vais avec Vanka, il a les cheveux plus frisés que toi ! » Allez donc causer avec elles ! Et cependant la première règle, pour la femme, doit être la crainte.
Le commis regarda l’avocat, la dame, moi-même, en retenant évidemment un sourire, et tout prêt à se moquer ou à approuver les paroles du marchand selon l’attitude des autres.
– Quelle crainte ? dit la dame.
– Cette crainte-ci : que la femme craigne son mari. Voilà quelle crainte !
– Ça, mon petit père, c’est fini.
– Non, madame, cela ne peut pas finir. Ainsi qu’elle, Ève, la femme, a été tirée de la côte de l’homme, ainsi elle restera jusqu’à la fin du monde, dit le vieux en secouant la tête si victorieusement et si sévèrement que le commis, décidant que la victoire était de son côté, éclata d’un rire sonore.
– Oui, c’est vous, hommes, qui pensez ainsi, répliqua la dame, sans se rendre et en se tournant vers nous. Vous vous êtes donné vous-mêmes la liberté ; quant à la femme, vous voulez la garder au sérail. À vous, n’est-ce pas, tout est permis.
– L’homme, c’est une autre affaire !
– Alors, d’après vous, à l’homme tout est permis ?
– Personne ne lui donne cette permission ; seulement, si l’homme se conduit mal au dehors, la famille n’en est pas augmentée, mais la femme, l’épouse, c’est un vase fragile, continua sévèrement le marchand.
Son intonation autoritaire subjuguait évidemment les auditeurs. La dame même se sentait écrasée, mais elle ne se rendait pas.
– Oui, mais vous consentirez, je pense, que la femme soit un être humain et ait des sentiments comme son mari. Que doit-elle faire si elle n’aime pas son mari ?
– Elle ne l’aime pas ! répéta orageusement le vieillard en fronçant les sourcils. Allons donc ! on le lui fera aimer !
Cet argument inattendu plut au commis et il émit un murmure approbatif.
– Mais non, on ne la forcera pas, dit la dame, là où il n’y a pas d’amour on n’obligera personne d’aimer malgré soi.
– Et si la femme trompe son mari, que faire ? fit l’avocat.
– Cela ne doit pas être, dit le vieux... Il faut y avoir l’œil.
– Et si cela arrive tout de même ? Avouez que cela arrive ?
– Cela arrive chez les messieurs, pas chez nous ! répondit le vieux. Et s’il se trouve un mari assez imbécile pour ne pas dominer sa femme, il ne l’aura pas volé. Mais pas de scandale tout de même. Aime ou n’aime pas, mais ne dérange pas la maison. Chaque mari peut dompter sa femme. Il a le pouvoir pour cela ! Il n’y a que l’imbécile qui n’y arrive pas.
Tout le monde se tut. Le commis remua, s’avança, et ne voulant pas rester en arrière des autres dans la conversation, commença avec son éternel sourire :
– Oui, chez notre patron, il est arrivé un scandale, et il est bien difficile d’y voir clair. C’est une femme qui aime à s’amuser, et voilà qu’elle a commencé à marcher de travers. Lui, est un homme capable et sérieux. D’abord, c’était avec le comptable. Le mari chercha à la ramener à la raison par la bonté. Elle n’a pas changé de conduite. Elle faisait toutes sortes de saloperies. Elle s’est mise à lui voler son argent. Lui, il la battait, mais quoi, elle devenait de pire en pire. Avec un non baptisé, avec un païen, avec un juif (sauf votre permission), elle se mit à faire des mamours. Que pouvait faire le patron ? Il l’a lâchée tout à fait, et il vit maintenant en célibataire. Quant à elle, elle traîne.
– C’est que c’est un imbécile, dit le vieux. Si, dès le premier jour, il ne l’avait laissée marcher à sa guise et l’avait bien tenue dans sa main, elle vivrait honnête, pas de danger ! Il faut ôter la liberté depuis le commencement : Ne te fie pas à ton cheval sur la grand-route. Ne te fie pas à ta femme chez toi.
À cet instant le conducteur passa, demandant les billets pour la prochaine station. Le vieux lui rendit le sien.
– Oui, il faut à temps dompter le sexe féminin, sinon tout périra.
– Et vous-même, à Kounavino, n’avez-vous pas fait la noce avec des belles ? demanda l’avocat en souriant.
– Ça c’est une autre affaire ! dit sévèrement le marchand. Adieu, ajouta-t-il en se levant. Il s’enveloppa de sa pelisse, souleva sa casquette, et, ayant pris son sac, sortit du wagon.
II
À peine le vieillard parti, une conversation générale s’engagea.
– En voilà un petit père du Vieux Testament ! dit le commis.
– C’est un Domostroy, dit la dame... Quelles idées sauvages sur la femme et le mariage.
– Oui, messieurs, dit l’avocat, nous sommes loin encore des idées européennes sur le mariage. D’abord, les droits de la femme, ensuite le mariage libre, puis le divorce, comme question non encore résolue...
– L’essentiel, et ce que ne comprennent pas les gens comme celui-là, reprit la dame, c’est que l’amour seulement consacre le mariage et que le mariage véritable est celui qui est consacré par l’amour.
Le commis écoutait et souriait, avec la volonté de se souvenir, afin d’en faire son profit, des conversations intelligentes qu’il entendait.
– Quel est donc cet amour qui consacre le mariage, dit subitement la voix du monsieur nerveux et taciturne qui, sans que nous nous en fussions aperçus, s’était approché de nous.
Il se tenait debout, ayant posé sa main sur la banquette, et évidemment ému. Sa figure était rouge, une veine se gonflait sur son front, et les muscles de ses joues tressaillaient.
– Quel est cet amour qui consacre le mariage ? répéta-t-il.
– Quel amour ? dit la dame. L’amour ordinaire entre époux !
– Et comment donc un amour ordinaire peut-il consacrer le mariage ? continua le monsieur nerveux, toujours ému, l’air fâché. Et il sembla vouloir dire quelque chose de désagréable à la dame. Elle le sentit et commença de s’émouvoir :
– Comment, mais très simplement, dit-elle.
Le monsieur nerveux saisit le mot au vol :
– Non, pas simplement !
– Madame dit, intercéda l’avocat en indiquant sa compagne, que le mariage doit être d’abord le résultat d’un attachement, d’un amour, si vous voulez, et que si l’amour existe, et dans ce cas seulement, le mariage représente quelque chose de sacré. Mais tout mariage qui n’est pas fondé sur un attachement naturel, sur de l’amour, n’a en lui rien de moralement obligatoire. Est-ce bien comme cela qu’il faut comprendre ? demanda-t-il à la dame.
La dame, d’un mouvement de tête, exprima son approbation sur cette traduction de sa pensée.
– Puis..., reprit l’avocat continuant son discours.
Mais le monsieur nerveux, se contenant évidemment avec peine, sans laisser l’avocat achever, demanda :
– Oui, monsieur, mais que faut-il entendre par cet amour qui seul consacre le mariage ?
– Tout le monde sait ce que c’est que l’amour, dit la dame.
– Et moi je ne le sais pas et je voudrais savoir comment vous le définissez ?
– Comment ? C’est bien simple, dit la dame.
Et elle parut pensive, puis :
– L’amour... l’amour, c’est une préférence exclusive d’un ou d’une à tous les autres...
– Une préférence pour combien de temps... pour un mois, pour deux jours, pour une demi-heure ? dit le monsieur nerveux avec une irritation particulière.
– Non, permettez, vous ne parlez pas évidemment de la même chose.
– Si, je parle absolument de la même chose ! De la préférence d’un ou d’une à tous les autres... Mais je demande : une préférence pour combien de temps ?
– Pour combien de temps ? Pour longtemps, pour toute la vie, parfois.
– Mais cela arrive seulement dans les romans. Dans la vie, jamais. Dans la vie, cette préférence d’un à tous les autres dure rarement plusieurs années, plus souvent plusieurs mois ou même des semaines, des jours, des heures...
– Oh ! monsieur... Mais non... non.. Permettez ! dîmes-nous tous trois en même temps.
Le commis lui-même émit un monosyllabe de réprobation.
– Oui, je sais, fit-il en criant plus haut que nous tous, vous parlez de ce qu’on croit exister, et moi je parle de ce qui est ! Tout homme éprouve ce que vous appelez amour envers chaque jolie femme, et très peu pour sa femme. C’est pour cela qu’on a fait le proverbe qui ne ment pas : « La femme d’autrui est un cygne blanc et la nôtre une absinthe amère. »
– Ah ! mais c’est terrible, ce que vous dites là. Il existe, pourtant, parmi les humains, ce sentiment qu’on nomme l’amour, et qui dure non pas des mois et des années, mais toute la vie ?
– Non, ça n’existe pas. Si l’on admettait même que Ménélas eût préféré Hélène pour toute la vie..., Hélène aurait préféré Pâris, et ce fut, c’est et sera ainsi éternellement. Et il n’en saurait être autrement, de même qu’il ne peut pas arriver que, dans un chargement de pois chiches, deux pois marqués d’un signe spécial viennent se mettre l’un à côté de l’autre. En outre, ce n’est pas seulement une improbabilité, mais une certitude que la satiété viendra d’Hélène ou de Ménélas. Toute la différence est que chez l’un cela arrive plus tôt, chez l’autre plus tard. C’est seulement dans les sots romans qu’on écrit « qu’ils s’aimèrent pour toute la vie ». Et il n’y a que des enfants qui peuvent le croire. Aimer quelqu’un ou quelqu’une toute sa vie, c’est comme qui dirait qu’une chandelle peut brûler éternellement.
– Mais vous parlez de l’amour physique... N’admettez-vous pas un amour fondé sur une conformité d’idéal, sur une affinité spirituelle ?
– Pourquoi pas ? Mais, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procréer ensemble. (Excusez ma brutalité.) C’est que cette conformité d’idéal ne se rencontre pas entre vieilles gens, mais entre de jeunes et jolies personnes ! dit-il, et il se mit à rire désagréablement. Oui, j’affirme que l’amour, l’amour véritable, ne consacre pas le mariage, comme nous sommes accoutumés à le croire, mais qu’au contraire il le ruine.
– Permettez, dit l’avocat, les faits contredisent vos paroles. Nous croyons que le mariage existe, que toute l’humanité ou, du moins, la plus grande partie, mène la vie conjugale, et que beaucoup d’époux finissent honnêtement une longue vie ensemble.
Le monsieur nerveux sourit méchamment :
– Et alors ? Vous dites que le mariage se fonde sur l’amour, et quand j’émets un doute sur l’existence d’un autre amour que l’amour sensuel, vous me prouvez l’existence de l’amour par le mariage. Mais de nos jours le mariage n’est qu’une violence et un mensonge.
– Non, pardon, fit l’avocat. Je dis seulement que les mariages ont existé et existent.
– Mais comment et pourquoi existent-ils ? Ils ont existé et ils existent pour des gens qui ont vu et voient dans le mariage quelque chose de sacramentel..., un sacrement qui engage devant Dieu ! Pour ceux-là, ils existent, et pour nous ils ne sont qu’hypocrisie et violence. Nous le sentons, et pour nous en débarrasser nous prêchons l’amour libre ; mais au fond, prêcher l’amour libre, ce n’est qu’un appel à retourner à la promiscuité des sexes (excusez-moi, dit-il à la dame), au péché au hasard de certains raskolniks. La vieille base est ébranlée, il faut en bâtir une nouvelle, mais ne pas prêcher la débauche.
Il s’échauffait tellement que tous se taisaient en le regardant, étonnés.
– Et cependant la situation transitoire est terrible. Les gens sentent qu’on ne peut pas admettre le péché au hasard. Il faut, d’une façon quelconque, régulariser les relations sexuelles, mais il n’existe pas d’autre base que l’ancienne, à laquelle plus personne ne croit. Les gens se marient à la mode antique sans croire en ce qu’ils font, il en résulte du mensonge, de la violence. Quand c’est du mensonge seul, cela se supporte aisément ; le mari et la femme trompent seulement le monde en se donnant comme monogames ; si en réalité ils sont polygame et polyandre, c’est mauvais, mais acceptable. Mais lorsque, comme il arrive souvent, le mari et la femme ont pris l’obligation de vivre ensemble toute leur vie (ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi), et que dès le second mois ils ont déjà le désir de se séparer, mais vivent quand même ensemble, alors arrive cette existence infernale où l’on se saoule, où l’on se tire des coups de revolver, où l’on s’assassine, où l’on s’empoisonne.
Tous se turent, nous nous sentions mal à l’aise.
– Oui, il en arrive, de ces épisodes critiques, dans la vie maritale !... Voilà, par exemple, l’affaire Posdnicheff, dit l’avocat, voulant arrêter la conversation sur ce terrain inconvenant et trop excitant. Avez-vous lu comment il a tué sa femme par jalousie ?
La dame dit qu’elle n’avait rien lu. Le monsieur nerveux ne dit rien et changea de couleur.
– Je vois que vous avez deviné qui je suis, dit-il subitement.
– Non, je n’ai pas eu ce plaisir.
– Le plaisir n’est pas bien grand. Je suis Posdnicheff.
Nouveau silence. Il rougit, puis pâlit de nouveau.
– Qu’importe d’ailleurs, dit-il, excusez, je ne veux pas vous gêner.
Et il reprit son ancienne place.
III
Je repris aussi la mienne. L’avocat et la dame chuchotaient. J’étais assis à côté de Posdnicheff et je me taisais. J’avais envie de lui parler, mais je ne savais pas par où commencer et il se passa ainsi une heure jusqu’à la station prochaine. Là, l’avocat et la dame sortirent, ainsi que le commis. Nous restâmes seuls, Posdnicheff et moi.
– Ils le disent ! Et ils mentent ou ne comprennent pas, dit Posdnicheff.
– De quoi parlez-vous ?
– Mais toujours de la même chose.
Il s’accouda sur ses genoux et serra ses tempes entre ses mains.
– L’amour, le mariage, la famille... tout cela des mensonges, mensonges, mensonges !
Il se leva, il abaissa le rideau de la lampe, il se coucha, s’accoudant sur les coussins, et ferma les yeux. Il demeura ainsi une minute.
– Il vous est désagréable de rester avec moi en sachant qui je suis ?
– Oh ! non !
– Vous n’avez pas envie de dormir ?
– Pas du tout.
– Alors, voulez-vous que je vous raconte ma vie ?
À ce moment passa le conducteur. Il l’accompagna d’un regard méchant, et commença seulement quand il fut sorti. Puis, pendant tout le récit, il ne s’arrêta plus une seule fois. Même des voyageurs nouveaux ne l’arrêtèrent point.
Sa figure, durant qu’il racontait, changea plusieurs fois si complètement qu’elle n’avait rien de semblable avec la figure d’avant. Ses yeux, sa bouche, ses moustaches, même sa barbe, tout était nouveau. C’était chaque fois une physionomie belle et touchante. Ces transformations se produisaient dans la pénombre, subitement, et pendant cinq minutes c’était la même face, qu’on ne pouvait comparer à celle d’avant, et puis, je ne sais comment, elle changeait et devenait méconnaissable.
IV
– Eh bien ! je vais donc vous raconter ma vie et toute mon effroyable histoire. Oui, effroyable, et l’histoire elle-même est plus effroyable que le dénouement.
Il se tut, passa ses mains sur ses yeux et commença :
– Pour bien comprendre, il faut tout raconter depuis le commencement, il faut raconter comment et pourquoi je me suis marié et ce que j’étais avant mon mariage. D’abord je vais vous dire qui je suis. Fils d’un riche gentilhomme des steppes, ancien maréchal de la noblesse, j’étais élève de l’Université, licencié en droit. Je me mariai dans ma trentième année. Mais avant de vous parler de mon mariage, il faut vous dire comme je vivais auparavant et quelles idées j’avais sur la vie conjugale. Je menais l’existence ainsi que tant d’autres gens soi-disant comme il faut, c’est-à-dire en débauché, et comme la majorité, tout en menant l’existence d’un débauché, j’étais convaincu que j’étais un homme d’une moralité irréprochable.
L’idée que j’avais de ma moralité provenait de ce que dans ma famille on ne connaissait point ces débauches spéciales si communes dans nos milieux de gentilshommes terriens, et aussi de ce que ni mon père ni ma mère ne se trompaient l’un l’autre. Par là je m’étais forgé, depuis mon enfance, le rêve d’une vie conjugale haute et poétique. Ma femme devait être la perfection accomplie, notre amour mutuel devait être incomparable, la pureté de notre vie conjugale sans tache. Je pensais ainsi, et tout le temps je m’émerveillais de la noblesse de mes projets.
En même temps, je passai dix ans de ma vie adulte sans me presser vers le mariage et je menais ce que j’appelais la vie réglée et raisonnable du célibataire. J’en étais fier devant mes amis et devant tous les hommes de mon âge qui s’adonnaient à toute espèce de raffinements spéciaux. Je n’étais pas séducteur, je n’avais pas de goût contre nature, je ne faisais pas de la débauche le principal but de ma vie, mais je prenais du plaisir dans les limites des règles de la société, et, naïvement, je me croyais un être profondément moral. Les femmes avec lesquelles j’avais des relations n’appartenaient pas qu’à moi, et je ne leur demandais pas autre chose que le plaisir du moment.
En tout cela, je ne voyais rien d’anormal ; au contraire, de ce que je ne m’engageais pas de cœur et payais argent comptant, je concluais à mon honnêteté. J’évitais ces femmes qui, en s’attachant à moi, ou en me donnant un enfant, pouvaient lier mon avenir. D’ailleurs, peut-être y eut-il des enfants ou des attachements, mais je m’arrangeais de façon à ne pas devoir m’en apercevoir...
Et vivant ainsi, je m’estimais comme un parfait honnête homme. Je ne comprenais pas que les débauches ne consistent pas seulement dans des actes physiques, que n’importe quelle ignominie physique ne constitue pas encore la débauche, mais que la véritable débauche est dans l’affranchissement des liens moraux vis-à-vis d’une femme avec laquelle on entre en relations charnelles, et moi je regardais comme un mérite cet affranchissement-là. Je me souviens que je me suis torturé une fois pour avoir oublié de payer une femme qui, probablement, s’était donnée à moi par amour. Je me suis tranquillisé seulement quand, lui ayant envoyé de l’argent, je lui ai montré que je ne me regardais comme aucunement lié avec elle. Ne hochez donc pas la tête comme si vous étiez d’accord avec moi (s’écria-t-il subitement avec véhémence) ; je connais ces trucs-là, vous tous, et vous tout particulièrement, si vous n’êtes pas une exception rare, vous avez les mêmes idées que j’avais alors ; et si vous êtes d’accord avec moi, c’est maintenant seulement ; auparavant vous ne pensiez pas ainsi. Moi non plus je ne pensais pas ainsi, et si l’on m’avait dit ce que je viens de vous dire, ce qui s’est passé ne me serait pas arrivé. D’ailleurs, c’est égal, excusez-moi, continua-t-il, la vérité est que c’est effroyable, effroyable, effroyable, cet abîme d’erreurs et de débauche, où nous vivons en face de la véritable question des droits de la femme...
– Qu’est-ce que vous entendez par la « véritable » question des droits de la femme ?
– La question de ce qu’est cet être spécial, organisé autrement que l’homme, et comment cet être et l’homme doivent envisager la femme...
V
Oui, pendant dix ans, j’ai vécu dans la débauche la plus révoltante, en rêvant l’amour le plus noble, et même au nom de cet amour. Oui, je veux vous raconter comment j’ai tué ma femme, et pour cela je dois dire comment je me suis débauché. Je l’ai tuée avant de l’avoir connue, j’ai tué la femme quand, la première fois, j’ai goûté la volupté sans amour, et c’est alors que j’ai tué ma femme. Oui, monsieur, c’est seulement après avoir souffert, après m’être torturé, que j’ai compris la racine des choses, que j’ai compris mon crime. Ainsi, vous voyez où et comment a commencé le drame qui m’a mené au malheur.
Il faut remonter à ma seizième année, quand j’étais encore au collège et mon frère aîné étudiant de première année. Je ne connaissais pas encore les femmes, mais, comme tous les enfants malheureux de notre société, je n’étais déjà plus innocent ; depuis plus d’un an déjà j’étais débauché par les gamins, et la femme, non pas quelconque, mais la femme comme une chose infiniment douce, la nudité de la femme me torturait déjà. Ma solitude n’était plus pure. J’étais supplicié, comme vous l’étiez, je suis sûr, et comme sont suppliciés les quatre-vingt-dix-neuf pour cent de nos garçons. Je vivais dans un effroi vague, je priais Dieu et je me prosternais.
J’étais déjà perverti en imagination et en réalité, mais les derniers pas restaient à faire. Je me perdais tout seul, mais sans avoir encore mis mes mains sur un autre être humain. Je pouvais encore me sauver, et voilà qu’un ami de mon frère, un étudiant très gai, de ceux qu’on appelle bons garçons, c’est-à-dire le plus grand vaurien, et qui nous avait appris à boire et à jouer aux cartes, profita d’un soir d’ivresse pour nous entraîner. Nous partîmes. Mon frère, aussi innocent que moi, tomba cette nuit... Et moi, gamin de seize ans, je me souillai et je coopérai à la souillure de la femme-sœur, sans comprendre ce que je faisais, jamais je n’ai entendu de mes amis que ce que j’accomplis là fût mauvais. Il est vrai qu’il y a dix commandements de la Bible, mais les commandements ne sont faits que pour être récités devant les curés, aux examens, et encore pas aussi exigés que les commandements sur l’emploi de ut dans les propositions conditionnelles.
Ainsi, de mes aînés, dont j’estimais l’opinion, je n’ai jamais entendu que ce fût répréhensible ; au contraire, j’ai entendu des gens que je respectais dire que c’était bien ; j’ai entendu dire que mes luttes et mes souffrances s’apaiseraient après cet acte ; je l’ai entendu et je l’ai lu. J’ai entendu de mes aînés que c’était excellent pour la santé, et mes amis ont toujours paru croire qu’il y avait en cela je ne sais quel mérite et quelle bravoure. Donc, on n’y voyait rien que de louable. Quant au danger d’une maladie, c’est un danger prévu : le gouvernement n’en prend-il pas soin ? Il règle la marche régulière des maisons de tolérance, il assure l’hygiène de la débauche pour nous tous, jeunes et vieux. Des médecins rétribués exercent la surveillance. C’est très bien ! Ils affirment que la débauche est utile à la santé, ils instituent une prostitution régulière. Je connais des mères qui prennent soin à cet égard de la santé de leurs fils. Et la science même les envoie aux maisons de tolérance !
– Pourquoi donc la science ? demandai-je.
– Que sont donc les médecins, ce sont les pontifes de la science ! Qui pervertit les jeunes gens en affirmant de telles règles d’hygiène ? Qui pervertit les femmes en leur apprenant et imaginant des moyens de ne pas avoir d’enfants ? Qui soigne la maladie avec transport ? Eux !
– Mais pourquoi ne pas soigner la maladie ?
– Parce que soigner la maladie, c’est assurer la débauche, c’est la même chose que la maison des enfants trouvés.
– Non, mais...
– Oui, si un centième seulement des efforts pour guérir la maladie était employé à guérir la débauche, il y a longtemps que la maladie n’existerait plus, tandis que maintenant tous les efforts sont employés non pas à extirper la débauche, mais à la favoriser en assurant l’innocuité des suites. D’ailleurs, il ne s’agit pas de cela, il s’agit de ce que moi, comme les neuf dixièmes, si ce n’est plus, non seulement des hommes de notre société, mais de toutes les sociétés, même les paysans, il m’est arrivé cette chose effrayante que je suis tombé et non pas parce que j’étais assujetti à la séduction naturelle d’une certaine femme. Non, aucune femme ne m’a séduit, je suis tombé parce que le milieu où je me trouvais ne voyait dans cette chose dégradante qu’une fonction légale et utile pour la santé, parce que d’autres n’y voyaient qu’un amusement naturel, non seulement excusable, mais même innocent pour un jeune homme. Je ne comprenais pas qu’il y avait là une chute, et je commençais à m’adonner à ces plaisirs (en partie désir et en partie nécessité) qu’on me faisait croire caractéristiques de mon âge, comme je m’étais mis à boire, à fumer.
Et, cependant, il y avait dans cette première chute quelque chose de particulier et de touchant. Je me souviens que tout de suite, là-bas, sans sortir de la chambre, une tristesse m’envahit si profonde que j’avais envie de pleurer. De pleurer sur la perte de mon innocence, sur la perte pour toujours de mes relations avec la femme ! Oui, mes relations avec la femme étaient perdues pour toujours. Des relations pures, avec les femmes, depuis et pour toujours, je n’en pouvais plus avoir. J’étais devenu ce qu’on appelle un voluptueux, et être un voluptueux est un état physique comme l’état d’un morphinomane, d’un ivrogne et d’un fumeur,
Comme le morphinomane, l’ivrogne, le fumeur n’est plus un homme normal, de même l’homme qui a connu plusieurs femmes pour son plaisir n’est plus normal. Il est anormal pour toujours, c’est un voluptueux. Comme on peut reconnaître l’ivrogne et le morphinomane d’après leur physionomie et leurs manières, on peut aussi reconnaître un voluptueux. Il peut se retenir, lutter, mais il n’aura plus jamais de relations simples, pures et fraternelles envers la femme. D’après sa manière de jeter un regard sur une jeune femme, on peut tout de suite reconnaître un voluptueux, et je suis devenu un voluptueux et je le suis resté.