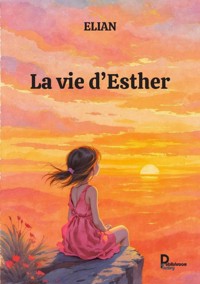
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Cette aventure a pour personnage principal une petite fille, Esther. Elle devra, pour sauver son frère d'un terrible sortilège , s'embarquer pour un long périple qui va les conduire tous les deux au cœur de l’Afrique tropicale. Sur leur route ils feront des rencontres inattendues et noueront des amitiés fortes. Ils connaitront aussi la trahison et le chagrin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
Publishroom Factorywww.publishroom.com
ISBN numérique : 978-2-38713-064-8ISBN PNB : 978-2-38713-065-5
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
La vie d’Esther
Élian
À Élise.
Table des matières
Première partie
Chapitre 1. La grippe
Ce matin, quand ma mère a ouvert les volets de ma chambre pour me réveiller, j’ai senti que je n’allais pas bien. Soit dit en passant, je n’aime pas quand elle me réveille en laissant la fenêtre ouverte comme elle le fait chaque matin. Malgré mes grognements, elle me répète chaque jour que « l’air frais du petit matin » est bon pour la santé, que cela renouvelle l’atmosphère confinée de la chambre, et patati et patata. Elle vient ensuite auprès de moi pour m’embrasser et elle ne peut s’empêcher, à chaque fois, de m’ébouriffer les cheveux. C’est vrai que mes cheveux ressemblent le matin à un plat de choucroute, mais à part mes parents et mon frère, personne d’autre ne les voit…
Pour une fois, il n’est pas utile de faire un référendum : la seule chose que tous les enfants de mon âge désirent le plus au monde à 7 heures du matin, en tout cas, un jour d’école, c’est de rester encore quelques minutes de plus sous la couette toute chaude, dans leur lit douillet, au calme.
J’entends le chant des oiseaux dans les arbres et le bruit des voitures qui filent sur la rocade, les voix de mon père et de ma mère qui discutent en bas dans la cuisine. Mon petit frère et ma grande sœur, sans doute aussi anéantis que moi à l’idée de se lever, somnolent encore dans leurs lits. J’ouvre un œil. La lumière m’aveugle, puis je distingue mes vêtements empilés la veille sur le dossier de ma chaise : c’est désespérant.
En plus, je ne me sens vraiment pas bien : j’ai mal à la tête, j’ai mal dans les muscles quand je bouge et j’ai plus froid que d’habitude.
Hier soir, pendant le souper, j’ai dit à mes parents que je n’étais pas bien. J’avais des frissons et j’étais déjà un peu courbaturée. Ils m’ont répondu que j’avais peut-être la grippe. En plus, il paraît qu’on est en pleine épidémie, alors pourquoi pas moi ? J’ai eu beau leur en parler devant mon bol de soupe, ils m’ont écoutée comme si j’étais en train de leur raconter des histoires pour ne pas aller à l’école. Les parents, ils sont toujours comme ça. Ils vous disent quand cela les arrange que la vérité sort de la bouche des enfants, mais lorsqu’on leur explique qu’on ne se sent pas prêt à faire face à deux heures de cours de mathématiques suivies de deux heures de français, ils vous regardent comme si vous vouliez tirer au flanc. C’est peut-être notre façon de formuler les choses qui ne va pas. En plus, j’ai pu remarquer que, dans de telles circonstances, il n’y a pas vraiment de solidarité entre les enfants, tout au contraire. Hier soir, pendant que je leur expliquais que je pensais être malade, j’ai surpris le clin d’œil amusé de ma sœur tandis que mon petit frère ne se gênait pas pour déclarer carrément à ma mère, me coupant la parole au passage, que je ne voulais pas aller à l’école, tout simplement. Elle est où la solidarité entre les enfants ? Ces deux-là, je les retiens…
Alors ce matin, malgré mon état déplorable – le nez qui coule, de la fièvre et mal partout – j’avais l’air d’une loque dans ma robe de chambre, mes parents ont quand même décidé de m’emmener à l’école. Ils ont eu un moment d’hésitation devant le thermomètre indiquant trente-huit degrés, mais ma mère qui est infirmière en réanimation à l’hôpital a simplement déclaré que je n’avais qu’une fébricule, et qu’avec un cachet de Doliprane, cela devrait aller. Évidemment avec une mère qui travaille en réanimation, je ne suis pas gâtée. Mais je dois reconnaître qu’elle a eu raison à cinquante pour cent, car jusqu’à midi, avec le cachet de paracétamol, tout s’est bien passé, je n’avais plus l’impression d’être malade.
C’est après la reprise des cours l’après-midi, en chimie, que cela s’est corsé. Le prof de chimie, il est marrant. Il me fait penser à un savant fou avec sa blouse pleine de taches et ses cheveux bruns qu’il passe son temps à rabattre sur son crâne tout lisse au milieu. Son nez très gros et plein de trous (en dehors des deux trous habituels pour respirer) ressemble à un cédrat et il marche bizarrement, en traînant une jambe. En plus, il s’énerve facilement et, quand il s’énerve, il devient tout rouge et on ne comprend plus ce qu’il dit ; il s’agite et tremble comme quelqu’un qui s’électrocute. Je te laisse imaginer la situation. C’est sûr, il n’aurait pas pu être prof de sport, à moins de se spécialiser dans la pétanque ou le croquet.
On faisait alors une expérience avec du soufre et de la limaille de fer. C’était chouette, en tout cas au début. On travaillait en binôme, et j’étais avec ma copine devant la paillasse. Mais quand l’odeur d’œuf pourri s’est répandue dans la pièce pendant la combustion de nos petits tas de fer et de soufre, comme des feux de Bengale, j’ai été prise de nausée et j’ai dû sortir en vitesse, direction les toilettes. Je crois que j’y ai laissé mon déjeuner, et les deux chouquettes que ma copine Anne m’avait données à la récré du matin, mais je n’ai pas vraiment pris le temps de vérifier dans le fond de la cuvette, j’étais trop mal.
Quand je suis revenue dans la salle de cours, je devais être très pâle, car le prof de physique-chimie n’a pas insisté pour que je reste. Il m’a tout de suite demandé d’aller à l’infirmerie avec ce fayot d’Auxence, le délégué de la classe. Une fois dans le couloir, il m’a dit qu’il m’enviait, parce que, vu mon état, je pourrais sans doute rater l’école une partie de la semaine. Dans le fond, je plains Auxence, parce que ses parents sont super austères, ils lui mettent une pression folle pour qu’il soit toujours le premier de la classe. C’est un garçon qui doit souffrir le week-end, alors pendant la semaine, il peut un peu respirer. En tout cas, il a eu les pétoches, Auxence, quand je me suis assise au pied des marches de l’infirmerie, parce que je ne me sentais pas bien. Il m’imaginait en train d’agoniser devant lui. Après un instant de panique, il a quand même eu la présence d’esprit d’appeler l’infirmière qui m’a aidée à m’allonger dans un lit. Il faudra que je le remercie.
L’infirmerie est située sous le toit de l’école. Le plafond est bas, les murs sont blancs comme de la farine et sur le sol il y a un carrelage clair. Contre les murs s’alignent des vitrines avec de vieux flacons, des fioles aux étiquettes jaunies, et même une énorme seringue avec une aiguille aussi grosse qu’une épingle à nourrice. Pas de quoi vous rassurer lorsque vous vous retrouvez ici. Mais l’infirmière – elle s’appelle Carole – est super chouette ; elle vient nous parler en classe et est toujours disponible quand on a des petits problèmes. Dans l’infirmerie, elle porte toujours une blouse blanche, mais dans la cour, elle ne l’a pas.
Il y a deux lits disposés dans deux pièces différentes sous le toit en pente. Carole m’a tout d’abord demandé où j’avais mal. Ensuite, elle m’a pris la température dans l’oreille et la tension en me mettant un brassard qu’elle a gonflé autour du bras. Puis, elle m’a expliqué la situation : je devais avoir la grippe, car nous étions en période d’épidémie. Je n’ai pas osé lui dire que j’avais déjà entendu parler de cette histoire et que mes parents n’avaient rien voulu entendre quand je leur avais dit que je pensais être malade.
Enfin, elle est allée fouiller dans son bureau qui se trouvait dans la pièce voisine et a consulté ma fiche avant d’appeler ma mère pour lui répéter ce qu’elle venait de me dire, si je n’avais pas d’allergie et lui dire de venir me chercher à l’infirmerie dès qu’elle le pourrait. Elle m’a expliqué quelque chose à propos de ma mère, m’avouant que son travail d’infirmière à l’hôpital ne devait pas être facile tous les jours. J’ai pensé que, de son côté, cela ne doit pas toujours être drôle d’écouter les problèmes des élèves et d’essayer d’y remédier. Enfin, elle m’a donné un médicament dilué dans un verre d’eau et m’a demandé de me reposer. Elle a tiré un store pour faire un peu d’ombre puis s’est retirée dans la pièce à côté. Par une lucarne, je voyais le ciel gris. Des mouettes passaient parfois devant en se laissant planer. J’étais bien, je n’avais pas froid, je me suis simplement endormie sans m’en rendre compte. C’est que je devais vraiment être fatiguée.
Je me suis réveillée quand j’ai entendu des voix dans la pièce voisine. Ma mère venait me chercher. Elle a parlé un instant avec l’infirmière puis elles sont toutes les deux entrées dans ma chambre. Il faisait déjà nuit.
Ma mère s’est assise sur le lit près de moi. Elle paraissait désolée. J’ai failli lui lâcher qu’elle aurait mieux fait de m’écouter le matin, lorsque je lui disais que j’étais malade, mais je me suis abstenue ; je ne voulais pas lui faire honte devant l’infirmière.
Je me suis habillée puis nous sommes parties après avoir remercié Carole. Elle est vraiment cool. Ma mère s’était garée juste devant la conciergerie, aussi je n’ai pas eu beaucoup à marcher pour y arriver.
Quand mon père est rentré le soir, il m’a regardé et m’a dit que j’avais une petite mine. Ils ont discuté avec ma mère et ont fini par décider que je resterai le lendemain à la maison. Mon petit frère faisait la tête, il était jaloux. Pour le faire enrager, je lui ai dit que je préférerais aller à l’école plutôt que d’être malade et de demeurer ici. Il ne m’a pas crue, mais au fond j’étais sincère, comme il faut toujours l’être avec son petit frère.
Je me suis couchée de bonne heure après avoir bu une infusion de tilleul avec une cuillère de miel. Dans mon lit, je grelottais. Pierre est venu me voir. Il semblait inquiet. Il m’a demandé si j’avais mal. Je l’ai rassuré en lui certifiant que j’allais bientôt guérir. Ma grande sœur Camille a glissé sa tête dans l’embrasure de la porte pour me souhaiter bonne nuit. Un peu plus tard, mon père m’a dit qu’il rentrerait demain en début d’après-midi, et qu’il faudrait que je reste seule avec le chien demain matin. Ma mère est ensuite venue me souhaiter bonne nuit après m’avoir expliqué que les parents de Anne, ma copine de l’école, lui passeront les cours que j’allais manquer. Elle a toujours l’esprit pratique, ma mère. Mon père est plus rêveur, plus tête en l’air. C’est étonnant comme ils sont différents.
Le lendemain matin, quel bonheur ! Ma mère m’a laissée tranquille, elle n’a pas ouvert les volets. Bien au chaud dans mes couvertures, je l’ai entendue ouvrir les volets dans la chambre de Camille et de Pierre ; je les ai entendus grogner tous les deux. Un peu plus tard, mon père est entré dans ma chambre et a posé sa main sur mon front. Il m’a dit qu’il avait neigé cette nuit, puis il m’a demandé si j’avais bien dormi. J’ai pris une voix de mourante pour lui répondre : il faut toujours s’adapter aux circonstances. J’avais bien trop peur qu’on change d’avis à mon sujet. J’ai perçu les cris de joie de Pierre quand il a vu la neige par la fenêtre.
Lentement, la maison s’est vidée. Camille est partie la première, puis ma mère avec mon frère et enfin mon père. De la porte d’entrée, il m’a rappelé qu’il rentrait tôt. L’instant d’après, sa voiture s’éloignait dans le chemin en faisant crisser les graviers.
Je me suis étirée dans mes draps. D’habitude, même le week-end, il y a toujours quelqu’un pour me réveiller. C’est souvent mon petit frère qui vient me rendre visite dans ma chambre et se glisser sous mes draps en rigolant, car il ne peut pas supporter d’être le seul à être réveillé. Ce jour-là, je n’avais pas besoin de m’habiller, je pouvais rester en pyjama toute la journée ou rester allongée dans mon lit. Malgré cela, je me suis levée, puis j’ai enfilé ma robe de chambre accrochée sur le radiateur de la salle de bains. J’en ai profité pour faire une grimace à la fille qui me regardait dans le miroir.
Dans la cuisine, mon bol de céréales m’attendait avec un mot de maman pour me dire ce qu’il y avait à manger pour midi. Mon petit frère avait dessiné un cœur au bas du mot. Je l’aime beaucoup, Pierre, même si parfois il est un peu lourd. Je crois que les filles grandissent un peu plus vite que les garçons ; en tout cas, c’est ce que disent souvent les adultes quand ils parlent entre eux. Je n’ai pas le souvenir d’avoir été aussi idiote que lui lorsque j’avais son âge, mais peut-être qu’on oublie ces choses-là.
Ma chienne Dolly a dû sentir qu’il y avait encore quelqu’un dans la maison, parce qu’elle est venue derrière la porte de l’entrée pour aboyer avec insistance. Au concours des chiens têtus, je suis certaine qu’elle monterait sur le podium. J’ai fini par lui ouvrir.
Dans la cuisine, elle a posé sa tête sur ma cuisse. Ses petits yeux noirs larmoyants semblaient m’implorer comme si elle mourait de faim. Elle est pourtant grosse comme une saucisse. Je lui ai donné un morceau de biscotte qui traînait sur la table, avec un peu de beurre dessus. Elle a paru satisfaite, j’ai eu l’impression qu’elle me souriait.
Elle a quatre ans. Je me rappelle quand papa l’a ramenée à la maison. C’était pendant la période de Noël. Comme elle venait d’un élevage, elle était très sauvage. Elle a commencé par se précipiter dans un casier vide de la bibliothèque dans la salle et est restée là pendant plus d’une heure. Elle reniflait partout et ressemblait à une pelote de laine blanche avec deux gros yeux de peluche noirs au milieu. Elle était tellement farouche, qu’elle grognait en retroussant ses babines et en montrant ses crocs quand on voulait l’approcher. Au début, nous avions l’interdiction de la toucher, car elle aurait pu nous mordre. Au fur et à mesure, elle s’est habituée à nous.
Je me souviens d’un jour où nous avons bien ri, quand papa, installé dans le canapé avec son journal, l’a posée sur son ventre. Elle a montré les crocs quand il a voulu la remettre sur le sol, il n’osait plus la toucher. C’était marrant de voir mon père terrorisé par une si petite boule de poils aussi teigneuse. Heureusement, elle a très vite changé, elle est devenue câline et adore les enfants, elle a vite oublié la dure vie du chenil. Jamais plus elle ne montre les dents. Elle adore aller avec maman ou Camille à l’école pour récupérer Pierre, parce qu’elle sait qu’elle aura des caresses, voire peut-être un morceau de gâteau.
Après le petit déjeuner, je me suis installée dans le canapé, sous le plaid. Dolly est venue poser son museau devant moi, puis voyant que je ne réagissais pas, elle est montée sur le canapé et s’est allongée sur le plaid, sa tête posée près de la mienne. Elle doit sentir que je suis malade. On a toutes les deux regardé la terrasse toute recouverte de neige. Des merles et des grives sautillaient autour des pommiers. Ils grattaient la neige de leurs pattes frêles pour découvrir les pommes enfouies sous la neige. Dans le saule près de la terrasse, deux mésanges s’accrochaient aux mailles d’un filet qui contenait des graines. C’est maman qui l’a attaché là, pour nourrir les oiseaux l’hiver et pour qu’on puisse les observer du salon.
Il n’y avait pas un souffle de vent. Les flocons tombaient en ligne droite et aucune branche ne bougeait. Si je n’avais pas été malade, je serais allée jouer dehors, faire de la luge ou construire un bonhomme de neige en lui enfilant le bonnet et l’écharpe de Pierre. J’imagine déjà la tête qu’il ferait, mon petit frère. À l’école, les copains ont dû s’amuser à se lancer des boules de neige dans la cour pendant la première récré.
Soudain, les oreilles de Dolly se dressèrent et elle se mit à grogner. Elle descendit du canapé et s’avança vers la baie vitrée où elle commença à aboyer comme une folle tout en courant d’une fenêtre à l’autre. Je finis par comprendre pourquoi : le chat du voisin, un vicieux celui-là, un chat tout roux avec une patte blanche, défilait tranquillement devant la terrasse sous les petits yeux de Dolly. Sans aucune appréhension, il s’arrêta et la nargua en faisant calmement sa toilette devant elle, séparé d’elle par la vitre. La vie de Dolly serait plus ennuyante si ce chat n’était pas là. Papa l’a surnommé son vieux copain. N’empêche que quand il le peut, il lui vide sa gamelle. Cette fois-ci, elle était vide, mais il alla quand même la renifler, histoire de lui montrer qu’elle ne l’impressionnait pas du tout.
Dolly était folle de rage, elle faisait les allers-retours entre la vitre et le canapé. Je n’avais pas besoin de connaître le langage canin pour comprendre ce qu’elle voulait me dire : « Ouvre-moi donc cette porte pour que je fasse goûter à ce mangeur de souris ce qu’il en coûte de venir ainsi me défier sur mon territoire. » Je me levai et allai lui ouvrir la fenêtre coulissante de la baie vitrée. Mais comme à chaque fois, ce fut la même chose, le chat courut vers le grillage puis en un bond, sauta dans le terrain du voisin tandis que la pauvre Dolly s’élançait comme une furie à sa poursuite. Je rigolai en la voyant se jeter contre le grillage et faire tomber des branches des arbres qui s’appuyaient dessus un paquet de neige. Alors, effrayée par cette avalanche inattendue, elle partit en hurlant dans la direction opposée, oubliant le chat. Dolly, malgré toutes les apparences, n’est pas très courageuse…
Après cela, je n’ai plus eu envie de retourner dans le canapé, mais je ne savais pas quoi faire. Il y avait près de moi, contre la porte vitrée, un grand coffre d’osier qui contient les jouets de Pierre. C’est un peu son coffre au trésor. Il déteste nous voir regarder ce qu’il y a dedans, peut-être parce qu’il craint que, Camille et moi, on reconnaisse certains de nos vieux jouets et qu’on les lui réclame. Je m’assis devant et soulevai le couvercle après avoir retiré le loquet métallique. Des figurines et des briques Lego par centaines, des toupies, un pirate en plastique, un porte-monnaie en tissu, une épée en bois, quelques cartes à jouer, des billes, de la pâte à modeler, un bloc-notes, une paire de lunettes aux verres teintés en rouge, un harmonica, une petite trousse à outils, un vieux doudou… C’étaient les premiers jouets que j’aperçus avant même de farfouiller dans le coffre. J’en reconnaissais certains qui m’avaient appartenu. J’allais plonger une main dans le tas de jouets, mais j’hésitai puis je renonçai. Je me dis que Pierre ne serait pas content de voir que moi, Sarah, sa sœur préférée de deux ans son aînée, je profitais de son absence, je trahissais sa confiance pour fouiller dans son coffre à trésors. Je rabattis le couvercle du coffre et remis le loquet dans sa position initiale, puis me tournai vers le piano. Ma grande sœur Camille aime bien en jouer quand elle rentre. Une partition était ouverte sur le chevalet. Moi aussi, je sais en jouer, mais beaucoup moins bien qu’elle. Mes parents lui font faire deux heures de piano par semaine et elle joue du piano tous les week-ends. Je ne suis pas aussi mordue qu’elle.
Chapitre 2. La fille au chapeau de paille
Je me tourne vers la bibliothèque. Mes parents ont plein de livres, des romans, des recueils de poésie, des livres de peinture, des bandes dessinées, et aussi plusieurs dictionnaires. Il y a une pochette de papier Canson posée sur le bord d’une niche. Je prends une feuille vierge et la dépose sur le bureau, trouve un crayon à papier dans une trousse ainsi qu’une boîte de crayons de couleur puis m’installe sur une chaise. Je reste ainsi un moment à réfléchir à ce que je vais dessiner. Je ne sais pas si c’est votre cas, mais j’ai souvent beaucoup de mal à commencer un dessin. Je cherche des idées, mais elles ne viennent pas. Papa dit qu’il ne faut pas s’obstiner, qu’il faut tâcher de penser à autre chose. C’est comme les mots dont on ne se souvient pas, mais qu’on a au bout de la langue : plus on insiste, et moins ils viennent. Ce n’est que quand on pense à autre chose qu’on finit par s’en souvenir. Le plus simple, c’est de prendre un modèle.
Dolly est à la fenêtre et aboie pour rentrer. Je me lève pour lui ouvrir et reste là, debout au milieu du salon à réfléchir à mon dessin. Enfin, mon regard tombe sur les livres de peinture. Parfois, papa me montre des peintures qu’il aime bien, il m’explique ce qu’elles veulent dire ou pourquoi il aime particulièrement certaines œuvres. Je l’écoute pour lui faire plaisir, mais c’est très vite assez barbant. Je ne lui dis pas, mais à mon air, il doit le deviner. D’ailleurs, il ne me fait voir qu’une ou deux peintures à la fois. Je m’agenouille pour regarder les titres. Il y a un gros livre sur la troisième étagère à partir du bas à gauche qui porte le nom de Raphaël. Il ne me l’a jamais montré, celui-là. Il doit pourtant y être depuis longtemps, car il est couvert de poussière.
Je l’ouvre en grand devant moi sur la table. Il y a beaucoup de dessins au crayon, des angelots et des vierges, de nombreux croquis, et même des photos de fresques murales. Je tourne les pages pour chercher ce qui me conviendrait le mieux comme modèle et je tombe sur une photographie en couleur de petit format. Il s’agit d’un portrait, une fille qui semble être un peu plus jeune que moi. Elle se tient debout dans un jardin, devant un parterre de fleurs blanches. Elle porte une robe bleu clair et un chapeau de paille assez large, tient contre elle une fleur et sourit. Elle a l’air sage. À ses vêtements tout à fait démodés, j’en déduis que cette photographie doit dater de l’époque de mes parents, quand ils étaient eux-mêmes enfants. Je ne connais pas cette petite fille, mais j’ai la vague impression qu’elle me rappelle quelqu’un, par certains de ses traits, l’ovale de son visage, la forme de ses yeux et de son nez. L’endroit aussi évoque un lieu qui m’est familier. En tout cas, ce portrait me convient comme modèle.
Je cale donc la photographie contre une trousse et commence à reproduire les différents éléments du décor après avoir tracé au milieu de la feuille une esquisse de la petite fille au chapeau de paille. Pour rendre l’apparence des fleurs en arrière-fond, j’ai envie d’utiliser de l’aquarelle, mais je n’ai pas le bon papier ; celui-ci va gondoler. Je décide de me focaliser dans un premier temps sur le portrait, on verra ensuite pour le décor. Tout d’abord, la forme générale du corps, puis la silhouette s’affine progressivement avec mes coups de crayon à papier. Je termine par les plis de la robe et par préciser des détails. Finalement, après bien des efforts, je suis assez contente de moi. J’aimerais bien te montrer ce dessin auprès de son modèle, je suis sûre qu’il te plairait à toi aussi.
J’abandonne enfin la pochette Canson sur une étagère avec mon dessin dessus et range le livre à sa place après y avoir réinséré la photographie.
Dolly me regarde au travers de la vitre. Avec ses petits yeux larmoyants, elle sait y faire pour vous faire pitié ; elle n’a pas besoin de la parole pour se faire comprendre. Je lui ouvre la porte-fenêtre puis mets de l’eau à chauffer dans une casserole. Lorsqu’elle commence à bouillir, je jette dessus quelques feuilles de verveine citronnelle. Doucement, elles s’étalent sur l’eau chaude, s’aplatissent tandis que l’eau prend la couleur vert-jaune de l’infusion et que se dégage cette odeur agréable qui fait penser à celle du citron. Dès qu’on pénètre dans la cuisine, on sent Dolly intéressée. Lorsque je suis dans le salon, elle reste couchée sur le tapis, sans se préoccuper de ma personne, mais dès qu’elle m’aperçoit dans la cuisine, elle vient vite voir ce qu’il s’y passe. La cuisine, c’est sa caverne d’Ali Baba. Elle y trouve toujours quelque chose à se mettre sous la dent.
Je verse l’infusion dans un bol, puis laisse couler dedans une cuillère à café de miel. Dolly a senti l’aubaine : elle place délicatement sa caboche sur ma cuisse et me regarde avec ses grands yeux larmoyants. Je finis par lui céder, car elle est pleine de ressources, et si je ne satisfais pas ses caprices, elle se met à couiner, puis finit par poser ses deux pattes sur la table. Je lui fais donc lécher ma cuillère de miel, mais elle n’aura rien d’autre.
Le tilleul m’a réchauffée. Maman m’a recommandé de faire mes devoirs, mais je n’en ai pas du tout envie. Je balaie bien vite loin de mon esprit cette idée farfelue. Maman est vraiment très pointilleuse sur les devoirs. Parfois, je me demande si je ressemblerai à ma mère lorsque je serai grande.
Tout ce calme autour de moi est tellement inhabituel que je me sens toute drôle, et même un peu inquiète. Je décide de retourner dans le canapé, sous le plaid avec mon chien à côté de moi. Dehors, les flocons tombent encore, comme au ralenti, et leur chute en douceur entraîne inexorablement la chute de mes paupières. Je ferme les yeux ; plusieurs fois, je me réveille, mais le sommeil s’empare de moi et je me laisse emporter, la tête calée contre un coussin, le corps tiède de mon chien tout contre moi.
J’ai dû dormir plusieurs heures, car je suis réveillée en sursaut par le bruit de la clé dans la serrure puis la porte qui s’ouvre et la voix de mon père dans l’entrée. Il m’appelle, je lui réponds encore assoupie. Dolly a bondi dès le crissement des graviers dans la cour, elle fête son retour et l’empêche de délacer ses chaussures en lui tournant autour. Mon père s’approche de moi, s’assied au bord du canapé et me regarde sans parler avant de me déclarer qu’il me trouve meilleure mine.
Papa travaille dans un laboratoire. Il fait de la recherche sur ce qu’il appelle « la mécanique des fluides ». Je n’ai jamais vraiment saisi en quoi cela consiste. Un jour, il a voulu m’expliquer cela simplement en me disant que la mécanique des fluides est un domaine de la physique et des mathématiques qui cherche à comprendre comment se comportent la purée, l’eau, le miel liquide, la pâte à tartiner ou le dentifrice dans certaines conditions expérimentales. À cette époque, il fallait que je rende un texte décrivant le métier de mes parents. Pas facile quand on a sept ans de résumer cela en une ou deux phrases. Après mûre réflexion, j’ai donc finalement écrit dans mon cahier que mon père s’intéressait au miel, à l’eau et au dentifrice. Dans le fond, je ne vois pas l’intérêt à mettre le miel ou la pâte à tartiner dans des équations compliquées quand il suffit simplement de les étaler sur une tranche de pain pour les savourer en toute tranquillité, sans se torturer l’esprit. Mais les adultes aiment bien s’entortiller le ciboulot.
Il m’a emmenée une fois dans son laboratoire, il n’y a pas très longtemps. C’était un peu une exception parce qu’il paraît qu’il faut demander une autorisation spéciale avant de pouvoir y entrer. J’y ai rencontré des gens bizarres qui se promènent en blouse blanche avec des badges et qui ont l’air de toujours se tracasser. Quand ils marchaient dans le couloir, ils couraient presque ; j’avais l’impression qu’ils avaient une grosse envie à satisfaire. S’il faut travailler autant à l’école pour avoir aussi des tracas plus tard, je préfère lever le pied sur les devoirs. Pourquoi s’embêter à l’école si c’est pour avoir des ennuis plus tard ? J’en ai parlé aux copains et ils sont tous d’accord avec moi, sauf Auxence, bien entendu. J’avoue quand même que, ce qui est chouette au laboratoire, c’est qu’ils peuvent manger des friandises et boire du café toute la journée devant leurs ordinateurs ou afficher les photos des copains sur leur bureau. J’aimerais bien pouvoir faire pareil à l’école…
Au laboratoire où travaille mon père, il y a des pièces pleines d’instruments bizarres où ils font des expériences des journées entières en restant assis sur la même chaise. Mon père m’a même raconté qu’il y a des chercheurs qui se posent une question et mettent trois ans ou plus à y répondre ; on les appelle les thésards. J’aimerais bien en rencontrer un pour voir à quoi ils ressemblent. Je me demande bien quel genre de question cela doit être pour mériter trois années de réflexion. Ce n’est sans doute pas une question du genre : comment couper une tranche de saucisson ?
Mon père est un grand rêveur, capable de partir travailler avec ses chaussons, comme cela lui est déjà arrivé. Vous pouvez lui parler, il semble vous écouter avec attention, mais si vous lui demandez de répéter ce que vous venez de lui dire, il ne sait pas toujours trop quoi répondre. Mais il faut bien le connaître pour s’en apercevoir parce qu’il a pourtant vraiment l’air de vous écouter. À la maison, il ne parle jamais de son travail, contrairement à maman qui nous raconte toute sa journée. Je suis certaine que même le soir, quand mes parents sont couchés, maman parle encore à papa de sa journée de travail. En tout cas, ils sont tous les deux très différents : maman est beaucoup plus pratique – en fait, je crois qu’on dit pragmatique – tandis que papa est dans la lune. Mais pour cela, on ne dit pas lunatique. Lunatique, c’est autre chose. C’est très bien comme cela que mes parents ne se ressemblent pas côté caractère, parce qu’il paraît que c’est l’idéal dans un couple d’être complémentaire. Enfin, c’est ce que disent les grandes personnes. Moi, à l’école, je m’entends plutôt bien avec les filles ou les garçons qui me ressemblent. En y réfléchissant bien pourtant, je reconnais que j’ai aussi des amis qui ne me ressemblent pas du tout.
Il est midi. J’ai mis la table pendant que papa s’occupait de réchauffer le repas.
Nous avons mangé en parlant des prochaines vacances de Noël. Papa m’a dit que ses parents venaient passer quelques jours à la maison. Je suis contente, parce qu’ils vont débarquer avec mon cousin Édouard qui a mon âge. La dernière fois qu’il est venu à la maison, c’était l’été dernier. Nous avons fait alors des promenades à vélo et maman nous a accompagnés à la piscine en plein air plusieurs après-midis d’affilée. C’était génial. On a même rencontré des copains de l’école qui sont venus manger à la maison. Le soir, on dormait dans la même chambre (pas dans le même lit bien sûr) et on parlait jusqu’à minuit. Édouard a une année de plus que moi. La dernière fois qu’il est venu, il a enfoncé dans la serrure une boulette de mouchoir en papier pour que mes parents ne voient pas la lumière de la lampe de chevet. On a bien rigolé une bonne partie de la nuit, jusqu’à ce que ma mère débarque en robe de chambre, ce qui a pas mal refroidi l’atmosphère.
Après avoir mangé et débarrassé la table, papa s’est chauffé un café puis est venu s’asseoir dans le canapé. Il ne neigeait plus depuis quelques heures, et la neige sur la terrasse avait déjà en partie fondu. Je suis allée m’habiller dans ma chambre, parce que j’avais un peu honte de rester en pyjama toute la journée.
En me voyant revenir, papa m’a demandé ce que j’avais fait pendant la matinée. Je lui ai répondu que j’avais un peu dormi, je lui ai raconté la scène du chat, ce qui l’a fait bien rire, puis je lui ai dit que j’avais dessiné un portrait. Papa aime bien me regarder dessiner ; ce n’est pas pour me donner des conseils, mais c’est simplement par plaisir. Une fois, maman nous a dit que papa est un contemplatif. Je ne sais pas trop bien ce que cela signifie, mais je crois que cela doit correspondre un peu à cela. Il m’a demandé de lui montrer le dessin. En revenant avec, je me suis dit que j’aurais dû lui parler de la photographie avant, mais c’était déjà trop tard.
Je lui ai passé mon portrait. Dans l’autre main, il tenait sa tasse de café. Il a regardé quelques secondes le dessin. Les traits de son visage ont alors complètement changé. Il est devenu pâle, le sourire qu’il avait juste avant s’est évanoui. Même, il a failli renverser sa tasse de café sur son pantalon. Il s’est tourné vers moi et m’a demandé :
— Où as-tu pris le modèle ?
— Je l’ai trouvé dans l’album sur le peintre Raphaël.
Alors il est devenu très sérieux, comme jamais je ne l’avais vu. Son menton tremblait un peu et cela m’a donné à moi aussi la bête envie de pleurer. Il lui a fallu un peu de temps pour se reprendre. Il est allé mettre sa tasse dans l’évier, il a bu un grand verre d’eau. Je l’ai entendu renifler. Je crois bien qu’il pleurait. Je ne pensais pas qu’un papa pouvait pleurer à cause d’une chose aussi petite qu’un dessin. Je me sentais vraiment très bête.
Quand il est revenu, son visage avait repris une apparence plus habituelle, un petit sourire était réapparu. Cela m’a rassurée. Il s’est assis auprès de moi et m’a regardée sérieusement, puis il m’a dit :
— Je vais te raconter une histoire, ou plutôt un secret, un grand secret qui doit le rester. Seuls tes grands-parents sont au courant de cette histoire, mais même eux n’en parlent jamais et, en aucun cas, il ne faudra la répéter ; en aucun cas, il ne faudra m’interrompre dans mon récit.
J’acquiesçai de la tête. Malgré lui, ses yeux s’étaient remplis de larmes. Son menton s’était remis à trembler, à se tordre. C’est ainsi qu’il commença son histoire.
Chapitre 3. Esther
— La petite fille que tu as dessinée ce matin est ma sœur Esther. Oui, je sais. Tu es étonnée parce que tu croyais que je n’avais ni frère ni sœur, tu pensais que j’étais fils unique. En vérité, cela n’est pas tout à fait exact.
J’avais alors à peu près ton âge quand cette photographie a été prise dans le jardin de tes grands-parents. Oui, j’avais environ onze ans. Le parterre de fleurs que tu as vu en arrière-plan sur la photographie était alors situé à l’abri du vent, au calme derrière une haute haie, et il y faisait bon dès les premiers jours du mois de mai. Esther avait l’habitude d’apporter une grande couverture et l’étalait sur l’herbe puis se mettait à lire ou à rêver. Cet endroit a un peu changé avec les années. Il y a maintenant des pieds de groseilliers où vous allez en cachette avec Pierre pour vous régaler lorsque les grappes de groseille sont bien rouges. La grande haie a été abattue depuis des années, car des maisons ont été construites dans le champ derrière. À présent, il y a un mur, une route de l’autre côté, et les toits de maison à perte de vue ; la ville est venue jusqu’ici. Quand j’avais ton âge, c’était la campagne…
J’ai passé mon enfance dans cette maison, avec ma sœur Esther, de trois ans ma cadette.
Les premiers souvenirs que j’ai d’elle restent très flous. Je me souviens de la nuit où, maman, ta grand-mère est allée dormir à l’hôpital, car elle était prête à accoucher. Ton grand-père l’a accompagnée au milieu de la nuit, puis il est revenu à la maison pour rester avec moi. À la maternité, on a prévenu mon père que l’accouchement n’aurait sans doute lieu que pendant la matinée. Je n’avais alors que trois ans. J’ai dormi cette nuit-là dans le lit de mes parents. Pendant la nuit, j’ai été réveillé par quelque chose qui pesait sur mes jambes. J’ai tout de suite pensé à Barbériborubéra, le nain au gros grelot grenat ou à un gnome de cette espèce et n’ai pas eu le courage de bouger pendant quelques minutes. J’étais vraiment tétanisé de terreur, n’osant réveiller mon père pour lui demander de me protéger contre le monstre au pied du lit. Les enfants se font parfois des idées de choses si simples. En réalité, c’était mon chat, un beau chartreux qui revenait tout juste de sa promenade nocturne. Je m’en suis aperçu lorsqu’il s’est mis à faire sa toilette tout en ronronnant.
Le lendemain, dans l’après-midi, je découvrais un petit être tout rose dans une grande boîte en plastique transparent. Par la fente de ses petits yeux, Esther explorait déjà le monde qui se tenait là tout prêt d’elle, dont elle n’était séparée que par les parois de sa couveuse. Ses doigts étaient si fins qu’ils en étaient presque translucides ; ses mains n’étaient pas plus grandes qu’une cuillère à café et ses pieds auraient aisément été chaussés avec des chaussures de poupée. De son petit corps fragile, des capteurs étaient reliés par des fils à différents instruments empilés sur un charriot à côté de la couveuse. Esther pesait près de six cents grammes à la naissance ; elle était née prématurée, ce qui signifie qu’elle était née avant le terme prévu. Les médecins s’étaient tout d’abord montrés réservés sur son sort, car Esther était une grande prématurée. Imagine donc qu’un enfant pèse environ trois kilos cinq à la naissance, alors qu’Esther ne pesait qu’un sixième du poids d’un nouveau-né normal !
Mais très vite, les médecins ont repris confiance et ont rassuré mes parents, car Esther faisait preuve d’une grande envie de vivre, une soif de découverte, une tonicité que peu d’enfants ont à cet âge.
Je ne m’en souviens pas vraiment, car je n’avais que trois ans alors, mais ma mère m’a raconté quelques années plus tard que mes deux premières phrases pour ma sœur ont été : « C’est ma sœur çà… elle est moche ! » et « C’est quand qu’elle repart ? ». En vérité, je vivais alors l’expérience de tous les aînés, celle d’un roi tout-puissant dans son petit royaume qui se fait détrôner par un coup d’État, par un petit frère ou une petite sœur. Alors que j’étais la veille encore le maître incontesté, je me retrouvai en un instant, devant cette couveuse qui contenait ma sœur. Tout d’un coup, le roi devenait prince ; j’étais relégué au second rang, ce qui était à mes yeux inacceptable.
Ma sœur est restée quelques semaines dans le service des nouveau-nés à l’hôpital, la néonatalogie, puis mes parents l’ont un jour ramenée à la maison. Je les vois encore arriver par la porte de l’entrée, mon père transportant fièrement le couffin jusqu’à la chambre de mes parents. Ma mère avait l’air fatiguée, elle était pâle, mais souriait. Dans son berceau, le visage rose de ma petite sœur dépassait à peine d’une couverture bleu ciel ; elle portait un petit bonnet et dormait à poings fermés.
Je n’ai guère de souvenirs précis de cette période, en dehors des évènements les plus marquants et étonnamment, je n’ai pas de souvenir d’Esther pendant ces premières années, à l’exception de cette période des premières semaines après sa naissance. Je me souviens d’un jour où ma mère a dû me laisser seul à la maison pour la sieste tandis qu’elle prenait Esther avec elle. Ma mère devait bien avoir une raison impérative de ne pas m’emmener avec elle, car elle ne m’aurait jamais laissé seul. Au fond de mon lit à barreaux, je retenais mon souffle, je fermais les yeux de toutes mes forces et faisais tous les efforts du monde pour me forcer à pleurer, et j’y parvenais finalement. Lorsqu’elle revint à la maison, ma mère me trouvait ruisselant de larmes et hurlant.
Mon père était médecin généraliste et ma mère enseignante. Papa partait fréquemment tôt le matin à son cabinet et rentrait assez tard le soir. Parfois, il était de garde et passait la nuit aux Urgences de l’hôpital. Il nous arrivait de ne pas le voir de la journée. Sa présence me manquait souvent, et j’enviais mes copains qui profitaient pleinement de leurs parents chaque jour de la semaine. Mon père rentrait souvent vers 20 heures. Ma mère lui laissait son repas dans le four pour le garder au chaud, et il mangeait ainsi en un quart d’heure tous les soirs, seul dans la cuisine tandis que ma mère nous couchait. Ensuite, il montait nous voir, commençant par ma sœur puis terminant par moi. Avec ma sœur, il s’asseyait auprès du lit et la prenait dans ses bras. Il demeurait ainsi près d’elle quelques instants, lui racontait très bas des histoires, la tête appuyée sur son oreiller, retirait la barrette de sa chevelure noire et dénouait ses cheveux. Lorsqu’il observait chez Esther les premiers stigmates de somnolence – frottements des yeux, paupières tombantes, silences prolongés et respiration plus profonde – il quittait sa chambre sur la pointe des pieds en laissant la porte entrouverte sur la lumière du couloir. Ce manège durait bien vingt minutes, et cela me paraissait une éternité. Je trépignais, j’enrageais, parfois je faisais irruption dans la chambre de ma sœur pour qu’il me rejoigne plus rapidement. Mais je dois avouer qu’il s’évertuait à donner à chacun d’entre nous le temps qu’il fallait, le temps nécessaire, car s’il adorait son travail, il considérait que le fait de ne pas voir ses enfants grandir – c’était l’expression qu’il employait – était pour lui une cause de tourment. À cet égard, par l’impuissance où il était de ne pas pouvoir nous accorder davantage de temps, il ressentait un sentiment de culpabilité dont il ne s’est jamais caché auprès de moi.
En entrant dans ma chambre, il prenait un livre de contes sur la table de chevet, et me demandait de choisir une histoire. C’était mon moment préféré dans la journée, et je cherchais à le faire durer le plus longtemps possible. Aussi choisissais-je les contes les plus longs, malgré ses protestations amusées. Lorsqu’il avait terminé la lecture, il éteignait la lumière et restait quelques minutes, allongé près de moi. Avec mon père auprès de moi dans l’obscurité, je me laissais aller, je lui racontais des fragments de ma journée, je lui faisais des confidences, et par jeu, il me promettait de garder pour lui ces petits secrets, et je pense qu’il tenait parole. Souvent, de fatigue, il s’endormait malgré lui à côté de moi.
Ma mère enseignait en école primaire. Lorsque j’étais en primaire et qu’Esther était encore en maternelle, elle arrivait avec nous un peu avant 8 heures pour préparer sa journée de classe. Nous restions dans la salle de classe en attendant qu’elle nous conduise dans la cour juste avant la sonnerie. Je me souviens de ces grandes cartes de géographie colorées ou de leçons de choses, du large tableau au-dessus de l’estrade sur lequel chaque jour elle écrivait la date à la craie, de ces craies de couleur, bleues, rouges ou vertes, de ces pupitres de bois alignés en plusieurs rangées. Cette salle de classe de mon enfance ne doit pas être très différente des salles de classe d’aujourd’hui.
Quelques minutes avant la sonnerie, nous descendions dans la cour. C’était une grande cour carrée, cernée par les bâtiments des salles de classe. Un seul arbre, un platane qui me paraissait gigantesque, apportait de l’ombre aux enfants quand les beaux jours pointaient leur nez. Son écorce grise était constellée de messages gravés par les élèves à l’insu des surveillants.
L’école maternelle se trouvait juste à côté du primaire. Une voie piétonne séparait les deux établissements. Chaque matin, j’accompagnais Esther au portail de son école et la regardais s’éloigner avec son cartable sur le dos. Arrivée à hauteur de la marelle, ma sœur s’arrêtait et se retournait pour me faire un signe de la main, puis elle partait en courant vers sa salle de classe, sa petite tête dépassant tout juste du cartable qui se balançait derrière elle. À ce moment de la journée, nous étions tous les deux très fiers : moi-même, en conduisant ma petite sœur au portail de l’école, je me sentais comme investi des hautes responsabilités d’une grande personne, et ma sœur, très fière de son grand frère, avait le sentiment d’être protégée par ce frère parfois ingrat, parfois complice.
Trois ans plus tard, elle entrait en primaire. Esther avait trois ans de moins que moi, ce qui est une différence importante à cet âge : j’avais mes amis et elle avait les siens, et les deux groupes ne se mélangeaient jamais. Nos regards se croisaient dans la cour de récréation, mais je feignais le plus souvent l’ignorance la plus complète, et elle faisait de même.
La jalousie a d’abord été l’élément déterminant de ma relation avec ma sœur et je dois dire que cela n’a pas dû être facile tous les jours avec un frère comme moi.
Je n’ai conservé de souvenirs précis que de quelques disputes ou de mauvais tours que je lui jouai pendant cette période où nous nous trouvions tous deux dans la même école. Lorsque nous en venions aux mains, ma sœur et moi, elle avait beau être de trois ans ma cadette, et j’avais beau avoir une tête de plus qu’elle, par sa détermination et son énergie, elle finissait souvent par prendre le dessus. Bien souvent, je battais en retraite et lui abandonnais la victoire sur le champ de bataille qu’elle occupait, encore tout échevelée, toute rouge encore du corps à corps dont elle sortait victorieuse.
À la confrontation directe, j’avoue que je préférais les mauvais tours sournois. Un jour, je roulai entre mes doigts une petite boule verte de wasabi. Il faut que je t’explique tout d’abord que le wasabi provient d’une plante. Il se présente souvent sous la forme d’une pâte de couleur verte. Son goût est assez proche de celui de la moutarde, en un peu plus fort. Si tu en mets une toute petite pointe sur ta langue, cela te monte au nez et te fait pleurer comme quand tu prends trop de moutarde. Ainsi donc, je roulai en cachette une petite boule de wasabi et la glissai discrètement dans l’assiette de ma petite sœur, parmi des petits pois. Tout en mangeant, assis en face d’elle, je la regardai manger du coin de l’œil. Quand enfin la boulette de wasabi disparut dans sa bouche, il ne se passa rien pendant une fraction de seconde, la mâchoire continua de travailler pour écraser entre ses petites dents fines les petits pois. Mais soudain, le mouvement de mastication s’interrompit, le visage se révulsa et Esther recracha sa bouchée dans son assiette en se jetant ensuite sur un verre d’eau qu’elle but d’un trait, devant mes parents médusés. Très vite, les explications que leur fournit Esther les mirent sur la voie, et j’en fus quitte pour des remontrances, mais je m’étais bien amusé.
Une autre fois, pendant une promenade avec mes parents, je mettais du poil à gratter sur le col de sa chemise. Je te parle de poil à gratter, mais sais-tu ce que c’est ?
Non ?
Eh bien, le poil à gratter provient de la baie de l’églantier, le parent sauvage de nos rosiers. Le fruit mûr a une couleur rouge foncé et ressemble en beaucoup plus petit à un ballon de rugby avec une petite touffe de cheveux poussant sur la partie opposée à la tige. Si tu le casses en deux, tu verras à l’intérieur, parmi de petites graines jaunâtres, une multitude de petits poils translucides. C’est cela, le poil à gratter. Chaque petit poil est pointu. Ces poils pénètrent dans la peau fine et produisent une sensation de démangeaison, d’urticaire irrésistible qui vous oblige à vous gratter. Bien souvent, il faut prendre une douche pour se débarrasser de ces poils.
Ce jour-là, je frottai une baie d’églantier sur le col de sa chemise puis m’éloignairapidement. La pauvre Esther, je la revois encore en train de se gratter, de pleurer à chaudes larmes, car cela finissait par lui faire mal. Je reconnais que si je rigolais bien au début lorsque je l’ai vue commencer à se gratter le cou, je regrettais bientôt mon geste, mais il était trop tard, quand elle s’est mise à pleurer. Pour ne rien arranger à l’affaire, mon père, excédé, m’a collé une fessée dont je me souviens encore.
Esther aussi n’était pas en reste, ce n’était pas non plus ce qu’on pourrait appeler une enfant modèle. Il lui arrivait par exemple de me narguer en prenant mon propre bol pour déjeuner, ou en mangeant la dernière crêpe. Elle m’énervait aussi lorsqu’elle s’appropriait mes vieux jouets, car même si je ne les utilisais plus, je considérais qu’ils m’appartenaient encore et préférais les laisser au fond d’un coffre à jouets plutôt que de les lui prêter. Elle avait cette manière de me regarder pour me provoquer, qui finissait par m’exaspérer.
Néanmoins, en grandissant, nous finissions par trouver des terrains d’entente et passions même de longs moments de la journée à jouer ensemble. J’avais par exemple des petites figurines qui représentaient des personnages de comics. Elle en choisissait quelques-unes dans la caisse et nous pouvions ainsi jouer tous les deux des heures durant sur le tapis de ma chambre, chacun d’entre nous incarnant un superhéros.
À l’emplacement du lotissement actuel où vivent tes grands-parents, il y avait un petit bois qui descendait à un ruisseau. Enfants, nous jouions souvent à cache-cache dans ce bois ; l’été, nous allions jusqu’à la rivière pour soulever les pierres au bord de l’eau, pour attraper des crevettes d’eau ou des sangsues que nous mettions dans des bocaux pour les regarder nager. Je crois que j’y ai passé là, avec ma petite sœur, les meilleurs moments de mon existence. Nous étions libres, n’avions véritablement aucun souci et notre existence devant nous, était pleine de promesses. Chaque jour, nous pouvions faire un métier différent, comme beaucoup d’enfants, nous étions insouciants, le jeu était le principal élément moteur de nos vies.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















