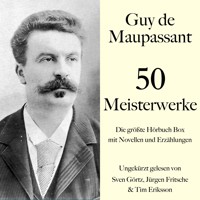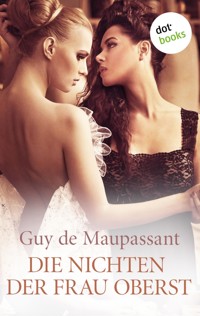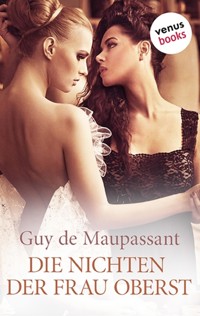0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Vie errante est le seizième recueil de nouvelles de l'écrivain Guy De Maupassant |1890|.
Guy de Maupassant était un maître de la nouvelle. Cette collection affiche sa diversité vivante, avec des contes qui varient en thème et en ton, allant de la tragédie et de la satire à la comédie et à la farce. Dans un style lucidement direct, il offre un réalisme sans faille et une ironie sceptique. Il dépeint les tromperies, les hypocrisies et les vanités à différents niveaux de la société. La prostitution est décrite avec franchise, tandis que la dureté de la guerre est habilement exposée.
Ses contes ont été télévisés et ont influencé les films, les opéras et la musique rock. Sans illusion mais humain, Maupassant reste notre contemporain.
| Source Introduction par Cedric Watts, M.A., Ph.D. |
Histoires courtes :
I.Lassitude
II.La nuit
III.La côte italienne
La Sicile
I. D’Alger à Tunis
II. Tunis
Vers Kairouan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
RECUEIL |16| - LA VIE ERRANTE (1890)
I.LASSITUDE
II.LA NUIT
III.LA CÔTE ITALIENNE
LA SICILE
I.D’ALGER À TUNIS
II.TUNIS
VERS KAIROUAN
GUY DE MAUPASSANT
LA VIE ERRANTE
RECUEIL |16|
COLLECTION COMPLÈTENOUVELLES
GUY DE MAUPASSANT
P. Ollendorff, 1890
Raanan Editeur
Livre 833 | édition 1
RECUEIL |16| - LA VIE ERRANTE(1890)
I.Lassitude
II.La nuit
III.La côte italienne
La Sicile
I. D’Alger à Tunis
II. Tunis
Vers Kairouan
I.LASSITUDE
J’ai quitté Paris et même la France, parce que la tour Eiffel finissait par m’ennuyer trop.
Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout, faite de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar inévitable et torturant.
Ce n’est pas elle uniquement d’ailleurs qui m’a donné une irrésistible envie de vivre seul pendant quelque temps, mais tout ce qu’on a fait autour d’elle, dedans, dessus, aux environs.
Comment tous les journaux vraiment ont-ils osé nous parler d’architecture nouvelle à propos de cette carcasse métallique, car l’architecture, le plus incompris et le plus oublié des arts aujourd’hui, en est peut-être aussi le plus esthétique, le plus mystérieux et le plus nourri d’idées ?
Il a eu ce privilège à travers les siècles de symboliser pour ainsi dire chaque époque, de résumer, par un très petit nombre de monuments typiques, la manière de penser, de sentir et de rêver d’une race et d’une civilisation.
Quelques temples et quelques églises, quelques palais et quelques châteaux contiennent à peu près toute l’histoire de l’art à travers le monde, expriment à nos yeux mieux que des livres, par l’harmonie des lignes et le charme de l’ornementation, toute la grâce et la grandeur d’une époque.
Mais je me demande ce qu’on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d’échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d’usine.
C’est un problème résolu, dit-on. Soit, — mais il ne servait à rien ! — et je préfère alors à cette conception démodée de recommencer la naïve tentative de la tour de Babel, celle qu’eurent, dès le douzième siècle, les architectes du campanile de Pise.
L’idée de construire cette gentille tour à huit étages de colonnes de marbre, penchée comme si elle allait toujours tomber, de prouver à la postérité stupéfaite que le centre de gravité n’est qu’un préjugé inutile d’ingénieur et que les monuments peuvent s’en passer, être charmants tout de même, et faire venir après sept siècles plus de visiteurs surpris que la tour Eiffel n’en attirera dans sept mois, constitue, certes, un problème, — puisque problème il y a —, plus original que celui de cette géante chaudronnerie, badigeonnée pour des yeux d’Indiens.
Je sais qu’une autre version veut que le campanile se soit penché tout seul. Qui le sait ? Le joli monument garde son secret toujours discuté et impénétrable.
Peu m’importe, d’ailleurs, la tour Eiffel. Elle ne fut que le phare d’une kermesse internationale, selon l’expression consacrée, dont le souvenir me hantera comme le cauchemar, comme la vision réalisée de l’horrible spectacle que peut donner à un homme dégoûté la foule humaine qui s’amuse.
Je me garderai bien de critiquer cette colossale entreprise politique, l’Exposition universelle, qui a montré au monde, juste au moment où il fallait le faire, la force, la vitalité, l’activité et la richesse inépuisable de ce pays surprenant : la France.
On a donné un grand plaisir, un grand divertissement et un grand exemple aux peuples et aux bourgeoisies. Ils se sont amusés de tout leur cœur. On a bien fait et ils ont bien fait.
J’ai seulement constaté, dès le premier jour, que je ne suis pas créé pour ces plaisirs-là.
Après avoir visité avec une admiration profonde la galerie des machines et les fantastiques découvertes de la science, de la mécanique, de la physique et de la chimie modernes ; après avoir constaté que la danse du ventre n’est amusante que dans les pays où on agite des ventres nus, et que les autres danses arabes n’ont de charme et de couleur que dans les ksours blancs d’Algérie, je me suis dit qu’en définitive aller là de temps en temps serait une chose fatigante mais distrayante, dont on se reposerait ailleurs, chez soi ou chez ses amis.
Mais je n’avais point songé à ce qu’allait devenir Paris envahi par l’univers.
Dès le jour, les rues sont pleines, les trottoirs roulent des foules comme des torrents grossis. Tout cela descend vers l’Exposition, ou en revient, ou y retourne. Sur les chaussées, les voitures se tiennent comme les wagons d’un train sans fin. Pas une n’est libre, pas un cocher ne consent à vous conduire ailleurs qu’à l’Exposition, ou à sa remise quand il va relayer. Pas de coupés aux cercles. Ils travaillent maintenant pour le rastaquouère étranger ; pas une table aux restaurants, et pas un ami qui dîne chez lui ou qui consente à dîner chez vous.
Quand on l’invite, il accepte à la condition qu’on banquettera sur la tour Eiffel. C’est plus gai. Et tous, comme par suite d’un mot d’ordre, ils vous y convient ainsi tous les jours de la semaine, soit pour déjeuner, soit pour dîner.
Dans cette chaleur, dans cette poussière, dans cette puanteur, dans cette foule de populaire en goguette et en transpiration, dans ces papiers gras traînant et voltigeant partout, dans cette odeur de charcuterie et de vin répandu sur les bancs, dans ces haleines de trois cent mille bouches soufflant le relent de leurs nourritures, dans le coudoiement, dans le frôlement, dans l’emmêlement de toute cette chair échauffée, dans cette sueur confondue de tous les peuples semant leurs puces sur les sièges et par les chemins, je trouvais bien légitime qu’on allât manger une fois ou deux, avec dégoût et curiosité, la cuisine de cantine des gargotiers aériens, mais je jugeais stupéfiant qu’on pût dîner, tous les soirs, dans cette crasse et dans cette cohue, comme le faisait la bonne société, la société délicate, la société d’élite, la société fine et maniérée qui, d’ordinaire, a des nausées devant le peuple qui peine et sent la fatigue humaine.
Cela prouve d’ailleurs, d’une façon définitive, le triomphe complet de la démocratie.
Il n’y a plus de castes, de races, d’épidermes aristocrates. Il n’y a plus chez nous que des gens riches et des gens pauvres. Aucun autre classement ne peut différencier les degrés de la société contemporaine.
Une aristocratie d’un autre ordre s’établit qui vient de triompher à l’unanimité à cette Exposition universelle, l’aristocratie de la science, ou plutôt de l’industrie scientifique.
Quant aux arts, ils disparaissent ; le sens même s’en efface dans l’élite de la nation, qui a regardé sans protester l’horripilante décoration du dôme central et de quelques bâtiments voisins.
Le goût italien moderne nous gagne, et la contagion est telle que les coins réservés aux artistes, dans ce grand bazar populaire et bourgeois qu’on vient de fermer, y prenaient aussi des aspects de réclame et d’étalage forain.
Je ne protesterais nullement d’ailleurs contre l’avènement et le règne des savants scientifiques, si la nature de leur œuvre et de leurs découvertes ne me contraignait de constater que ce sont, avant tout, des savants de commerce.
Ce n’est pas leur faute, peut-être. Mais on dirait que le cours de l’esprit humain s’endigue entre deux murailles qu’on ne franchira plus : l’industrie et la vente.
Au commencement des civilisations, l’âme de l’homme s’est précipitée vers l’art. On croirait qu’alors une divinité jalouse lui a dit : « Je te défends de penser davantage à ces choses-là. Mais songe uniquement à ta vie d’animal, et je te laisserai faire des masses de découvertes. »
Voilà, en effet, qu’aujourd’hui l’émotion séductrice et puissante des siècles artistes semble éteinte, tandis que des esprits d’un tout autre ordre s’éveillent qui inventent des machines de toute sorte, des appareils surprenants, des mécaniques aussi compliquées que les corps vivants, ou qui, combinant des substances, obtiennent des résultats stupéfiants et admirables. Tout cela pour servir aux besoins physiques de l’homme, ou pour le tuer.
Les conceptions idéales, ainsi que la science pure et désintéressée, celle de Galilée, de Newton, de Pascal, nous semblent interdites, tandis que notre imagination paraît de plus en plus excitable par l’envie de spéculer sur les découvertes utiles à l’existence.
Or, le génie de celui qui, d’un bond de sa pensée, est allé de la chute d’une pomme à la grande loi qui régit les mondes, ne semble-t-il pas né d’un germe plus divin que l’esprit pénétrant de l’inventeur américain, du miraculeux fabricant de sonnettes, de porte-voix et d’appareils lumineux.
N’est-ce point là le vice secret de l’âme moderne, la marque de son infériorité dans un triomphe ?
J’ai peut-être tort absolument. En tout cas, ces choses, qui nous intéressent, ne nous passionnent pas comme les anciennes formes de la pensée, nous autres, esclaves irritables d’un rêve de beauté délicate, qui hante et gâte notre vie.
J’ai senti qu’il me serait agréable de revoir Florence, et je suis parti.
II.LA NUIT
Sortis du port de Cannes à trois heures du matin, nous avons pu recueillir encore un reste des faibles brises que les golfes exhalent vers la mer pendant la nuit. Puis un léger souffle du large est venu, poussant le yacht couvert de toile vers la côte italienne.
C’est un bateau de vingt tonneaux tout blanc, avec un imperceptible fil doré qui le contourne comme une mince cordelière sur un flanc de cygne. Ses voiles en toile fine et neuve, sous le soleil d’août qui jette des flammes sur l’eau, ont l’air d’ailes de soie argentée déployées dans le firmament bleu. Ses trois focs s’envolent en avant, triangles légers qu’arrondit l’haleine du vent, et la grande misaine est molle, sous la flèche aiguë qui dresse, à dix-huit mètres au-dessus du pont, sa pointe éclatante par le ciel. Tout à l’arrière, la dernière voile, l’artimon, semble dormir.
Et tout le monde bientôt sommeille sur le pont. C’est un après-midi d’été, sur la Méditerranée. La dernière brise est tombée. Le soleil féroce emplit le ciel et fait de la mer une plaque molle et bleuâtre, sans mouvement et sans frisson, endormie aussi, sous un miroitant duvet de brume qui semble la sueur de l’eau.
Malgré les tentes que j’ai fait établir pour me mettre à l’abri, la chaleur est telle sous la toile que je descends au salon me jeter sur un divan.
Il fait toujours frais dans l’intérieur. Le bateau est profond, construit pour naviguer dans les mers du Nord et supporter les gros temps. On peut vivre, un peu à l’étroit, équipage et passagers, à six ou sept personnes dans cette petite demeure flottante et on peut asseoir huit convives autour de la table du salon.
L’intérieur est en pin du nord verni, avec encadrements de teck, éclairé par les cuivres des serrures, des ferrures, des chandeliers, tous les cuivres jaunes et gais qui sont le luxe des yachts.
Comme c’est bizarre ce changement, après la clameur de Paris ! Je n’entends plus rien, mais rien, rien. De quart d’heure en quart d’heure, le matelot qui s’assoupit à la barre, toussote et crache. La petite pendule suspendue contre la cloison de bois fait un bruit qui semble formidable dans ce silence du ciel et de la mer.
Et ce minuscule battement troublant seul l’immense repos des éléments me donne soudain la surprenante sensation des solitudes illimitées où les murmures des mondes, étouffés à quelques mètres de leurs surfaces, demeurent imperceptibles dans le silence universel !
Il semble que quelque chose de ce calme éternel de l’espace descend et se répand sur la mer immobile, par ce jour étouffant d’été. C’est quelque chose d’accablant, d’irrésistible, d’endormeur, d’anéantissant comme le contact du vide infini. Toute la volonté défaille, toute pensée s’arrête, le sommeil s’empare du corps et de l’âme.
Le soir venait quand je me réveillai. Quelques souffles de brise crépusculaire, très inespérés d’ailleurs, nous poussèrent encore jusqu’au soleil couché.
Nous étions assez près des côtes, en face d’une ville, San Remo, sans espoir de l’atteindre. D’autres villages ou petites cités, s’étalant au pied de la haute montagne grise, ressemblaient à des tas de linge blanc mis à sécher sur les plages. Quelques brumes fumaient sur les pentes des Alpes, effaçaient les vallées en rampant vers les sommets dont les crêtes dessinaient une immense ligne dentelée dans un ciel rose et lilas.
Et la nuit tomba sur nous, la montagne disparut, des feux s’allumèrent au ras de l’eau tout le long de la grande côte.
Une bonne odeur de cuisine, sortit de l’intérieur du yacht, se mêlant agréablement à la bonne et fraîche odeur de l’air marin.
Lorsque j’eus dîné, je m’étendis sur le pont. Ce jour tranquille de flottement avait nettoyé mon esprit comme un coup d’éponge sur une vitre ternie ; et des souvenirs en foule surgissaient dans ma pensée, des souvenirs sur la vie que je venais de quitter, sur des gens connus, observés ou aimés.
Être seul, sur l’eau, et sous le ciel, par une nuit chaude, rien ne fait ainsi voyager l’esprit et vagabonder l’imagination. Je me sentais surexcité, vibrant, comme si j’avais bu des vins capiteux, respiré de l’éther ou aimé une femme.
Une petite fraîcheur nocturne mouillait la peau d’un imperceptible bain de brume salée. Le frisson savoureux de ce tiède refroidissement de l’air courait sur les membres, entrait dans les poumons, béatifiait le corps et l’esprit en leur immobilité.
Sont-ils plus heureux ou plus malheureux ceux qui reçoivent leurs sensations par toute la surface de leur chair autant que par leurs yeux, leur bouche, leur odorat ou leurs oreilles ?
C’est une faculté rare et redoutable, peut-être, que cette excitabilité nerveuse et maladive de l’épiderme et de tous les organes qui fait une émotion des moindres impressions physiques et qui, suivant les températures de la brise, les senteurs du sol et la couleur du jour, impose des souffrances, des tristesses et des joies.
Ne pas pouvoir entrer dans une salle de théâtre, parce que le contact des foules agite inexplicablement l’organisme entier, ne pas pouvoir pénétrer dans une salle de bal parce que la gaieté banale et le mouvement tournoyant des valses irrite comme une insulte, se sentir lugubre à pleurer ou joyeux sans raison suivant la décoration, les tentures et la décomposition de la lumière dans un logis, et rencontrer quelquefois par des combinaisons de perceptions, des satisfactions physiques que rien ne peut révéler aux gens d’organisme grossier, est-ce un bonheur ou un malheur ?
Je l’ignore ; mais, si le système nerveux n’est pas sensible jusqu’à la douleur ou jusqu’à l’extase, il ne nous communique que des commotions moyennes, et des satisfactions vulgaires.
Cette brume de la mer me caressait, comme un bonheur. Elle s’étendait sur le ciel, et je regardais avec délices les étoiles enveloppées de ouate, un peu pâlies dans le firmament sombre et blanchâtre. Les côtes avaient disparu derrière cette vapeur qui flottait sur l’eau et nimbait les astres.
On eût dit qu’une main surnaturelle venait d’empaqueter le monde, en des nuées fines de coton, pour quelque voyage inconnu.
Et tout à coup, à travers cette ombre neigeuse, une musique lointaine venue on ne sait d’où, passa sur la mer. Je crus qu’un orchestre aérien errait dans l’étendue pour me donner un concert. Les sons affaiblis, mais clairs, d’une sonorité charmante, jetaient par la nuit douce un murmure d’opéra.
Une voix parla près de moi.
« Tiens, disait un marin, c’est aujourd’hui dimanche et voilà la musique de San Remo qui joue dans le jardin public. »
J’écoutais, tellement surpris que je me croyais le jouet d’un joli songe. J’écoutai longtemps, avec un ravissement infini, le chant nocturne envolé à travers l’espace.
Mais voilà qu’au milieu d’un morceau il s’enfla, grandit, parut accourir vers nous. Ce fut d’un effet si fantastique et si surprenant que je me dressai pour écouter. Certes, il venait, plus distinct et plus fort de seconde en seconde. Il venait à moi, mais comment ? Sur quel radeau fantôme allait-il apparaître ? Il arrivait, si rapide, que, malgré moi, je regardai dans l’ombre avec des yeux émus ; et tout à coup je fus noyé dans un souffle chaud et parfumé d’aromates sauvages qui s’épandait comme un flot plein de la senteur violente des myrtes, des menthes, des citronnelles, des immortelles, des lentisques, des lavandes, des thyms, brûlés sur la montagne par le soleil d’été.
C’était le vent de terre qui se levait, chargé des haleines de la côte et qui emportait aussi vers le large, en la mêlant à l’odeur des plantes alpestres, cette harmonie vagabonde.
Je demeurais haletant, si grisé de sensations, que le trouble de cette ivresse fit délirer mes sens. Je ne savais plus vraiment si je respirais de la musique, ou si j’entendais des parfums, ou si je dormais dans les étoiles.
Cette brise de fleurs nous poussa vers la pleine mer en s’évaporant par la nuit. La musique alors lentement s’affaiblit, puis se tut, pendant que le bateau s’éloignait dans les brumes.
Je ne pouvais pas dormir, et je me demandais comment un poète moderniste, de l’école dite symboliste, aurait rendu la confuse vibration nerveuse dont je venais d’être saisi et qui me paraît, en langage clair, intraduisible. Certes, quelques-uns de ces laborieux exprimeurs de la multiforme sensibilité artiste s’en seraient tirés à leur honneur, disant en vers euphoniques, pleins de sonorités intentionnelles, incompréhensibles et perceptibles cependant, ce mélange inexprimable de sons parfumés, de brume étoilée et de brise marine, semant de la musique par la nuit.
Un sonnet de leur grand patron Baudelaire me revint à la mémoire :
La nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles. L’homme y passe à travers des forêts de symboles Qui l’observent avec des regards familiers.