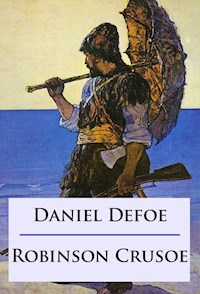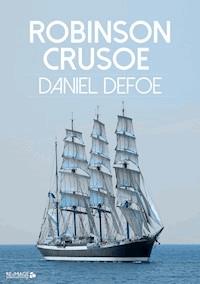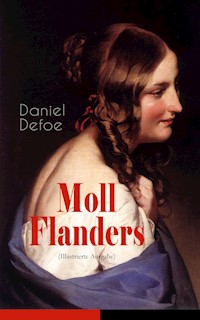3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Il est des livres qui, au fil des siècles, sortent de la littérature pour devenir des mythes : le personnage, la conception de l'histoire, s'élèvent alors à une valeur universelle, et les générations successives y reconnaissent, de temps à autre, les significations que leur angle de vision est mieux à même de saisir et d'assimiler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LA VIE ET LES AVENTURES DE ROBINSON CRUSOE
DANIEL DEFOE
Traduction et édition 2024 par David De Angelis
Tous les droits sont réservés
Contenu
CHAPITRE I-DÉBUT DE LA VIE
CHAPITRE II-ESCLAVAGE ET FUITE
CHAPITRE III-NAUFRAGÉS SUR UNE ÎLE DÉSERTE
CHAPITRE IV - PREMIÈRES SEMAINES SUR L'ÎLE
CHAPITRE V - LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON - LE JOURNAL
CHAPITRE VI- LA MALADIE ET LA CONSCIENCE
CHAPITRE VII-EXPÉRIENCE AGRICOLE
CHAPITRE VIII-ÉTUDIER SA POSITION
CHAPITRE IX-A BATEAU
CHAPITRE X - LES CHÈVRES DE LA FAMILLE DES TAMES
CHAPITRE XI-TROUVE L'EMPREINTE D'UN PIED D'HOMME SUR LE SABLE
CHAPITRE XII-UNE RETRAITE DANS UNE GROTTE
CHAPITRE XIII-NAUFRAGE D'UN NAVIRE ESPAGNOL
CHAPITRE XIV-UN RÊVE RÉALISÉ
CHAPITRE XV - L'ÉDUCATION DE VENDREDI
CHAPITRE XVI-LE SAUVETAGE DES PRISONNIERS DES CANNIBALES
CHAPITRE XVII-VISITE DES MUTINS
CHAPITRE XVIII - LE NAVIRE RÉCUPÉRÉ
CHAPITRE XIX - RETOUR EN ANGLETERRE
CHAPITRE XX - COMBAT ENTRE FRIDAY ET UN OURS
CHAPITRE I. DÉBUT DE LA VIE
Je suis né en 1632, dans la ville de York, d'une bonne famille, bien qu'elle ne soit pas originaire de ce pays, mon père étant un étranger de Brême qui s'est d'abord installé à Hull. Mon père était un étranger originaire de Brême qui s'était d'abord installé à Hull. Il s'était constitué une bonne fortune en faisant du commerce et, abandonnant son métier, il avait ensuite vécu à York, d'où il avait épousé ma mère, dont les parents s'appelaient Robinson, une très bonne famille dans ce pays, et qui m'avait donné le nom de Robinson Kreutznaer ; mais, par la corruption habituelle des mots en Angleterre, nous nous appelons maintenant - nous nous appelons nous-mêmes et nous écrivons notre nom - Crusoe ; et c'est ainsi que mes compagnons m'ont toujours appelé.
J'avais deux frères aînés, dont l'un était lieutenant-colonel d'un régiment d'infanterie anglais dans les Flandres, autrefois commandé par le célèbre colonel Lockhart, et qui a été tué lors de la bataille de Dunkerque contre les Espagnols. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de mon second frère, pas plus que mon père ou ma mère n'ont su ce qu'il était advenu de moi.
Comme j'étais le troisième fils de la famille et que je n'avais pas été formé à un métier, j'ai commencé très tôt à me remplir la tête de pensées décousues. Mon père, qui était très âgé, m'avait donné une bonne part d'instruction, dans la mesure où l'éducation à la maison et l'école gratuite de campagne sont généralement possibles, et m'avait destiné au droit ; mais je ne voulais rien d'autre que de prendre la mer ; et mon penchant pour cela m'a conduit si fortement contre la volonté, voire les ordres de mon père, et contre toutes les supplications et persuasions de ma mère et de mes autres amis, qu'il semblait y avoir quelque chose de fatal dans cette propension de la nature, qui tendait directement à la vie de misère qui allait m'arriver.
Mon père, homme sage et grave, me donna de sérieux et excellents conseils contre ce qu'il prévoyait être mon dessein. Il m'appela un matin dans sa chambre, où il était confiné par la goutte, et s'entretint très chaleureusement avec moi à ce sujet. Il me demanda quelles raisons, autres qu'un simple penchant vagabond, me poussaient à quitter la maison paternelle et mon pays natal, où je pouvais être bien introduit et où j'avais la perspective d'accroître ma fortune par l'application et l'industrie, tout en menant une vie d'aisance et de plaisir. Il m'a dit que c'étaient des hommes à la fortune désespérée, d'une part, ou à la fortune aspirante et supérieure, d'autre part, qui partaient à l'aventure pour s'élever par l'esprit d'entreprise et se rendre célèbres dans des entreprises d'une nature hors du commun ; que toutes ces choses étaient soit trop au-dessus de moi, soit trop au-dessous de moi ; que le mien était l'état moyen, ou ce que l'on pourrait appeler la station supérieure de la basse vie, dont il avait constaté, par une longue expérience, qu'elle était la meilleure au monde, la plus propre au bonheur humain, n'étant pas exposée aux misères et aux difficultés, au travail et aux souffrances de la partie mécanique de l'humanité, et n'étant pas embarrassée par l'orgueil, le luxe, l'ambition et l'envie de la partie supérieure de l'humanité. Il m'a dit que je pouvais juger du bonheur de cet état par une seule chose, à savoir que c'était l'état de vie que tous les autres peuples enviaient ; que les rois ont souvent déploré la conséquence malheureuse d'être nés pour de grandes choses, et qu'ils auraient souhaité être placés au milieu des deux extrêmes, entre le moyen et le grand ; que le sage a donné son témoignage à ce sujet, comme norme de félicité, quand il a prié pour n'avoir ni pauvreté, ni richesse.
Il m'a dit de l'observer, et j'ai toujours constaté que les calamités de la vie étaient partagées entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'humanité, mais que la partie moyenne avait le moins de désastres, et n'était pas exposée à autant de vicissitudes que la partie supérieure ou la partie inférieure de l'humanité ; qu'ils n'étaient pas soumis à autant de dépressions et de malaises, soit du corps, soit de l'esprit, que ceux qui, par une vie vicieuse, le luxe et les extravagances d'une part, ou par un travail pénible, le manque de produits de première nécessité et une alimentation médiocre ou insuffisante d'autre part, s'attirent des maladies par les conséquences naturelles de leur mode de vie ; que la position moyenne de la vie était calculée pour tous les genres de vertu et toutes les sortes de jouissances ; que la paix et l'abondance étaient les servantes d'une fortune moyenne ; que la tempérance, la modération, la tranquillité, la santé, la société, toutes les distractions agréables et tous les plaisirs désirables étaient les bénédictions qui accompagnaient la position moyenne de la vie ; que c'est ainsi que les hommes traversaient le monde en silence et en douceur, et en sortaient confortablement, sans être gênés par les travaux des mains ou de la tête, sans être vendus à une vie d'esclavage pour le pain quotidien, sans être harcelés par des circonstances perplexes qui privent l'âme de la paix et le corps du repos, sans être enragés par la passion de l'envie, ou par la soif secrète et brûlante de l'ambition pour les grandes choses ; mais, dans des circonstances faciles, glissant doucement à travers le monde, et goûtant sensiblement les douceurs de la vie, sans l'amertume ; sentant qu'ils sont heureux, et apprenant par l'expérience de chaque jour à le savoir plus sensiblement.
Après cela, il me pressa vivement, et de la manière la plus affectueuse, de ne pas jouer au jeune homme, ni de me précipiter dans des misères que la nature et la situation dans laquelle j'étais né semblaient avoir prévues ; que je n'étais pas obligé de chercher mon pain ; qu'il ferait bien pour moi, et s'efforcerait de me faire entrer équitablement dans la position de vie qu'il venait de me recommander ; et que si je n'étais pas très facile et très heureux dans le monde, ce devait être mon simple destin ou ma faute qui devait y faire obstacle ; et qu'il n'aurait rien à se reprocher, ayant ainsi rempli son devoir en m'avertissant contre des mesures qui, il le savait, me seraient nuisibles ; en un mot, que de même qu'il ferait de très bonnes choses pour moi si je restais et m'installais chez moi comme il me l'avait ordonné, de même il ne participerait pas à mes malheurs au point de m'encourager à partir ; et pour conclure, il me dit que j'avais mon frère aîné pour exemple, à qui il avait fait subir les mêmes persuasions sérieuses pour l'empêcher de participer aux guerres des Basses Terres, mais qu'il n'avait pas pu l'emporter, ses jeunes désirs l'ayant poussé à s'enrôler dans l'armée, où il fut tué ; Et bien qu'il ait dit qu'il ne cesserait pas de prier pour moi, il a osé me dire que si je faisais cette démarche insensée, Dieu ne me bénirait pas, et que j'aurais le loisir de réfléchir plus tard au fait d'avoir négligé ses conseils alors qu'il n'y en avait peut-être aucun pour m'aider à me rétablir.
J'ai observé dans cette dernière partie de son discours, qui était vraiment prophétique, bien que je suppose que mon père ne le savait pas lui-même - je dis que j'ai observé les larmes couler très abondamment sur son visage, surtout quand il a parlé de mon frère qui avait été tué ; et quand il a dit que j'avais le loisir de me repentir et que personne ne pouvait m'aider, il était si ému qu'il a interrompu le discours et m'a dit que son cœur était si plein qu'il ne pouvait plus m'en dire davantage.
Je fus sincèrement touchée par ce discours, et, en effet, qui pourrait l'être autrement ? Je résolus de ne plus penser à partir à l'étranger, mais de m'installer à la maison selon le désir de mon père. Hélas ! quelques jours suffirent pour que tout s'estompe ; et, en somme, pour éviter toute nouvelle importunité de la part de mon père, je résolus, quelques semaines plus tard, de m'enfuir tout à fait loin de lui. Cependant, je n'agis pas aussi précipitamment que la première chaleur de ma résolution l'avait incité à le faire ; je pris ma mère à un moment où je la trouvais un peu plus agréable qu'à l'ordinaire, et je lui dis que mes pensées étaient si entièrement tournées vers le monde que je ne me contenterais jamais de rien avec assez de résolution pour aller jusqu'au bout, et que mon père ferait mieux de me donner son consentement plutôt que de m'obliger à partir sans lui ; que j'avais maintenant dix-huit ans, ce qui était trop tard pour devenir apprenti dans un métier ou clerc chez un avocat ; que j'étais sûr que si je le faisais, je n'irais jamais jusqu'au bout de mon temps, mais que je m'enfuirais certainement de chez mon maître avant la fin de mon temps, et que je prendrais la mer ; et que si elle parlait à mon père de me laisser faire un voyage à l'étranger, si je revenais à la maison et que cela ne me plaisait pas, je n'irais pas plus loin ; et je promettrais, par une double diligence, de rattraper le temps que j'avais perdu.
Cela mit ma mère dans une grande passion ; elle me dit qu'elle savait qu'il ne servirait à rien de parler à mon père de ce sujet ; qu'il savait trop bien quel était mon intérêt pour donner son consentement à quelque chose qui me ferait tant de mal ; et qu'elle se demandait comment je pouvais penser à une telle chose après la discussion que j'avais eue avec mon père, et les expressions si aimables et si tendres qu'elle savait que mon père avait employées à mon égard ; et qu'en somme, si je voulais me ruiner, il n'y avait pas d'aide pour moi ; mais je pouvais compter que je n'aurais jamais leur consentement ; que, pour sa part, elle ne participerait pas autant à ma destruction ; et que je ne pourrais jamais dire que ma mère était disposée à le faire alors que mon père ne l'était pas.
Bien que ma mère ait refusé d'en parler à mon père, j'ai appris par la suite qu'elle lui avait rapporté tout le discours et que mon père, après avoir montré une grande inquiétude à ce sujet, lui avait dit en soupirant : "Ce garçon pourrait être heureux s'il restait à la maison ; mais s'il part à l'étranger, il sera le plus malheureux des malheureux qui soient jamais nés : Je ne peux pas y consentir."
Ce n'est que près d'un an plus tard que je me suis détachée, bien que, dans l'intervalle, je sois restée obstinément sourde à toutes les propositions d'affaires, et que j'aie souvent reproché à mon père et à ma mère d'être si résolument opposés à ce qu'ils savaient être mes inclinations. Mais un jour que j'étais à Hull, où je me rendais par hasard, sans avoir l'intention de faire une fugue à ce moment-là, et que l'un de mes compagnons était sur le point de s'embarquer pour Londres sur le navire de son père, et qu'il m'incitait à l'accompagner avec l'attrait commun des hommes de mer, à savoir que mon passage ne me coûterait rien, je n'ai plus consulté ni mon père ni ma mère, et je ne leur ai même pas envoyé un mot à ce sujet ; Mais les laissant entendre ce qu'ils voulaient, sans demander la bénédiction de Dieu ou de mon père, sans tenir compte des circonstances ou des conséquences, et à une heure malheureuse, Dieu le sait, le 1er septembre 1651, je me suis embarqué sur un navire à destination de Londres. Jamais, je crois, les malheurs d'un jeune aventurier n'ont commencé plus tôt et n'ont duré plus longtemps que les miens. Le navire n'était pas encore sorti de l'Humber que le vent commença à souffler et la mer à monter de la manière la plus effrayante ; et comme je n'avais jamais été en mer auparavant, j'étais incroyablement malade de corps et terrifié d'esprit. Je commençai alors à réfléchir sérieusement à ce que j'avais fait et à la justesse du jugement du Ciel pour avoir malencontreusement quitté la maison de mon père et abandonné mon devoir. Tous les bons conseils de mes parents, les larmes de mon père et les supplications de ma mère me revinrent à l'esprit, et ma conscience, qui n'avait pas encore atteint le degré de dureté auquel elle est parvenue depuis, me reprocha d'avoir méprisé les conseils et d'avoir manqué à mon devoir envers Dieu et mon père.
Pendant tout ce temps, la tempête s'intensifiait et la mer montait très haut, mais rien de comparable à ce que j'ai vu maintes fois depuis ; non, ni à ce que j'ai vu quelques jours plus tard ; mais c'était suffisant pour m'affecter alors, moi qui n'étais qu'un jeune marin et qui n'avais jamais rien connu de tel. Je pensais que chaque vague nous aurait engloutis, et que chaque fois que le navire s'abîmerait, comme je le pensais, dans le creux de la mer, nous ne pourrions plus jamais nous relever ; dans cette agonie de l'esprit, j'ai fait de nombreux vœux et pris de nombreuses résolutions : s'il plaisait à Dieu d'épargner ma vie au cours de ce seul voyage, si jamais je remettais le pied sur la terre ferme, je rentrerais directement chez mon père et ne remonterais plus jamais à bord d'un navire tant que je vivrais ; je suivrais ses conseils et ne me précipiterais plus jamais dans des misères comme celles-ci. Maintenant, je voyais clairement la bonté de ses observations sur la position intermédiaire de la vie, combien il avait vécu facilement et confortablement tous ses jours, et n'avait jamais été exposé à des tempêtes en mer ou à des troubles sur le rivage ; et je résolus de rentrer chez mon père, comme un vrai prodigue qui se repent.
Ces sages et sobres pensées se poursuivirent pendant toute la durée de la tempête, et même quelque temps après ; mais le lendemain, le vent s'apaisa et la mer se calma, et je commençai à m'y habituer un peu ; cependant, je restai très grave pendant toute cette journée, et j'avais encore un peu le mal de mer ; Le soleil s'est couché parfaitement clair et s'est levé de la même façon le lendemain matin ; comme il n'y avait que peu ou pas de vent, que la mer était lisse et que le soleil brillait, le spectacle était, à mon avis, le plus charmant que j'aie jamais vu.
J'avais bien dormi pendant la nuit, et je n'avais plus le mal de mer, mais j'étais très joyeux, regardant avec étonnement cette mer qui était si agitée et si terrible la veille, et qui pouvait devenir si calme et si agréable en si peu de temps. Et maintenant, de peur que mes bonnes résolutions ne perdurent, mon compagnon, qui m'avait incité à partir, vient me trouver : "Eh bien, Bob, me dit-il en me tapant sur l'épaule, comment vous sentez-vous après cela ? Je suis sûr que vous avez eu peur, n'est-ce pas, la nuit dernière, quand il n'y avait qu'un capuchon de vent ? "Un capuchon, vous appelez ça ?", dis-je, "c'était une terrible tempête". "Une tempête, espèce d'imbécile, répond-il ; appelez-vous cela une tempête ? Ce n'était rien du tout ; donnez-nous un bon navire et une bonne chambre de mer, et nous n'aurons que faire d'un tel grain de vent ; mais vous n'êtes qu'un marin d'eau douce, Bob. Allons, faisons un bol de punch, et nous oublierons tout cela ; voyez-vous quel temps charmant il fait maintenant ? Pour abréger cette triste partie de mon histoire, nous avons fait comme tous les marins ; le punch a été fait et j'en ai été à moitié ivre ; et dans cette méchanceté d'une nuit, j'ai noyé tout mon repentir, toutes mes réflexions sur ma conduite passée, toutes mes résolutions pour l'avenir. En un mot, de même que la mer avait retrouvé sa surface lisse et son calme serein après l'apaisement de la tempête, de même la précipitation de mes pensées étant passée, mes craintes et mes appréhensions d'être englouti par la mer étant oubliées, et le courant de mes anciens désirs étant revenu, j'ai entièrement oublié les vœux et les promesses que j'avais faits dans ma détresse. Je trouvais, il est vrai, quelques intervalles de réflexion, et les pensées sérieuses s'efforçaient, pour ainsi dire, de revenir de temps en temps ; mais je les repoussais, je m'en réveillais comme d'une maladie, et, m'appliquant à la boisson et à la compagnie, je maîtrisais bientôt le retour de ces crises - c'est ainsi que je les appelais ; et, en cinq ou six jours, j'avais remporté sur la conscience une victoire aussi complète que pouvait le désirer un jeune homme qui avait résolu de ne pas être troublé par cette conscience. Mais je devais encore subir une autre épreuve ; et la Providence, comme elle le fait généralement en pareil cas, résolut de me laisser entièrement sans excuse ; car si je ne prenais pas cela pour une délivrance, la prochaine devait être telle que le pire et le plus endurci des misérables parmi nous en reconnaîtrait à la fois le danger et la miséricorde.
Le sixième jour de notre séjour en mer, nous entrâmes dans les routes de Yarmouth ; le vent étant contraire et le temps calme, nous n'avions guère avancé depuis la tempête. Nous fûmes obligés de jeter l'ancre, et nous restâmes là, le vent continuant à être contraire - c'est-à-dire au sud-ouest - pendant sept ou huit jours, au cours desquels un grand nombre de navires de Newcastle vinrent dans ces mêmes routes, comme le port commun où les navires pouvaient attendre un vent pour la rivière.
Cependant, nous n'étions pas restés là si longtemps que nous aurions dû remonter le fleuve, mais le vent soufflait trop frais et, après quatre ou cinq jours, il souffla très fort. Cependant, les routes étant considérées comme aussi bonnes qu'un port, le mouillage étant bon et nos amarres très solides, nos hommes n'étaient pas inquiets et ne craignaient pas le moins du monde le danger ; ils passaient leur temps à se reposer et à s'amuser, à la manière de la mer ; mais le huitième jour, au matin, le vent s'est levé et nous avons mis tout le monde au travail pour abattre nos grands mâts et faire en sorte que tout soit bien ajusté et serré, afin que le navire puisse naviguer aussi facilement que possible. Vers midi, la mer devint très haute, et notre navire s'enfonça dans le gaillard d'avant, embarquant plusieurs paquets de mer, et nous pensâmes une fois ou deux que notre ancre s'était détachée ; notre capitaine ordonna alors de retirer l'ancre d'écoute, de sorte que nous naviguâmes avec deux ancres en avant, et les câbles s'écartèrent jusqu'à l'extrémité.
Il soufflait alors une terrible tempête, et je commençai à lire la terreur et la stupéfaction sur les visages des marins eux-mêmes. Le capitaine, bien que vigilant dans la préservation du navire, entrait et sortait de sa cabine près de moi, et je l'entendais dire tout bas, à plusieurs reprises : "Seigneur, sois miséricordieux envers nous ! nous allons être perdus ! nous allons être défaits !" et ainsi de suite. Pendant ces premières précipitations, j'étais stupide, couché dans ma cabine, qui se trouvait dans l'entrepont, et je ne peux pas décrire mon tempérament : Je ne pouvais pas reprendre la première pénitence que j'avais apparemment piétinée et contre laquelle je m'étais endurci : Je pensais que l'amertume de la mort était passée et que cela ne ressemblerait en rien à la première ; mais lorsque le capitaine lui-même est venu me voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il m'a dit que nous étions tous perdus, j'ai été terriblement effrayé. Je me suis levé de ma cabine et j'ai regardé dehors, mais je n'ai jamais vu un spectacle aussi lugubre : la mer était haute comme des montagnes et déferlait sur nous toutes les trois ou quatre minutes ; quand j'ai pu regarder autour de moi, je n'ai vu que de la détresse autour de nous ; deux navires qui naviguaient près de nous avaient coupé leurs mâts par la planche, car ils étaient très chargés ; et nos hommes ont crié qu'un navire qui naviguait à environ un mille devant nous était en train de sombrer. Deux autres navires, chassés de leurs ancres, ont quitté les routes pour prendre la mer, à tout hasard, et sans qu'aucun mât ne soit debout. Les navires légers s'en sortaient le mieux, car ils n'avaient pas à travailler autant sur la mer ; mais deux ou trois d'entre eux s'enfoncèrent et s'approchèrent de nous, s'enfuyant avec seulement leur voile de flèche déployée devant le vent.
Vers le soir, le second et le maître d'équipage ont supplié le capitaine de notre navire de les laisser couper le mât de misaine, ce qu'il n'a pas voulu faire ; mais le maître d'équipage lui a protesté que s'il ne le faisait pas, le navire sombrerait, et il a consenti ; et lorsqu'ils ont coupé le mât de misaine, le grand mât s'est tellement détaché et a tellement secoué le navire qu'ils ont été obligés de le couper aussi et de dégager le pont.
Chacun peut juger de l'état dans lequel je devais me trouver à ce moment-là, moi qui n'étais qu'un jeune marin et qui avais déjà eu une telle frayeur à un tout petit âge. Mais si je peux exprimer à cette distance les pensées qui m'habitaient à ce moment-là, j'étais dix fois plus horrifié par mes anciennes convictions et par le fait d'être revenu aux résolutions que j'avais malencontreusement prises au début, que par la mort elle-même ; et cela, ajouté à la terreur de la tempête, m'a mis dans un tel état que je ne saurais le décrire par aucun mot. Mais le pire n'était pas encore arrivé ; la tempête continua avec une telle fureur que les marins eux-mêmes reconnurent qu'ils n'avaient jamais vu pire. Nous avions un bon navire, mais il était très chargé et s'enfonçait dans la mer, si bien que les marins criaient de temps en temps qu'il allait sombrer. J'avais l'avantage de ne pas savoir ce qu'ils entendaient par fondre, jusqu'à ce que je m'en enquière. Cependant, la tempête était si violente que je vis, ce qu'on ne voit pas souvent, le capitaine, le maître d'équipage et quelques autres plus sensibles que les autres, en train de prier et s'attendant à chaque instant à ce que le navire coule à pic. Au milieu de la nuit, alors que nous étions en pleine détresse, l'un des hommes qui était descendu pour voir a crié qu'il y avait une fuite ; un autre a dit qu'il y avait un mètre cinquante d'eau dans la cale. On appela alors tout le monde à la pompe. À ce mot, mon cœur, comme je l'ai cru, est mort en moi et je suis tombé à la renverse sur le côté du lit où j'étais assis, dans la cabine. Cependant, les hommes me réveillèrent et me dirent que moi qui ne pouvais rien faire auparavant, j'étais aussi capable de pomper qu'un autre ; à ce moment-là, je me levai et me rendis à la pompe, où je travaillai de tout mon cœur. Pendant ce temps, le capitaine, voyant quelques petits colliers qui, incapables de résister à la tempête, étaient obligés de glisser et de courir vers la mer, et qui s'approchaient de nous, ordonna de tirer un coup de canon en signe de détresse. Moi qui ne savais pas ce qu'ils voulaient dire, j'ai cru que le navire s'était brisé ou qu'il était arrivé quelque chose d'épouvantable. En un mot, j'ai été tellement surpris que je suis tombé en pâmoison. Comme c'était une époque où tout le monde devait penser à sa propre vie, personne ne s'est soucié de moi, ni de ce que j'étais devenu ; mais un autre homme s'est approché de la pompe et, me repoussant du pied, m'a laissé étendu, me croyant mort ; et il s'est écoulé beaucoup de temps avant que je ne revienne à moi.
Nous continuâmes à travailler ; mais l'eau augmentant dans la cale, il était évident que le navire allait sombrer ; et bien que la tempête commençât à se calmer un peu, il n'était pas possible qu'il puisse nager jusqu'à ce que nous arrivions dans un port ; le capitaine continua donc à tirer des coups de canon pour demander de l'aide ; et un navire léger, qui s'était arrêté juste devant nous, osa sortir un bateau pour nous aider. Le bateau s'est approché de nous au prix de grands risques, mais il nous était impossible de monter à bord, et le bateau ne pouvait pas s'approcher du bord du navire, jusqu'à ce qu'enfin les hommes rament de bon cœur et risquent leur vie pour sauver la nôtre ; nos hommes leur ont jeté une corde sur la poupe avec une bouée, puis l'ont déviée sur une grande longueur, qu'ils ont saisie après beaucoup d'efforts et de risques, et nous les avons tirés sous notre poupe, et nous sommes tous montés dans leur bateau. Il ne servait à rien, ni à eux ni à nous, une fois dans le bateau, de songer à rejoindre leur propre navire ; aussi nous nous mîmes tous d'accord pour le laisser filer, et seulement pour le ramener vers le rivage autant que nous le pourrions ; et notre capitaine leur promit que si le bateau était arrimé au rivage, il le rendrait à leur maître : ainsi, en partie à la rame et en partie au moteur, notre bateau s'éloigna vers le nord, en inclinant vers le rivage presque jusqu'à Winterton Ness.
Nous n'avions pas quitté notre navire depuis plus d'un quart d'heure que nous le vîmes couler, et c'est alors que je compris pour la première fois ce que signifiait le naufrage d'un navire. Je dois reconnaître que j'ai à peine levé les yeux lorsque les marins m'ont dit qu'il coulait ; car, à partir du moment où ils m'ont mis dans le canot plutôt que de me laisser monter, mon cœur était comme mort en moi, en partie à cause de la frayeur, en partie à cause de l'horreur de l'esprit et de la pensée de ce qui m'attendait encore.
Pendant que nous étions dans cette situation - les hommes travaillant encore à la rame pour rapprocher le bateau du rivage - nous pouvions voir (lorsque, notre bateau montant sur les vagues, nous pouvions voir le rivage) un grand nombre de personnes courir le long de la plage pour nous aider lorsque nous nous en approcherions ; mais nous n'avancions que lentement vers le rivage ; et nous ne pûmes l'atteindre que lorsque, ayant dépassé le phare de Winterton, le rivage s'abaisse vers l'ouest, en direction de Cromer, et que la terre se détache un peu de l'eau sous l'effet de la violence du vent. C'est là que nous sommes entrés, et bien que ce ne soit pas sans difficulté, nous nous sommes mis en sécurité sur le rivage, et nous avons ensuite marché à pied jusqu'à Yarmouth, où, en tant que malheureux, nous avons été traités avec beaucoup d'humanité, aussi bien par les magistrats de la ville, qui nous ont assigné de bons quartiers, que par certains marchands et propriétaires de navires, et nous avons reçu de l'argent en quantité suffisante pour nous transporter soit à Londres, soit à Hull, comme nous le jugions bon.
Si j'avais eu le bon sens de retourner à Hull et de rentrer chez moi, j'aurais été heureux, et mon père, comme dans la parabole de notre bienheureux Sauveur, aurait même tué le veau gras pour moi ; car comme le bateau sur lequel j'étais parti avait été jeté dans les routes de Yarmouth, il lui fallut beaucoup de temps avant d'avoir l'assurance que je ne m'étais pas noyé.
Mais mon mauvais sort me poussait maintenant avec une obstination à laquelle rien ne pouvait résister ; et bien que ma raison et mon jugement plus serein m'aient plusieurs fois appelé à rentrer chez moi, je n'avais pas le pouvoir de le faire. Je ne sais comment appeler cela, et je ne prétendrai pas qu'il s'agit d'un décret secret qui nous pousse à être les instruments de notre propre destruction, même si elle est devant nous et que nous nous y précipitons les yeux ouverts. Il est certain que rien d'autre qu'une misère décrétée et inévitable, à laquelle il m'était impossible d'échapper, n'aurait pu me pousser à aller de l'avant contre les calmes raisonnements et persuasions de mes pensées les plus retirées, et contre deux instructions aussi visibles que celles que j'avais reçues lors de ma première tentative.
Mon camarade, qui avait contribué à m'endurcir auparavant, et qui était le fils du maître, était maintenant moins avancé que moi. La première fois qu'il m'adressa la parole après notre arrivée à Yarmouth, ce qui ne dura que deux ou trois jours, car nous étions séparés dans la ville par plusieurs quartiers, je dis bien la première fois qu'il me vit, il sembla que son ton avait changé ; Je dis que la première fois qu'il me vit, il me sembla que son ton avait changé ; et, d'un air très mélancolique et secouant la tête, il me demanda comment je me portais ; et, disant à son père qui j'étais, et comment je n'avais fait ce voyage que pour un essai, afin d'aller plus loin à l'étranger, son père, se tournant vers moi d'un ton très grave et très inquiet : "Jeune homme, dit-il, vous ne devriez plus jamais aller en mer ; vous devriez prendre cela pour un signe clair et visible que vous ne devez pas être un homme de mer"." "Pourquoi, monsieur", dis-je, "ne voulez-vous plus prendre la mer ?" "Mais comme vous avez fait ce voyage à titre d'essai, vous voyez quel goût le Ciel vous a donné de ce qui vous attend si vous persistez. C'est peut-être à cause de vous qu'il nous est arrivé tout cela, comme à Jonas dans le navire de Tarsis. Je vous en prie, poursuit-il, qui êtes-vous, et pour quelle raison avez-vous pris la mer ? Sur ce, je lui racontai une partie de mon histoire ; à la fin, il entra dans une étrange passion : "Qu'avais-je fait, dit-il, pour qu'un tel malheureux vienne sur mon navire ? Pour mille livres, je ne remettrais pas les pieds dans le même navire que toi." C'était là, comme je l'ai dit, une excursion de ses esprits, qui étaient encore agités par le sentiment de sa perte, et c'était plus loin qu'il n'avait le droit d'aller. Cependant, il me parla ensuite très gravement, m'exhortant à retourner auprès de mon père et à ne pas tenter la Providence pour ma ruine, me disant que je pourrais voir une main visible du Ciel contre moi. "Et, jeune homme, me dit-il, soyez-en sûr, si vous ne retournez pas, où que vous alliez, vous ne rencontrerez que désastres et déceptions, jusqu'à ce que les paroles de votre père s'accomplissent sur vous.
Nous nous séparâmes peu après, car je ne lui répondis pas grand-chose et je ne le revis plus ; je ne savais pas quel chemin il avait pris. Quant à moi, ayant un peu d'argent dans ma poche, je me rendis à Londres par voie de terre, et là, ainsi que sur la route, j'eus de nombreux combats avec moi-même pour savoir quel cours de vie je devais prendre, et si je devais rentrer chez moi ou prendre la mer.
Pour ce qui est de rentrer à la maison, la honte s'opposa à la meilleure motion qui s'offrit à mes pensées, et il me vint immédiatement à l'esprit qu'on se moquerait de moi parmi les voisins, et que j'aurais honte de voir, non seulement mon père et ma mère, mais même tout le monde ; d'où j'ai souvent observé depuis, combien le tempérament commun de l'humanité est incongru et irrationnel, surtout chez les jeunes, par rapport à la raison qui devrait les guider dans de tels cas, à savoir qu'ils n'ont pas honte de pécher, et qu'ils ont pourtant honte de se repentir. Ils n'ont pas honte de pécher, mais ils ont honte de se repentir ; ils n'ont pas honte de l'action pour laquelle ils devraient à juste titre être considérés comme des imbéciles, mais ils ont honte du retour, qui seul peut les faire considérer comme des sages.
Dans cet état de vie, cependant, je suis resté quelque temps, incertain des mesures à prendre et du cours de la vie à mener. Une irrésistible réticence me poussait à rentrer chez moi ; et comme je restais un peu à l'écart, le souvenir de la détresse dans laquelle j'avais été plongé s'estompait, et à mesure qu'il s'estompait, le peu de mouvement que j'avais dans mon désir de rentrer s'estompait avec lui, jusqu'à ce qu'enfin je mette tout à fait de côté mes pensées et que je cherche à partir en voyage.
CHAPITRE II. L'ESCLAVAGE ET LA FUITE
L'influence néfaste qui m'a d'abord éloigné de la maison paternelle, qui m'a précipité dans l'idée folle et indigeste d'accroître ma fortune, et qui a imprimé ces idées si fortement en moi qu'elles m'ont rendu sourd à tous les bons conseils, aux supplications et même aux ordres de mon père, cette même influence, quelle qu'elle soit, m'a présenté la plus malheureuse de toutes les entreprises, et je me suis embarqué sur un navire à destination de la côte d'Afrique, ou, comme nos marins l'appelaient vulgairement, un voyage vers la Guinée.
Mon grand malheur fut de ne pas m'être embarqué comme marin dans toutes ces aventures, alors que, même si j'avais travaillé un peu plus dur qu'à l'ordinaire, j'aurais appris en même temps le devoir et la fonction d'un homme de mât de misaine et, avec le temps, j'aurais pu me qualifier pour un second ou un lieutenant, sinon pour un capitaine. Mais comme c'était toujours mon destin de choisir le pire, j'ai fait de même ici ; car ayant de l'argent en poche et de bons vêtements sur le dos, j'allais toujours à bord avec l'habit d'un gentleman ; et ainsi je n'avais rien à faire sur le navire, et je n'ai pas appris à en faire.
J'eus tout d'abord la chance de tomber en assez bonne compagnie à Londres, ce qui n'arrive pas toujours à des jeunes gens aussi libres et malavisés que je l'étais alors, le diable n'omettant généralement pas de leur tendre quelque piège très tôt ; mais il n'en fut pas ainsi pour moi. Je fis d'abord la connaissance du capitaine d'un navire qui avait été sur la côte de Guinée et qui, ayant eu beaucoup de succès là-bas, était résolu à y retourner. Ce capitaine, prenant goût à ma conversation, qui n'était pas du tout désagréable à cette époque, m'ayant entendu dire que j'avais l'intention de voir le monde, me dit que si je voulais faire le voyage avec lui, je n'aurais rien à débourser ; je serais son camarade et son compagnon ; et si je pouvais emporter quelque chose avec moi, j'en aurais tout l'avantage que le commerce admettrait ; et peut-être recevrais-je quelque encouragement.
J'acceptai l'offre et, me liant d'amitié avec ce capitaine, qui était un homme honnête et simple, je fis le voyage avec lui et emportai avec moi une petite aventure que, grâce à l'honnêteté désintéressée de mon ami le capitaine, j'augmentai considérablement, car j'emportai environ 40 livres sterling en jouets et en bagatelles que le capitaine m'avait demandé d'acheter. Ces 40 livres, je les avais rassemblées grâce à l'aide de certaines de mes relations avec lesquelles je correspondais et qui, je crois, avaient obtenu de mon père, ou du moins de ma mère, qu'ils contribuent autant que cela à ma première aventure.
Ce fut le seul voyage dont je puisse dire qu'il fut couronné de succès dans toutes mes aventures, ce que je dois à l'intégrité et à l'honnêteté de mon ami le capitaine ; sous sa direction, j'ai acquis une bonne connaissance des mathématiques et des règles de la navigation, j'ai appris à tenir le compte de la route du navire, à faire des observations, et, en un mot, à comprendre certaines choses qu'il est nécessaire de comprendre pour un marin ; En un mot, ce voyage a fait de moi à la fois un marin et un marchand, car j'ai rapporté de mon aventure cinq livres et neuf onces de poudre d'or, ce qui m'a rapporté à Londres, à mon retour, près de 300 livres sterling, et cela m'a inspiré ces aspirations qui ont depuis lors si bien achevé ma ruine.
Cependant, même au cours de ce voyage, j'eus aussi mes malheurs ; en particulier, je fus continuellement malade, étant jeté dans une violente calenture par la chaleur excessive du climat ; notre principal commerce se faisait sur la côte, depuis la latitude de 15 degrés nord jusqu'à la ligne elle-même.
Mon ami étant mort peu après son arrivée, pour mon plus grand malheur, je résolus de refaire le même voyage, et je m'embarquai sur le même navire avec celui qui avait été son second lors du précédent voyage, et qui avait maintenant pris le commandement du navire. Ce fut le voyage le plus malheureux que l'homme ait jamais fait, car bien que je n'aie pas emporté tout à fait 100 livres sterling de ma nouvelle fortune, et qu'il me restât 200 livres sterling, que j'avais logées chez la veuve de mon ami, qui était très juste envers moi, je tombai dans de terribles malheurs. Le premier fut le suivant : notre navire, qui faisait route vers les îles Canaries, ou plutôt entre ces îles et la côte africaine, fut surpris au petit matin par un rover turc de Sallee, qui nous poursuivit avec toute la voilure qu'il pouvait déployer. Nous entassâmes aussi toute la toile que nos vergues pouvaient déployer ou que nos mâts pouvaient porter, pour nous dégager ; mais comme le pirate nous rattrapait et qu'il nous rejoindrait certainement dans quelques heures, nous nous préparâmes à combattre ; notre navire avait douze canons, et le voyou dix-huit. Vers trois heures de l'après-midi, il s'approcha de nous et, se plaçant par erreur juste devant notre hanche, au lieu de notre poupe, comme il l'avait prévu, nous fîmes porter huit de nos canons de ce côté et le bombardâmes, ce qui le fit repartir, après avoir riposté à nos tirs et à ceux de près de deux cents hommes qu'il avait à son bord. Cependant, nous n'avons pas été touchés par un seul homme, tous nos hommes étant restés à proximité. Il se prépara à nous attaquer de nouveau, et nous à nous défendre. Mais en nous abordant la fois suivante sur notre autre quartier, il fit monter soixante hommes sur nos ponts, qui se mirent immédiatement à découper et à tailler les voiles et le gréement. Nous les avons harcelés avec de la grenaille, des demi-piques, des poudrières et d'autres objets semblables, et nous les avons débarrassés de notre pont à deux reprises. Cependant, pour abréger cette partie mélancolique de notre histoire, notre navire étant désemparé, trois de nos hommes tués et huit blessés, nous avons été obligés de céder et avons été emmenés tous prisonniers à Sallee, un port appartenant aux Maures.
L'usage que j'en fis ne fut pas aussi terrible que je l'avais d'abord craint ; je ne fus pas non plus emmené à la cour de l'empereur, comme le furent le reste de nos hommes, mais je fus gardé par le capitaine du rover comme son propre prix, et je devins son esclave, étant jeune et agile, et apte à faire son travail. Ce changement surprenant de ma situation, d'un marchand à un misérable esclave, m'a complètement bouleversé, et j'ai repensé au discours prophétique de mon père, qui m'avait dit que je serais misérable et que je n'aurais personne pour me soulager, et j'ai pensé que cela s'était maintenant si bien réalisé que je ne pouvais pas être pire, car maintenant la main du Ciel m'avait rattrapé, et j'étais perdu sans rédemption ; mais, hélas ! Mais hélas, ce n'était qu'un avant-goût de la misère que j'allais connaître, comme on le verra dans la suite de cette histoire.
Comme mon nouveau patron, ou maître, m'avait emmené chez lui, j'espérais qu'il m'emmènerait avec lui lorsqu'il repartirait en mer, pensant que son destin serait un jour ou l'autre d'être capturé par un navire espagnol ou portugais, et qu'alors je serais libéré. Mais cet espoir s'est vite envolé, car lorsqu'il est parti en mer, il m'a laissé sur le rivage pour m'occuper de son petit jardin et faire les corvées courantes des esclaves dans sa maison ; et lorsqu'il est rentré de sa croisière, il m'a ordonné de rester dans la cabine pour veiller sur le navire.
Ici, je ne pensais qu'à mon évasion et à la méthode que je pourrais employer pour la réaliser, mais je ne trouvais aucun moyen qui eût la moindre probabilité, rien qui pût rendre l'hypothèse rationnelle, car je n'avais personne à qui la communiquer et qui voulût s'embarquer avec moi - aucun compagnon d'esclavage, aucun Anglais, Irlandais ou Écossais à part moi-même ; de sorte que pendant deux ans, bien que je me fusse souvent réjoui de mon imagination, je n'eus jamais la moindre perspective encourageante de mettre cette idée en pratique.
Au bout de deux ans environ, une circonstance étrange s'est présentée, qui m'a remis en tête l'idée de tenter de recouvrer ma liberté. Mon patron étant resté à la maison plus longtemps que d'habitude sans équiper son navire, ce qui, comme je l'ai entendu dire, était dû à un manque d'argent, il avait l'habitude, une ou deux fois par semaine, parfois plus souvent si le temps était beau, de prendre la pinasse du navire et d'aller pêcher sur la route ; Et comme il nous emmenait toujours, le jeune Maresco et moi, pour ramer sur le bateau, nous le rendions très joyeux, et je me montrais très adroit pour attraper le poisson ; si bien que parfois il m'envoyait avec un Maure, un de ses parents, et le jeune - le Maresco, comme ils l'appelaient - pour attraper un plat de poisson pour lui.
Une fois, alors que nous étions à la pêche par un matin calme, un brouillard se leva si épais que nous perdîmes de vue le rivage alors que nous n'en étions pas à une demi-lieue ; nous ramâmes sans savoir où ni dans quelle direction, et nous travaillâmes toute la journée et toute la nuit suivante ; le matin venu, nous nous aperçûmes que nous avions tiré vers la mer au lieu de tirer vers le rivage, et que nous étions au moins à deux lieues du rivage. Cependant, nous nous sommes remis à l'eau, bien qu'avec beaucoup de travail et quelques dangers, car le vent s'est mis à souffler assez fort le matin, mais nous avions tous très faim.
Mais notre protecteur, averti par ce désastre, résolut de prendre davantage soin de lui à l'avenir ; et, ayant près de lui la chaloupe de notre navire anglais qu'il avait prise, il résolut de ne plus aller à la pêche sans une boussole et quelques provisions ; Il ordonna donc au charpentier de son navire, qui était aussi un esclave anglais, de construire au milieu de la chaloupe une petite salle ou cabine, comme celle d'un chaland, avec un endroit où l'on pouvait se tenir derrière pour gouverner et tirer l'écoute principale ; devant, il y avait de la place pour un ou deux hommes qui se tenaient debout et qui manœuvraient les voiles. Elle naviguait avec ce que nous appelons une voile d'épaule de mouton, et la bôme passait par-dessus le toit de la cabine, qui était très confortable et basse, et qui contenait de la place pour s'allonger, avec un ou deux esclaves, et une table pour manger, avec quelques petits casiers pour y mettre des bouteilles d'alcool qu'il jugeait bon de boire, ainsi que son pain, son riz et son café.
Nous allions souvent à la pêche avec ce bateau, et comme j'étais très habile à prendre du poisson pour lui, il ne partait jamais sans moi. Il arriva qu'il avait décidé d'aller sur ce bateau, soit pour le plaisir, soit pour la pêche, avec deux ou trois Maures de quelque distinction en ce lieu, et pour lesquels il avait fait des provisions extraordinaires ; il avait donc envoyé à bord du bateau, pendant la nuit, un plus grand nombre de provisions qu'à l'ordinaire ; et il m'avait ordonné de préparer trois fusées avec de la poudre et de la grenaille, qui se trouvaient à bord de son navire, parce qu'ils voulaient s'amuser à faire de la chasse à l'oiseau aussi bien qu'à faire de la pêche.
J'ai tout préparé comme il me l'avait demandé et j'attendais le lendemain matin avec le bateau lavé, ses antiques et ses pendentifs enlevés, et tout ce qu'il fallait pour accueillir ses invités ; quand, à un moment donné, mon patron est monté seul à bord et m'a dit que ses invités avaient différé leur départ à cause d'une affaire qui était tombée, et m'a ordonné, avec l'homme et le garçon, comme d'habitude, de sortir avec le bateau et de leur prendre du poisson, car ses amis devaient souper chez lui, et il m'a ordonné que dès que j'aurais du poisson, je le ramène chez lui ; ce que je me suis préparé à faire.
C'est à ce moment-là que mes anciennes notions de délivrance revinrent à l'esprit, car je me rendais compte que j'allais avoir un petit navire à ma disposition. Mon maître étant parti, je me préparai à m'équiper, non pas pour pêcher, mais pour voyager, bien que je ne sache pas, et que je n'y pense même pas, vers où je devais me diriger - mon désir était de sortir de cet endroit.
Mon premier soin fut de faire semblant de parler à ce Maure, afin d'obtenir quelque chose pour notre subsistance à bord ; car je lui dis que nous ne devions pas avoir la prétention de manger le pain de notre protecteur. Il répondit que c'était vrai, et il apporta dans le bateau un grand panier de biscottes ou de biscuits, et trois jarres d'eau fraîche. Je savais où se trouvait la caisse de bouteilles de mon patron, dont il était évident, d'après la marque, qu'elle provenait d'une prise anglaise, et je les transportai dans le bateau pendant que le Maure était sur le rivage, comme si elles y avaient été auparavant pour notre maître. Je fis aussi monter dans le bateau un gros morceau de cire d'abeille, qui pesait environ un demi-centième de poids, ainsi qu'un paquet de ficelle ou de fil, une hachette, une scie et un marteau, toutes choses qui nous furent fort utiles par la suite, surtout la cire, pour faire des chandelles. J'essayai de lui jouer un autre tour, auquel il se prêta innocemment : il s'appelait Ismaël, qu'ils nomment Muley ou Moely ; je l'appelai donc : "Moely, dis-je, les fusils de notre protecteur sont à bord du bateau ; ne peux-tu pas te procurer un peu de poudre et de grenaille ? Peut-être pourrons-nous tuer quelques alcamies (volailles semblables à nos courlis) pour nous-mêmes, car je sais qu'il garde les provisions de l'artilleur à bord du navire. "Oui, dit-il, je vais en apporter ; et en conséquence il apporta un grand sac de cuir qui contenait une livre et demie de poudre, ou plutôt plus, et un autre contenant de la grenaille, qui en contenait cinq ou six livres, avec quelques balles, et il mit le tout dans le bateau. En même temps, j'avais trouvé dans la grande cabine un peu de la poudre de mon maître, avec laquelle je remplis une des grandes bouteilles de la caisse, qui était presque vide, et je versai ce qu'elle contenait dans une autre ; et ainsi pourvus de tout ce qui était nécessaire, nous quittâmes le port pour aller à la pêche. Le château, qui se trouve à l'entrée du port, savait qui nous étions, et ne fit aucune attention à nous ; nous n'étions pas à plus d'un mille du port que nous hissâmes nos voiles et nous mîmes à pêcher. Le vent soufflait du nord-nord-est, ce qui était contraire à mon désir, car s'il avait soufflé du sud, j'aurais été sûr de gagner la côte d'Espagne, et au moins d'atteindre la baie de Cadix ; mais mes résolutions étaient les suivantes : quel que soit le vent, je quitterais l'horrible endroit où je me trouvais, et je laisserais le reste au destin.
Après avoir pêché quelque temps sans rien prendre - car lorsque j'avais des poissons à l'hameçon, je ne les remontais pas pour qu'il ne les vît pas - je dis au Maure : "Cela n'ira pas ; notre maître ne veut pas être servi de la sorte ; nous devons nous tenir plus loin." Comme je tenais la barre, je fis avancer le bateau d'une lieue, puis je le ramenai comme si je voulais pêcher ; alors, donnant la barre au garçon, je m'avançai jusqu'à l'endroit où se trouvait le Maure, et, faisant mine de me pencher pour chercher quelque chose derrière lui, je le pris par surprise avec mon bras sous sa taille, et je le jetai par-dessus bord dans la mer. Il se releva immédiatement, car il nageait comme un bouchon, et il m'appela, me supplia de l'embarquer, me dit qu'il ferait le tour du monde avec moi. Il nagea si fort après le bateau qu'il m'aurait atteint très vite, car il n'y avait pas beaucoup de vent ; alors je montai dans la cabine et, prenant une des pièces de chasse, je la lui présentai en lui disant que je ne lui avais fait aucun mal et que, s'il se tenait tranquille, je ne lui en ferais pas non plus. "Mais, lui dis-je, vous nagez assez bien pour atteindre le rivage, et la mer est calme ; faites de votre mieux pour atteindre le rivage, et je ne vous ferai aucun mal ; mais si vous vous approchez du bateau, je vous tire une balle dans la tête, car je suis résolu à recouvrer ma liberté ;" alors il se retourna et nagea vers le rivage, et je ne doute pas qu'il ne l'atteignit facilement, car c'était un excellent nageur.
J'aurais pu me contenter d'emmener ce Maure avec moi et de noyer le garçon, mais je n'ai pas osé lui faire confiance. Quand il fut parti, je me tournai vers le garçon, qu'ils appelaient Xury, et je lui dis : "Xury, si tu me restes fidèle, je ferai de toi un grand homme ; mais si tu ne te frappes pas le visage pour me rester fidèle - c'est-à-dire si tu ne jures pas par Mahomet et par la barbe de son père -, je te jetterai aussi à la mer." Le garçon me sourit et me parla si innocemment que je ne pus me méfier de lui, et il me jura de m'être fidèle et de parcourir le monde avec moi.
Tandis que j'étais en vue du Maure qui nageait, je me tins directement au large avec le bateau, en m'étirant plutôt au vent, afin qu'on pût me croire parti vers l'embouchure du détroit (comme devait le penser, en effet, toute personne qui avait eu l'esprit tranquille) : Car qui aurait pu croire que nous naviguions vers le sud, vers une côte vraiment barbare, où des nations entières de nègres étaient sûres de nous entourer de leurs canots et de nous détruire ; où nous ne pouvions pas aller sur le rivage sans être dévorés par des bêtes sauvages, ou par des sauvages encore plus impitoyables de l'espèce humaine.
Mais dès que le soir tomba, je changeai de cap et me dirigeai directement vers le sud et l'est, en infléchissant un peu ma route vers l'est, afin de me rapprocher du rivage ; J'eus un bon vent frais et une mer douce et tranquille, et je fis une telle route que je crois que le lendemain, à trois heures de l'après-midi, quand je touchai la terre pour la première fois, je n'étais pas à moins de cent cinquante milles au sud de Sallee, bien au-delà des possessions de l'empereur du Maroc, ou même de tout autre roi de la région, car nous ne vîmes aucun habitant.
Cependant, j'avais tellement peur des Maures, et je craignais tellement de tomber entre leurs mains, que je ne voulais ni m'arrêter, ni aller sur le rivage, ni jeter l'ancre ; le vent continua à souffler jusqu'à ce que j'aie navigué de cette manière pendant cinq jours ; Je me risquai donc à gagner la côte, et je jetai l'ancre à l'embouchure d'une petite rivière, dont je ne connaissais ni la latitude, ni le pays, ni la nation, ni le cours d'eau. Je ne voyais ni ne désirais voir aucun peuple ; ce que je désirais avant tout, c'était de l'eau fraîche. Nous arrivâmes à cette crique le soir, résolus à nager sur le rivage dès que la nuit serait tombée et à découvrir le pays ; mais dès que la nuit fut tout à fait tombée, nous entendîmes des bruits si épouvantables d'aboiements, de rugissements et de hurlements de créatures sauvages, de nous ne savons quelle espèce, que le pauvre garçon était prêt à mourir de peur et me supplia de ne pas aller sur le rivage jusqu'au jour. "Eh bien, Xury, dis-je, je ne le ferai pas ; mais il se peut que nous voyions des hommes dans la journée, qui seront aussi méchants pour nous que ces lions". "Alors nous leur donnerons le fusil de chasse", dit Xury en riant, "et nous les ferons courir." Xury parlait un tel anglais en conversant avec nous, les esclaves. Cependant, j'étais heureux de voir le garçon si joyeux, et je lui donnai un verre (tiré de la caisse de bouteilles de notre patron) pour le réconforter. Après tout, le conseil de Xury était bon, et je le suivis ; nous jetâmes notre petite ancre et restâmes tranquilles toute la nuit ; je dis tranquilles, car nous ne dormîmes pas ; car en deux ou trois heures, nous vîmes d'énormes créatures (nous ne savions pas comment les appeler) de toutes sortes descendre sur le rivage de la mer et courir dans l'eau, se vautrer et se laver pour le plaisir de se rafraîchir ; elles poussaient des hurlements et des cris si affreux que je n'en ai jamais entendu de pareils.
Xury était terriblement effrayé, et moi aussi d'ailleurs ; mais nous le fûmes encore plus lorsque nous entendîmes l'une de ces puissantes créatures s'approcher à la nage de notre bateau ; nous ne pouvions pas la voir, mais nous pouvions l'entendre, car elle soufflait comme une bête monstrueuse, énorme et furieuse. Xury dit que c'était un lion, et il se peut que ce soit le cas pour ce que j'en sais ; mais le pauvre Xury me cria de lever l'ancre et de ramer ; "Non, dis-je, Xury ; nous pouvons glisser notre câble, avec la bouée, et prendre le large ; ils ne peuvent pas nous suivre bien loin." A peine avais-je dit cela, que je vis la créature (quelle qu'elle fût) à moins de deux avirons, ce qui me surprit quelque peu ; cependant, je m'approchai immédiatement de la porte de la cabine, et, prenant mon fusil, je tirai sur elle ; sur quoi elle se retourna immédiatement et se remit à nager vers le rivage.
Mais il est impossible de décrire les bruits horribles, les cris hideux et les hurlements qui s'élevaient, aussi bien sur le bord du rivage que plus haut dans la campagne, au bruit ou au rapport du canon, chose que j'ai quelque raison de croire que ces créatures n'avaient jamais entendue auparavant : Cela me convainquit qu'il n'était pas question pour nous d'aller à terre la nuit sur cette côte, et comment s'y aventurer le jour était une autre question ; car tomber entre les mains de l'un ou l'autre des sauvages aurait été aussi grave que de tomber entre les mains des lions et des tigres ; du moins, nous étions tout aussi inquiets du danger que cela représentait.
Quoi qu'il en soit, nous étions obligés d'aller chercher de l'eau sur le rivage d'une manière ou d'une autre, car il ne nous en restait plus une pinte dans le bateau ; la question était de savoir où et quand y parvenir. Xury me dit que si je le laissais aller sur le rivage avec une des jarres, il irait voir s'il y a de l'eau et m'en rapporterait. Je lui demandai pourquoi il irait, pourquoi je n'irais pas et pourquoi il resterait dans le bateau. Le garçon m'a répondu avec tant d'affection que je l'ai aimé pour toujours. Il a dit : "Si les hommes sauvages viennent, ils me mangeront, tu vas voir." "Eh bien, Xury, dis-je, nous irons tous les deux et si les hommes sauvages viennent, nous les tuerons et ils ne mangeront ni l'un ni l'autre." Je donnai donc à Xury un morceau de pain à manger et un verre de la caisse de bouteilles de notre protecteur dont j'ai parlé plus haut ; nous hissâmes le bateau aussi près du rivage que nous le jugions convenable et nous gagnâmes le rivage à pied, n'emportant rien d'autre que nos bras et deux jarres pour l'eau.
Je ne voulais pas m'éloigner de la vue du bateau, craignant que des canoës avec des sauvages ne descendent la rivière ; mais le garçon, voyant un endroit bas à environ un mille dans la campagne, s'y rendit, et peu après, je le vis venir vers moi en courant. Je pensais qu'il était poursuivi par un sauvage ou effrayé par une bête sauvage, et j'ai couru vers lui pour l'aider ; mais quand je me suis approché de lui, j'ai vu quelque chose qui pendait sur ses épaules, c'était une créature qu'il avait tuée, comme un lièvre, mais de couleur différente et avec des pattes plus longues ; cependant, nous en étions très contents, et c'était de la très bonne viande ; mais la grande joie du pauvre Xury a été de me dire qu'il avait trouvé de la bonne eau et qu'il n'avait pas vu d'hommes sauvages.
Mais nous nous aperçûmes par la suite que nous n'avions pas à nous donner tant de mal pour trouver de l'eau, car un peu plus haut dans le ruisseau où nous étions, nous trouvâmes de l'eau douce quand la marée était basse, qui coulait un peu plus haut ; nous remplîmes donc nos jarres, nous nous régalâmes du lièvre qu'il avait tué et nous nous préparâmes à poursuivre notre route, n'ayant vu aucun pas d'une créature humaine dans cette partie du pays.