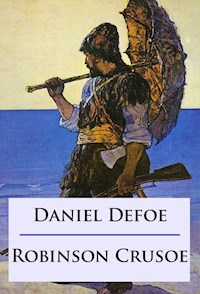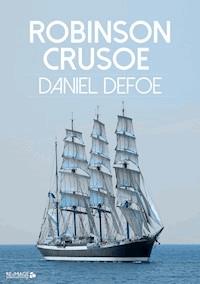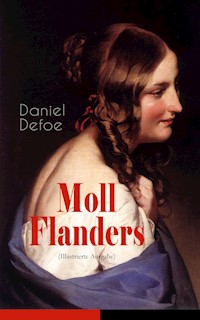12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,36 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,36 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Née à Poitiers, de parents protestants, Roxane est venue en Angleterre en 1683 avec ses parents qui fuyaient devant la persécution. Très belle, elle épouse à quinze ans un riche brasseur. Après huit ans d'une vie assez brillante, son mari prend la fuite pour éviter la faillite. La jeune femme est réduite à la misère. Elle confie ses enfants à ses beaux-parents et devient la maîtresse de son propriétaire, sa servante, Amy, jouant le rôle décisif de l'entremetteuse. Le couple est parfaitement assorti et va s'établir à Paris, où Roxane devient rapidement célèbre pour sa beauté.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniel
Lady Roxana
table des matières
PRÉFACE
L’histoire de cette belle dame porte avec elle son propre témoignage. Si elle n’est pas aussi belle que la dame même est représentée l’être, si elle n’est pas aussi divertissante que le lecteur le peut désirer, ni beaucoup plus qu’il ne peut raisonnablement s’y attendre, et si toutes les parties les plus divertissantes n’en sont pas appropriées à l’instruction et au perfectionnement du lecteur, le narrateur déclare que ce doit être la faute de son récit ; il aura habillé l’histoire de vêtements inférieurs à ceux que la dame dont il rapporte les paroles, préparait pour l’offrir au monde.
Il prend la liberté de dire que ce récit diffère de la plupart des pièces contemporaines de ce genre, bien que quelques-unes d’entre elles aient rencontré dans le monde un très bon accueil. Je dis qu’il en diffère en un point considérable et essentiel, à savoir qu’il est fondé sur la vérité des faits ; de sorte que l’œuvre n’est pas un conte, mais une histoire.
La scène est placée si près du lieu où la partie principale de l’action s’est passée, qu’il a été nécessaire de déguiser les noms et les personnages, de peur que le souvenir d’événements, qui ne sauraient être encore complètement oubliés dans ce quartier de la ville, ne soit ravivé, et que les faits ne puissent être restitués trop clairement par bon nombre de gens vivant encore aujourd’hui, qui, par les détails, reconnaîtraient les personnages.
Il n’est pas toujours nécessaire que les noms des personnages se découvrent, et l’histoire peut n’en être pas moins utile de mainte façon. Si nous étions toujours obligé ou de nommer les personnages, ou de ne pas faire le récit, il en résulterait cette seule conséquence : c’est que beaucoup d’histoires agréables et charmantes seraient ensevelies dans l’ombre, et que le monde serait à la fois privé du plaisir et du profit qu’il y trouve.
L’auteur déclare qu’il connaissait particulièrement le premier mari de cette dame, le brasseur, et son père, et aussi ses difficultés d’argent ; et il sait que toute cette première partie du récit est vraie.
Ceci peut, il l’espère, être une garantie de la bonne foi du reste, bien que la fin de l’histoire se passe à l’étranger et ne puisse pas être si facilement attestée que le commencement. Cependant, comme c’est la dame elle-même qui l’a racontée, nous avons d’autant moins de motifs de mettre en doute la vérité de cette dernière partie.
À la manière dont elle raconte son histoire, il est évident qu’elle n’insiste nulle part pour se justifier. Encore moins offret-elle sa conduite, ou même aucun trait de sa conduite, si ce n’est son repentir, comme modèle à imiter. Au contraire, elle fait de fréquentes digressions pour censurer et condamner justement ses propres actes. Combien de fois ne s’adresse-t-elle pas les reproches les plus passionnés, nous fournissant des réflexions pleines de justesse pour les cas semblables !
Il est vrai qu’elle a trouvé un succès inespéré dans toutes ses fautes. Mais même dans la plus grande élévation de sa prospérité, elle reconnaît fréquemment que les plaisirs dus à sa mauvaise conduite ne valaient pas le repentir, et que toute les satisfactions qu’elle avait, toute sa joie en présence de sa fortune, non, pas même toute l’opulence où elle nageait, ni son éclat extérieur, ni l’appareil et les honneurs qui l’accompagnaient, ne pouvaient calmer son esprit, ni faire taire les reproches de sa conscience, ou lui procurer une heure de sommeil, lorsque de justes réflexions la tenaient éveillée.
Les généreuses déductions qui se tirent de cette partie de l’histoire valent autant que tout le reste, et, étant le but avoué de la publication, la justifient pleinement.
S’il y a des passages dans ce récit où, étant obligé de rapporter une action mauvaise, on semble la décrire trop clairement, l’auteur déclare qu’on a pris tout le soin imaginable de se garder des indécences et des expressions immodestes ; et l’on espère que vous n’y trouverez rien qui puisse exciter un esprit vicieux, mais que vous y trouverez, au contraire, à chaque page, beaucoup pour le décourager et le confondre.
Les scènes de crime ne peuvent guère être représentées de manière que quelques-uns n’en fassent un criminel usage. Mais lorsque le vice est peint sous ses viles couleurs, ce n’est pas pour le faire aimer, mais pour l’exposer au mépris ; et si le lecteur fait un mauvais usage d’un tel tableau, la méchanceté lui en appartient tout entière.
D’un autre côté, les avantages du présent ouvrage sont si grands, et le lecteur vertueux y trouvera l’occasion de tant de perfectionnements, que nous ne faisons pas de doute que ce récit, quelque médiocrement raconté qu’il soit, ne pénètre jusqu’à lui dans ses meilleures heures de loisir, et ne soit lu avec délices et profit à la fois.
CHAPITRE I er
SOMMAIRE. – Je suis mariée à un riche brasseur. – Mort de mon père et du père de mon mari. – Mystérieuse disparition de mon mari. – Je vends mes effets pour vivre. – Attachement de ma servante, Amy. – Conseils de deux amies. – Mes enfants sont envoyés à leur tante. – Conduite haineuse de la tante. – Caractère aimable de l’oncle. – Générosité de mon propriétaire. – Mon propriétaire dîne avec moi. – Le mobilier de ma maison est restauré. – Déclaration d’amour. – Mon propriétaire devient mon locataire. – Le piège de la pauvreté. – Je me résous à partager le lit de mon propriétaire. – Nous nous prenons comme époux.
Je suis née, comme je l’ai appris de mes amis, dans la ville de Poitiers, province ou comté de Poitou, en France, d’où je fus amenée en Angleterre par mes parents, qui s’enfuirent à cause de leur religion vers l’an 1683, époque où les protestants furent bannis de France par la cruauté de leurs persécuteurs.
Moi, qui ne savais que peu de chose, ou rien du tout, de ce qui m’avait fait amener ici, j’étais assez contente de m’y trouver. Londres, ville grande et gaie, me plut infiniment ; car, en ma qualité d’enfant, j’aimais la foule, et à voir beaucoup de beau monde.
Je ne conservai rien de la France que le langage, mon père et ma mère étant de meilleur ton que ne l’étaient ordinairement, en ce temps-là, ceux qu’on appelle réfugiés. Ayant fui de bonne heure, lorsqu’il était encore facile de réaliser leurs ressources, ils avaient, avant leur traversée, envoyé ici des sommes importantes, ou, autant que je m’en souviens, des valeurs considérables en eau-de-vie de France, papier et autres marchandises. Tout cela se vendit dans des conditions très avantageuses, et mon père se trouva fort à l’aise en arrivant, de sorte qu’il s’en fallait qu’il eût à s’adresser aux autres personnes de notre nation qui étaient ici, pour en obtenir protection ou secours. Au contraire, sa porte était continuellement assiégée d’une foule de pauvres misérables créatures mourant de faim, qui, en ce temps-là, s’étaient réfugiées ici, pour des raisons de conscience ou pour quelque autre cause.
J’ai même entendu mon père dire qu’il était harcelé par bien des gens qui, pour la religion qu’ils avaient, auraient aussi bien pu rester où ils étaient auparavant. Mais ils accouraient ici par troupeaux, pour y trouver ce qu’on appelle en anglais a livelihood, c’est-à-dire leur subsistance, ayant appris que les réfugiés étaient reçus à bras ouverts en Angleterre, qu’ils trouvaient promptement de l’ouvrage, car la charité du peuple de Londres leur facilitait les moyens de travailler dans les manufactures de Spitalfields, de Canterbury et autres lieux, – qu’ils avaient pour leur travail un salaire bien plus élevé qu’en France, et autres choses semblables.
Mon père, disais-je, m’a raconté qu’il était plus harcelé des cris de ces gens-là que de ceux qui étaient de vrais réfugiés, ayant fui dans la misère pour obéir à leur conscience.
J’avais à peu près dix ans lorsqu’on m’amena dans ce pays où, comme je l’ai dit, mon père vécut fort à l’aise, et où il mourut environ onze ans plus tard. Pendant ce temps, je m’étais formée pour la vie mondaine, et liée avec quelques-unes de nos voisines anglaises, comme c’est la coutume à Londres. Tout enfant, j’avais choisi trois ou quatre compagnes et camarades de jeux d’un âge assorti au mien, de sorte qu’en grandissant nous nous habituâmes à nous appeler amies et intimes ; et ceci contribua beaucoup à me perfectionner pour la conversation et pour le monde.
J’allais à des écoles anglaises, et, comme j’étais jeune, j’appris la langue parfaitement bien, ainsi que toutes les manières des jeunes filles anglaises. Je ne conservai donc rien des Françaises que la connaissance du langage ; encore n’allai-je pas jusqu’à garder des restes de locutions françaises cousues dans mes discours, comme la plupart des étrangers ; mais je parlais ce que nous appelons le pur anglais, aussi bien que si j’étais née ici.
Puisque j’ai à donner la description de ma personne, il faut qu’on m’excuse de la donner aussi impartialement que possible, et comme si je parlais d’une autre. La suite vous fera juger si je me flatte ou non.
J’étais (je parle de moi lorsque j’avais environ quatorze ans) grande, et très bien faite ; d’une sagacité de faucon dans les questions qui ne dépassent pas le niveau ordinaire des connaissances ; prompte et vive dans mes discours, portée à la satire, toujours prête à la repartie, et un peu trop libre dans la conversation, ou, comme nous disons en anglais, un peu trop hardie (bold), bien que d’une modestie parfaite dans ma conduite. Étant née Française, je devais danser, comme quelques-uns le prétendent, naturellement ; en effet, j’aimais extrêmement la danse ; je chantais bien également, et si bien que, comme vous le verrez, cela me fut plus tard de quelque avantage. Avec tout cela, je ne manquais ni d’esprit, ni de beauté, ni d’argent. C’est ainsi que j’entrai dans le monde, possédant tous les avantages qu’une jeune femme pouvait désirer pour se faire bien venir des autres et se promettre une vie heureuse pour l’avenir.
Je me considérais comme heureuse lorsqu’il eut trouvé quelqu’un à qui céder la brasserie. Là dessus la servante se mit en devoir de retourner. « Tenez, enfant, dit Amy, donnez la main à l’un d’eux, et je mènerai le reste. » Amy et elle avaient concerté ceci entre elles, et c’était assez bien imaginé. « Madame, je reviendrai une autre fois. Je vois que vous êtes occupée. » Jetée à la porte ? dis-je. Et quoi ? avec tous ses enfants ? Pauvres agneaux, que deviennent-ils ? « C’est un cas bien triste, ma chère, vraiment ; et il faut faire quelque chose. » » – Et quoi ? voulez-vous prendre quatre enfants à élever ? dit la femme. La pauvre femme mit alors son mot. » – Je me soucie de tout cela moins que d’un liard, quant à moi, dit la femme. Je n’en garderai pas un. Là-dessus, il convoque et rassemble tous les parents à une taverne près de là. Ayant donc ainsi parlé, il s’assit, me fit asseoir, but à ma santé, et me fit boire deux verres de vin coup sur coup. « Vous en avez besoin », disait-il. Et, en effet, j’en avais besoin. Lorsque j’eus fini : « Allons, Amy, dit-il, avec la permission de votre maîtresse, vous aurez aussi un verre. » Et il lui fit boire deux verres de suite également. Puis, se levant : Lorsqu’il fut parti, Amy changea tout à fait de physionomie : de sa vie, elle n’avait eu l’air plus gai. « Chère madame, dit-elle, que veut faire ce gentleman ? » – Je vous garantis, madame, qu’il vous demandera une faveur avant longtemps. » – Non, non, vous vous trompez, Amy, j’en suis sûre, répondis-je. Vous avez entendu ce qu’il a dit, n’est-ce pas ? » – Oui, dit Amy. Mais c’est égal, vous verrez ce qu’il fera après dîner. » – Eh bien ! et après, quoi ? » – Eh bien ! après, il sait aussi que vous êtes jeune et belle, et il a la plus sûre amorce du monde pour vous prendre avec. » – Soit, Amy, dis-je ; mais il peut aussi se trouver déçu dans une affaire comme celle-là. » – Ah ! madame, dit Amy, j’espère que vous ne le refuserez pas, s’il l’offre. » – Qu’entendez-vous par là, friponne ? lui dis-je. Non. Je mourrais de faim auparavant. » – Quoi ! consentir à coucher avec lui pour avoir du pain ? Amy, comment pouvez-vous parler ainsi ? lui dis-je. » – Oui, dis-je. Mais s’il veut me donner assez de bien pour vivre, il ne couchera pas avec moi, je vous en réponds. « – Je le sais, il est vrai, dis-je, et tu l’es pour l’amour de moi. Mais se prostituer, Amy !… et je m’arrêtai. Lorsque nous eûmes ainsi causé, il m’invita à la gaîté. « Allons, dit-il, mettez de côté ces choses mélancoliques, et soyons joyeux. » » – Oui, dit Amy, j’en suis convaincue, et c’est ce que j’admire. C’est un ami tel que le monde en a peu de semblables. « Allons, madame, me dit-il ; il faut me faire voir votre maison » (car il avait envie de revoir tout à nouveau). » – Non, monsieur, lui dis-je. C’est votre maison, à vous, que je vais vous faire voir, s’il vous plaît. » « Eh bien, Amy, lui dit-il, j’ai l’intention de coucher dans votre lit demain soir. » – Ce soir, si vous voulez, monsieur, dit Amy très innocemment ; votre chambre est toute prête. » – Eh bien, Amy, dit-il, je suis bien aise que vous soyez si bien disposée. J’eus un léger mouvement de surprise au mot de noces. Il se mit à rire. » – Je ne vous comprends pas, dis-je. N’ai-je pas un mari, et vous une femme ? » – Quoi ! Vous ne voudriez pas pousser l’impudence si loin, coquine, lui dis-je ; n’est-ce pas ? » – Qu’est-ce qui prend la gueuse, de parler ainsi ? dis-je. Honnête ! Comment cela peut-il être honnête ? » – Et vous voudriez que je dise cela, Amy ? lui dis-je. » – En vérité, je ne sais que faire, repris-je. » – Je ne sais pas comment vous feriez, dit Amy. » « – Quant à cela, ma chère, me dit-il, j’ai pris des mesures qui rétabliront l’égalité. » Sur ces mots, je lui pris la main ; il retint la mienne, et y mit un baiser.Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!