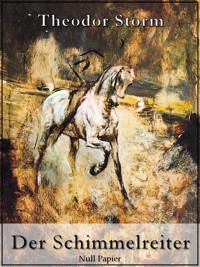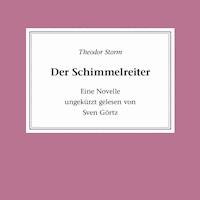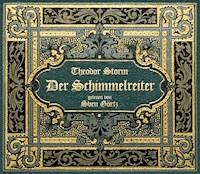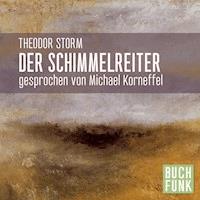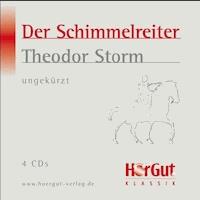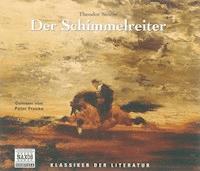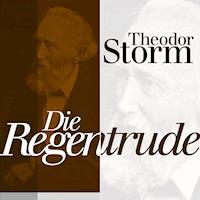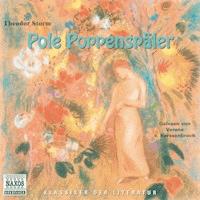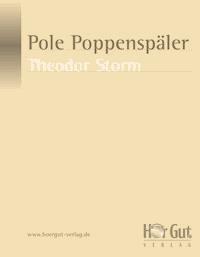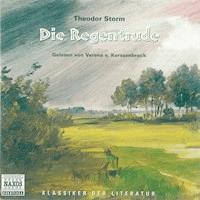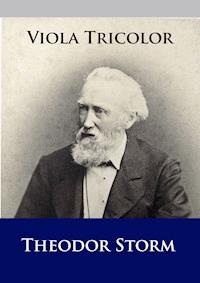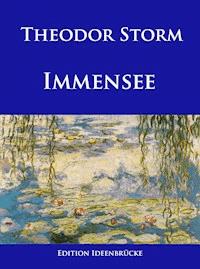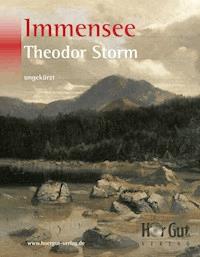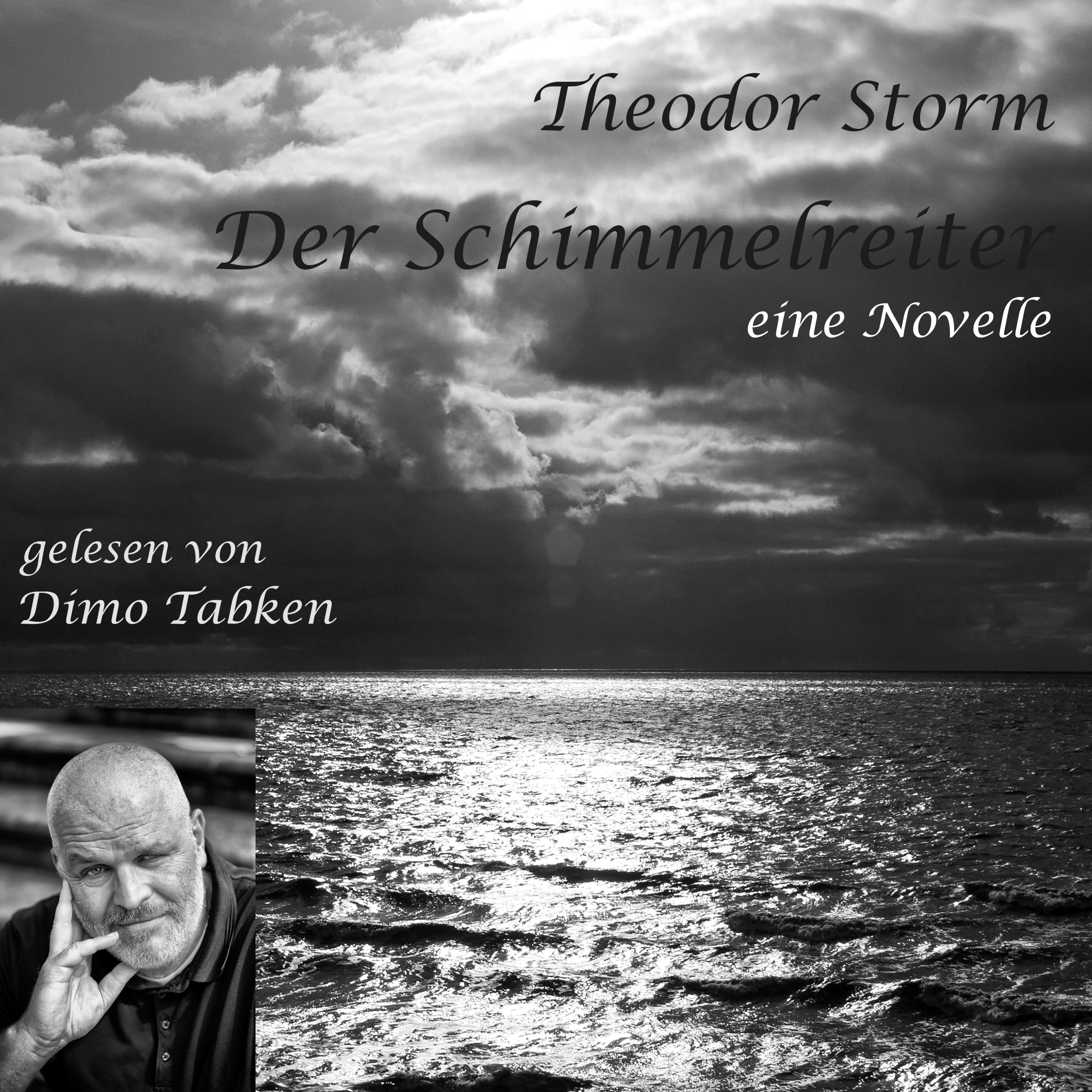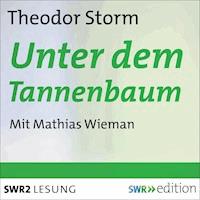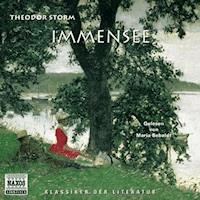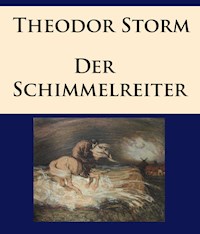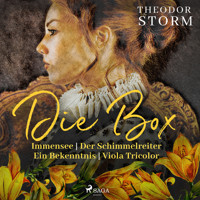Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
(Traduit de l’allemand par
Alain Préaux)
Cette nouvelle de
Theodor Storm, intitulée en allemand «Auf der Universität» (À l’Université), appartient à la période où son auteur habitait Heiligenstadt (1862). Elle se fonde sur un fait réel, le drame d’une jeune fille de tailleur, aussi ravissante que mystérieuse, désireuse de changer de classe sociale et de se hisser au rang de la moyenne bourgeoisie. Ce qui fascine en elle est d’abord et surtout son regard, une arme pour celle qui le possède et arrive à s’en servir.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né le 14 septembre 1817 à Husum, petite ville du Slesvig, alors danois,
Hans Theodor Storm était le fils aîné de l’avocat
Johan Casimir Storm et de
Lucie Woldsen. Son père, jugeant que le niveau des études secondaires à Husum n’était pas suffisant, l’envoya terminer son parcours scolaire au célèbre Katarineum de Lübeck (que devraient fréquenter également, mais quelques décennies plus tard, les frères
Heinrich et
Thomas Mann). Grâce à son ami
Ferdinand Röse, il s’initia à la littérature allemande moderne et se montra surtout impressionné par les
Lieder de
Heinrich Heine, les œuvres de
Joseph von Eichendorff et le
Faust de
Goethe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LAURE
OUVRAGES D'ALAIN PRÉAUX
CHEZ LE MÊME ÉDITEUR
Heinrich Heine, biographie, 2001
Le Voyage du claustré (Speer-Hölderlin),essai, 2007
OUVRAGES TRADUITS PAR ALAIN PRÉAUX
CHEZ LE MÊME ÉDITEUR
Friedrich Hölderlin,Poèmes de l’autre vie,1993
Friedrich Hölderlin,Prose de l’autre vie,1996
A. von Hoherwiese,Hölderlin, l’énigme,essai, 1996
Wilhelm Busch,Le Corbeau,récits illustrés,2003
Wilhelm Busch,Le Virtuose,récits illustrés, 2003
Theodor Storm,Les Fils du sénateur, récit, 2006
Theodor Storm
Laure
Traduit de l’allemand, préfacé et annoté par
Alain Préaux
Catalogue sur simple demande.
www.lecri.be [email protected]
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6721-4
© Le Cri édition,
Av Leopold Wiener, 18
B-11700 Bruxelles
En couverture : Honoré Daumier (1807-1879),Un amateur.
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
1. Vie et œuvre de Theodor Storm
Comme j’ai déjà abordé dans le détail la vie et l’œuvre de Theodor Storm dans mon introduction auxFils du sénateur, une nouvelle du même auteur parue en février 2006 chez le même éditeur et dans la même collection, je me contenterai d’indiquer ici les repères principaux en la matière.
Né le 14 septembre 1817 à Husum,petite ville du Slesvig, alors danois,Hans Theodor Storm était le fils aîné de l’avocat Johan Casimir Storm et de Lucie Woldsen. Son père, jugeant que le niveau des études secondaires à Husum n’était pas suffisant, l’envoya terminer son parcours scolaire au célèbreKatarineumde Lübeck. Il entama ensuite des études de droit à Kiel, dès Pâques 1837, puis à Berlin, et à nouveau à Kiel où il les termina.
Il retourna à Husum, où il devint avocat, comme son père. Contrairement à la plupart des écrivains de son temps, il possédait ainsi un métier qui l’installait solidement dans la réalité bourgeoise. Au mois de septembre 1846, il épousa sa cousine Constanze, la fille aînée du maire Esmarsch, de la commune de Segenberg. Un an plus tard, il conçut une vive passion pour Dorothea Jensen (19 ans), généralement appelée « Do ». Constanze alla jusqu’à proposer un ménage à trois, mais la jeune fille refusa et quitta Husum. Ce n’est qu’après le décès de Constanze (1865), morte en mettant au monde sa fille Gertrud, que Storm put épouser sa « Do » (1866).
Fin 1848, il souscrivit une protestation des citoyens de Husum à l’adresse du commissaire danois du Schleswig-Holstein. Pendant la guerre qui opposa le Danemark auDeutscher Bund(Fédération allemande), il préféra fermer son bureau d’avocat pour ne pas devoir traiter avec les autorités danoises. Celles-ci exigèrent alors de lui une déclaration de loyauté. Pour toute réponse, Storm rejoignit le mouvement populaire qui entendait faire du Schleswig-Holstein un pays indépendant à la fois du Danemark et de la Prusse. En guise de représailles, le gouvernement danois lui retira son privilège d’avocat. Dès lors, Storm exerça son métier à Potsdam, une ville qu’il prit assez vite en grippe. Sa nomination à Heiligenstadt améliora considérablement sa situation matérielle, et il trouva plus de temps pour ses activités littéraires, surtout dans le domaine de la nouvelle.
Entre temps, les tensions politiques s’étaient chaque jour aggravées au Schleswig-Holstein. Une âpre guerre de succession avait d’abord éclaté après le décès de Frédéric VII du Danemark (1863), un prince allemand, Friedrich von Augustenburg, s’étant opposé à Christian IX, le nouveau roi du Danemark. Le « Deutsche Bund » fut aussitôt appelé à l’aide et des troupes aussi bien hanovriennes que saxonnes envahirent le Holstein. Storm se mêla aux événements politico-militaires en envoyant à la revueDie Gartenlaube(La Tonnelle) un poème intituléGräberin Schleswig(Tombes au Slesvig), qu’il avait conçu comme un appel au mouvement populaire du Schleswig-Holstein. En février 1864, Storm fut proclamé par un mouvement populaire à la place du gouverneur danois à Husum. Il introduisit aussitôt sa démission auprès de l’administration prussienne, qui la lui refusa. Néanmoins, il persista dans son désir d’émancipation et jura fidélité en tant que gouverneur du Holstein (17 mars 1864). En juin de la même année, le Danemark déposa les armes, cédant toutes ses prétentions sur le Schleswig-Holstein aussi bien à la Prusse qu’à l’Autriche.
Cependant, Storm éprouva une amère déception en constatant que la libération de son pays ne se déroulait pas comme prévu. Le mouvement populaire avait en effet été neutralisé par les armées prussiennes et autrichiennes qui, mandatées par le « Deutsche Bund », avaient envahi le Schleswig-Holstein. La politique annexionniste de la Prusse se révéla peu à peu : le Holstein revint d’abord à l’Autriche et le Schleswig à la Prusse. En 1865, le gouverneur et général prussien Edwin von Manteuffel accusa son homologue autrichien d’exciter le Holstein contre la Prusse. Peu après, des troupes prussiennes envahirent le Holstein pour préserver les droits de la Prusse. Leur victoire scella la dépendance politique du Schleswig-Holstein ainsi que celle, administrative, de Storm à l’égard de la Prusse.
Sous le régime des Junker prussiens, une sorte de césarisme se mit à régner dans le Schleswig-Holstein. Storm comprit très vite l’inanité de toute résistance : il abandonna sa fonction de gouverneur et se retira à Husum, où il cultiva ses relations familiales et goûta au commerce de ses amis, souvent des écrivains tels Tourgueniev, Keller, Mörike, etc. Le 3 juillet 1866, le destin du Schleswig-Holstein se décida lorsque, les troupes prussiennes écrasèrent les armées autrichiennes à Königgrätz (Sadowa). Début 1867, les deux anciens duchés danois se trouvaient incorporés comme nouvelle province dans l’État prussien. Storm se déchaîna, parlant de cettefreche Junkerherrschaft(insolente domination des Junker), de laBismarkische Räuberpolitik(Politique de brigands à la Bismarck) et duSystem der brutalen Machtherrschaft(Système de l’hégémonie de la force brutale). En août 1867, il ajoutait, sur un ton quasi prophétique : « La barbarie incroyablement naïve de ces gens [les Prussiens] creuse profondément le sillon de la haine dans le front des habitants du Schleswig-Holstein. Ce n’est pas de cette façon que l’on unira l’Allemagne. »1
Résigné, Storm se retira de la vie active en automne 1879 : il demanda sa préretraite, laquelle lui fut accordée le 1ermai 1880. Il avait alors 63 ans. Il quitta Husum pour s’installer dans sonAltersvilla(Villa de la vieillesse) de Hademarschen (Holstein). Depuis 1866, il souffrait d’une pénible maladie. Au début de l’année 1887, les médecins diagnostiquèrent un cancer de l’estomac. Malgré les souffrances, il parvint à achever sa plus longue nouvelle, qui est aussi son chef-d’œuvre absolu :Der Schimmelreiter(L’Homme au Cheval blanc). Il décéda le 4 juillet 1888. Le 7 juillet, il fut enterré au cimetière Sankt-Jürgen de Husum ; son cercueil fut suivi par une immense foule. Mais aucun prêtre n’était présent, comme il l’avait expressément souhaité.
*
En 1882, Storm avait déclaré à l’un de ses amis, le célèbre germaniste Erich Schmidt, que son « art de la nouvelle était issu de [son] lyrisme ». Et de fait, sa nouvelle la plus célèbre de son vivant,Immensee(1849/50), rappelle beaucoup ses débuts poétiques. Les autres, écrites à la même époque, peuvent être qualifiées de « romantiques » en ce sens qu’elles valent moins par l’intrigue que par l’évocation des états d’âme, des amours manquées et des vies frustrées, acceptées sans révolte et sans violence. Conformément au goût du temps, qui excluait toute peinture exagérée ou choquante des conflits inévitables et non évités 2, Storm participe alors à la première phase duBürgerlicher Realismus(Réalisme bourgeois), aussi appelé « programmatique » : le ton de la résignation est typique de ses premières nouvelles, comme de celles de ses contemporains : l’échec de la Révolution de 1848/1849 y est bien sûr pour beaucoup.
Après 1864, sa production se tarit, pour ne reprendre qu’une dizaine d’années plus tard. Il renonce alors presque entièrement à la poésie et ses nouvelles répondent à un art nouveau, celui de la seconde phase duBürgerlicher Realismus, plus dur, plus cru, plus violent et plus pessimiste, bref plus « réaliste » que le premier. Elles n’annoncent pas encore pour autant les audaces, voire les outrances du naturalisme d’un Gerhart Hauptmann (1862-1946), le futur « Zola allemand ». Mais après quelque dix années passées en Prusse, Storm sait que la littérature doit être davantage que le simple enregistrement d’ambiances et d’états d’âmes, qu’il appelle tout simplement desSituationen. Ses personnages se sont enracinés, individualisés. Ils ne sont plus passifs, mais secoués d’appétits et de haines. Ils luttent contre un destin qu’eux-mêmes aggravent de tout le poids de leurs passions. Au lieu des fins résignées d’autrefois, les nouvelles s’achèvent maintenant en tragédies. La structure dramatique remplace peu à peu la confession lyrique, de sorte que Storm pourra bientôt affirmer à son ami Gottfried Keller que sa passion pour la nouvelle avait complètement « avalé son lyrisme ». C’est ainsi que ses meilleures œuvres en ce domaine furent presque toutes écrites dans ses dernières années, exactement à partir de 1873.
2. Laure
Comme la fin est en quelque sorte dévoilée dans ce commentaire de « Laure », le lecteur épris de suspense ferait mieux de lire ces quelques mots après avoir lu l’œuvre jusqu’au bout. Cette nouvelle, dont le titre allemand est « Auf der Universität » (À l’Université) appartient à la période où Storm habitait la petite ville de Heiligenstadt. Elle fut rédigée entre mars et juin 1862 et parut l’année suivante sous forme de livre, assortie d’une dédicace adressée à l’ami Eduard Mörike. Si je n’ai pas traduit le titre littéralement, c’est que l’intérêt central de la nouvelle ne me paraissait pas tant tourner autour de l’université (qui fournit il est vrai le titre du cinquième chapitre sur les huit que compte la nouvelle) que de l’héroïne elle-même, la ravissante et mystérieuse Laure, dont le prénom apparaît d’emblée, comme titre du premier chapitre.
Storm a trouvé son inspiration dans un événement véridique qui l’a apparemment très impressionné. Dans une lettre à son ami Fontane, un autre écrivain à succès de cette fin du dix-neuvième siècle allemand, il écrivit notamment ceci : « La motivation extérieure m’a été donnée par le souvenir d’une fille de tailleur qui – alors que j’étudiais encore à Kiel – s’est jetée dans les bras des étudiants par dépit de se croire abandonnée de son bien-aimé, un jeune homme parti en voyage. Lorsque ce dernier revint, il était trop tard. »3
À Heiligenstadt, Storm se détache peu à peu du ton lyrique de ses nouvelles antérieures pour intégrer de plus en plus des éléments épiques au sein de la structure classique de la « nouvelle de situation ». L’époque de ses premiers chefs-d’œuvre, dont la nouvelle lyriqueImmensee, semble désormais révolue. En effet, le mode de narration a changé : tantôt le narrateur s’implique fortement dans l’action – n’est-il pas amoureux de Laure ? – tantôt il s’efforce de garder une certaine distance par rapport aux événements, en conduisant même une enquête sur la vie qu’a menée Laure depuis qu’il s’est rendu à l’université. Son rôle s’apparente alors à celui d’un détective 4. En outre, les fondements sociaux du conflit sont bien mieux dévoilés et décrits qu’auparavant : la nouvelle traite du rapport entre la moyenne, voire la nouvelle bourgeoisie, celle des parvenus et nouveaux riches (auxquels appartiennent nombre d’étudiants) et les « petites gens », les tailleurs, les cabaretiers, les menuisiers, etc.
Le drame de Laure est dû à son désir de changer de classe sociale et de se hisser au rang de la moyenne bourgeoisie. La jeune fille possède certes de nombreux arguments, dont sa surprenante beauté et ses magnifiques cheveux noirs ne sont pas les moindres. Mais ce qui fascine en elle, c’est d’abord et surtout son regard. N’est-elle pas la fille de monsieur et madame Beauregard 5, au nom si symbolique et qui revient sans cesse dans la nouvelle ? Le seul substantif de « regard » (« Blick » en allemand) ainsi que les diverses formes conjuguées du verbe « regarder (« blicken ») nous amènent à repérer un total de quelque soixante occurrences. Si l’on ajoute à cette somme déjà astronomique pour une nouvelle en vérité assez brève les verbes apparentés tels que « observer », « voir », « apercevoir », etc., on constatera une nette prédilection pour la perception visuelle. Ce « regard » envoûtant de mademoiselle Laure (ou Léonore) Beauregard représente une arme pour celle qui le possède et parvient à s’en servir. Ainsi l’un des deux étudiants qui évoque la jeune fille, certes conquise entre temps par le rugrave, trouve-t-il pour qualifier la fascination qu’exerce sur chacun ce fameux regard, des mots qui apparentent Laure à une charmante diablesse. L’allusion se trouve au milieu du chapitre six : « C’est une couturière, Louis ! répondit l’autre en riant. Mais lorsqu’elle te dévisage si froidement de ses yeux noirs… ! Elle est damnée de la tête aux pieds… ! »
Mais la force d’envoûtement du regard de mademoiselle Beauregard connaît des limites, surtout quand celle-ci se heurte à la puissance du rugrave, incarnation parfaite de la classe sociale à laquelle Laure aspire tant de faire partie. C’est du moins ce qu’il ressort de l’extrait suivant, situé à la fin du septième chapitre : « La musique reprit. Mais le rugrave ne se leva pas pour aller chercher sa cavalière. Il leva la main d’un air indifférent et lui fit signe des doigts. Je la vis lui adresser un regard furibond et se cacher les yeux dans sa main appuyée sur la table, mais elle ne se leva pas. Le rugrave fronça les sourcils et, au bout d’un moment, il se leva d’un bond, traversa la salle et alla se planter en face d’elle. Comme elle s’obstinait à ne pas lever les yeux, il lui passa le bras autour du cou et la souleva rapidement de sa chaise. Puis il lui débita – semble-t-il – quelques mots véhéments. Mais je me trouvais quant à moi trop loin pour comprendre quoi que ce fût. Enfin, il se rendit avec elle à la tête des autres et ouvrit la danse. Elle était devenue une jeune femme parfaitement développée, même si elle ne lui arrivait qu’à la poitrine. Je les observai de très longues minutes. Elle avait relevé tête et nuque et le regardait ainsi d’en dessous, comme portée par le bras de son cavalier, n’effleurant le sol que du bout des orteils. Il se penchait sur elle, les yeux immobiles comme ceux d’un jeune oiseau de proie, fixant son visage qu’elle lui tendait en fermant les paupières. »
*
Cette nouvelle se présente pour ainsi dire comme un pendant négatif à celle que Storm avait publiée en 1860, soit deux ans auparavant, sous le titre de « Drüben, auf dem Markt » (De l’autre Côté, sur la Place du Marché). En effet, comme le docteur Christophe, Laure se trouve confrontée à une société bourgeoise sûre d’elle-même, qui se rend coupable de la non-intégration des protagonistes. Les deux œuvres ne se répètent heureusement pas tout à fait : ainsi, à la différence du docteur Christophe, Laure reconnaît bien vite les racines de l’exclusion. La société bourgeoise (spécialement celle des jeunes femmes de la classe moyenne, les jeunes parvenues) lui apprend avec une rare cruauté sa non-appartenance à ce club très fermé. Mais, contrairement au brave et niais docteur Christophe, Laure est assez fine pour évaluer correctement la situation : elle sait bien qu’elle n’a rien à attendre de Philippe, le narrateur, un jeune bourgeois aussi bon que brave, ni de qui que ce soit de provenance bourgeoise. Et elle ne se gêne pas de le faire savoir à Philippe – qu’elle aime pourtant. Quand, lors du bal de clôture, elle voit d’autres jeunes bourgeois se moquer de son père, elle n’hésite pas à prendre le parti de l’auteur de ses jours et, sans qu’on puisse la retenir, elle quitte la salle dans un éclat.
Mais ni son intelligence, ni sa sensibilité ne préserveront Laure de succomber aux attraits du bonheur que lui fait faussement miroiter la vie bourgeoise. Les leçons de danse, comme le remarque à plusieurs reprises un Christophe (celui de cette nouvelle-ci) plus sensible et plus fin qu’on ne l’aurait cru, ont littéralement pourri la jeune fille. Malgré les humiliations qu’elle a dû endurer à ces occasions, elle a pris goût aux charmes de la vie bourgeoise. La charmeuse a été ensorcelée : une nouvelle version, en quelque sorte, de l’arroseur arrosé !