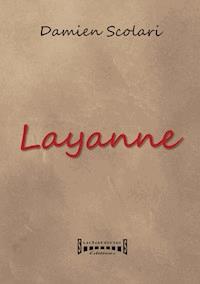
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sudarènes Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jean-Baptiste est amer et désabusé. Mais une rencontre va tout changer...
De l’inertie d’une plage niçoise à l’explosion dans le désert, en passant par la destruction de Palmyre, ce livre est un morceau de piano. Chacun de ses mouvements rajoute une note affective bouleversante.
Jean-Baptiste s’enlise. Il ne se reconnait pas dans son prochain, dans cet homme assoiffé de progrès et d’expansions. Il désespère... en tout cas il n’espère plus. Il ne croit pas en cet homme, en ses promesses, aux conquêtes du scientisme alors il regarde le ciel pour s’évader, pour s’extirper du sentiment de vide qui le hante. Puis une rencontre... Une rencontre avec Luce, sauvage, lumineuse, le fait chavirer. Elle rêve d’être une étoile, de pétiller à l’horizon. Tous deux veulent sortir de l’Histoire. Ils veulent écrire la leur, hors du monde. Ils veulent rêver. Vont-ils y arriver ? Elle le conduira là où jamais il ne crut pouvoir aller, bien plus loin qu’il ne pouvait l’imaginer ou même l’espérer. Mais qui est cette jeune exilée hypersensible qui sombre dans la mélancolie chaque fois que la Syrie meurtrie subit les bombes et assauts de l’État Islamique ? Jusqu’où Jean-Baptiste ira-t-il pour faire briller cette étoile au-dessus des flammes qui anéantissent une civilisation ?
Une histoire bouleversante...
Layanne ? C’est un prénom. Il signifie douceur et sensibilité.
Une histoire d'amour émouvante et envoûtante.
EXTRAIT
Que s’est-il passé Luce ? Comment n’ai-je rien pu voir arriver ? Tout ça s’est-il réellement produit ? Pour de bon ? Pour de vrai ? Je ne peux pas y croire, non, je ne peux pas y croire. Un rêve, un cauchemar. Je n’ai rien vu. Je n’ai rien vu. Et je suis là, assis, des points lumineux au-dessus de ma tête, d’autres sièges, d’autres gens, un couloir. J’ouvre, je ferme les yeux. Que s’est-il passé Luce ? Mon trésor ! Je ne peux pas y croire. Je souffle, je respire. Je me calme. La haine. Des vertiges. L’envie de vomir. L’envie de mourir. L’amour. La mort. L’éphémère. La Beauté. Luce ! Luce ! Luce ! Du calme, du calme. Respire, ferme les yeux. L’amour. La mort. L’éphémère. La Beauté... Luce...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Damien Scolari est un écrivain niçois de 26 ans, passionné d’art et de littérature, au commencement de son 3e cycle de psychologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Et toi que j'aime,Que j'ai aiméCompagnon d'un jour ou d'une annéeDéjà tu sais que dans mon cœur même moisi flottent encoreviolence et tendresse »Mano Solo, Je suis venu vous voir avant de partir
1
Que s’est-il passé Luce ? Comment n’ai-je rien pu voir arriver ? Tout ça s’est-il réellement produit ? Pour de bon ? Pour de vrai ? Je ne peux pas y croire, non, je ne peux pas y croire. Un rêve, un cauchemar. Je n’ai rien vu. Je n’ai rien vu. Et je suis là, assis, des points lumineux au-dessus de ma tête, d’autres sièges, d’autres gens, un couloir. J’ouvre, je ferme les yeux. Que s’est-il passé Luce ? Mon trésor ! Je ne peux pas y croire. Je souffle, je respire. Je me calme. La haine. Des vertiges. L’envie de vomir. L’envie de mourir. L’amour. La mort. L’éphémère. La Beauté. Luce ! Luce ! Luce ! Du calme, du calme. Respire, ferme les yeux. L’amour. La mort. L’éphémère. La Beauté… Luce… Tout s’est-il réellement produit ? Je ne peux y croire… Non… Ce n’était qu’un rêve, un mauvais rêve, un rêve d’amour. Tu me disais : « un rêve d’amour c’est une lumière blanche dans un ciel bleu » …. Le rêve d’amour…c’est ça, oui, c’est ça ! Une lumière blanche dans un ciel bleu. Rêve d’amour ? C’est le titre d’un morceau de piano qui nous raconte sans intrigue ce qui se joue dans un cœur désabusé, voilà tout…
Voilà… Je me calme… Je me calme…
Luce ne m’a jamais joué ce morceau bien qu’elle me jouait dans nos nuits chaleureuses les histoires que lui racontait son cœur. Elle n’avait pas envie de l’apprendre, elle aimait l’écouter. Elle n’avait pas besoin de le jouer, nous le vivions suffisamment.
Un rêve d’amour ne raconte jamais l’amour mais il raconte sa tendre violence, son mal, son impossibilité. L’amour rêve d’inscrire son histoire hors de l’Histoire, c’est bien de ça que rêve l’amour. Il combat les canons de son époque et souhaite créer quelque chose, autre chose de moins sordide, de plus grandiose ! Aimer c’est se révolter ! Se révolter contre le monstre de l’Histoire qui cherche à nous phagocyter.
Avec Luce, nous avons essayé de sortir de l’impossible, pour rentrer dans le rêve. Avons-nous réussi ? Oh, je n’en sais rien, je ne sais plus, je ne sais plus rien ! Gardons en mémoire cette interrogation, peut-être trouverons-nous une réponse ou peut-être pas. Je n’en sais vraiment rien.
Au départ j’étais seul ou entouré de personnes seules, loin de l’ivoire et des cordes, loin des sonates, des sérénades et des concertos. J’essayais de dormir et dormais souvent trop, beaucoup trop. Certains matins je me forçais à respirer. Je n’étais pas là. Nous ressentons tous ce mal qui nous pousse à croire que nous ne sommes pas nés à la bonne époque, en pensant que notre époque est la pire – mais arriverons-nous à faire pire ?
« Luce, ma Luce… »
Luce ne m’a jamais quitté et depuis que je l’ai rencontrée, c’est comme si elle avait toujours été là. Cette lumière blanche dans mon ciel bleu, une étoile dans la nuit.
Je vole et en moi une sonate résonne, résonne et me fait m’envoler encore plus loin ! Comment donc en suis-je arrivé à traverser les cieux ? Reprenons doucement, doucement… La rencontre… Oui… La rencontre.
Tout commença par un ami qui me demanda si j'avais vu le temps qu'il faisait. Je lui répondis que non, je n'avais pas encore levé la tête. Puis … avec les heures et les minutes qui passaient comme des heures, et l'ennui qui me traversait pendant tout ce temps, je finis par lever la tête vers le ciel, et vis les avions et les traces blanches qu’ils laissent derrière eux. C'est vrai oui ! On a beau dire ce que l'on veut, voir passer ces grosses machines au-dessus de nous, ça nous donne souvent l’envie d'y être. Alors, je les regardais passer avec Pierre, présent à mes côtés. On s'amusait à s'imaginer la destination de chaque avion. Et même si parfois, l’un d’eux prenait la direction de l'Italie, on se disait qu'il pouvait partir en Afrique, aux États-Unis, ou même ailleurs, on s'en foutait de la réalité. La réalité ça n’a aucune importance. En soit, ça sert à quoi la réalité ?
Je lui demandai si un jour il avait voulu piloter un de ces engins, il me répondit que non, jamais. Jamais il n’eut l'idée de devenir pilote. C'est peut-être parce que, dès tout petit, il dut porter des lunettes munies de verres de plusieurs centimètres. Il savait qu'il ne pourrait jamais devenir pilote. Ou alors c’est parce qu'il avait peur de piloter. Je ne sais pas. Mais à dire vrai, je ne me suis jamais non plus, posé cette question. Pourtant j'en ai passé des heures à les regarder décoller.
A Nice, quand on est sur la plage et qu’on regarde l'horizon, on s'en va, on voyage. Mais ce qu'il y a de plus beau, en plus de l'horizon qui se profile devant nous, c'est que l'aéroport n'étant pas loin, on part à chaque fois qu'il y en a un qui décolle, ça permet de voyager encore plus loin.
…
Il y a cette sensation qui me traverse à chaque fois, comme un bercement, et je suis là, dans un de ces engins, avec d’autres passagers. Assis, je reformule, je me répète l’histoire, mon histoire, celle de cette dernière année inoubliable. Et je n’accepte rien, ni la fatalité, ni la tragédie.
Je les déteste déjà, je les déteste si facilement. Regarde-les tous ces gens heureux, si heureux qu’ils me répugnent, sans même les connaître, je les déteste tous ! Et je me répugne moi-même d’être un de ces hommes.
Je suis dans cette machine volante, j'ai l'odeur de la mer qui me colle à la peau et le son des vagues contre les galets. Souvent je ferme les yeux et je respire profondément pour que toute l'innocence de l'enfance me revienne.
« Je suis la pluie Luce, et tu es le vent. »
…
Sur cette plage, je regardais Pierre à côté de moi qui s'amusait à empiler des galets, les uns sur les autres, et les galets tombaient, il persistait, la rondeur des galets ne lui permettait pas d’en faire ce qu'il voulait. L'absurde est partout. Pierre c'était un ami d'enfance qui habitait dans le centre-ville et avec qui j’allais souvent sur la plage. On s'allumait quelques cigarettes, on commençait à parler et finalement le silence s'installait, on s'apaisait, on voyageait et on se posait des questions qui ne voulaient rien dire, des questions qui ne servaient à rien, mais qui nous permettaient de passer le temps. C'était le plaisir du pauvre comme dirait Joyce. Oui ! Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais demandé à Pierre s'il avait lu Ulysse. « Ulysse ? me dit-il, tu rigoles, il est illisible. Il a écrit pour les analystes, ceux qui aiment se casser le cerveau dans des analyses biscornues. Je ne sais pas, rajouta-t-il, ils ne doivent pas savoir quoi faire de leur temps. » Je me mis à rire parce qu'il n'avait pas tort et qu’il avait mis un temps si court à me dire tout ce qu’il m’avait dit que je m’étonne encore de ne pas l’avoir oublié. Déjà à cette époque-là, nous ne savions pas quoi faire de notre temps, alors j’essayais de lire Joyce comme tant de littérateurs. Seulement ma curiosité ne fut pas assouvie, elle se prit un mur de briques et de phrases à rallonge qui n'en finissent pas ou qui s'arrêtent ou qui ne commencent même pas – elle en eut mal au ventre.
Oui tout commença comme ça, une question sur le temps, sur Joyce, des avions qui passent, la mer et quelques cigarettes. Il faisait beau, le temps passait doucement mais rapidement, comme toujours. La mer était bleue : même si l'eau est transparente, elle est toujours bleue. Et Pierre respirait fortement, en fumant sa cigarette.
- Tu vas faire quoi demain ? me demanda-t-il curieusement.
- Je ne sais pas, je ne sais jamais ce que je vais faire demain. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est demain ?
- Le jour qui suit aujourd'hui, demain ça suit toujours aujourd'hui.
- Mais aujourd'hui, souviens-toi, hier on l’appelait « demain », et demain, demain, ce sera aujourd'hui.
- Oui, tu as raison. Il n'y a finalement que des « hier ».
- Oui, aujourd'hui, demain, ce sera hier.
- Oui, me dit-il, d’une voix étranglée.
- Et des avions décolleront et la mer sera encore là. C'est toujours comme ça.
Il me regarda avec des yeux pétillants. Je le regardai sans savoir si mes yeux brillaient comme les siens. Et l'après-midi passa.
2
Ce n'est pas ce jour-là que je pris la décision de m’enfuir. Et ce n’est pas à Venise ou ailleurs, que je voulus m’évader. Mais ce fut ce jour-là, avant que tout ne commence, que je compris que je voulais être dans un de ces avions qui partent, qui partent indéfiniment, ailleurs, là où l’on ne s’ennuie pas. J'en avais marre de toujours les regarder sans bouger.
Après ce moment à la plage, je voulus rentrer chez moi, dans mon petit appartement. Pierre resta avec moi et Luc nous rejoignit. On essayait de comprendre le sens de tout ça. Pourquoi on était là et pourquoi d'autres étaient ailleurs. La réponse la plus simple fut celle du hasard.
On essayait surtout de sortir d’une immobilité répugnante, d’une mélancolie qui s’emparait de nous. On avait cette impression de tourner en rond, de toujours faire la même chose et de s’ennuyer à mourir. Oui, on s’ennuyait, parce qu’il n’y avait rien, rien pour nous sortir de l’ennui, pour créer du mouvement. Me reviennent quelques bribes de conversation mais rien de flambant, rien de grandiose, quand on sait tout ce qui se passa par la suite.
« Luce, m’aimes-tu autant que je t’aime ? Je suis la pluie, tu es le vent. Et le vent fait virevolter les gouttes de pluie. Ô ma Luce. »
- Je ne crois pas au hasard, lança Luc en s’asseyant sur une chaise, près du rebord de la fenêtre fermée.
- Moi non plus, répondit Pierre, mais il faut bien reconnaître qu’il existe.
- Oui, il existe, seulement je n'y crois pas. Il n'y a pas de hasard.
- Comment peux-tu dire que le hasard existe et en même temps dire que tu n'y crois pas ?
- Parce que je n'ai pas envie d'y croire tout simplement.
- Ce n'est pas si simple.
- Si, évidement.
Je les regardais, j'avais envie de rire mais ne riais pas. En même temps, je pensais encore à tous ces engins qui perforent les cieux, vus la veille ou l’après-midi même. Je songeais à tous ceux qui passaient au-dessus de l’immeuble ou qui traversaient la méditerranée et le monde entier.
Combien d’avions décollent, dans ce monde, lors d’une minute ? Aucune idée.
Il y avait des gens dans ces avions qui passaient au-dessus de moi, ils ont dû découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, respirer un nouvel air. J'écoutais sans vraiment écouter, j'entendais des phrases et certaines me faisaient rire.
- Tu es con ! décocha Pierre.
- Mais non ! répliqua Luc.
- Tu dis n'importe quoi !
- Tu ne comprends donc rien. L'homme est libre de croire ce qu'il a envie de croire, tu ne vas tout de même pas m’emmerder. Même si nous savons que notre croyance est absurde, si nous avons envie d'y croire nous le pouvons si ça nous fait du bien. Une croyance n'est jamais rationnelle de toute façon. Lâche-moi !
Franchement, cette discussion me demandait trop d'engagements, j’arrêtai d’écouter et me mis à sourire pour leur montrer qu’ils partaient bien trop loin sans même bouger. Pierre se tourna vers moi pour m’interroger sur la raison de mon hébétement et en profiter pour connaître mon avis sur le hasard et tout le reste. Une seule phrase me vînt à l'esprit : « qu'est-ce qu'on fout là ? » Ils arrêtèrent soudainement de parler et me regardèrent avec de grands yeux. « Passe-moi une bière ! » me lança Luc. Je lui donnai une bière. Il l’ouvrit et but une gorgée. « Ça va ? ». Je lui répondis d'un signe de tête que tout allait pour le mieux.
Je me levai, ouvris la fenêtre et me mis à contempler le ciel en soupirant, un nouvel avion passa, laissant derrière lui une trace blanche qui d'abord forma une ligne témoignant de sa direction pour, peu après, se dissiper doucement.
3
Je songeais, les yeux grands ouverts en regardant par la fenêtre, au vide, à l’urbain, à l’humain sans l’humain, à ce qu’il restera de nous après. Beaucoup de gens ont peur, et avaient déjà peur à ce moment-là, peur de tout, des bombes et des autres. Je n’ai plus peur maintenant, à quoi bon avoir peur ? Si je réfléchis bien, c'est même cette pensée du vide urbain, de l’humain sans l’humain, de grandes villes sans fantôme qui me réconfortait. Ça n'a plus rien à voir avec tout ce que je ressens à l’heure actuelle, avec toutes mes larmes qui depuis ont coulé. Mais je me souviens qu’à ce moment-là, cette pensée d’une planète sans l’homme me réchauffait le cœur. Tout le reste, ce n’était qu’un rêve, un rêve un instant donné, Luce… On croit qu’on sort de cet ennui qui nous ronge, on croit un instant se mettre en mouvement, mais ce n’est qu’illusion. En réalité, nous sommes tous immobiles, un corps coulé dans du béton. On s’imagine bouger, mais ce n’est qu’une croyance, en réalité, on ne bouge pas, rien ne bouge.
Et toutes mes pensées qui se chevauchent. Et je repense à tout ça. Pourquoi encore s’en souvenir ? Pourquoi encore penser à ça ? J’aimerais tant ne me souvenir de rien, avoir tout oublié.
Le dernier morceau que Layanne m’a joué fut le concerto pour piano, numéro deux de Shostakovich, le deuxième mouvement en andante. Je pouvais entendre chacune des notes résonner dans mon cœur, dans mon esprit, je tremblais assis à ses côtés, la regardant toute droite, partir les yeux grands ouverts ou presque fermés et je me demandais vers quelle nouvelle contrée elle s’envolait. Pensait-elle à ce génie qui un soir avait composé ce morceau pour elle, pour qu’elle le joue devant moi, transmettant par sa grâce ce qui de son cœur devait aller dans le mien ? C’était chez elle, je la revois encore.
Je pense à tout ça. Elle me le jouait chez elle, pour moi, par amour, il y a moins d’une semaine.
Puis… le cœur a ses raisons… Et la raison peut tomber malade.
J’ai pris un billet au dernier moment. Je ne sais même plus où cet avion atterrit ! Non ! C’est faux, je ne le sais que trop bien ! Ça ne m'intéresse pas tellement parce que, ce que j'aime, c'est m’envoler, tout oublier. Ressentir cette sensation lorsqu'on part, lorsqu'on se lève et qu'on se dit : « c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je pars, que je quitte tout ». On croit presque que c’est pour toujours, on monte dans l'avion, le train ou le bus ou même dans une voiture et se profile devant nous : la liberté.
Pfff ! En réalité, ça ne m’intéresse pas, je m’en balance de ça. Elle me jouait Shostakovich, il n’y avait que ça, réellement que ça.
Je ferme les yeux, je retourne en arrière. Je reviens chez moi, quasiment un an plus tôt. Je regardais par la fenêtre de mon appart, il y avait du bruit, le bruit des voitures, comme un vrombissement. Il y avait des cris : le cri des parents sur les enfants qui tentent encore d'être libres. Il y avait un peu de vent, encore du soleil. Et Luc et Pierre se mirent à mes côtés pour regarder eux-aussi devant eux.
- L'homme n'aime pas le vide, me dit Luc philosophiquement comme s’il avait entendu mes pensées.
- Toi non plus, répondit Pierre, ne me laissant même pas le temps d’en placer une.
- Pourquoi ?
Je restais donc silencieux, toujours à regarder droit devant moi, mais je prêtais une oreille particulière à cette chamaillerie infantile. Ces deux-là, ils ne faisaient que ça, ils vivaient une histoire d’amour derrière des cris et des débats, sans queue ni tête, des grands enfants qui ne savaient pas combien ils s’aimaient.
- Sur tes peintures il n'y a jamais de blanc.
- Et alors, le vide est noir ! affirma Luc d’un ton moqueur.
- Noir ? Mais tu es con ou quoi ?
- Comment ? Il regardait Pierre avec des yeux que seul lui pouvait faire, petits profonds, gentils et méchants à la fois.
- Déjà, le vide, je le vois blanc, rajouta Pierre, vexé.
- Mais qu’est-ce que t’y connais-toi !
Pierre regarda Luc les yeux dans le vague, il tentait de le transpercer mais malgré l’intention, le regard ne suivait pas. Je restais à côté d’eux, le sourire figé sur mes lèvres. On ne faisait rien. Il n’y avait rien à faire. On parlait seulement, pour passer le temps, parce qu’il fallait bien passer le temps. Le hasard, le vide…
Luc, il se prenait pour un peintre conceptuel en donnant de grands titres à ses petites toiles, mais en les regardant, je voyais un dessinateur, quelqu’un qui avait un bon coup de crayon, plus réaliste que nouveau réaliste. Et Pierre ? Il me faisait rire, c’était le genre de personnage qui cherchait l’art, qui cherchait à être artiste, qui posait des questions en connaissant les réponses, qui cherchait à pousser à bout les philosophes c’est-à-dire tout le monde, parce que nous sommes tous des philosophes.
- On s'en fout que tu le vois blanc, le vide est noir.
- Un monochrome c'est vide ou pas ?
- Évidement que non !
- Eh bien si ! C'est totalement vide !
- Non ! cria Luc toujours avec ses drôles d’yeux, on ne peut pas représenter le vide. Il faut forcément représenter quelque chose de plein pour représenter le vide. Le vide n'existe que par rapport au plein, tu comprends ? Un monochrome c’est plein, mais à travers le plein, tu perçois le vide. Putain ! Tu ne comprends vraiment rien.
Il se mit à rire à plein poumons, je le suivis dans son éclat. Pierre restait là, sans rien comprendre, sans rien dire. Je me demandais comment il pouvait aller si loin avec si peu. Et la réponse me vint comme une évidence : c’était ça notre richesse, une richesse illusoire, savoir faire avec le vide.
- Dans un monochrome, dit Pierre, on peut y mettre ce que l'on veut. C'est le principe même du monochrome. Une œuvre sans œuvre, qui permet au spectateur d'y voir ce qu'il veut.
- Ça c'est la pensée absurde du spectateur ! Tu sais, le spectateur qui se donne de l'importance et qui tue la démarche de l'artiste !
- La démarche de l'artiste ? Dans ce cas, tous les peintres en bâtiment sont des artistes !
Luc commençait à voir rouge, ses joues devenaient quasi violettes alors qu'il était blanc, blanc comme son verre, blanc comme un monochrome. Pierre jubilait parce que, même si sa pensée était très intéressante, juste ou injuste, ou en partie juste et en partie injuste, on pouvait voir dans son regard qu'il parlait seulement pour rendre Luc fou. Et moi, dans tout ça, je me marrais, oui je me marrais…
Sentez-vous comme je ne crois même plus à ce que je dis ? Je ne crois plus en rien. Vous allez comprendre pourquoi. Merde, voilà que je commence à me parler tout seul.
- La démarche réelle de l'artiste, on ne la connaît jamais parfaitement. Une toile ne peut par elle-même jamais représenter le vide, de par son essence elle est pleine. Mais ce qu'elle peut faire, c'est en représentant quelque chose, ne rien représenter.
- Oui, c'est une représentation de l’absence de représentation.
En soi, qu'est-ce que ça pouvait bien dire si ce n'est rien ? Et comment pouvaient-ils, en plein après-midi, en regardant par la fenêtre l'espace et l'horizon, se prendre autant la cervelle et se la tordre et tordre de la sorte.
Je m'allumai une cigarette, je pensai au vide. Mais comment penser le vide ? Le vide c'est justement l'impensable… Non ?
- Alors si tu es d'accord, lança Luc tout excité, c'est bien à partir du plein, qu'il pensa le vide.
Pierre ne répondit pas, pas de suite et quand il répondit je n'entendis rien, je n’en avais plus rien à foutre.
Un court instant, il n'y eut plus de bruit, plus de voitures, ni de cris. Il n'y eut plus aucune voiture sur la route, personne dans les rues, et il n'y eut pas de vent. Une pensée absurde me traversa : pense-t-on le plein à partir du vide ou le vide à partir du plein ? Et ma cigarette était finie… déjà.
Il faut que je respire. Il faut que je respire, encore plein d’émotions indifférenciées.
« Luce, je ne me souviens de rien… ou alors, je me souviens de tout. »
Le temps s’est arrêté. Je suis comme mort, transparent, miroitant l’impossible. Je suis un reflet. Je suis un reflet qui se dissipe au loin, dans le ciel, dans un désert, comme des cendres qu’on jetterait dans le vent.
4
Tout ça pour ça ! Tout ça pour rien … ! On peut comprendre qu’il ne se passait rien !
Et BOOM ! MERDE !
Dans ce putain d’avion, je pense à Kundera, dès que je pense à elle, je pense à lui. Dès que je pense à lui, je pense à elle : Kundera ! La fausse note !
J’ai encore ce nom dans ma tête, lui mon rival, quand je pense que j’en suis encore jaloux, je ne peux pas me l’enlever de l’esprit ! Je l’ai rencontré avec elle, j’ai même dû aller le voir à travers son œuvre pour me rapprocher d’elle. Elle était avec lui à l’hôpital. Elle tenait son livre dans ses mains. Je voulais le lui arracher pour y mettre les miennes. Lui, qui commença un de ses livres par la pensée de l'éternel retour, cette pensée de Nietzsche. C'est pour Luce que j’ai lu ce livre, Luce, cette femme à qui je pense, cette femme pour qui j’ai pris ce billet d'avion, au dernier moment…
Assis sur mon siège, je transpire, j’étouffe et ça me gratte. Elle est encore avec moi. Elle brille et me regarde.
« Luce, je pense à toi. »
Ce livre ! C'est L'insoutenable légèreté de l'être ! AAAH ! Quelle légèreté ! Dans tout ça je ne vois que de la lourdeur, la lourdeur de l’éphémère ! Une lourde légèreté ! Que ce soit vrai ou pas, on s’en fout, n’est-ce pas ? L'homme est responsable de son désir, de sa vie. Est-ce si véridique que ça ? Je n’en sais rien, j’ai mal et je ne crois qu’en la fatalité !
Je ne suis pas bien placé, je suis côté couloir mais j'arrive à voir à travers le hublot malgré tout, si je tourne la tête. Il y a une femme qui ne fait que bailler à côté de moi mais elle ne dort pas. J'ai envie de lui dire : « mais dors putain ! » Seulement je me retiens, je mime l'indifférence, je ne la regarde même pas. Je ne peux pas tendre les jambes. J'ai mal aux fesses. J'ai envie de marcher, de courir, de hurler ou tout simplement de parler à quelqu'un de quelque chose, de pourquoi nous sommes là. Quand j'étais en bas, sur la plage, au frais, à regarder les avions partir, je ne pensais jamais à la durée de vol, au confort des passagers. Je pensais seulement à m’enfuir, m’enfuir, voilà tout. M’évader ? Y a-t-il une mauvaise raison pour s’évader ? Mais il est vrai que maintenant une certaine réalité me revient. Et je ne sais même pas pour combien de temps je suis là. Je passerais pour un imbécile si je demandais : « excusez-moi, mais où allons-nous ? Ah… d'accord… Il nous reste combien de temps ? »
L’avion peut voler éternellement que je n’en ai rien à carrer. N’est-ce pas beau que passer son existence à traverser les cieux, à faire le tour du monde, comme toutes ces âmes sur leurs chars ailés qui naviguent autour de la Terre ? Peut-être que Luce et moi étions une de ces âmes…
Mais si je devais indéfiniment refaire cette vie, est-ce que je poserais cette question ou est-ce que j'attendrais la surprise de l'atterrissage… ? Mais s’il explosait, accepterais-je de mourir sans savoir où j’allais ? Seulement, je sais très bien où je vais, malheureusement je n’ai rien oublié. Je me souviens encore, c’était il y a quelques jours. Rien, rien, je n’ai rien pu oublier et je n’oublierai jamais. Peut-être même que tout mon malheur se situe dans le fait que je ne peux oublier, non, je ne peux pas oublier.
…
Je n'en sais rien. Referais-je la même chose ? Quelle question absurde ! L'éternel retour n’est pas une idée si mystérieuse, elle m’est même familière, ce mythe, ce mythe, il me gratte, il me colle à la peau.
5
Luc et Pierre venaient de partir, il faisait nuit. J'étais tout seul dans mon petit deux pièces et j'attendais. Il faisait chaud, puis froid puis chaud. En fait, j'avais chaud dans le lit, froid en dehors. Je voulais écrire quelques lignes pour préparer un livre de poèmes. Je voulais écrire et à côté faire des croquis pour en faire un cahier, plein de croquis, plein de poèmes mais je n'arrivais pas à écrire, je n’arrivais pas à dessiner. Comment passer le temps quand on arrive à rien ? Cela faisait un moment que je n'écrivais plus, je perdais trop de temps à réfléchir sur quoi écrire. Au moment d'écrire je n'avais plus rien à dire. Comment écrire si je n'avais plus rien à dire ? Surtout si on s'essaie à la poésie … C’est tellement vieux jeu la poésie !
Je pris une page blanche et je me mis à gratter des phrases, des mots, des lettres. Des problématiques surgirent, puis plein, plein de problématiques très sérieuses. Elles me hantent aujourd’hui, sans vraiment me hanter, d’une certaine manière, Luce y a répondu.
Doit-on écrire de la poésie pour faire de la poésie ou suffit-il d'aimer, d'aimer, tout simplement ? Pas de réponse… ou peut-être une réponse : du champagne. Pourquoi du champagne ? Parce que l'amour et le champagne piquent autant. Quand on aime, on boit du champagne et quand on boit du champagne on finit par écrire de la poésie. Mais doit-on écrire de la poésie pour simplement, simplement dire qu'on s'aime, qu'on s'aime … simplement ?
Et là, je ne sais pourquoi, depuis j'ai essayé de comprendre, j'ai pensé à Lévi-Strauss. Est-ce que le poète est un anthropologue de l'amour ?
Oui. Mais là encore une question, puis plein d’autres questions, encore, c’est ça l’ennui.
Suffit-il d'écrire, d'écrire encore et toujours, dans une pièce, sous des draps, à des heures perdues, perdues comme celles-ci, pour dire tout son amour ? Et quand son amour est grand, qu'il y a des jours où les mots nous manquent, parce qu'il fait trop beau ou qu'il ne fait même pas beau ? Il ne fait même plus beau dire qu'on s'aime.
Le regard dans la nuit et la nuit solitaire … Mais il ne suffit pas de dire qu'on s'aime pour aimer alors je l'écrivais quand même, comme pour chercher du sens, là où il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas de sens à l'amour, car l'amour est vagabond. Pour les vagues à l'âme qui se croient poètes, l’amour est toujours vagabond. Et je parlais d’amour et j’écrivais sur l’amour, sans aimer. Alors qu'il n'y avait même pas, même pas de quoi écrire une chanson ou des poèmes sans nom.
J'en ai marre. J'en avais déjà marre à ce moment-là. Je m’emmerdais dans un monde où tous les loisirs qu’on me proposait ne me convenaient pas. Il y avait trop de choses, j’avais tout essayé : la musique, le sport, les jeux-vidéos et tout le reste : boire des verres en terrasse, boire des verres à l’intérieur, boire des verres en marchant, assis, debout, en mangeant… Plus rien n’attisait chez moi de passion.
Mais en y repensant maintenant, j'en ai d'autant plus marre. Il n'y a même plus de poètes ! Comment peut-il encore y avoir de l'amour ou de la passion ?
6
C’est ainsi, dans cet état immobile, désabusé de tout, que pendant plusieurs jours, je ne parvins pas à dormir. J'essayais mais je n'y arrivais pas. Je sortais marcher, en fumant quelques cigarettes mais les cigarettes ne m'aidaient pas à dormir. Je repensais à cette femme que j'avais aimée, mais je l'avais aimée trop tard. Je pensais à cette autre femme que j'avais aimée aussi, mais celle-ci je l'avais aimée trop tôt. J'avais écrit des textes pour elles.
Il faisait chaud, j’avais froid. Deux jours après cette nuit de réflexion, j'entrai dans un bar. Il faisait sombre, la lumière était orange, l'ampoule était aussi vieille que le bar et le patron du bar. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait cette femme métisse au bar qui me regardait avec ses dents blanches. Je lui souris mais elle ne m'excitait pas, alors à quoi bon lui avoir souri ? Je n'avais pas la tête aux îles. Ils sont tristes les tropiques, surtout dans les soirs de solitude, puis elle buvait du rhum. Je ne suis pas excité par les femmes qui boivent du rhum. Je n'avais pas la tête à la débauche et de toute façon, ce que je voulais c'était dormir. Je regardais mon téléphone en commandant un thé. Je bus mon thé en regardant les messages sur mon téléphone. Je regardais défiler les conversations et je répondais aux gens à qui je n'avais pas voulu répondre, je n'avais pas voulu leur répondre dans mes moments de bonheur. J'avais commandé juste pour pouvoir m'asseoir et il y avait un couple à côté de moi qui s'envoyait des fleurs, à grands coups de « je t'aime, moi aussi et pour toujours et pour tout le temps et c'est comme ci qu'on s'aime, et non c'est comme ça… » J'écoutais pour passer le temps, pour me moquer.
Dans mon cahier, je pourrais écrire mes pensées, ou tout et n'importe quoi pour que le lecteur s'amuse. Mais qu'il s'amuse à quoi ? A lire n'importe quoi, sans aucun rapport avec les croquis qui eux-mêmes renvoient à n'importe quoi ? J'aime bien ce concept. Il y a des lecteurs et je repense aux lecteurs de Joyce qui doivent bien aimer ça.
Il faisait chaud et froid en même temps. J'avais chaud à l'extérieur et froid à l'intérieur. Je sortis du bar, j'avançai quelques mètres et je m'allumai une cigarette quand je revis une des femmes avec qui j'avais couché. Je marchais, abattu. Je sentais tout le poids de mon corps et mon cerveau voulait sortir de sa boite. Je sentais ma peau se tirer et se craqueler. J’étais un fantôme qui se déficelait. Elle marchait seule, à contre sens de mon avancée. Je ne pouvais pas la louper, elle non plus. Une fois à ses côtés, je feignis de ne pas la voir mais elle m'accosta :
- Jean-Baptiste !
Je me retournais vers elle, je n'avais que ça à faire, comment ne pas la louper ?
- Oui, ai-je dit sans pouvoir dire autre chose.
- Qu'est-ce que tu fais là ?
Elle me sourit. Je pensais lui avoir brisé le cœur, mais des fois on croit des choses incroyables. Même si dans le fond nous le savons, ce n'est pas parce qu'on ne rappelle pas, qu'on fait souffrir une femme. Parfois même, ça va dans son sens.
- Je ne sais pas trop ce que je fais là, et toi ?
- Rien, me dit-elle, je rentrais chez moi, tu veux venir ?
Je ne savais pas quoi répondre, mais je ne savais pas non plus pourquoi refuser. Alors je consentis sans trop me défendre, ni me débattre. Je savais qu'elle habitait à quelques pas du bar et je n'étais qu'à quelques pas du bar. Je la suivis. On ne parla pas de grand-chose pendant qu'on marchait. Elle me regardait mais je ne sentais pas de désir en elle. Je sentais plutôt de la nonchalance. Elle marchait comme vers l’abattoir, comme si tout allait se terminer à ce moment-là, elle lâchait ses bras ballants, elle marchait doucement, très doucement, les jambes fragiles. Elle aurait pu tomber à tout moment. Ses jambes étaient nues et blanches. Elle avait un tatouage sur la cuisse. Son short s'arrêtait juste en dessous des fesses. Elle portait une chemise à demi ouverte mais elle n'avait pas assez de poitrine pour que ça fasse vulgaire. Je la suivais. On arriva en bas de chez elle. Je n'avais pas envie de coucher avec elle, mais je montai quand même. Elle ouvrit la porte, se retourna vers moi et me dévisagea comme me demandant « pourquoi suis-je là », avec elle ? Je ne dis rien. On alla dans le salon. Il était sombre, peu de meubles, un canapé, un fauteuil, une table basse et dans un coin, une télévision. On n’aurait jamais pu penser que ce salon fût habité, ou du moins utilisé. Elle s'allongea sur le canapé et s'alluma une cigarette. Dans l'obscurité, on voyait la fumée épaisse et grise monter vers le plafond. Je m'assis sur le fauteuil, je regardai ses jambes, maigres, fragiles. Je ne savais pas, mais réellement pas ce que je faisais là.
7
Merde ! Vous sentez cette odeur ? Vous sentez qu’il n’y a pas d’odeur, que ça ne sent rien ? Ça ne sent pas mauvais, ça ne sent pas bon non plus. Ça ne pue pas ! La climatisation me fait mal à la tête. Ils doivent désinfecter l’air. Ils vont finir par nous désinfecter le cerveau !
C’est la lumière de Layanne qui raviva le mien, sa sensibilité, les étoiles dans ses yeux, ses morceaux de piano quand le soir elle jouait pour apaiser nos angoisses et créer du mouvement, dans un air éteint.
Je fixe le couloir, le couloir qui sépare les rangées de sièges. La femme à côté de moi, celle de toute à l'heure s'est enfin endormie, avec un bandeau sur les yeux. Jamais, je ne pourrais porter quelque chose de pareil et encore moins dormir avec. Souvent, il y a des tremblements, j'ai des sursauts, ça me sort de ma rêverie éveillée et solitaire.
Il fait chaud, je sens les gouttes de sueur commencer à perler sur mon front. Je n’ose pas regarder l’heure pour ne pas penser aux nombres de minutes écoulées depuis le décollage.
Tout est lent dans ce monde de rapidité, attendre toujours et il ne se passe jamais rien.
Parfois je priais la mort pour qu’elle me surprenne et même la mort ne me surprenait pas.
Ce soir-là, je restai assis sur le fauteuil en silence, attendant que le monstre de l’ennui vienne nous avaler tous les deux, mais rien. Elle se leva, me servit un verre de mauvais vin, du rosé. Elle s'en servit un verre aussi, on le but en silence. Je sentais la sueur sur mon front et des gouttes de sueur ruisseler dans mon dos, comme maintenant. J’avais si chaud. Ma chemise se collait à ma chair, elle se collait à ma peau et ma peau se collait à ma chemise, le tout se collait au cuir du fauteuil, un vieux fauteuil en cuir blanc jauni par la vieillesse. J’avais toujours froid, à l’intérieur. Elle balançait ses jambes, il y avait ses ombres qui se projetaient, et je voyais la forme de ses pieds sur le mur. On ne pouvait pas distinguer la couleur réelle de ce mur. Elle les balançait, sans aucune sensualité, sans aucune volonté de m'attirer vers elle. Elle fumait en recrachant la fumée de sa cigarette vers le plafond. De temps en temps, elle me jetait des regards. Je la fixais, je fixais ses jambes en restant assis. Je posais mon verre sur la table, il tomba, se cassa. Elle ne dit rien. Elle se leva, alla m'en chercher un autre, ramena la bouteille. Elle transpirait. Je voyais sa frange collée à son front. Elle me servit et me le tendit sans passion en soupirant comme si vivre lui était difficile. Je le pris, le bus d'un trait, et d'un coup, d’un seul, je me levai. Elle se figea et lâcha la bouteille qui se renversa sur le sol. On resta un moment comme ça, à se regarder. Puis elle me prit par la main. Je lâchai sa main, elle se laissa faire, elle ne voulut pas me la reprendre. Je partis. Oui, je partis. Il n’y avait que ça à faire.
Une fois dans la rue, je pensai à ce vieil ivrogne de Bukovski, qui en plus de baiser des prostituées nonchalantes, dans ses livres, du moins dans le dernier de lui que je lus, ne mettait pas de majuscule. C'était un peu déstabilisant. Je me demandais pourquoi il voulut s'affranchir d'une telle règle. Était-ce sa manière de répondre à l’enlisement ? Mais j'appréciais ses nouvelles. Et malgré la chaleur de la ville, l'heure tardive et le fait que je ne voulais pas rentrer chez moi, je n'avais rien à critiquer sur ses écrits.
Je continuais à marcher vers je ne sais où. Je pensais malgré tout au fait que j'aurais pu rester, « mais à quoi bon, pensai-je, je ne suis même pas dans les avions qui décollent, je ne vais pas m'envoyer en l'air, ici-bas. »
Ah oui ! Il y a ça aussi… et puis merde, je n'avais pas envie de me retrouver dans sa chambre. On avait compris tous les deux, que ça ne mènerait à rien. Je ne l'aurais pas rappelée, elle ne l'aurait pas voulu. C'était mieux que je parte sans mot et sans rire comme un vieux comédien qui ne connait même plus son rôle.
8
Deux nuits plus tard j’appelai Luc. Il répondit. J'allai le retrouver prêt de chez lui. Il descendit quelques minutes après que je sois arrivé. Il avait la gueule pleine de peinture. Je lui demandai pourquoi, il me dit qu'il se disputait avec l'une de ses toiles qui ne voulait pas lui rendre toute l'attention qu'il lui portait. Je lui dis que ce n'était pas de sa faute à elle, qu’il lui en demandait peut-être trop. Il me répondit qu'on n’en demande jamais trop en peinture et que c'était à elle de comprendre toute l'exigence de l'artiste.
- Mais alors, lui dis-je, qu'as-tu fait ?
- Je l'ai détruite, me dit-il, je l'ai complètement détruite.
- Ah…
- Elles ne comprennent que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre.
- Mais as-tu crié en la détruisant ?
- Oh que oui ! J'ai hurlé, je l'ai empoignée par les mains et je l'ai trouée sur mon chevalet, mais avant ça, je lui avais déjà envoyé ma peinture. Elle n'avait rien compris.
Il me raconta ensuite qu'il fallait du temps pour domestiquer ses toiles. Pollock avait réussi à faire entendre à ses toiles ce qu'il fallait pour qu'elles l'écoutent et qu'elles comprennent et réceptionnent toute sa spontanéité. Il n'en était pas encore là, mais il savait à ce moment-là, et je pense qu'il le sait toujours, que ça allait venir, qu'elles allaient finir par accepter tous ses jaillissements.
On marcha quelques heures à déblatérer sur le temps qui passe et qui ne mène à rien. On finit par monter à son appartement, où il me montra son chef d’œuvre. Je vis un foutoir pas possible avec de la peinture de partout et une toile en pièces. Et je lui dis : « mais peut-être que toute ton œuvre est là, peut-être que c'est parce qu'elle t'a dit non, et que tu as eu la rage, qu'elle t'a permis de faire sortir ce qu'il y avait en toi. C’est là, oui, là que réside tout ton travail de spontanéité, elle est là ton œuvre. » Il me regarda un instant sans vraiment comprendre, sceptique. Je sentais la térébenthine renversée par terre, ça me perçait les tempes. « Oui, me dit-il, je suis d'accord. Elle est là, devant nous. Elle est finie. »
9
Franchement quand j’y pense j’aurais dû sauter moi aussi ! Pourquoi ne pas foutre cet avion en l’air ? Ouvrir la sortie de secours et sauter, vivre une dernière sensation forte avant l’impact final. Je n’ai jamais eu de courage, même pour me suicider.
« Luce putain, je pense à toi ! »
Luce… A l’hôpital, elle tenait ce livre dans les mains, je revois la scène en boucle, elle me passe constamment devant les yeux, je ne peux pas l’effacer. Je n’écrivais même pas, elle le lisait ! Elle me parlait de lui, j’avais ce vertige, je ne la connaissais pas beaucoup, je la rencontrais, elle me plaisait déjà, je commençais déjà à le haïr, le haïr d’une haine folle, premier sentiment qui revenait en moi dans un monde désaffecté, premier plaisir qu’elle m’offrit sans même le savoir.
Vous allez tout comprendre, soyez patient. Et je me parle à moi-même comme à quelqu’un – c’est la solitude, c’est ça, le trop de solitude dans ce monde de la pleine communication, du réseau -. Mais je me comprends… Je me comprends…
J’ai ce vertige, ce même vertige qu’en haut d’une tour, il me parcourt. Parait que cette vie est morte dès aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas en tenir compte, qu'il faut la vivre comme si elle se répétait éternellement… Ou peut-être que je n'ai pas compris et que ce fou ne dit pas ça. Je n'ai entrevu dans ce livre que l'absurde de l'insoutenable, mais que dire de l'insoutenable ? C’est à travers ce livre que je me suis rapproché d’elle, ô ma Luce, ma lumière, mon amour !





























