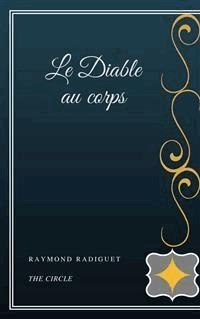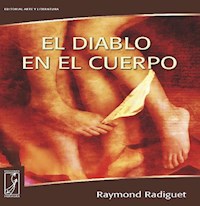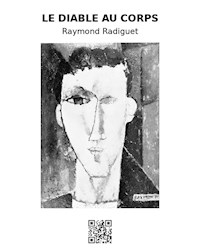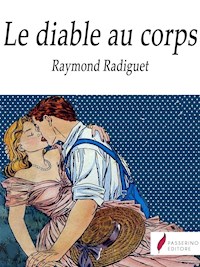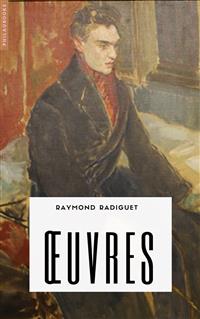Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Le Bal du comte d'Orgel est un roman de l'écrivain français Raymond Radiguet, publié en 1924. Ce livre raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre le comte d'Orgel, sa femme et un jeune homme. L'œuvre est saluée pour sa finesse psychologique et son style élégant, et elle est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française du XXe siècle. Le Bal du comte d'Orgel est un roman empreint de sensualité et de subtilité, qui explore les tourments de l'amour et de la passion.
Extrait : ""La comtesse d'Orgel appartenait par sa naissance à l'illustre maison des Grimoard de la Verberie. Cette maison brilla pendant de nombreux siècles d'un lustre incomparable. Ce n'est pourtant pas que les ancêtres de Mme d'Orgel se fussent donné le moindre mal. Toutes les circonstances glorieuses auxquelles les autres familles doivent leur noblesse, cette maison tire son orgueil d'y être restée étrangère."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335005202
©Ligaran 2015
Les mouvements d’un cœur comme celui de la comtesse d’Orgel sont-ils surannés ? Un tel mélange du devoir et de la mollesse semblera peut-être, de nos jours, incroyable, même chez une personne de race et une créole. Ne serait-ce pas plutôt que l’attention se détourne de la pureté, sous prétexte qu’elle offre moins de saveur que le désordre ?
Mais les manœuvres inconscientes d’une âme pure sont encore plus singulières que les combinaisons du vice. C’est ce que nous répondrons aux femmes, qui, les unes, trouveront Mme d’Orgel trop honnête, et les autres trop facile.
La comtesse d’Orgel appartenait par sa naissance à l’illustre maison des Grimoard de la Verberie. Cette maison brilla pendant de nombreux siècles d’un lustre incomparable. Ce n’est pourtant pas que les ancêtres de Mme d’Orgel se fussent donné le moindre mal. Toutes les circonstances glorieuses auxquelles les autres familles doivent leur noblesse, cette maison tire son orgueil d’y être restée étrangère. Une pareille attitude ne va point à la longue sans danger. Les Grimoard étaient au premier rang de ceux qui inspirèrent à Louis XIII la résolution d’affaiblir la noblesse féodale. Leur chef supporta mal cette injure, et c’est avec bruit qu’il quitta la France. Les Grimoard s’installèrent à la Martinique.
Le marquis de la Verberie retrouve sur les indigènes de l’Ile la puissance de ses aïeux sur les paysans de l’Orléanais. Il dirige des plantations de cannes à sucre. En satisfaisant son besoin d’autorité, il accroît sa fortune.
Nous commençons alors à assister à un singulier changement de caractère dans cette famille. Sous un soleil délicieux, il semble que fonde peu à peu l’orgueil qui la paralysait. Les Grimoard, comme un arbre sans élagueur, étendent des branches qui recouvrent presque toute l’île. En débarquant, on va leur rendre ses devoirs. Qu’un nouveau venu se découvre une parenté avec eux, sa fortune est faite. Aussi, le premier soin de Gaspard Tascher de la Pagerie arrivant dans l’Ile, sera-t-il d’établir son cousinage, tout lointain qu’il soit. Le mariage d’un Grimoard avec une demoiselle Tascher noue ces liens un peu lâches. Cependant les années passent. Malgré les Grimoard, les Tascher de la Pagerie ne jouissent pas d’une grande considération. La défaveur, le scandale même atteignent à leur comble, lorsque la jeune Marie-Joseph Tascher s’embarque pour la France et que l’on publie les bans de son mariage avec un Beauharnais, dont le père possède des plantations à Saint-Domingue.
Les Grimoard furent les seuls à ne point tenir rigueur à Joséphine après le divorce. C’est elle qui leur annonce la Révolution. Ils accueillent cette nouvelle avec plaisir. Les Grimoard n’avaient jamais pensé que la famille qui les avait dépouillés de leurs droits pût encore tenir longtemps sur le trône. Peut-être crurent-ils d’abord la Révolution menée par les seigneurs, et pour eux. Mais quand ils sauront la tournure des choses de France, ils blâmeront ceux à qui on coupe la tête de n’avoir pas suivi leur exemple, de n’être pas partis au bon moment, c’est-à-dire sous Louis XIII.
De leur île, comme des voisins malveillants derrière leur judas, ils observent le vieux continent. Cette Révolution les égaye. Quoi de plus drôle, par exemple, que ce mariage de la petite cousine avec un général Bonaparte ! Mais où la plaisanterie leur semblera excessive, ce sera lors de la proclamation de l’Empire. Ils y voient l’apothéose de la Révolution. Le bouquet de ce feu d’artifice retombe en une pluie de croix, de titres, de fortunes. Cette immense mascarade, où l’on change de nom comme on met un faux-nez, les blesse. On assiste dans la Martinique à un branlebas curieux. L’île charmante se dépeuple en un clin d’œil. Joséphine qui se constitue une famille essaye d’attacher à la Cour ses parents les plus vagues, quelquefois les plus humbles, mais dont les noms ne datent pas d’hier. C’est aux Grimoard qu’elle a pensé d’abord. Les Grimoard ne répondent pas. Ce ne sera qu’une fois Joséphine répudiée que l’on renouera avec elle. Le marquis lui écrira même une lettre fort morale, lui disant qu’il n’avait jamais pu prendre la chose au sérieux. Il lui offre son toit. Sa haine pour l’Empire éclate. Jusque-là, il se retenait, à cause de leur parenté.
Il pourra surprendre qu’en suivant cette famille le long des siècles, nous ayons feint de ne voir qu’un personnage, toujours le même. C’est que nous nous soucions peu, ici, des Grimoard, mais de celle en qui ils vivent. Il faut comprendre que Mlle Grimoard de la Verberie, née pour le hamac sous des cieux indulgents, se trouve dépourvue des armes qui manquent le moins aux femmes de Paris et d’ailleurs, quelle que soit leur origine.
Mahaut, à sa naissance, avait été reçue sans grand enthousiasme. La marquise Grimoard de la Verberie n’avait jamais vu de nouveau-né. Quand on présenta Mahaut à sa mère, cette femme qui avait subi avec courage les douleurs de l’enfantement s’évanouit, croyant avoir fait un monstre. Quelque chose lui resta de ce premier choc, et Mahaut, petite, fut entourée de suspicion. Comme elle ne parla qu’assez tard, sa mère la croyait muette.
Mme Grimoard attendait un autre enfant avec impatience, espérant un garçon. Elle le parait d’avance de toutes les vertus refusées à sa fille. Elle était grosse lorsqu’un affreux cataclysme détruisit Saint-Pierre. La marquise fut sauvée par miracle, mais on craignit un moment pour sa raison, et pour l’enfant qu’elle allait mettre au monde. Cette île ne lui inspira désormais que de l’horreur ; elle refusa d’y rester. Les médecins représentèrent à son mari combien il serait criminel de la contrarier. C’est ainsi que les Grimoard que rien n’avait pu convaincre, même la promesse d’un royaume, débarquèrent en France, au mois de juillet 1902. Par hasard le domaine de la Verberie était à vendre. Ce fut avec la conviction de venger ses ancêtres que le marquis réintégra leur domaine. Il se croyait son propre ancêtre et rappelé par Louis XIII suppliant ; il passa toute sa vie en procès avec des paysans dont il pensait être encore le seigneur.
Mme Grimoard mit au jour un enfant mort. Par un accident féminin, dont le cataclysme fut cause, elle devint hors d’état de prétendre à la maternité. Son désespoir s’accrut du fait que le mort-né était un garçon. La marquise y gagna une prostration maladive, qui fit d’elle une créole des images, passant sa vie sur une chaise-longue.
Son cœur de mère ne pouvant plus espérer de fils, ne semble-t-il pas que son amour pour Mahaut aurait dû s’accroître ? Mais cette petite fille, si pleine de vie, si turbulente, lui semblait presque une offense à ses espoirs brisés.
Mahaut grandissait à la Verberie comme une liane sauvage. Sa beauté, son esprit ne naquirent pas en un jour, mais plus sûrement. C’était chez la vieille négresse Marie, que l’on se prêtait chez les Grimoard comme un objet de famille, que Mahaut trouvait de la vraie tendresse ; une tendresse subalterne, c’est-à-dire celle qui ressemble le plus à de l’amour.
Après la Séparation, il fallut bien élever Mahaut à la Verberie même. Ce fut aux mains d’une vieille fille sans fortune, et d’une excellente famille de province, que passa Mlle Grimoard. Sa mère somnolait toute la journée ; le seul soin que prit d’elle son père fut de lui apprendre que personne n’était digne d’une Grimoard. Mais la fraîcheur de ses premières enfances, elle la retrouva en épousant, à dix-huit ans, le comte Anne d’Orgel, un assez beau nom de chez nous. Elle s’éprit follement de son mari qui, en retour, lui en témoigna une grande reconnaissance et l’amitié la plus vive, que lui-même prenait pour de l’amour. La négresse Marie fut la seule à ne pas voir cette alliance d’un bon œil. Son reproche était fondé sur la différence d’âge. Elle trouvait le comte d’Orgel trop vieux. Marie entra néanmoins à l’hôtel d’Orgel pour ne pas être séparée de la comtesse. Elle n’avait, disait-on, rien à faire. Mais parce que son emploi n’était pas défini, les domestiques se déchargeaient sur elle de mille petites besognes. À la fin de ses journées, la négresse tombait de fatigue.
Le comte Anne d’Orgel était jeune ; il venait d’avoir trente ans. On ne savait de quoi sa gloire, ou du moins son extraordinaire position était faite. Son nom n’y entrait pas pour grand-chose, tant, même chez ceux qu’hypnotise un nom, le talent prime tout. Mais, il faut le reconnaître, ses qualités n’étaient que celles de sa race, et son talent mondain. Son père, qu’on admirait en se moquant, venait de mourir. Anne, aidé de Mahaut, redonna un lustre à l’hôtel d’Orgel, où naguère l’on s’était bien ennuyé. Ce furent les Orgel qui, si l’on peut dire, ouvrirent le bal au lendemain de la guerre. Le feu comte d’Orgel eût trouvé sans doute que son fils faisait trop de place, dans ses invitations, au mérite personnel et à la fortune. Cet éclectisme, sévère malgré tout, ne fut pas la moindre raison du succès des Orgel. Il contribua d’autre part à les faire blâmer par ceux de leurs parents qui dépérissaient d’ennui à ne recevoir que des égaux. Aussi les fêtes de l’hôtel d’Orgel étaient à ces parents une occasion unique de distraction et de médisance.
Parmi les hôtes dont la présence eût dérouté le feu comte d’Orgel, on doit mettre au premier plan Paul Robin, un jeune diplomate. Il considérait comme une chance d’être reçu dans certaines maisons ; et la plus grande chance, à ses yeux, était d’aller chez les Orgel. Il classait les gens en deux groupes : d’un côté ceux qui étaient des fêtes de la rue de l’Université, et, de l’autre, ceux qui n’en étaient point. Ce classement allait jusqu’à le retenir dans ses admirations : il en usait ainsi envers son meilleur ami, François de Séryeuse, auquel il reprochait secrètement de ne tirer aucun avantage de sa particule. Paul Robin, assez naïf, jugeait les autres d’après lui-même. Il ne pouvait concevoir que les Orgel ne représentassent à François rien d’exceptionnel, et qu’il ne cherchât d’aucune façon à forcer les circonstances. Paul Robin, d’ailleurs, était heureux de cette supériorité fictive et n’essayait pas d’y mettre fin.
On ne pouvait rêver deux êtres plus loin l’un de l’autre que ces deux amis. Cependant ils croyaient s’être liés à cause de leurs ressemblances. C’est-à-dire que leur amitié les poussait à se ressembler, dans la limite du possible.
L’idée fixe de Paul Robin était d’« arriver ». Alors que d’autres ont le travers de croire qu’on les attendra toujours, Paul trépignait en pensant qu’il allait manquer le train. Il croyait aux « personnages » et que l’on peut jouer un rôle.
Débarrassé de toute cette niaise littérature, invention du XIXe siècle, quel n’eût pas été son charme !
Mais ceux qui ne sentent pas les qualités profondes et se laissent prendre aux masques, n’osent s’aventurer par crainte de sables mouvants. Paul croyait s’être réussi une figure ; en réalité, il s’était contenté de ne pas combattre ses défauts. Cette mauvaise herbe l’avait peu à peu envahi et il trouvait plus commode de faire penser qu’il agissait par politique alors que ce n’était que faiblesse. Prudent jusqu’à la lâcheté, il fréquentait divers milieux ; il pensait qu’il faut avoir un pied partout. À ce jeu, on risque de perdre l’équilibre. Paul se jugeait discret, il n’était que cachottier. Ainsi divisait-il sa vie en cases : il croyait que lui seul pouvait passer de l’une à l’autre. Il ne savait point encore que l’univers est petit et que l’on se retrouve partout. « Je dîne chez des gens », répondait-il à François de Séryeuse l’interrogeant sur l’emploi de sa soirée. Ces « gens » signifiaient pour lui « mes gens ». Ils lui appartenaient. Il en avait le monopole. Une heure après, il retrouvait Séryeuse à son dîner. Mais malgré les tours que lui jouait la cachotterie, il ne s’en pouvait défaire.
Par contre, Séryeuse était l’insouciance même. Il avait vingt ans. Malgré son âge et son oisiveté, il était bien vu par des aînés de mérite. Assez fou sous bien des rapports, il avait eu la sagesse de ne pas brûler les étapes. Le dire précoce, rien n’eût été plus inexact. Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. Mais les jeunes gens sont si impatients d’atteindre les moins accessibles, et d’être des hommes, qu’ils négligent ceux qui s’offrent.
En un mot, François avait exactement son âge. Et, de toutes les saisons, le printemps, s’il est la plus seyante, est aussi la plus difficile à porter.
La seule personne en compagnie de laquelle il se vieillît était Paul Robin. Ils exerçaient l’un sur l’autre une assez mauvaise influence.
Le samedi 7 février 1920, nos deux amis étaient au cirque Médrano. D’excellents clowns y attiraient le public des théâtres.
Le spectacle était commencé. Paul, moins attentif aux entrées des clowns qu’à celles des spectateurs, cherchait des visages de connaissance. Soudain, il sursauta.
En face d’eux entrait un couple. L’homme fit, avec son gant, un léger bonjour à Paul.
– C’est bien le comte d’Orgel demanda François.
– Oui, répondit Paul assez fier.
– Avec qui est-il ? Est-ce sa femme ?
– Oui, c’est Mahaut d’Orgel.
Dès l’entracte, Paul fila comme un malfaiteur, profitant de la cohue, à la recherche des Orgel, qu’il souhaitait voir, mais seul.
Séryeuse, après avoir fait le tour du couloir, poussa la porte des Fratellini. On se rendait dans leur loge comme dans celle d’une danseuse.
Il y avait là des épaves grandioses, des objets dépouillés de leur signification première, et qui, chez ces clowns, en prenaient une bien plus haute.
Pour rien au monde, M. et Mme d’Orgel ne se fussent dispensés, étant au cirque, de cette visite aux clowns. Pour Anne d’Orgel, c’était se montrer simple.
Voyant entrer Séryeuse, le comte mit immédiatement ce nom sur son visage. Il reconnaissait chacun, ne l’eût-il aperçu qu’une fois, et d’un bout d’une salle de spectacle à l’autre ; ne se trompant ou n’écorchant un nom que lorsqu’il le voulait.
Il devait à son père l’habitude d’adresser la parole à des inconnus. Le feu comte d’Orgel s’attirait fréquemment des réponses désagréables de personnes qui n’acceptent pas ce rôle de bête curieuse.
Mais ici, l’exiguïté de la loge ne pouvait permettre à ceux qui s’y trouvaient de s’ignorer. Anne joua une minute avec Séryeuse en lui adressant quelques phrases sans lui montrer qu’il le connaissait de vue. Il comprit que François était gêné de n’avoir pas été reconnu et que la partie se jouât inégale. Alors se tournant vers sa femme : « M. de Séryeuse, dit-il, ne semble pas nous connaître aussi bien que nous le connaissons ». Mahaut n’avait jamais entendu ce nom, mais elle était habituée aux manèges de son mari.
– J’ai souvent, ajouta ce dernier en souriant à Séryeuse, prié Robin « d’organiser quelque chose ». Je le soupçonne de faire mal les commissions.
Venant de voir François avec Paul, dont il connaissait le travers, il mentait comme l’affabilité sait mentir.
Tous les trois raillèrent les cachotteries de Robin. On décida de le mystifier. Il fut entendu entre Anne d’Orgel et François que l’on feindrait de se connaître de longue date.
Cette innocente farce supprima les préliminaires de l’amitié. Anne d’Orgel voulut faire visiter à François, qui la connaissait, l’écurie du cirque, comme si c’eût été la sienne.
De temps en temps, quand il sentait qu’elle ne pouvait le surprendre, François jetait un coup d’œil sur Mme d’Orgel. Il la trouvait belle, méprisante et distraite. Distraite, en effet ; presque rien n’arrivait à la distraire de son amour pour le comte. Son parler avait quelque chose de rude. Cette voix d’une grâce sévère apparaissait rauque, masculine, aux naïfs. Plus que les traits, la voix décèle la race. La même naïveté eût fait prendre celle d’Anne pour une voix efféminée. Il avait une voix de famille et ce fausset conservé au théâtre.
Vivre un conte de fée n’étonne pas. Son souvenir seul nous en fait découvrir le merveilleux. François appréciait mal ce qu’avait de romanesque sa rencontre avec les Orgel. Ce tour qu’ils voulaient jouer à Paul les liait. Ils se sentaient complices. Ils étaient leurs propres dupes, car ayant décidé de faire croire à Robin qu’ils se connaissaient de longue date, ils le croyaient eux-mêmes.
Une sonnette avait annoncé la fin de l’entracte. François pensait avec mélancolie qu’il devait se séparer des Orgel, et rejoindre Paul. Anne proposa de déplacer quelqu’un pour « rester ensemble ». La farce n’en serait que meilleure.
Paul détestait les retards, et tout ce qui peut vous faire remarquer sans bénéfice. Il songeait plus à l’opinion des autres qu’à la sienne. Déjà mécontent d’avoir manqué les Orgel, et de n’avoir su se dépêtrer de moindres personnages rencontrés sur son chemin, il grognait contre François à cause de son retard. Quand il vit le trio, il n’en crut pas ses yeux.
Anne agissait toujours comme s’il eût été connu de la terre entière, mais, à rebours du vieux comte, le faisait avec assez de bonne grâce pour obtenir bien des résultats. Cette assurance, ou cette inconscience, lui réussirent une fois de plus. Il n’eut qu’à dire un mot pour que l’ouvreuse déplaçât deux spectateurs.
Le dialogue entre Anne d’Orgel et Séryeuse faisait supposer à Paul, peu apte à brûler les étapes, qu’ils se connaissaient depuis longtemps. Rageur, se sentant joué, il s’efforçait de cacher sa surprise.
La faculté d’enthousiasme d’Anne d’Orgel était sans bornes. Il paraissait venir au cirque pour la première fois, mais n’en renonçait pas moins à feindre de connaître les numéros. Le nain passait-il sur le rebord de la piste, il lui faisait les mêmes petits signes que, tout à l’heure, à Paul.
Car s’il parlait souvent d’une façon vague de ce que l’on appelle les grands de la terre, c’était avec la modestie qui sied lorsqu’on parle de soi. Il lui arrivait de dépeindre en deux mots irrespectueux une souveraine, et de s’étendre une heure, minutieusement, passionnément, comme on décrit des mœurs d’insectes, sur les gens d’une autre caste, c’est-à-dire, selon lui, des inférieurs. Du reste en face de cette race étrangère il perdait la tête, et ne pensait qu’à éblouir. Cette timidité loquace le poussait alors aux pires maladresses, à des folies de phalène autour d’une lampe.
Pendant la guerre, il lui avait été donné d’approcher des hommes de classes différentes. À cause de cela, la guerre l’avait amusé.
Cet amusement lui retira le bénéfice de son héroïsme : il fut suspect. Les généraux n’aimaient pas un blanc-bec qui parlait sans trêve, n’avait pas la moindre idée du respect hiérarchique, prétendait renseigner sur l’état d’esprit de l’Allemagne, son moral, et ne cachait pas qu’il correspondait, par la Suisse, avec ses cousins autrichiens. Bien qu’il eût plusieurs fois mérité la Croix de la Légion d’honneur, elle ne lui fut jamais offerte.
Son père était pour beaucoup la cause de cette injustice : il était, lui, formidable. Il ne voulut jamais quitter son château de Colomer, en Champagne. « Je ne crois pas aux obus », criait-il à son cocher auquel il commandait d’atteler pour la promenade quotidienne. Aux sentinelles lui demandant le mot d’ordre il répondait : « Je suis M. d’Orgel. »
Incapable de reconnaître les grades, il disait « Monsieur l’Officier » tout soldat pourvu de galon, qu’il fût sergent ou colonel. On se vengea par mille farces. Sous prétexte que la Patrie avait besoin de pigeons-voyageurs, les officiers, ses hôtes, réquisitionnèrent les pigeons du colombier qui, le soir même, relevaient le menu de la popote. M. d’Orgel l’apprit. À partir de ce jour, il répéta : « Je ne sais ce que vaut Monsieur Joffre, mais ses gens sont des escrocs. »