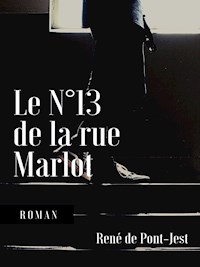Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Au cours d'un voyage d'affaires en Amérique, Raymond Deblain, célibataire invétéré, épouse la belle Rhéa, fille d'Elias Panton, riche industriel de Philadelphie. À son retour en France, il la présente à son ami et voisin, le docteur Plemen, éminent médecin de la ville de Vermel. Rhéa s'intègre vite dans la société provinciale suscitant admiration et jalousie. Peu de temps après sa soeur Jenny, mariée à son tour, vient la rejoindre et le couple Deblain vit heureux jusqu'au jour où Raymond est trouvé mort dans son lit. Le docteur Plemen après examen du corps conclut à un assassinat par empoisonnement...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Cas du docteur Plemen
Le Cas du docteur PlemenPROLOGUE. L’HÔTEL DE LA RUE BOISSIÈREPREMIÈRE PARTIEDEUXIÈME PARTIEÉPILOGUE. LE SECRET DE WILLIAMPage de copyrightLe Cas du docteur Plemen
René de Pont-Jest
À LA MÉMOIRE
DU GRAND AVOCAT CRIMINEL DU XIXe SIÈCLE
Le bien regretté maître
CHARLES-ALEXANDRE LACHAUD
Souvenir respectueux
De celui qu’il ne cessa d’honorer de son amitié.
René de PONT-JEST.
Paris, 15 avril 1887.
PROLOGUE. L’HÔTEL DE LA RUE BOISSIÈRE
Il eût été difficile de découvrir dans tout Paris une habitation d’un aspect plus gracieux que celle qui portait le numéro 164 de la rue Boissière, à Passy.
À travers les barreaux de la grille qui la défendait du côté de la voie publique, on apercevait un petit jardin que se disputaient les hortensias et les roses ; puis, au delà, une jolie construction à l’italienne, à un seul étage, dont les murs disparaissaient en partie sous la vigne vierge et le chèvrefeuille.
On eût dit un nid d’amoureux, tant il y régnait de calme, tant les visiteurs y étaient rares.
À l’intérieur de ce mignon hôtel, tout était confortable, non pas de ce confortable anglais, froid, sec, méthodique, qui donne aux plus riches appartements de Londres des airs de chambres garnies et fréquemment inhabitées, mais de cet élégant et chaud confortable parisien, que les étrangers cherchent vainement à imiter.
Le meuble sévère du grand cabinet de travail, au côté gauche du rez-de-chaussée, disait bien que c’était là le séjour d’un homme studieux ; mais les fleurs dont était constamment ornée la salle à manger, ainsi que les albums et bibelots d’art placés sur les tables et les consoles du salon, trahissaient la présence d’une femme jeune et pleine de goût, âme de cette paisible demeure.
En effet, il arrivait parfois que les passants, qui ne s’étaient arrêtés devant le petit hôtel de la rue Boissière que pour en examiner le jardin, laissaient échapper un mouvement d’admiration à la vue d’une jeune fille dont la tête adorable se montrait, comme au milieu d’un cadre parfumé, à l’une des fenêtres de la maison.
Tout ce que les voisins savaient de cette jolie enfant, c’est qu’elle se nommait Jane, avait dix-sept ou dix-huit ans, était douce et charmante, et demeurait là avec son père, qu’on pensait n’être que son père adoptif, M. William Witson.
Bien que M. Witson et miss Jane parlassent tous deux très purement le français, on les croyait étrangers, Anglais ou Américains. Les curieux avaient tenté vainement d’en apprendre davantage.
Il n’y avait dans la maison que deux domestiques : une cuisinière – qui peut-être aurait bavardé, si elle avait eu quelque chose d’intéressant à dire, mais elle n’était entrée au service de M. Witson qu’à l’arrivée de celui-ci rue Boissière – et une femme de chambre, ne connaissant pas un mot de notre langue et ne sortant jamais sans sa jeune maîtresse.
La maison abritait encore une cinquième personne, mais nul ne se serait hasardé à l’interroger, tant elle était de physionomie sévère et paraissait peu communicative. C’était mistress Vanwright, qui, après avoir été l’institutrice de miss Jane, qu’elle adorait, était restée près d’elle en qualité de gouvernante.
Quant à William Witson, c’était un homme d’une quarantaine d’années, d’apparence robuste, à la tenue correcte, aux traits fins et distingués. Ne portant pour toute barbe que de longs favoris blonds, il avait quelque chose de l’officier de marine ou du magistrat.
Très matinal, il se promenait dès la première heure du jour dans son jardin, où miss Jane, à son réveil, venait le rejoindre pour lui donner son front à baiser. Puis il se retirait dans son cabinet de travail, où il se mettait à parcourir fiévreusement les journaux qu’il recevait un peu de tous les pays du monde, journaux parmi lesquels figuraient de nombreuses feuilles judiciaires : la Gazette des Tribunaux et le Droit, de Paris ; le Police News, de Londres ; le Juristische Blætter, de Berlin ; le Freischütz, de Francfort ; la Gerichtshalle, de Vienne ; la National Police Gazette et le Illustrated Police News, de New-York.
La rapidité avec laquelle Witson lisait tous ces journaux prouvait la connaissance parfaite qu’il avait des langues étrangères. Il n’abandonnait cette lecture que pour se mettre à table à dix heures, en face de miss Jane. Celle-ci s’efforçait alors d’arracher celui qu’elle appelait « son ami » aux préoccupations constantes qui semblaient l’obséder.
Mais ses efforts n’avaient, le plus souvent, qu’un succès momentané.
Si Witson acceptait toujours avec un affectueux sourire les observations de la jeune fille sur l’existence trop sévère qu’il menait ; s’il lui promettait de vivre moins isolé, de se distraire davantage, son regard se fixait fréquemment sur sa jolie interlocutrice avec une expression de douloureuse tendresse.
Il paraissait lui reprocher de si peu comprendre le but de sa vie, de ne pas deviner qu’elle était aussi intéressée que lui-même au résultat de ses travaux.
Et, sans doute pour ne pas se laisser dominer par l’émotion qui, dans ces moments-là, s’emparait de lui, William se remettait à dévorer de nouveau, dans ses feuilles judiciaires, le récit de quelques-uns de ces crimes dont la cause et le but échappent également au psychologue, crimes qui semblent commis pour le seul amour du mal, et dont les auteurs, monstres moraux, sont, pour ainsi dire, irresponsables.
Ce n’était pas là, probablement, ce que cherchait l’étranger ; car, si les articles de ce genre arrêtaient un instant son esprit, il jetait bientôt loin de lui ses journaux, avec un mouvement de colère et de déception.
Il ne fallait rien moins qu’un baiser de Jane pour le calmer.
Parfois, après avoir déjeuné rapidement, William sortait, presque toujours seul.
Ces jours-là, il se rendait alors au palais de justice, où il avait les plus honorables relations parmi les magistrats, ce qui lui permettait d’être particulièrement assidu aux audiences des grands procès criminels.
À demi caché dans les rangs de la foule, bien qu’il eût une place réservée sur l’estrade, derrière la Cour, il suivait les débats avec un vif intérêt.
Évidemment il était là en romancier ou en criminaliste, estimant que, si misérable que soit l’homme qui défend son honneur ou sa tête, il ne devrait jamais être donné en spectacle aux désœuvrés et aux femmes atteintes de cette forme de névrose : la curiosité malsaine.
Ce qui frappait ceux avec lesquels notre mystérieux personnage échangeait ses impressions pendant les suspensions d’audience, c’était son érudition en jurisprudence, en procédure, en toutes matières, pour ainsi dire, et son indulgence, sa pitié pour les accusés, si grands, si avoués que fussent leurs crimes.
« On ne sait pas, répétait-il volontiers, on ne sait jamais ! Souvent il n’y a pas plus de raison pour croire aux aveux d’un prévenu qu’il n’y en a pour accepter ses dénégations. Le travail qui se fait dans l’esprit de celui qu’on a brusquement isolé doit compter pour beaucoup. On ne se représente pas assez les tortures physiques de la prison préventive, non plus que les angoisses morales de l’instruction criminelle.
« Aux prises avec un magistrat habile, pressé de questions inutiles et cependant répétées sous mille formes différentes, humilié par ce juge, qui, ne cherchant qu’un coupable et voulant le trouver dans celui qu’il interroge, lui parle sur un ton malveillant, le trouble, lui tend tous les pièges, guette ses moindres paroles pour les dicter à son greffier, en donnant à ces paroles l’interprétation qui lui convient ; aux prises, dis-je, avec cet inquisiteur impitoyable, le prévenu perd souvent la tête, et la confusion de ses réponses, les rétractations qu’il tente, les explications nouvelles qu’il donne, tout est mis à sa charge. S’il se défend avec trop d’énergie, c’est qu’il comprend quel danger il court, qu’il s’était préparé à la lutte, qu’il veut égarer la justice. Donc il est coupable. Son indignation n’est qu’une comédie et doit éloigner de lui toute pitié. Si, au contraire, il balbutie, courbe le front, rougit ou pâlit, ne trouve rien à dire, c’est qu’il comprend combien il lui serait impossible de repousser les faits relevés contre lui. Sa culpabilité est donc évidente. S’il rit, c’est de cynisme ; s’il pleure, c’est d’épouvante. »
Lorsqu’on le mettait sur ce terrain, Witson ne tarissait pas, son calme ordinaire l’abandonnait, le sang lui montait au visage ; il était visible qu’il ne comprimait qu’avec peine les sentiments violents qui l’agitaient. Il était surtout d’une sévérité excessive, presque brutale pour les médecins légistes, ces auxiliaires indispensables, mais si dangereux, de la justice.
« Ce qu’il y a de terrible, poursuivait-il à ce sujet, c’est quand l’instruction criminelle a appelé à son aide quelques-uns de ces savants prêts à tout sacrifier à un système, ne voyant rien en dehors de leur école, incapables, par orgueil, de revenir sur une erreur. Plutôt que de changer un iota aux conclusions de leurs rapports, ils laisseraient condamner dix innocents ; plutôt que de reconnaître qu’ils se sont trompés, ils inventeraient les phénomènes chimiques et physiologiques les plus opposés à toutes les lois naturelles connues. »
Et William racontait volontiers, à propos de ce point spécial, l’épouvantable erreur judiciaire dont avait été victime une jeune femme de Douai, quelques années auparavant.
Poursuivie, arrêtée et incarcérée sous la prévention d’infanticide, mise au secret, pressée, torturée pendant deux mois par son juge d’instruction, menacée de la prolongation indéfinie de son emprisonnement préventif si elle n’avouait pas, cette malheureuse finit par se reconnaître coupable. Traduite en cour d’assises, elle fut condamnée à cinq ans de prison, et, moins de trois mois après sa condamnation, elle accouchait à terme à la maison centrale de Melun. De sorte qu’en s’en rapportant aux dates fixées par l’instruction même, cette pauvre fille était enceinte de quatre mois au moment précis où on prétendait qu’elle avait mis au monde et tué son enfant.
Mais cette démonstration matérielle de l’innocence ou, mieux encore, de l’impossibilité de la culpabilité de cette femme ne troubla pas plus le médecin légiste que les magistrats qui l’avaient condamnée.
Le docteur que le parquet s’était adjoint démontra par a + b, dans un savant rapport, qu’il s’était trouvé, dans le cas dont il s’agissait, en présence d’une grossesse double, de deux conceptions indépendantes l’une de l’autre, ayant des dates différentes, ce qu’on appelle une superfétation, phénomène qui n’était pas sans précédent. C’était dire une énormité, car si le fait s’est présenté çà et là, chez les animaux, en particulier dans la race chevaline, il n’est pas reconnu comme vérité incontestable dans la race humaine, et sans entrer ici dans des développements qui nous conduiraient trop loin, les physiologistes n’admettent la superfétation que dans des conditions particulières que n’avait pas offertes la femme en cause. De plus, il était permis de n’avoir qu’une confiance limitée dans l’expérience du docteur auquel cette malheureuse avait eu affaire, puisqu’en constatant son récent accouchement il ne s’était pas aperçu qu’elle était enceinte de cinq mois. On le voit, l’accusée aurait dû tout au moins bénéficier du doute. Mais que serait devenue l’infaillibilité de la médecine légale et de la justice ? Et la condamnation fut bel et bien maintenue.
Le bureau des grâces daigna seulement abréger la peine de la victime de cette monstrueuse erreur.
Lorsqu’il sortait de l’une de ces audiences d’assises où il avait eu l’occasion d’émettre ses idées sur l’instruction criminelle, Witson rentrait chez lui plus splénétique que jamais, et miss Jane, pendant plusieurs jours, tentait de vains efforts pour le distraire.
Cependant la jolie enfant s’y employait de toute son âme, car l’affection qu’elle avait vouée à son ami était profonde. Elle hésitait parfois à l’exprimer, ayant remarqué ce fait étrange : lorsqu’elle se montrait trop empressée auprès de lui, il devenait plus froid et plus réservé, et quand, au contraire, elle le négligeait un peu, sa tendresse se faisait plus expansive. Il semblait craindre par moments d’être trop aimé, et par d’autres de l’être trop peu.
On eût juré que, dans Jane, tout à la fois il adorait l’enfant et craignait la femme.
La vérité, c’est que William était violemment épris de cette jeune fille qu’il avait recueillie dix années auparavant, et qu’il s’efforçait de dissimuler cet amour comme s’il était un crime. Craignant de se trahir, il avait formé plusieurs fois le projet de se séparer d’elle ; mais, au moment de lui faire part de sa résolution, le courage lui avait manqué, et rien n’avait été changé à la vie commune.
L’Américain souffrait visiblement de cette lutte ainsi que du silence qu’il s’était imposé ; cependant mistress Vanwright lui avait en vain conseillé d’agir autrement.
En apprenant par l’excellente femme que le cœur de sa fille adoptive lui appartenait tout entier, William avait pâli et s’était écrié :
– Non, je n’oserai jamais lui révéler l’horrible secret qui nous sépare. Peut-être me maudirait-elle ! Le mieux est de me taire, lors même que je devrais souffrir cent fois plus encore. Elle est jeune, belle, bien élevée, et riche, puisque je le suis ; détournez-la de moi ; elle aimera un jour ; ce jour-là, elle sera heureuse ; je disparaîtrai, et ma faute sera expiée.
Quant à miss Jane, qui ne savait rien des tourments intimes de son ami, elle mettait ses variations de caractère ainsi que ses accès de taciturnité sur le compte de ses travaux et de ses recherches, dont elle ignorait le but, et elle l’aimait davantage de jour en jour, sans s’interroger, dans sa naïveté, sur la nature de cette affection.
Ce dont elle était certaine, c’est qu’elle n’aurait pu en ressentir aucune autre. William Witson était tout pour elle. Elle se souvenait bien qu’elle n’avait pas toujours vécu auprès de lui ; elle se rappelait vaguement une époque lointaine où, tout à coup, elle s’était trouvée seule, séparée brusquement d’une jeune femme, sa mère sans doute, qui s’était éloignée en pleurant, après l’avoir couverte de baisers.
Dans quel pays et à quelle époque cela s’était-il passé ? Sur ce point, sa mémoire lui faisait défaut, et elle avait interrogé inutilement son institutrice à ce sujet.
En lui affirmant qu’elle n’était près d’elle que depuis une dizaine d’années, que c’était M. Witson qui l’avait chargée de son éducation et que, par conséquent, elle ignorait tous les faits antérieurs à son entrée dans la maison, mistress Vanwright avait mis fin aux questions embarrassantes de la jeune fille.
Celle-ci s’était alors hasardée à interroger William ; mais, à ses premiers mots, il lui avait répondu :
– Vous n’avez pas connu votre mère, ma chère enfant ; vous étiez trop jeune lorsque vous l’avez perdue, et c’est parce que vous étiez sans famille que je vous ai recueillie, adoptée, élevée, aimée comme ma fille chérie. Si vous êtes heureuse, ne cherchez pas à en savoir davantage.
Tout cela avait été dit si tristement que Jane s’était jetée au cou de son ami en lui demandant pardon de son indiscrétion, et, depuis cette époque, elle avait renoncé à approfondir le mystère de son enfance pour être tout entière au présent, dont un seul point la préoccupait.
Elle se demandait avec une sorte d’épouvante et une curiosité bien féminine pourquoi son père adoptif allait ainsi d’un pays à un autre, changeant de nom et se mêlant aux aventures les plus dramatiques, au mépris de tout danger, comme s’il y fût forcé par le devoir.
Elle se rappelait que, cinq ou six ans auparavant, il s’était absenté de New-York, où il l’avait laissée sous la garde de mistress Vanwright, et qu’elle lui avait écrit à Paris, à l’adresse de William Dow ; et l’année précédente, lorsqu’il l’avait emmenée à Boston, il s’était fait appeler Charles Murray. Aujourd’hui, il était devenu William Witson.
De tous ces noms, quel était véritablement le sien ? Quel était donc le but de cette existence étrange, tourmentée, sombre souvent, toujours mystérieuse ?
La jeune fille ne pouvait le comprendre, et, en raison de cette ignorance, elle vivait dans une inquiétude incessante, qu’elle s’efforçait toutefois de dissimuler, dans la crainte de déplaire à celui qui était tout pour elle.
Les choses en étaient là dans le petit hôtel de la rue Boissière, quand, un matin, après le déjeuner, William, qui s’était mis, comme de coutume, à lire ses journaux, jeta tout à coup un cri de surprise.
– Qu’avez-vous donc ? lui demanda Jane en abandonnant l’album qu’elle feuilletait.
– C’est bizarre, répondit l’Américain, dont la physionomie s’était animée. Oh ! cela n’est pas fort intéressant pour vous. C’est un simple fait divers, comme les feuilles judiciaires en publient tant chaque jour, que je trouve dans la Gazette des Tribunaux ; mais il arrive que je connais le nom d’un des personnages dont il est question. Il s’agit d’une femme qui est notre compatriote.
– Je ne puis pas en savoir davantage ?
– Si vraiment. Tenez, écoutez !
Et Witson, reprenant son journal, lut à haute voix :
« On nous écrit de Vermel : « Notre ville, si calme d’ordinaire, est sous le coup d’une émotion profonde, causée par un événement entouré de mystère. Il y a une quinzaine de jours, le riche manufacturier Raymond Deblain, dont la santé paraissait excellente, a été trouvé mort, le matin, par son valet de chambre. Un des honorables docteurs de notre ville, appelé aussitôt, n’a pu que constater ce décès presque subit, qu’il a attribué à une angine de poitrine, et les obsèques de M. Deblain ont eu lieu avec le concours d’une foule considérable ; puis soudain, au moment où notre regretté compatriote était déjà un peu oublié, son exhumation a été ordonnée par le parquet, et le corps a été transporté à l’amphithéâtre de l’École de médecine. Le savant docteur Plemen est chargé d’en faire l’autopsie. On parle d’empoisonnement ; mais on comprend que la plus grande réserve nous est imposée.
« M. Deblain, qui avait à peine quarante-cinq ans, jouissait de l’estime générale. Il avait épousé, il y a trois ans, à Philadelphie, une jeune et jolie Américaine, miss Rhéa Panton, dont l’arrivée produisit à Vermel une vive sensation. C’était un ménage fort uni. La maison des Deblain était gaie, constamment pleine d’amis.
« Nous devons nous abstenir de répéter tout ce qui se dit à propos de cet événement, aussi bien par respect pour ceux que frappe un aussi grand malheur que pour ne pas entraver l’action de la justice. »
L’article se terminait là.
– Alors c’est cette dame que vous connaissez ? demanda miss Jane à William.
– Je l’ai vue souvent, lorsqu’elle était enfant, répondit-il ; j’étais très lié avec sa famille.
– À Philadelphie ?
– Oui, à… dans cette ville.
Witson avait rougi en se reprenant pour dire : « Dans cette ville. » au lieu de répéter : « À Philadelphie. »
– Philadelphie ! redit la jeune fille, que l’embarras de son ami n’avait pas frappée ; il me semble que ce nom-là me rappelle des souvenirs confus.
– Cependant vous n’y êtes jamais allée, observa vivement l’Américain.
Puis, comme pour détourner sa jeune interlocutrice des pensées qu’elle semblait suivre, il reprit :
– Demain ou après, nous en saurons davantage. Je vais me faire adresser tous les journaux de Vermel. Pauvre petite femme, déjà veuve ! Elle doit avoir à peine vingt et un ans. C’était la plus ravissante enfant qu’on pût voir. Comment son père l’a-t-il mariée à un Français, et à un homme du double de son âge ? Si elle n’a pas d’enfant, elle retournera sans doute en Amérique. Enfin, attendons.
Le surlendemain, William, qui avait reçu les trois journaux de Vermel, n’y trouva rien de nouveau sur la mort de M. Deblain ; mais, vingt-quatre heures plus tard, il lut, dans l’un d’eux, cette nouvelle, qui lui causa la plus vive émotion :
« À la suite du rapport de l’éminent docteur Plemen, qui conclut à l’empoisonnement de M. Raymond Deblain par des sels de cuivre, le parquet a ordonné une perquisition dans l’hôtel de notre infortuné concitoyen, et le résultat de cette perquisition a été si compromettant pour sa veuve que celle-ci a été arrêtée. La ville entière est dans la consternation. On ne peut croire à la culpabilité de Mme Deblain, que son mari adorait, et qui semblait vivre avec lui dans d’excellents rapports. On blâme généralement la précipitation du procureur de la république et de M. Babou, le juge d’instruction à qui cette affaire est confiée.
« Quant au docteur Plemen, il avait été chargé d’une mission doublement pénible à remplir pour lui, car il était très lié avec la victime de ce drame, et l’un des intimes de cette maison si hospitalière, où la jolie Mme Deblain régnait en souveraine. Mais un homme tel que l’éminent praticien ne discute pas avec le devoir. Le docteur Plemen vient de donner là un grand exemple de dévouement professionnel.
« Nous n’en dirons pas davantage aujourd’hui, ne voulant pas répéter les bruits romanesques qui circulent à propos de Mme Deblain. Elle est au secret absolu dans la maison d’arrêt des Carmes ; mais nous suivrons avec soin toutes les phases de l’enquête, pour en faire part à nos lecteurs. »
Witson avait relu plusieurs fois ce récit en s’interrompant pour s’écrier :
« Ce n’est pas possible, la fille de mon vieil ami Panton n’a pu se rendre coupable d’un pareil crime ! »
Ensuite il s’était levé et, tout en marchant à grands pas dans son cabinet de travail, il murmurait :
– Quelle étrange chose que le hasard ! Un empoisonnement par des sels de cuivre, affirmé par un toxicologue aussi savant que le docteur Plemen… Et s’il se trompait ! Décidément je veux voir de près cette affaire, quand ce ne serait que pour le père de cette malheureuse femme !
Ces réflexions furent interrompues par l’arrivée de miss Jane.
– Eh bien ! quoi de nouveau à Vermel ? demanda-t-elle à Witson.
Celui-ci la mit au courant de ce qu’il venait d’apprendre et termina en disant :
– Je partirai ce soir.
– Vous allez encore vous éloigner ? fit-elle avec un ton de doux reproche.
– Il le faut ; je dois cela à mon compatriote Panton, dont la fille est accusée par erreur, je le jurerais.
William avait pris dans ses mains celles de sa fille adoptive et s’efforçait de la rassurer.
– Toutes vos absences me sont si pénibles, lui disait-elle. Il y a quelques années, lorsque vous m’avez laissée en Amérique pour venir à Paris, je n’ai éprouvé qu’un grand chagrin ; mais l’an dernier, quand vous êtes allé chez les Sioux, à la recherche de preuves contre Gobson, mon chagrin s’est accru de la terreur que j’avais des dangers que vous pouviez courir. Que deviendrais-je, s’il vous arrivait un malheur ? Il est vrai que j’en mourrais !
En s’exprimant ainsi, Jane avait appuyé son adorable tête de vierge sur l’épaule de son ami.
– Chère enfant, répondit l’Américain en faisant appel à toute son énergie pour paraître calme, il ne s’agit aujourd’hui de rien de semblable. Vermel est à quelques heures de Paris. Je n’ai aucun péril à courir, et qui sait si je ne trouverai pas dans cette excursion la fin de ces soucis que je ne vous dissimule pas toujours assez. Ce sera peut-être là ma dernière épreuve !
– Et la mienne aussi, murmura la jeune fille en rougissant, mais si bas que William ne l’entendit, pour ainsi dire, qu’avec son cœur.
Le lendemain, après s’être muni des lettres d’introduction qui pouvaient lui être nécessaires, Witson quitta Paris.
PREMIÈRE PARTIE
I LE CHEF-LIEU DE SEINE-ET-LOIRE
Il y avait trois mois à peine que M. Raymond Deblain, grand fabricant de tissus à Vermel, était parti pour l’Amérique du Nord, dans le but de régler certaines affaires en litige depuis plusieurs années, et aussi pour étendre ses relations commerciales de l’autre côté de l’Océan, lorsque le bruit se répandit soudain dans sa ville natale qu’il s’était marié à Philadelphie.
Personne ne voulut tout d’abord ajouter foi à cette nouvelle, tant elle était inattendue et paraissait inadmissible, étant donné ce qu’on savait des idées et des habitudes de celui dont il s’agissait.
Raymond Deblain avait dépassé la quarantaine sans jamais parler de prendre femme, légitimement du moins ; il s’était toujours applaudi d’être resté célibataire, au spectacle des mésaventures conjugales de quelques maris de sa connaissance ; et c’était vainement que les plus jolies héritières du département lui avaient été offertes ; car il était riche, beau cavalier, manquant un peu de distinction dans son laisser-aller, mais de caractère facile, plein de cœur et d’entrain.
La Médaille militaire, qu’il avait gagnée pendant la guerre franco-allemande – bien qu’il fût alors libéré du service, il s’était engagé de suite – allait à merveille à sa tournure d’ancien sous-officier de cavalerie.
C’était enfin le type sympathique du viveur de province, élégant et gai, mais sachant, bien que sceptique et volontiers gouailleur, ne pas froisser ouvertement les préjugés et les idées bourgeoises de ceux qui l’entourent.
Il n’était vraiment pas possible que M. Deblain eût ainsi rompu brusquement avec son passé, cela en faveur de quelque miss excentrique, comme on se représente trop souvent en France, en province surtout, les vierges de l’Union.
Ceux de ses amis qui connaissaient ses goûts d’indépendance, son amour des plaisirs faciles et des liaisons sans lendemain, traitaient donc ce mariage exotique de fable ridicule.
Est-ce que, s’il avait jamais l’intention d’entrer en ménage, le beau Raymond, ainsi qu’on l’appelait toujours, ne prendrait pas tout simplement pour compagne l’une de ses jolies compatriotes ! Est-ce qu’il pourrait jamais oublier qu’il se trouvait à Vermel dix, vingt jeunes filles charmantes, de bonnes familles et bien dotées, parmi lesquelles il n’avait qu’à choisir !
De plus, est-ce qu’il se serait jamais marié sans consulter son intime, son alter ego, le docteur Erik Plemen ; sans lui en demander la permission, ou tout au moins sans le prévenir ?
En effet, depuis plus de dix ans, MM. Deblain et Plemen étaient inséparables ; ce qui s’expliquait aisément, car s’ils exerçaient des professions différentes, ils avaient absolument les mêmes goûts, défauts et qualités. Tous deux savaient faire marcher de front le travail et les distractions les plus mondaines.
Ils habitaient, boulevard Thiers – presque toutes les villes de province ont un boulevard ou une avenue Thiers – deux hôtels contigus derrière lesquels s’étendaient de fort beaux jardins, qui communiquaient par une porte dont Erik et Raymond avaient une clef, de façon à pouvoir aller de l’un chez l’autre, quand cela leur plaisait, à toute heure du jour et de la nuit, sans même que leurs gens pussent le savoir.
Intelligent et actif, le grand manufacturier ne négligeait jamais ses affaires, et quant au docteur Erik Plemen, c’était non seulement un médecin fort habile, dévoué à ses malades, secourable aux malheureux, mais encore un chimiste de premier ordre, un toxicologue déjà célèbre.
Ses travaux avaient été couronnés plusieurs fois par l’Académie de médecine. Vermel était fier de lui, et on s’étonnait qu’un homme de sa valeur ne fût pas à Paris, où bien certainement il occuperait un des premiers rangs parmi les membres de la Faculté.
On disait que c’était par ambition qu’il était resté dans le chef-lieu de Seine-et-Loire, où il avait été envoyé à l’occasion de la dernière épidémie de choléra.
Pendant plusieurs mois, il avait combattu le fléau avec un véritable héroïsme ; il s’était ainsi attiré les sympathies de tous, et, jugeant sans doute le terrain bon pour lui, il s’était installé dans ce grand centre industriel, où sa clientèle était devenue rapidement considérable.
Décoré, chef de service à l’hôpital, membre du conseil général du département, il rêvait d’augmenter encore à la Chambre le nombre de ces médecins dont la présence de certains dans le Parlement est peut-être le salut pour les malades de la province, mais semble, hélas ! indiquer que la France est vraiment souffrante, puisque tant de docteurs se mêlent de ses affaires, comme s’ils se groupaient à son chevet pour l’achever à coups d’ordonnances.
Au physique, Erik Plemen, qui avait trente-six à trente-sept ans, offrait, avec sa physionomie intelligente, ses regards de feu, ses lèvres sensuelles, son tempérament ardent, un superbe spécimen de la race slave, car il était étranger.
Né en Hongrie, mais élevé à Paris, où il avait été l’un des plus brillants sujets de l’École de médecine, il s’était fait naturaliser et avait été reçu docteur. Nous venons de dire dans quelles circonstances il s’était fixé à Vermel, où, chaque jour, on s’applaudissait d’avoir un praticien aussi expert et aussi dévoué.
Au moral, c’était un ambitieux, un esprit volontaire, dominateur, n’admettant pas aisément qu’un obstacle soit jamais infranchissable pour celui qui veut vraiment atteindre un but.
Il l’avait maintes fois prouvé, dans l’exercice de sa profession, par des expériences et des opérations qui, heureusement, jusque-là, avaient toujours donné raison à sa hardiesse.
Aussi avait-il un empire absolu sur son ami Raymond, brave garçon d’un caractère assez faible, qui le consultait en toute occasion, même lorsqu’il s’agissait de son industrie.
Mais lorsque le négociant et le médecin en avaient fini, le premier avec ses affaires, le second avec ses travaux professionnels, ils étaient tout au plaisir, ne boudant pas plus l’un que l’autre devant une partie de chasse, une table bien servie, quelques heures de baccara et un sourire de jolie femme. Tout cela sans excès, avec cette petite hypocrisie à laquelle la province condamne même ceux qui ne se soucient que médiocrement du qu’en-dira-t-on.
D’ailleurs Vermel n’avait pour ainsi dire que l’écho de leurs fredaines, car M. Deblain, qui avait une succursale de sa maison à Paris, y faisait de fréquents voyages, et le docteur Plemen venait souvent le rejoindre dans l’élégant pied-à-terre qu’il habitait au boulevard Haussmann.
De plus, le grand manufacturier possédait, à quatre ou cinq lieues de la ville, une fort belle maison de campagne, bien abritée des regards indiscrets du dehors par les épais massifs du jardin, au centre duquel s’élevait l’habitation ; et les époux Ternier, concierges de cette propriété, qui s’appelait tout simplement la Malle, mais que les jeunes gens de Vermel avaient surnommée romantiquement « la Tour de Nesle », étaient aveugles, muets, incorruptibles.
Tels étaient les deux amis, et on ajoutait, pour rendre plus extravagante encore la nouvelle du mariage de l’un de ces frères siamois, que M. Deblain, fils d’une famille cléricale, avait épousé une protestante.
Personne ne pouvait, ne voulait donc croire à cette union, et le docteur Plemen, questionné par les uns et les autres, ne répondait qu’en haussant les épaules, car Raymond ne lui avait pas écrit un seul mot à ce sujet. Bien au contraire, dans une assez longue lettre qu’il lui avait adressée, il s’était étendu complaisamment, avec son entrain habituel et sa pointe d’ironie accoutumée, sur la liberté que les mœurs américaines laissent aux jeunes filles et sur sa flirtation avec une certaine miss Rhéa Panton, fille d’un grand industriel, son correspondant à Philadelphie. Puis, cela raconté, il avait terminé sa lettre par une sorte d’évocation à son amour du célibat.
Il lui paraissait donc impossible, non que Deblain n’eût pas changé d’opinion – il connaissait son peu d’énergie, son tempérament facile aux entraînements et son esprit malléable – mais qu’il fût allé aussi loin dans son évolution sociale sans l’en informer, tout au moins aussitôt la sottise accomplie.
Aussi attendait-il patiemment et en laissant dire, convaincu qu’un mot de son ami lui permettrait bientôt de démentir le racontar américain, ou que le voyageur en démontrerait lui-même la fausseté en revenant garçon… comme il était parti.
Ceci dit, ouvrons ici, sans aller plus loin, une parenthèse, pour fixer ceux de nos lecteurs qui, soucieux des reproches d’ignorance géographique que nous adressent si volontiers nos ennemis d’outre-Rhin, comme ils nous accusent d’ailleurs d’immoralité, eux, les fabricants de cartes transparentes – Augias donnant l’ordre de nettoyer les écuries d’autrui – chercheraient, sur une carte de France, Vermel et le département de Seine-et-Loire.
Ce sont là deux noms de fantaisie, créés à plaisir pour nous laisser liberté entière dans ce récit, où, tout en mettant en scène des types provinciaux pris sur le vif, en faisant le procès à des abus et à des sottises judiciaires, en démasquant des lâchetés et des hypocrisies politiques, nous tenons cependant à échapper à des reproches qui pourraient nous être adressés, non sans quelque apparence de raison.
En effet, forcé, par la nature du drame que nous voulons raconter, de lui donner pour théâtre le siège d’une cour d’appel, si nous ne nous transportions pas dans un milieu imaginaire, nous risquerions fort, soit de paraître viser des personnalités s’agitant réellement dans telle ou telle ville, soit de voir nos appréciations détournées sciemment de leur but, dénaturées et dirigées, par ceux-là mêmes qui pourraient se les appliquer, contre des hommes que, bien au contraire, nous estimons et aimons. Et, puisque l’occasion nous en est offerte, qu’on nous permette d’ajouter ceci :
Bien certainement le littérateur ne puise pas toujours dans sa seule imagination ; il s’inspire souvent d’une situation sociale qu’il a eue sous les yeux, d’un fait dont il a été témoin ou qu’on lui a raconté, de caractères et de ridicules qui se sont manifestés devant lui ; mais cette situation, ce fait, ces caractères et ces ridicules ne sont que des points de départ, des matériaux, des embryons qu’il doit établir, classer, rendre logiques, développer et coordonner.
Désireux de créer un type en harmonie parfaite avec l’aventure qu’il veut mettre en scène, il ne photographie pas plus un individu bon ou mauvais, rencontré par hasard, qu’il ne copie textuellement la situation qui, en frappant son esprit, lui a donné l’idée première de son œuvre.
Quels que soient ses vertus ou ses vices, l’homme est rarement complet ; le romancier est forcé, pour les besoins de sa cause, de faire son héros pire ou meilleur qu’il ne lui a apparu ; et il arrive que les événements réels sont si étrangement conduits par le hasard, ils sont si souvent la preuve que le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable, que le lecteur n’ajouterait point foi au récit où les effets – ce qui se produit fréquemment dans la nature – ne sembleraient pas la conséquence directe des causes.
L’écrivain qui a un but bien défini et demeure soucieux de l’atteindre par des moyens logiques prend donc à chacun des modèles qui lui sont offerts quelques-uns de leurs défauts et quelques-unes de leurs qualités, afin de créer des personnages dans le ton des événements qu’il a résolu de peindre.
S’il arrive que, dans ces personnages fictifs, certains individus réellement existants sont reconnus, ce n’est pas, le plus souvent, parce que le romancier a tout simplement photographié d’après nature, mais parce que la nature s’est plu, une fois par hasard, à faire aussi complet que le rêvait le romancier.
Dans ces cas de rencontres fortuites, la vérité seule y gagne ; tant pis pour ceux qui sont ainsi démasqués !
Revenons maintenant à Vermel et à l’émotion que la seule supposition du mariage américain de Raymond Deblain y causait.
Ainsi que nous l’avons écrit plus haut, on se refusait obstinément à admettre cet événement, qui renversait tant de croyances et si bon nombre d’espérances matrimoniales, et le docteur Plemen surtout n’y voulait pas ajouter foi ; mais un beau jour, le doute ne fut plus possible pour personne, car, moins d’un mois après l’arrivée de la nouvelle qui avait ainsi troublé ses amis, M. Deblain rentra dans sa ville natale en compagnie de la jeune femme qu’il avait bel et bien épousée de l’autre côté de l’Océan, dans les circonstances bizarres que nous allons raconter.
II MASTER ELIAS PANTON AND C°
Le jour où il s’était embarqué sur l’un de ces superbes steamers de la Compagnie transatlantique qui font, en moins de neuf jours, la traversée du Havre à New-York, Raymond Deblain n’en était pas à son premier voyage en mer. Non point qu’il eût doublé le cap de Bonne-Espérance ni traversé le détroit de Magellan ; mais, dans le Sud, il était allé jusqu’à Alger, même en Égypte, et, dans le Nord, il avait visité Stockholm et Copenhague.
Or, si la Méditerranée est généralement assez douce aux navigateurs, si ce n’est pas précisément à ceux qui la parcouraient de son temps qu’Horace souhaitait un œs triplex – à moins que le poète latin n’ait voulu parler qu’au figuré, et que le triple airain ne fût un remède de l’époque contre le mal de mer – il n’en est pas de même de la Manche et de la mer du Nord, où les gros temps sont fréquents et aussi durs que dans les parages océaniens réputés les plus dangereux.
L’ami du docteur Plemen avait donc le pied et l’estomac marins, ce qui lui permit de faire excellente figure sur le Pereire, d’y vivre confortablement et, par conséquent, d’arriver en Amérique dans de parfaites dispositions de corps et d’esprit.
Après être resté une huitaine de jours à New-York « l’impériale cité », comme disent les Yankees, sans se laisser trop ahurir par le brouhaha de Broadway, ni demeurer plus stupéfait qu’il n’eût été raisonnable à la vue du fameux pont de Brooklyn, mais sans oublier de visiter le musée Barnum, ni de faire l’excursion classique à la cascade du Passaïc, il prit le chemin de fer pour Philadelphie.
Il avait annoncé son arrivée à M. Panton, l’important manufacturier pour qui il avait fait tout exprès la traversée.
Il existait depuis fort longtemps de grandes relations d’affaires entre les Deblain, de Vermel, et les Panton, de Philadelphie. Cela datait du père d’Elias Panton et de celui de Raymond Deblain.
Depuis plus de vingt-cinq ans, les deux maisons échangeaient leurs tissus, en vertu de ce principe, faux le plus souvent, mais fort heureusement mis en pratique, car c’est de lui que sont nées la plupart des opérations commerciales entre les peuples : « Il n’y a de bon que ce qui vient de l’étranger. »
C’est surtout en France qu’on pense ou tout au moins qu’on s’exprime ainsi.
Tentez donc de persuader à nos élégants, si souvent ridicules de mise et de tournure, qu’un tailleur du boulevard des Italiens les habillerait aussi bien qu’un tailor de Regent-Street, et qu’un bottier ne les chausserait pas plus mal si son nom ne se terminait point en ker, kof ou ky. Faites donc croire à une cocodette qu’il n’est pas indispensable que son chien s’appelle Charly ou Polly pour paraître de race.
Essayez donc de convaincre tous ces épris de l’exotique que les gants de Suède se fabriquent en France, tout aussi bien que le papier anglais, les cigares de la Havane, le vin de Madère et tant d’autres produits étiquetés de noms étrangers, et que la belle Fatma est peut-être tout simplement de la tribu des Beni-Batignolles.
Est-ce que le nom d’un ténor pourrait finir autrement qu’en i, lors même qu’il serait né place Maubert ? Nicolas, Nicolini. Est-ce qu’à Paris, avoir de l’accent n’est pas déjà avoir du talent ?
Il y a trois ou quatre ans, à l’époque de la grande invasion toulousaine, des gens apprenaient à gasconner. Certains mots de la langue d’oc étaient de vrais : « Sézame, ouvre-toi ! »
Les relations des Panton et des Deblain reposaient donc surtout sur ce principe : ne pas être du pays, venir de loin. Alors, cela se conçoit : Master Panton se disposait à accueillir de son mieux Raymond Deblain, qui venait de France.
La famille Panton se composait, à cette époque, de cet Elias Panton, chef de la maison ; de sa femme Bertha, née Thompson ; de leurs deux filles, Jenny et Rhéa ; du frère de Mme Panton, le révérend Jonathan Thompson, et du fils de celui-ci, Archibald Edward, grand garçon de vingt-cinq à vingt-six ans, apprenti clergyman, par ordre de son père et par vocation.
Jonathan était un grand diable, maigre et long comme un jour sans pain, invariablement vêtu d’une étroite houppelande noire, fermée par un seul rang de boutons, ainsi qu’une soutane, et montant jusqu’au col blanc qui serrait, comme en un carcan, le cou de héron du personnage.
Au-dessus était un visage blême, toujours soigneusement rasé, osseux, découpé à la serpe, à l’air béat, aux yeux sans éclat, de couleur indécise, circonflexés d’épais sourcils en broussailles, et aux lèvres pâles où le sourire était une grimace.
Ses bras, si longs qu’on eût dit ceux d’un chimpanzé, se terminaient par des mains noueuses, poilues aux phalanges. Ce monument humain d’architecture éclectique avait pour base des pieds gigantesques, toujours lourdement chaussés, et pour faîte un haut chapeau, d’où s’échappaient de longues mèches de cheveux roux, et qui avait de si larges bords plats que son propriétaire était toujours garanti de la pluie ou du soleil.
Cet honorable personnage était un des plus infatigables commentateurs de la Bible qu’ait jamais fait naître le droit au libre examen, point de départ et l’une des conséquences du protestantisme.
Grâce à ce droit et à la recherche du mieux, cet ennemi du bien, le révérend Jonathan en était à son seizième avatar dans la religion réformée.
Il avait été tour à tour presbytérien, méthodiste, unitaire, puséyste, mais puséyste au point de faire croire qu’il finirait par se rallier au catholicisme, puis quaker mouillé et particulariste. Au moment où nous le présentons à nos lecteurs, il penchait vers le swedenborgisme, car il commençait à raconter qu’à l’imitation du célèbre rêveur suédois il communiquait directement avec Dieu et les anges.
On le voit, la folie ou le doute venaient tout doucement.
Ainsi que le digne Jonathan, son fils Archibald était haut, maigre, blond filasse, grave et commentateur intrépide des saintes Écritures.
C’était, conséquemment, entre le père et le fils, d’interminables dissertations théologiques. Le révérend affirmait que son digne héritier deviendrait une des lumières de l’Église réformée ; mais, en attendant, il le poussait à épouser sa cousine Rhéa, dont il était amoureux… et qui avait une dot considérable, ce que ne dédaignaient pas les Thompson, tout clergymen qu’ils fussent.
Elias Panton, le chef de cette famille, était un gros homme d’une soixantaine d’années, rubicond, solide, ne faisant partie, au désespoir de son beau-frère, d’aucune société de tempérance, sceptique, bon vivant, essentiellement pratique, rond et loyal en affaires, ainsi que le sont fort souvent les Américains, quoi qu’on en dise, et valant, pour nous exprimer comme le font les Yankees lorsqu’ils veulent évaluer la fortune de l’un d’eux, un bon million de dollars.
Mme Panton, elle, était une longue et maigre personne absolument insignifiante. Née dans une famille puritaine, elle n’avait jamais eu le goût de l’élégance ni des plaisirs mondains, mais elle était fort experte dans la confection des plum-puddings ainsi que dans celle des tartes à la rhubarbe, et admirait son frère Jonathan, ce dont celui-ci abusait à chaque instant pour l’enlever aux soins du ménage, dans le seul but de commenter avec elle quelque verset controversé de la Bible, ou de lui raconter sa dernière vision swedenborgienne.
Quant à misses Jenny et Rhéa, qui avaient l’une dix-neuf et l’autre dix-huit ans, elles étaient bien les plus complets et aussi les plus charmants spécimens féminins de l’éducation américaine et de cette civilisation à la vapeur à laquelle les États-Unis doivent leur prodigieux développement depuis un demi-siècle.
Fort jolies toutes deux, hardies, ne doutant de rien, libres d’allures, tout en restant parfaitement sages, fort peu surveillées par leur père, qui s’en rapportait entièrement à leur expérience précoce pour se choisir des maris, car Rhéa ne voulait pas entendre parler de son cousin, de même que sa sœur désespérait par sa froideur un certain colonel Barnabé Gould-Parker, soldat ambitieux et bourru, qui avait dix fois demandé sa main ; laissées libres par leur mère, qui n’osait leur adresser la moindre observation, bien qu’elles fussent remplies de respect pour elle, et accueillant par des éclats de rire les psalmodies mystiques de leur oncle Jonathan, elles avaient à Philadelphie la réputation des plus gaies et des plus intrépides sportswomen qui se pussent rencontrer.
Ce qui complétait les deux charmantes filles du gros Elias, c’était l’affection sans bornes qui les unissait, le souci que chacune avait des moindres joies de l’autre, et leur communauté de goûts, malgré leurs différences de caractère et de tempérament.
Rhéa surtout, plus folle, plus expansive que Jenny, témoignait à celle-ci une véritable adoration. Elle lui aurait certainement sacrifié, non pas seulement tous les Archibald et tous les colonels de la terre, mais toutes les autres affections, si cela avait pu contribuer à son bonheur. Quand on se permettait de lui faire un compliment qui ne s’adressait pas en même temps à sa sœur, elle tournait lestement les talons au maladroit.
Mlles Panton avaient bien une sorte de gouvernante, dame de compagnie, chargée de les escorter : miss Gowentall, épaisse personne d’une quarantaine d’années et atrocement myope ; mais, le plus souvent, la pauvre femme perdait de vue les jeunes misses avant qu’elles fussent sorties de la maison paternelle, et c’était presque toujours d’un côté diamétralement opposé à celui qu’elles avaient pris qu’elle les cherchait, pendant des heures entières, parfois en société du révérend Jonathan et de son fils Archibald, que la conduite de leurs nièces et cousines scandalisait, et qui profitaient de l’occasion que leur offrait la solitude de miss Gowentall pour placer un de leurs sermons.
Très élégantes, Jenny et Rhéa parlaient fort correctement le français, adoraient tout ce qui venait de la France, en suivaient toutes les modes avec beaucoup de goût, et si elles n’étaient pas mariées depuis déjà longtemps, c’était tout simplement, – car, indépendamment du grave Archibald et du colonel Gould-Parker, les soupirants ne leur manquaient pas, – parce qu’elles rêvaient d’entraîner quelque jour leur père à Paris, où elles étaient persuadées qu’elles trouveraient aisément des époux à leur choix, grâce à leur beauté et à leur dot, cent mille dollars au moins.
Malheureusement pour l’ambition de ses filles, Elias Panton demeurait sourd à ce projet, et Jenny, cœur romanesque et tempérament ardent, commençait à s’impatienter d’attendre, tandis que sa sœur, plus calme et plus pratique, se contentait de guetter l’occasion, en fuyant son trop grave et trop blême cousin.
C’est précisément à ce moment psychologique que le manufacturier américain annonça à ses héritières l’arrivée de Raymond Deblain, son correspondant de Vermel, et son ami, bien qu’il ne l’eût jamais vu.
En vrai Yankee que le souci de ses intérêts n’abandonne jamais, master Panton ajouta, en s’adressant aussi bien à ses enfants qu’à sa femme, à son beau-frère et à son neveu qu’il entendait qu’on fit fête à son hôte.
La longue mistress Panton songea de suite à quelque surprise gastronomique pour le Français ; l’honorable Jonathan demanda si celui qu’on attendait appartenait à l’Église protestante, ce à quoi le gros Elias ne répondit qu’en haussant les épaules, et les jolies misses, sans même s’informer si l’ami de leur père était jeune ou vieux, ne pensèrent tout d’abord qu’à lui prouver que les jeunes filles de l’Union n’étaient ni moins charmantes ni moins élégantes que les plus charmantes et les plus élégantes des Parisiennes.
C’était dans ces dispositions d’esprit que se trouvaient les divers membres de la famille Panton, lorsque la voiture que Raymond Deblain avait prise à la gare de Wilmington le déposa devant la porte du fort bel hôtel que le bonhomme Elias et les siens habitaient, dans Walnut street, la rue par excellence du haut commerce et des banques, à Philadelphie.
Car le chef de la maison Panton and C° avait télégraphié à M. Deblain, à New-York, que sa chambre l’attendait sous son toit, depuis le jour où il lui avait annoncé son départ du Havre, et l’ami du docteur Plemen, qui en avait déjà assez des hôtels américains, immenses caravansérails où tout étranger peut se croire encore sur la place publique, s’était empressé de répondre à son correspondant qu’il acceptait avec reconnaissance son hospitalité.
Introduit dans le grand hall du rez-de-chaussée, le manufacturier de Vermel eut bientôt fait connaissance avec tous les Panton, hommes et femmes, que master Elias lui présenta, après s’être présenté lui-même.
Cette présentation fut faite, d’ailleurs, le plus lestement du monde, à l’américaine, et de façon à mettre de suite Raymond Deblain fort à son aise, tout en le surprenant un peu.
– Ma femme, dit à peu près le riche Yankee, dans un français des plus fantaisistes, une excellente maîtresse de maison qui, j’en suis certain, ne vous laissera manquer de rien ; mon beau-frère, le révérend Jonathan Thompson qui, si vous le lui permettez et peut-être même si vous ne lui permettez pas, tentera de vous convertir ; mes filles Jenny et Rhéa, deux têtes folles, dont l’unique souci sera de vous demander des nouvelles des modes françaises et de vous procurer toutes les distractions possibles ; enfin mon neveu, Archibald-Edward Thompson, une des futures lumières de notre Église, d’après ce qu’affirme son père.
Raymond Deblain s’inclina respectueusement devant Mme Panton, salua avec défiance le révérend et son fils, qui lui rendirent son salut comme l’eussent fait des automates, sans qu’un muscle de leurs visages glabres trahît leurs impressions, et répondit galamment au vigoureux shake-hands des deux jeunes filles, qui lui avaient tendu leurs petites mains en souriant.
Le jour même, Elias introduisit son hôte à son club, the Union Reform club ; les demoiselles Panton lui chantèrent, après le dîner, et cela le plus drôlement du monde, une demi-douzaine d’airs, du Petit Duc et de la Petite Mariée, au lieu des cantiques que leur excellent oncle avait dévotement apportés sur le piano ; et lorsque l’hôte des Panton monta se coucher, il trouva auprès de sa tasse de thé, prévenance de la brave maîtresse de la maison, une jolie petite Bible, premier jalon de conversion posé là par le digne Jonathan lui-même.
Le lendemain et toute la semaine, notre héros, que cela intéressait d’ailleurs beaucoup, visita avec Elias les manufactures les plus importantes de Philadelphie, de Berlington et de Camden, les deux cités manufacturières qui s’étendent de l’autre côté du Delaware, sur la rive gauche, et il fut tout aux affaires qu’il était venu régler en Amérique ; mais bientôt Jenny et Rhéa s’emparèrent de lui, et ce ne fut plus alors, pour Raymond, que parties de plaisir, dont surtout la plus jeune des deux sœurs était le boute-en-train.
Presque tous les matins, il montait à cheval avec elles, et il était heureux qu’il fût parfait cavalier, car, à peine dans Fairmount park ou sur la rive du Wissahickon, lieux ordinaires des promenades des sportsmen de la ville, c’étaient d’intrépides temps de galop, pendant lesquels Rhéa prenait un malin plaisir à l’effrayer par sa hardiesse.
Parfois, mais accompagnées dans ces excursions-là par miss Gowentall, Mlles Panton s’embarquaient avec M. Deblain sur un léger steamer soit pour descendre jusqu’à la Pointe, là où la rivière de Schuykill se jette dans le Delaware, et où se termine la grande presqu’île sur laquelle s’étend Philadelphie, avec ses rues de douze kilomètres, orientées nord et sud et coupées à angles droits par d’autres voies s’en allant est et ouest, ses trois cents temples et ses six mille usines ; soit pour se rendre à l’île verdoyante de Windmill, au milieu du fleuve ; soit encore pour remonter le majestueux cours d’eau jusqu’à Wilmington et revenir par le chemin de fer.
Mais il arrivait alors, la digne gouvernante n’ayant pas moins horreur de l’eau comme moyen de locomotion que comme breuvage, qu’elle se réfugiait, dès le départ, dans l’intérieur du bâtiment, et que les deux jolies Américaines n’en étaient que mieux seules avec leur compagnon, qu’elles grisaient réellement de leur jeunesse et de leur gaieté.
Puis ce furent les théâtres, tous les théâtres, grands et petits, qu’il fallut voir, de succulents dîners qu’Elias Panton donnait en l’honneur de son hôte, des bals ou l’ami du docteur Plemen était le cavalier attitré des deux jeunes filles, des soupers sans fin, à Belmont-Mansion, le café Anglais de Philadelphie, des distractions incessantes ; si bien que Raymond rentrait le soir, tout à fait charmé, mais brisé de fatigue et se demandant si ses deux charmantes amies étaient d’acier pour résister à une semblable existence.
Ces jours-là surtout, il s’endormait sans songer à ouvrir aucune de toutes les petites Bibles noires, rouges, bleues, vertes qui s’amoncelaient dans sa chambre, et dont il trouvait chaque soir un nouvel exemplaire sous son oreiller, grâce à la ténacité du révérend Jonathan, qui parfois l’arrêtait au passage, pour lui dire d’un ton prophétique : « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; Malheur à l’homme par qui le scandale arrive ; ou bien : C’est par la prière qu’on chasse le démon ; ou encore : Quittez le chemin du vice pour prendre celui de la vertu ; maximes bibliques que M. Deblain trouvait sans doute fort respectables, mais dont le débit monotone et trop souvent répété lui faisait comparer, dans ses accès de gaieté, le long clergyman à l’un de ces hommes-sandwichs qui s’en vont, dans les quartiers les plus mal famés de Londres, cuirassés devant et derrière de larges pancartes, exhortant les pécheurs et pécheresses au repentir.
Aussi l’impitoyable Thompson s’épuisait-il en d’inutiles tentatives, et cela tout simplement parce que l’hôte de son beau-frère ne songeait le plus souvent qu’au dernier shake-hands ou au dernier sourire de la plus jeune des héritières du gros Elias.
Car il était arrivé fatalement que, malgré son expérience et ses quarante ans, notre héros se sentait fort entraîné vers miss Rhéa, non pas qu’il en fût passionnément amoureux, mais il la trouvait amusante et prenait un vrai plaisir de vieux garçon, quelque peu vicieux, à cette intimité facile où il vivait avec cette jolie personne de moins de vingt ans, gaie, spirituelle, troublante, qui le traitait en ami, ne se fâchait pas s’il gardait dans sa main, plus longtemps qu’il n’était nécessaire, son petit pied quand il l’aidait à monter à cheval, ou s’il la pressait un peu trop contre lui en valsant, et qui riait malicieusement, comme une femme qui comprend à demi-mot, lorsqu’il lui murmurait à l’oreille quelque galanterie gauloise.
Tous les matins, il faisait porter aux deux sœurs, par leur femme de chambre, de forts beaux bouquets, et chacune d’elles en détachait une fleur pour la placer à son corsage ; mais si Jenny se contentait de le remercier par un mot aimable, Rhéa complétait l’expression de sa gratitude en attachant elle-même une rose à sa boutonnière.
Raymond en était arrivé ainsi tout doucement à flirter, et c’est à ce moment qu’il écrivit à son ami Plemen :
« Ces misses américaines sont vraiment les plus adorables créatures du monde. De vraies Parisiennes, avec plus de franchise dans les allures, moins de pose, plus de spontanéité ! On dirait qu’elles sont nées uniquement pour le plaisir, et que leur existence joyeuse ne peut avoir que des lendemains sans soucis !
« À la bonne heure, ici, les pères et mères ne sont pas là qui vous surveillent et vous couchent en joue pour faire de vous des gendres. Je vais, viens, pars et reviens avec les filles du brave Elias Panton, sans qu’il y trouve à redire, pas plus que le public, qui voit cela tous les jours, pas plus que leur mère, qui me soigne et me dorlote, comme si j’étais son fils et n’avais encore que quinze ans.
« Il n’y a d’ombre au tableau qu’une certaine miss Gowentall, gouvernante de Mlles Panton ; mais si tu voyais avec quel sans gêne celles-ci l’oublient çà et là, puis un sévère clergyman, le révérend Jonathan, leur oncle, qui veut absolument faire de moi un disciple de Swedenborg et me glisse ses petites Bibles dans toutes les poches, aux éclats de rires, d’ailleurs, de ses jeunes nièces.
« C’est une seconde édition, en grotesque, de ma dévote tante Dusortois, Ah ! pour le coup, celle-ci me jugerait tout à fait damné si elle savait quelle existence folle je mène ici, au milieu de ces mécréants, entre ces deux jolies petites parpaillotes.
« L’une d’elles surtout, miss Rhéa, est ravissante, et sapristi ! si je n’avais pas fait vœu de coiffer sainte Catherine ! Mais je me contente d’être au mieux avec cette délicieuse enfant, qui a des yeux de turquoises, des lèvres de carmin, un teint de lis et de roses, des dents de perle, une taille de guêpe, des épaules d’albâtre, des cheveux d’ébène, et de l’esprit comme un démon.
« Tu le vois, mon cher docteur, dans mon enthousiasme descriptif, j’appelle tous les régimes à mon aide : le minéral, le végétal et l’animal.
« À bientôt cependant, car mes affaires sont terminées et, quoique je m’amuse fort à Philadelphie, je n’oublie ni Vermel ni mes amis.
« J’emporterai bien certainement un fort agréable souvenir de miss Rhéa, à qui je ne déplais pas peut-être, malgré ma quarantaine ; mais il ne manque pas dans notre bonne ville de jolis minois qui la chasseront vite de mon esprit. Ce n’est pas en Amérique qu’on a le droit d’oublier que la liberté est le premier des biens. Hip, hip, hurrah, for liberty ! »