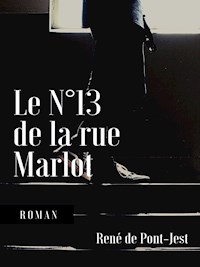Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans la Chine du XIXe siècle, un meurtre est commis lors d'une cérémonie de mariage. Qui est l'assassin? Les coupables le sont-ils réellement? Nous le saurons assez vite, car ce roman est prétexte à nous faire découvrir les relations anglo-chinoises en rapport avec le trafic de l'opium et le fonctionnement de la justice à cette époque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Fleuve des perles
Le Fleuve des perlesPRÉFACEPREMIÈRE PARTIE. UNE GOUTTE D’EAUDEUXIÈME PARTIE. LE NÉNUPHAR BLANCPage de copyrightLe Fleuve des perles
René de Pont-Jest
PRÉFACE
MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE,
Je viens de faire un voyage pendant lequel votre ouvrage, le Fleuve des Perles, a été mon seul compagnon. J’ai pris le plus grand plaisir à lire ce livre où vous dépeignez, avec autant de talent que de sincérité, les usages, la morale et les lois de mon pays.
Vous avez su, à l’intérêt d’une action dramatique savamment charpentée, ajouter, sans nuire en quoi que ce soit à la suite du récit, l’attrait qui s’attache toujours à tout ce qui est peinture fidèle des mœurs d’un pays et du milieu ambiant. Il est difficile d’entremêler avec plus d’art Européens et Chinois, colonies et indigènes, monde exotique et couleur locale.
Le titre seul, d’ailleurs, l’Araignée-Rouge, est déjà, pour un lettré chinois, une promesse qui désarmerait d’avance la critique, si toutefois celle-ci était possible, lorsqu’il s’agit d’un récit terrible, qui, tour à tour, intéresse, passionne, attache, séduit et laisse le lecteur comme sous le charme d’un rêve étrange, né des sentiments les plus variés, des sensations les plus diverses du cœur humain.
Les colères de Tchou ont grondé en moi ; j’ai tremblé pour I-té et Saule-Brodé.
Lorsqu’on se personnifie ainsi avec les acteurs d’un roman, pour vivre de leur vie et se sentir mourir de leurs haines et de leurs souffrances, le livre n’a plus besoin d’éloges et n’a rien à redouter de la critique, même la plus sévère.
Je dois ajouter, ici, que les admirables dessins de Régamey interprètent votre livre d’une façon exquise. M. Félix Régamey est trop connu pour que des louanges puissent ajouter à sa réputation, et chacun sait avec quel art il a su s’assimiler l’Orient, sous toutes ses formes. Mais je ne puis m’empêcher de dire, encore une fois, combien ses illustrations m’ont charmé.
Agréez, cher Monsieur, l’expression de ma vive gratitude et de mes sentiments les plus distingués.
TCHENG Kl-TONG.
Paris, 15 décembre 1889.
PREMIÈRE PARTIE. UNE GOUTTE D’EAU
I LES NOCES DU SEIGNEUR LING
La nuit était venue ; les bâtiments de tous pays qui sillonnaient la rivière des Perles n’y apparaissaient plus que comme des ombres fantastiques, au milieu du brouillard s’élevant des flots, après une journée torride ; les oiseaux faisaient entendre leurs derniers chants ; les lis fermaient leurs corolles ; les nénuphars se penchaient sur leurs tiges, en s’étendant sur les eaux, comme pour obéir, eux aussi, aux gongs de la pagode, qui avaient sonné la prière du soir et dit que le moment du repos était arrivé.
Cependant, sur la rive droite de ce grand fleuve, la seule voie de communication entre Macao et Canton, une villa, pleine d’animation et de lumières, faisait un contraste complet avec le silence et le calme qui régnaient sur les environs.
Un orchestre, composé, d’une centaine de musiciens, envoyait au loin ses notes joyeuses que redisaient les échos ; mille lanternes de couleur donnaient un aspect féerique aux superbes jardins dont l’habitation était entourée, et les détonations incessantes des pièces d’artifice, qui, après avoir décrit leurs sillons lumineux dans le ciel sans étoiles, retombaient au milieu des rizières, réveillaient d’innombrables couples de gros pigeons bleus qui s’enfuyaient à tire-d’aile.
Cette villa était la demeure du jeune Ling-Ta-Lang, ce qui veut dire : Ling enfant aîné. Il s’était marié le jour même, et la fête qu’il donnait en l’honneur de cet heureux événement ne semblait pas toucher à sa fin.
Personne ne songeait à se retirer ; les embarcations pavoisées et les chaises à porteurs qui devaient reconduire les invités à la ville allaient les attendre longtemps encore, malgré l’impatience toute naturelle qu’éprouvait Ling à se séparer de ses hôtes, pour rejoindre, dans sa chambre nuptiale, celle qui était sa femme et dont il ne connaissait pas plus les traits qu’elle-même ne connaissait ceux de son mari.
Car c’est ainsi que les choses se passent dans l’Empire du Milieu, et je n’y crois pas les ménages plus mauvais que dans nos contrées. Là-bas, les époux ne se voient que lorsqu’ils sont irrévocablement unis.
Ling savait seulement que sa jeune femme se nommait Saule-Brodé et qu’un enfant de dix ans n’aurait pu chausser ses souliers de satin rose.
Le père du marié, Ling-Tien-Lo – honneurs du Ciel – un des plus riches négociants de Canton, avait dit un soir à son héritier qu’il était temps d’en finir avec les plaisirs faciles et qu’il lui avait trouvé une femme réunissant toutes les qualités et possédant tous les charmes.
Le fils avait obéi, car, en Chine, le manque de respect aux parents est sévèrement puni ; il avait échangé aussitôt avec sa fiancée inconnue les présents d’usage et, trois mois plus tard, le matin même du jour où commence ce récit, il avait vu arriver sur le pas de sa porte un ravissant palanquin de palissandre incrusté d’ivoire.
Il en était sorti, soigneusement enveloppée dans d’épais et longs voiles de mousseline tissée d’or et d’argent, celle qui allait être désormais sa compagne, mais il n’avait pu même lui adresser la parole ni se faire reconnaître d’elle. Ses servantes l’avaient rapidement entraînée pour l’enfermer dans l’appartement qui lui était destiné.
Ling s’était consolé de cet échec en se rappelant qu’il avait orné cet appartement avec tout le luxe imaginable, et que chacun des objets sur lesquels Saule-Brodé arrêterait ses regards lui affirmerait l’amour de son mari.
Puis il ne s’était plus occupé que de la fête, fête à laquelle prenaient part une foule d’étrangers, pendant que son père recevait quelques intimes dans l’appartement de sa belle-fille. Pour satisfaire aux lois de l’hospitalité, les portes de la maison étaient ouvertes depuis le matin à tous ceux qui voulaient en franchir le seuil.
Il y avait là nombre de gens que le jeune Ling n’avait jamais vus, mais aux toasts desquels il lui avait cependant fallu répondre si souvent, qu’au coucher du soleil il avait la tête brisée et ne songeait plus qu’à s’esquiver aussitôt qu’il le pourrait, pour prendre l’air dans le jardin.
Il comptait bien que ses invités se presseraient dans la grande galerie de la villa lorsque les acrobates qu’il avait fait venir de Canton commenceraient leurs exercices, et il attendait impatiemment que cette heure sonnât, ne prêtant plus qu’une oreille distraite aux accords de l’orchestre et ne répondant que machinalement aux compliments qu’on lui adressait.
S’il avait été moins absorbé, il aurait certainement distingué deux de ses hôtes, dont les regards s’arrêtaient souvent sur lui avec des expressions différentes et qui ne prenaient aucune part à la joie générale.
L’un était un tout jeune homme d’un visage pâle, d’une physionomie mélancolique et sévère.
À son costume et au bouton de cuivre qui surmontait sa coiffure, il était facile de le reconnaître pour un lettré attaché à la pagode de Fo.
Il était entré dans la villa en même temps que le palanquin de la mariée ; il avait suivi celle-ci du regard jusqu’à ce que les portes de son appartement se fussent refermées derrière elle ; puis il s’était mêlé à la foule, mais sans partager ses jeux, et bien qu’il se fût dirigé à plusieurs reprises vers la porte de sortie, il était toujours revenu sur ses pas, comme retenu dans l’habitation par un aimant irrésistible.
Dix fois dans la journée, Ling-Ta-Lang, qui le connaissait, l’avait salué d’un sourire amical et le jeune savant lui avait répondu, mais avec un effort pénible et une contrainte douloureuse qui eussent frappé tout homme moins aveuglément heureux que l’époux de Saule-Brodé.
Quant au second personnage, dont l’attitude contrastait également avec celle des joyeux hôtes de la villa, c’était un individu d’une trentaine d’années, maigre, de haute taille et de tournure commune, bien qu’il fût élégamment vêtu, comme un riche marchand.
Ses gros yeux ronds, à fleur de tête, injectés de sang, avaient des regards d’une fixité magnétique, et ses lèvres rouges et lippues, constamment relevées par un sourire ironique, lui donnaient une physionomie tout à la fois grotesque et bestiale.
Il n’était guère possible d’oublier ses traits lorsqu’on les avait vus une seule fois.
Cet être étrange n’était sans doute arrivé qu’à la nuit tombante, car les maîtres de la maison ne l’avaient pas remarqué. Il est vrai qu’il avait passé la plus grande partie de la soirée dans le parc.
On eût dit qu’il n’était venu dans cette habitation que pour compter les allées du jardin et en étudier les massifs.
Cependant, après avoir reconnu le lettré, avec un sentiment de joie habilement dissimulée, il s’était décidé à le suivre dans les galeries, où les jongleurs allaient donner leur représentation.
Tout en évitant d’être vu de celui qui le précédait, le sinistre personnage s’efforçait néanmoins de ne pas s’en éloigner. Il le rejoignit à le toucher au moment même où les invités, appelés par les sons retentissants des gongs, se précipitaient vers le théâtre.
Profitant alors du mouvement pressé de la foule, il détacha vivement, à l’aide d’un poignard, l’éventail de laque que le serviteur de Fo portait suspendu à sa ceinture, et, cela fait, il se retira en arrière, en cédant la place aux curieux qui se bousculaient pour mieux voir.
Ce singulier larcin avait été si adroitement exécuté que personne, pas même celui qui en avait été la victime, ne s’en était aperçu.
Au même instant, convaincu que l’attention de tous était détournée de lui par les acrobates, Ling se glissa à travers ses amis, pour s’élancer dans le jardin avec un soupir de soulagement, non sans jeter un regard chargé d’amour vers l’appartement de sa femme, dont quelques minutes seulement le séparaient encore.
L’étranger, qui ne quittait pas des yeux le mari de Saule-Brodé depuis qu’il avait caché sous son vêtement l’éventail volé, sortit rapidement lui-même par l’extrémité opposée de la galerie et, se cachant derrière les arbres, prit une allée parallèle à celle que son hôte suivait en rêvant.
Il savait sans doute que, faisant un coude cent pas plus loin, les deux chemins se rejoignaient au milieu de massifs de cactus et d’aloès.
Les illuminations s’étaient peu à peu éteintes, le parc était plongé dans d’épaisses ténèbres.
Une heure plus tard, trois coups rapidement frappés résonnèrent à la porte de l’appartement nuptial.
À ce signal, les servantes ouvrirent et, se voilant le visage, livrèrent passage à celui qui se présentait en maître. Ensuite elles sortirent et fermèrent les portes derrière elles.
Le silence le plus profond régnait dans la villa.
On n’entendait plus, redits par les échos du fleuve des Perles, que les chants monotones des bateliers et des porteurs de chaises, qui reconduisaient chez eux les invités du seigneur Ling-Ta-Lang.
II L’EMPREINTE SANGLANTE
Les maisons chinoises ne sont pas aussi complètement ridicules qu’on se plaît trop à le croire, au contraire, et si les architectes de ce pays n’emploient le plus souvent les lourds matériaux, la pierre et le marbre, que pour les palais et les temples, ils n’en construisent pas moins, pour les particuliers, des habitations charmantes et surtout admirablement appropriées aux mœurs et aux usages de ceux qui doivent les occuper.
Ces habitations ont rarement plus d’un étage et sont divisées en deux parties tout à fait distinctes : celle où le maître du logis reçoit les visiteurs et celle qui n’appartient qu’à la famille, car autant le Chinois est communicatif dans les affaires, les fêtes et les réceptions, autant il est réservé à l’égard de tout ce qui touche à sa vie intime.
Le rez-de-chaussée de ces maisons renferme la salle à manger, les cuisines et la salle de bains. Il est toujours précédé d’une pièce exclusivement consacrée aux ancêtres et aux génies de la demeure.
Tout cela est riche, somptueux ; mais c’est principalement pour leurs femmes que les sujets du Fils du Ciel déploient leur amour du luxe.
On comprend donc que l’appartement que Ling avait fait installer pour sa jeune compagne devait être un modèle d’élégance et de bon goût.
C’était, à la suite les unes des autres, une série de petites pièces délicieusement ornées, où il s’était plu à rassembler toutes les excentricités de l’ameublement national, toutes les étrangetés de son pays étrange.
La chambre à coucher, qui se trouvait au fond de cette retraite, sévèrement interdite dans l’extrême Orient à tout autre homme qu’au mari, était surtout ravissante. Le parquet en mosaïque y disparaissait sous une natte épaisse, moelleuse et fine comme un tissu de Cachemire ; les tentures étaient de lourde soie jaune, sur laquelle étaient brodés les héros les plus fantastiques de la mythologie bouddhique, et les meubles sculptés en bois de santal dont le parfum embaumait l’atmosphère.
Tout autour de la pièce régnait un large divan recouvert de renard bleu ; cent oiseaux voltigeaient dans leurs cages dorées ; les plantes les plus rares s’épanouissaient dans d’admirables jardinières de porcelaine émaillée, et sur le lit, de deux pieds de hauteur seulement et enveloppé de rideaux de mousseline de soie, deux grands oreillers de satin attendaient les époux.
Puis, à la tête de ce lit et sur une table de porphyre, se trouvait un merveilleux coffret d’ivoire sculpté, que Saule-Brodé ouvrit avec la plus vive curiosité lorsqu’elle se fut familiarisée avec toutes les richesses de son appartement.
Elle pressentait que ce coffret renfermait les cadeaux de noce de son époux.
En effet, à peine en eut-elle soulevé le couvercle qu’elle poussa un cri de joie et, pendant un moment, resta éblouie.
Du reste, la plus blasée des Parisiennes n’aurait peut-être pas éprouvé moins de surprise ni moins de plaisir.
Il y avait là de délicieux bracelets d’or, des colliers de perles, de grandes épingles à tête de jade, pour relever les cheveux que la jeune femme n’aurait plus le droit de laisser pendre le lendemain en longues nattes sur ses épaules, des boucles d’oreilles en corail pâle divinement fouillé, des éventails merveilleux et vingt autres joyaux d’un prix inestimable.
Quant à la jolie mariée, dont les petites mains aux ongles roses jouaient avec ces bijoux, c’était une enfant de quinze ans à peine, aux grands yeux veloutés, au sourire plein de charmes ; adorable enfin dans ses expansions naïves, dans ses étonnements successifs.
Pendant de longs instants, la vue de toutes ces parures l’arracha à ses terreurs vagues de vierge inconsciente, et ses servantes la laissèrent tout entière à ses joies nouvelles ; mais le moment arriva où elles la prévinrent qu’elle devait se préparer à recevoir son mari.
On venait de leur annoncer que la fête allait finir et que les invités commençaient déjà à se retirer.
Saule-Brodé rougit et courba la tête ; elle sentit, en frissonnant, tomber un à un les vêtements qui l’enveloppaient pudiquement, et bientôt elle se vit seule, tremblante, dans cet asile mystérieux qu’une lampe de cristal éclairait à peine, et où ne parvenaient que confusément les accords de l’orchestre et les bravos des derniers spectateurs qui applaudissaient les acrobates de Canton.
Soudain elle entendit frapper à la porte extérieure de son appartement les trois coups dont la signification lui avait été enseignée, et son cœur battit à rompre sa poitrine.
Dans son trouble, elle courut se jeter sur son lit, dont les longs rideaux la recouvrirent comme d’un linceul, étouffa un cri de frayeur en voyant s’approcher d’elle l’homme auquel elle devait appartenir, et, trop frêle pour résister à une semblable émotion, elle s’évanouit en sentant deux lèvres imprimer sur son épaule un baiser qui lui parut une morsure.
La lampe s’était éteinte, les oiseaux eux-mêmes s’étaient endormis ; la nuit poursuivait son cours.
De longues heures s’écoulèrent ainsi, sans que nul bruit vînt troubler le silence qui enveloppait la villa.
Lorsque Saule-Brodé reprit connaissance, elle avait passé sans doute de son évanouissement au sommeil, car le jour commençait à poindre et, bien qu’elle se sentît brisée, ses terreurs s’étaient un peu amoindries.
Plus calme, elle ne cherchait qu’à se rendre compte de ce qui s’était passé, s’efforçant peut-être encore de croire qu’elle n’avait été que le jouet d’un songe, et elle restait immobile, les yeux fermés, sans oser faire un mouvement, dans la crainte de réveiller celui qui devait être à ses côtés et dont elle était à jamais la compagne.
Tout à coup elle entendit pousser dans le jardin un grand cri qui la fit tressaillir ; puis cent autres cris se succédèrent et elle se souleva épouvantée, prêtant l’oreille à ces éclats sinistres, au milieu desquels il lui semblait qu’on prononçait son nom avec des accents de fureur.
Des pas pressés résonnèrent aussitôt dans la galerie qui conduisait à son appartement, et, volant en éclats, la porte de sa chambre livra passage à un homme aux traits bouleversés, qui se précipita vers elle en s’écriant :
– Mon fils ! qu’avez-vous fait de mon fils ?
C’était Ling-Tien-Lo.
Tous les gens de la maison l’avaient suivi jusque sur le seuil de la pièce, mais ils n’osaient y pénétrer.
La jeune femme étendit instinctivement la main pour demander protection à son époux.
Le lit était vide.
Affolée, ne comprenant rien à ce qui se passait, croyant être sous l’empire d’un horrible rêve, elle se laissa glisser à terre. Là, ses petites mains jointes, elle interrogeait du regard son beau-père. Mais celui-ci ne la voyait plus ; ses yeux épouvantés étaient fixés sur la couche nuptiale ; ses lèvres se choquaient convulsivement sans émettre aucun son, et, d’un bras tremblant, il désignait le coussin que sa belle-fille venait de découvrir en se levant.
Les assistants avaient répondu à ce geste par un murmure d’horreur, et leurs regards ne quittaient pas le lit.
Alors Saule-Brodé, elle aussi, tourna la tête de ce côté, mais pour se jeter bien vite en arrière, en étouffant un cri d’épouvante, et tomber à genoux, en se voilant le visage.
L’oreiller de satin sur lequel, cinq minutes auparavant, elle dormait encore, portait l’empreinte d’une large main sanglante, et le précieux coffret à bijoux gisait à terre, vide et brisé.
Les serviteurs se taisaient, n’osant rompre le silence lugubre de cette scène, que troublaient seuls les sanglots de la mariée de la veille.
Soudain la fille de Mme Liou sentit qu’on la forçait brusquement à se relever. Il lui fallut bien obéir.
Le père de son mari, revenu de sa stupeur, lui répétait de nouveau, cette fois avec rage :
– Voyons, qu’avez-vous fait de mon fils ?
– Je ne sais, balbutia-t-elle, je le pensais près de moi. Pourquoi n’est-il pas ici ? Que…
– Pourquoi, misérable ! pourquoi ? Tu oses le demander ! Oh ! tu vas le savoir !
Il la saisit entre ses bras, l’emporta aussi facilement qu’il eût pu le faire d’un enfant, et après avoir traversé en courant la galerie et la moitié du parc, il atteignit un épais massif au milieu duquel il la laissa tomber brutalement en lui disant :
– Tiens, malheureuse ! voilà ce que ton complice et toi vous avez fait de mon fils, de celui qui était ton seigneur et maître.
Dépouillé de ses habits de fête et le visage crispé par une dernière convulsion, le pauvre Ling-Ta-Lang gisait là, sur le sable, au milieu d’une mare de sang et frappé d’une large blessure, dont les lèvres béantes laissaient voir son cœur à nu.
À cet horrible spectacle, Saule-Brodé comprit qu’on l’accusait d’un crime infâme. Aussitôt elle roula sur le sol, auprès du cadavre de son époux, au milieu des cactus dont les épines, déjà teintes du sang du mort, lui déchirèrent le visage.
Quant à Ling, après s’être pieusement agenouillé pendant quelques minutes, il donna ses ordres aux serviteurs qui se trouvaient là ; puis il se dirigea vers l’habitation, sans se préoccuper autrement de celle qui, pour lui, n’était plus qu’un assassin.
III L’ARRESTATION
À peine couverte d’une pièce d’étoffe que, par pudeur plutôt que par pitié, une de ses servantes avait jetée sur elle, Saule-Brodé était toujours affaissée sur le sable du jardin, auprès du corps de son mari, lorsque le préfet de police de Canton, qui avait été prévenu par un courrier, arriva avec son escorte et ses gardes.
Ce fonctionnaire s’appelait Fo-hop. C’était un homme jeune, intelligent, appelé depuis peu au poste important et difficile qu’il occupait, et comme le père de la victime jouissait d’un grand crédit, il s’était hâté d’accourir, heureux qu’il était de rencontrer une telle occasion de déployer son zèle et de prouver son habileté.
La nouvelle de l’assassinat du jeune Ling s’était si rapidement répandue dans les environs que, malgré l’heure matinale, une foule énorme était déjà groupée devant la villa. Les domestiques avaient été forcés d’en barricader solidement les issues, car les menaces du dehors à l’adresse de la jeune femme permettaient de craindre que quelques individus de bonne volonté ne s’introduisissent dans le parc pour devancer l’œuvre de la justice.
À la vue des hommes de police, reconnaissables aux ornements rouges de leur coiffure, le peuple poussa un hourra de satisfaction sauvage et ouvrit ses rangs, sans attendre d’y être invité à coups de fouet.
Fo-hop se nomma, les gens de la maison s’empressèrent de lui livrer le passage, et il pénétra dans le jardin, dont la grille, au désespoir des curieux, se referma aussitôt derrière lui.
Ling-Tien-Lo, le visage dans les deux mains, était assis sur un banc, à quelques pas de la porte.
Le chef de la police s’approcha de lui et le toucha doucement à l’épaule.
Le malheureux père leva la tête.
Ses yeux étaient remplis de larmes. La colère avait fait place chez lui à ce désespoir muet qui est le propre des hommes forts.
Comprenant qu’il devait momentanément vaincre sa douleur, il se redressa avec courage et fit signe au fonctionnaire de l’accompagner.
Bientôt ils arrivèrent à l’endroit sinistre, mais sans avoir échangé un seul mot.
Saule-Brodé, accroupie, courbée sur elle-même comme une fleur sur sa tige brisée, semblait inanimée.
Les mouvements précipités de son sein, soulevé par les sanglots, indiquaient seuls qu’elle vivait encore.
Quant au cadavre, on avait étendu sur lui une grande robe de soie et deux serviteurs se tenaient à ses côtés, mais il était dans le même état où il avait été découvert.
En Chine, ainsi que dans nos pays, il est défendu de toucher, avant l’arrivée de la police, à un individu assassiné, non seulement afin que les magistrats puissent se rendre compte, par l’examen et la position du corps, de la façon dont le crime a été commis, mais aussi parce que tout propriétaire sur le terrain duquel est trouvé un mort peut être traduit devant les tribunaux par la famille du défunt, et condamné à une forte amende, souvent même à la prison.
Après avoir jeté autour de lui un coup d’œil investigateur, Fo-hop pria le père de la victime de lui dire ce qu’il savait de cet attentat mystérieux. Il fit ensuite découvrir le cadavre, dont Ling-Tien-Lo détourna les yeux, et il l’examina longuement.
Après quoi, il alla et vint de l’allée à l’endroit où était le corps, étudiant le terrain, cherchant une piste, se livrant évidemment à un travail mental qui le préoccupait vivement.
Cela dura quelques instants.
– Seigneur, dit-il enfin au malheureux marchand, votre fils n’a pas été tué par sa femme ; c’est une main d’homme robuste qui lui a fait cette profonde et large blessure. De plus, tout me fait supposer qu’il a été frappé sans avoir pu se défendre, car je ne vois aucune trace de lutte autour de la place qu’il occupe, tandis que je remarque ici près des piétinements et des fragments de branches qui indiquent que c’est là qu’il est tombé. Seulement, comme aucun de ces débris n’est taché de sang et que le bas des vêtements de votre enfant n’en est pas non plus souillé, j’en conclus que le poignard n’a été employé qu’en second lieu, alors qu’il était déjà couché à terre, sans mouvement et à la merci de son assassin.
– Quelle est donc votre pensée ? hasarda Ling, qui écoutait tous ces détails avec horreur.
– Ou je me trompe fort, ou votre fils a été saisi dans l’allée, paralysé, étouffé peut-être entre deux bras solides, puis porté et frappé par son meurtrier là où nous le voyons. La preuve, c’est que, sur l’espace qui sépare ces deux endroits, celui de la lutte ou de la rencontre et celui de la mort, on ne voit que les traces des pieds d’un seul individu, pieds fortement imprimés dans le sable, comme ceux d’un homme chargé d’un pesant fardeau. Je dois être dans le vrai. Qu’en dites-vous, Mim-po ?
Ces derniers mots s’adressaient à un troisième personnage, qui, penché sur Ling-Ta-Lang, avait entr’ouvert ses vêtements et examinait attentivement la blessure.
Ce nouveau venu était le médecin de la famille, qu’on était allé chercher.
– Votre Seigneurie a certainement raison, répondit le docteur ; cette plaie a été faite avec une arme lourde et à deux tranchants qu’une femme ne saurait manier ; de plus, les lèvres du mort indiquent par leur couleur et leur tuméfaction, qu’avant de l’assassiner, on lui a fait prendre, sinon du poison, du moins un narcotique stupéfiant. Lequel ? Cela me serait plus difficile à préciser.
– Seigneur Ling, reprit Fo-hop avec un sourire d’orgueil, vous pouvez faire enlever le corps de votre fils. Que cette femme soit conduite dans son appartement et que les servantes qui étaient auprès d’elle hier soir s’y rendent tout de suite. Donnez aussi des ordres pour que personne ne sorte d’ici.
Saule-Brodé assistait à cette scène épouvantable sans paraître y rien comprendre.
Ses yeux hagards allaient du cadavre ensanglanté de son époux à son beau-père et aux autres personnes qui étaient là.
On eût dit que toute son intelligence l’avait déjà abandonnée.
Lorsqu’elle sentit qu’on la soulevait, elle essaya de marcher, mais ses jambes fléchirent aussitôt.
On fut obligé de la porter.
Au même instant, les serviteurs qui relevaient le mort découvrirent sous lui un éventail qu’on n’avait pas aperçu jusque-là.
L’un de ces hommes le tendit au chef de la police.
– C’est à votre fils, cet éventail ? demanda ce dernier à Ling-Tien-Lo.
– Non, fit tristement le vieillard en branlant la tête, je ne le reconnais pas. D’ailleurs ce n’est pas là son chiffre.
L’éventail portait en effet, sur une de ses lames, un nom parfaitement distinct, bien qu’il fût taché de sang, et ce nom n’était pas celui du marié.
– Alors c’est celui de son assassin ! s’écria le fonctionnaire. Prenez courage, mon ami ; grâce à ce seul indice, nous le découvrirons ; votre enfant sera vengé !
Et confiant la précieuse pièce de conviction à l’un de ses officiers, Fo-hop ordonna à son secrétaire de le suivre.
Ils se dirigèrent tous vers la maison.
Les ordres du préfet avaient été exécutés. Saule-Brodé l’y avait précédé.
Il la rejoignit, ainsi que ses servantes, dans cette chambre nuptiale où nous avons vu la vierge attendant son époux.
L’appartement était toujours en désordre, comme l’avait trouvé le pauvre père, lorsqu’il en avait arraché sa belle-fille.
Le magistrat examina tout avec le plus grand soin, prit de nombreuses notes, et passa à l’interrogatoire des femmes de chambre.
Toutes furent d’accord dans leur récit. Après avoir entendu frapper à la porte de l’appartement de leur maîtresse, vers le milieu de la nuit, elles avaient ouvert au marié, qu’elles avaient reconnu à son riche costume, malgré la demi-obscurité qui régnait dans la pièce où elles attendaient. Elles s’étaient ensuite retirées.
Elles ignoraient par conséquent si Ling-Ta-Lang était sorti de chez sa femme et à quelle heure, ou si un autre homme s’y était introduit.
Quant à Saule-Brodé, elle n’en savait pas davantage.
– À une heure que je ne saurais indiquer, répondit-elle à Fo-hop, en s’efforçant de retrouver un peu de calme, mon époux est entré dans cette chambre, j’ai été saisie de frayeur et je me suis évanouie. Je n’ai plus rien vu, rien entendu que les cris de mort qui m’ont réveillée ce matin. Je ne puis dire autre chose !
– Comment ! reprit le préfet de police sévèrement, vous ignorez le moment où votre mari vous a quittée, vous n’avez entendu personne pénétrer dans votre appartement après son départ ? Un autre homme a pris sa place auprès de vous, voici l’empreinte sanglante de sa main sur le coussin où vous reposiez votre tête : cet inconnu a pu briser ce coffret, en enlever les bijoux et s’enfuir sans que vous vous soyez aperçue de rien ?
– J’ignore ce qui s’est passé, je vous le jure, murmura la jeune femme, en s’affaissant de nouveau sur elle-même.
– Cet éventail, ne le connaissez-vous pas ? lui demanda Fo-hop, en la forçant à lever les yeux.
– Non, balbutia Saule-Brodé, non !
– Ce nom ne vous dit rien ?
– Ce nom ? Mais si, je le connais, répondit vivement l’infortunée, qui regardait l’éventail à travers ses larmes et dont les lèvres eurent aussitôt un sourire d’espoir, c’est celui de I-té.
– Qui cela, I-té ?
– I-té, mon cousin, le professeur d’astronomie à la pagode Mi.
– Eh bien ! cet I-té est l’assassin de votre époux, car cet éventail a été trouvé sous son cadavre ! Vous, vous êtes sa complice !
À cette accusation terrible et si nettement formulée, la pauvre enfant jeta un cri d’horreur et tomba à la renverse sur le sol.
– Gardes, emparez-vous de cette misérable ! commanda le fonctionnaire ; elle appartient à la justice !
Cinq minutes après, le palanquin fermé dans lequel Saule-Brodé gisait inanimée sortait de la villa au milieu des imprécations de la foule.
Moins d’une heure plus tard, les soldats de police se débarrassaient de leur triste fardeau dans la cour de la prison de Canton.
IV LA COUR DES SUPPLICES
La prison de Canton – grand monument carré, bas et sombre, situé à l’entrée de la ville et adossé au large rempart de la seconde enceinte – était l’un des plus horribles lieux de détention qu’il fût possible de s’imaginer.
Il n’y existait aucun jour sur l’extérieur, sauf la lourde porte rouge qui en était l’entrée.
À droite et à gauche de cette porte, à une quinzaine de pieds de hauteur, sortaient de la muraille de grandes traverses de bois de deux mètres de longueur et semblables à des bras de potence.
À l’extrémité de chacune d’elles se balançaient des cages en bambous qui renfermaient des têtes de suppliciés, les unes déjà desséchées, les autres fraîchement coupées et dont le sang tombait en larges gouttes sur le sol, pendant que leurs bouches grimaçantes semblaient implorer la pitié publique.
Quelques-unes de ces affreuses dépouilles, ayant traversé les barreaux pourris de leurs cages, n’y restaient attachées que par leurs longues queues de cheveux, et, suspendues dans le vide, tournaient au gré du vent.
Quelques autres, au contraire, plus anciennes encore, étaient tombées à terre, où des passants pressés et cyniques les avaient repoussées du pied le long du mur. Elles formaient là un véritable charnier humain.
La prison devait ces hideux ornements à la razzia qui avait été faite peu de temps auparavant dans les rangs du Nénuphar-Blanc, association de voleurs et d’assassins d’autant plus redoutable qu’elle était alliée aux rebelles, et que les musulmans la protégeaient, sous le prétexte qu’elle était une secte religieuse et politique.
Saule-Brodé, à demi morte et enfermée dans le palanquin de police, avait été privée de ce navrant spectacle, mais celui que lui offrait l’intérieur de la geôle n’était pas fait davantage pour calmer ses terreurs.
Pendant que le chef de l’escorte était allé prévenir le directeur, la malheureuse avait été introduite dans une petite pièce humide où elle était tombée sur un banc de bois.
Là, elle eût pu croire peut-être encore qu’elle n’était que le jouet d’un épouvantable cauchemar, si les gémissements et les cris de douleur qui frappèrent tout à coup ses oreilles n’étaient venus la rappeler trop vite à la réalité.
Faisant alors un effort surhumain, elle voulut voir ceux qui poussaient ces plaintes et s’approcha de l’étroite fenêtre grillée qui éclairait la salle où elle se trouvait, mais à peine eut-elle hasardé un coup d’œil au dehors qu’elle se rejeta vivement en arrière, en se cachant le visage dans les mains. Cette ouverture donnait sur une cour intérieure où les détenus subissaient les peines auxquelles ils étaient condamnés.
Il y avait là, accroupis dans la boue et en plein soleil, une centaine de misérables aux membres sanglants et décharnés, à la face livide et terreuse, et couverts à peine de quelques vêtements en lambeaux.
Les uns étaient attachés par une jambe à une chaîne de fer rivée à un bloc de fonte d’un tel poids qu’il leur était impossible de le déplacer. Lorsqu’ils voulaient prendre un peu d’exercice, ils devaient tourner comme des bêtes fauves dans un rayon de quelques pas.
D’autres, les poignets liés au bout d’un morceau de bois dont l’extrémité supérieure était fixée au collier qu’ils avaient au cou, ne pouvaient ni baisser, ni lever les mains, et cette privation était une véritable torture.
Un des suppliciés avait la main et le pied droits enclavés dans une planche de trente centimètres de hauteur à peu près, et il devait faire ainsi, dix fois par jour, le tour du préau.
Un garde, ou plutôt un bourreau, le tirait en avant par une chaîne passée autour de sa taille, tandis qu’un autre le frappait d’un lourd bâton pour le faire avancer.
Ce martyrisé était par conséquent forcé de se traîner sur la jambe qu’il avait de libre, et le corps courbé, dans la position la plus douloureuse. Puis, çà et là, sur ce sol fangeux, on apercevait, rampant ainsi qu’un monstrueux crabe, un prisonnier chargé de sa cage, lourd cuvier renversé, par le fond duquel passaient ses mains et sa tête, mais par des trous si étroits qu’il ne pouvait les retirer.
Lorsqu’il voulait se reposer, il était obligé de s’accroupir de façon à ce que son pesant fardeau touchât la terre ; lorsqu’il désirait se déplacer un peu, il devait en supporter tout le poids sur les épaules.
Deux fois par jour, les femmes de ceux qui subissaient ces horribles peines étaient autorisées à venir leur donner à manger, ce qu’elles faisaient en leur introduisant elles-mêmes les aliments dans la bouche.
Ceux qui n’étaient pas mariés ou dont, hélas ! personne, parent ou ami, ne prenait soin, étaient nourris par les geôliers, et il arrivait souvent que le matin, en voulant faire sortir de son immobilité une cage oubliée dans un coin, on ne trouvait plus dessous qu’un cadavre.
Pour échapper à cet odieux tableau, Saule-Brodé s’était retirée dans le fond de la pièce où on l’avait enfermée.
Blottie dans un des angles de la muraille, elle s’efforçait de fermer les oreilles aux hurlements de douleur de ces malheureux et songeait alors à ses propres infortunes, lorsque la porte de sa chambre s’ouvrit brusquement pour livrer passage à l’officier de police qui l’avait escortée.
Il précédait le directeur de la prison et deux autres visiteurs, sur lesquels la veuve de Ling leva ses yeux hagards.
Le directeur était un homme d’une cinquantaine d’années, d’une physionomie sévère, et l’un de ceux qui l’accompagnaient n’avait pas non plus rien qui frappât beaucoup, ni dans sa tournure ni dans ses vêtements.
Le fonctionnaire cependant lui témoignait le plus grand respect, et, après avoir jeté tous deux un coup d’œil étonné sur la prisonnière, ils échangèrent rapidement quelques mots, que Liou-Siou n’entendit même pas, car ses regards restaient fixés, malgré elle, sur le troisième des nouveaux venus. C’est que cet individu était un personnage qu’il n’était pas facile d’oublier lorsqu’on l’avait vu seulement une fois.
C’était un grand gaillard d’une épouvantable laideur et d’un aspect repoussant.
Son visage atrocement ravagé par la petite vérole grimaçait un sourire cynique, qui découvrait des gencives saignantes et décharnées.
Ses yeux, éraillés et injectés, clignotaient comme ceux d’un fauve ; ses narines dilatées et mobiles semblaient flairer l’odeur du carnage.
Il était coiffé d’un chapeau en fils de fer et vêtu d’une tunique rouge, dont la ceinture de cuir retenait un fouet à cinq lanières terminées par des clous aiguisés.
Immobile sur le seuil de la porte comme pour en défendre l’entrée, il s’appuyait de la main droite sur un long bambou maculé de sang.
Il semblait à la cousine d’I-té qu’elle connaissait déjà ce monstre, qu’elle l’avait déjà aperçu, et la mémoire lui revint sans doute tout à coup, car elle ferma les yeux en étouffant un cri d’horreur.
Elle venait de se souvenir que sa mère, pour l’effrayer, alors qu’elle était enfant et refusait d’obéir, lui avait parfois montré, sur un de ces dessins qu’on vend en Chine le jour des exécutions, un homme qui ressemblait à celui qui était devant elle, et que cet homme était le bourreau.
Hélas ! elle ne se trompait pas !
Le mandarin qui accompagnait le directeur était le magistrat chargé d’instruire l’affaire de l’assassinat de Ling-Ta-Lang, et les règlements exigeaient que les fonctionnaires de cet ordre fussent toujours escortés de celui qui était le dernier mot de la loi, comme pour leur rappeler à chaque instant les conséquences de leurs sentences et la gravité de leurs devoirs.
Sur un signe du mandarin, le bourreau s’approcha de la prisonnière.
Celle-ci le sentit venir bien certainement, car un frisson glacé s’empara de tout son être, et lorsque le sinistre personnage étendit la main de son côté, elle se releva vivement, dans l’espoir d’échapper à la souillure de son attouchement. L’homme sourit de son rictus bestial et lui ordonna de le suivre.
Elle obéit en se traînant à ses côtés, et ils traversèrent ainsi, d’abord ce lieu de supplice que nous avons dépeint plus haut, ensuite une longue galerie déserte, qui les conduisit dans la partie de la prison réservée aux femmes.
Cinq minutes plus tard, la mariée de la veille entendait retomber derrière elle une lourde porte. De nouveau, la pauvre Saule-Brodé était seule, avec ses angoisses, séparée de sa mère, de ses amis, de tous ceux qui auraient pu la défendre !
Celle dont la vie, vingt-quatre heures auparavant, s’ouvrait si pleine de douces promesses, n’avait plus, pour horizon, que les murs humides d’un étroit cachot, et, pour avenir, que la cour criminelle et son arrêt effrayant.
Faisons maintenant un pas en arrière pour dire par quel enchaînement fatal de circonstances une vierge de quinze ans avait ainsi passé de toutes les joies à toutes les douleurs.
V ÉCLAT DE RIRE DE JEUNE FILLE
Il était à peu près huit heures du matin et, bien qu’on ne fût encore qu’à la fin du mois de février, l’aurore promettait cependant à la province de Canton une de ces belles et tièdes journées de printemps qui font du sud de la Chine une des contrées bénies du ciel.