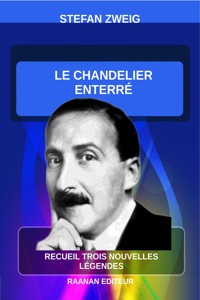
1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Trois nouvelles, deux histoires juives et une bouddhiste que l’auteur considère comme des légendes. La première, «Le chandelier enterré», nous conte l’histoire de la menorah, le chandelier symbole de la religion juive. Dans la seconde, «Rachel contre Dieu», l’auteur reprend l’histoire de Jacob et Rachel dans la Bible, cette dernière se rebelle contre Dieu cruel envers son peuple. Et dans la troisième, «Virata», guerrier intrépide vient au secours de son roi pour empêcher une rébellion et tue sans s’en douter son frère aîné. Présentation Le Chandelier enterré Le Chandelier enterré est une légende concernant le candélabre sacré allumé en permanence dans le Temple de Jérusalem. Lors de la conquête de Jérusalem par Titus en 70 et la destruction du Second Temple, les Romains emportent comme trophée le chandelier ou Ménorah en or massif. Il fait ensuite partie du butin emporté par les Vandales lors du sac de Rome de 455. Le récit de Stefan Zweig (1937) relate le sac de Rome puis raconte la quête de la menorah par Benjamin Marnefesch (« l'homme que Dieu a rudement éprouvé ») deux générations plus tard et son sauvetage par Benjamin et Zacharie à Byzance.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SOMMAIRE
LE CHANDELIER ENTERRÉ
RACHEL CONTRE DIEU
VIRATA
Série : Stefan Zweig
|14| LE CHANDELIER ENTERRÉ
STEFAN ZWEIG
LE CHANDELIER ENTERRÉ
RECUEIL TROIS NOUVELLES
LÉGENDES
Paris, 1937
Traducteur Alzir Hella
Raanan Éditeur
Livre 1266 | édition 1
raananediteur.com
LISTE DES NOUVELLES
LE CHANDELIER ENTERRÉ
RACHEL CONTRE DIEU
VIRATA
LE CHANDELIER ENTERRÉ
Légende
C’était par une belle journée de juin 455 ; le combat qui venait d’opposer, au Circus Maximus de Rome, deux gigantesques Hérules à une meute de sangliers hyrcaniens s’était terminé dans le sang, lorsque vers la troisième heure de l’après-midi une agitation croissante commença à s’emparer des milliers de spectateurs. Tous les voisins de la loge richement décorée de tapis et de statues, où l’empereur Maxime était assis au milieu des officiers du palais, avaient été surpris d’y voir entrer un messager couvert de poussière et qui venait apparemment de mettre pied à terre après une furieuse galopade. À peine eut-il transmis ses nouvelles au monarque que, contre tous les usages, celui-ci se leva au moment le plus pathétique du jeu ; toute la cour le suivit avec la même hâte insolite, et bientôt les sièges réservés aux sénateurs et aux autres dignitaires se vidèrent à leur tour. Un départ aussi précipité ne pouvait pas se produire sans raison grave. En vain d’éclatantes fanfares annoncèrent-elles un nouveau combat de bêtes et un lion numide à crinière noire s’élança-t-il par la grille ouverte avec un sourd rugissement au-devant du glaive court des gladiateurs – une vague d’inquiétude surgissant dans l’écume blême des visages soucieux et interrogateurs, souleva irrésistiblement l’assistance anxieuse et y déferla en tous sens. On se levait, on se montrait les places vides des notables, on se questionnait, on faisait du tapage, on sifflait ; puis une nouvelle bouleversante, venue on ne sait d’où, se répandit soudain parmi les spectateurs : les Vandales, ces pirates redoutés de la Méditerranée, avaient débarqué à Portus avec une flotte considérable et marchaient déjà sur la ville insouciante. Les Vandales ! Ce mot d’abord chuchoté devint tout à coup une clameur retentissante poussée par des centaines et des milliers de poitrines, et parcourut les gradins de pierre du cirque : Les Barbares ! Les Barbares ! » Déjà la multitude, comme emportée par une bourrasque, se ruait vers la sortie. Ce fut la panique. Les gardes quittèrent leur poste et fuirent avec tout le monde ; on sautait par-dessus les sièges ; on se frayait un chemin à coups de poing et d’épée, on piétinait les femmes et les enfants qui poussaient des cris aigus. Devant les issues, se produisaient des remous d’où partaient des hurlements et des plaintes. En un instant le vaste ovale de marbre, où la minute d’avant quatre-vingt mille personnes formaient un bloc sombre et bruyant, fut complètement évacué. Silencieuses et désertes sous le soleil ardent, les arènes ressemblaient maintenant à une carrière abandonnée. Seul sur la piste – car les combattants avaient fui aussitôt avec les autres – le lion oublié, secouant sa crinière noire, rugissait d’un air de défi au milieu de cette solitude imprévue.
C’étaient bien les Vandales. Des messagers se succédant sans cesse répandaient à présent dans la ville des nouvelles de plus en plus alarmantes. Ces hommes vifs et énergiques montés sur des centaines de voiliers et de galères venaient de débarquer. Déjà les cavaliers numides et berbères accouraient avec leurs capes blanches sur la Via Portuensis de toute la vitesse de leurs étalons aux longs cous, précédant le gros de l’armée ; demain, après-demain la troupe des pillards serait aux portes de Rome, et rien n’était prêt pour la défense. Les mercenaires impériaux combattaient au loin, du côté de Ravenne ; les fortifications étaient en ruine depuis le passage d’Alaric Personne ne songeait à résister. Les riches et les hauts personnages faisaient apprêter en grande hâte mules et chariots pour sauver avec leur vie tout au moins une partie de leurs biens. Mais il était déjà trop tard. Le peuple ne souffrit pas que les grands le pressurent dans la prospérité pour l’abandonner dans l’adversité. Et quand Maxime, l’empereur, voulut s’enfuir du palais avec sa suite, il fut accueilli par une grêle d’injures et de pierres. Puis la populace irritée tomba sur ce poltron et massacra en pleine rue son pitoyable empereur, à coups de hache et de massue. On ferma les portes comme chaque soir ; mais la ville n’en fut que davantage prisonnière de la peur. Une affreuse appréhension pesait comme un brouillard lourd et malsain sur les maisons silencieuses et sans lumière, tandis que l’obscurité enveloppait d’un manteau étouffant la cité menacée qui frissonnait de terreur. Cependant, comme à l’ordinaire, les étoiles scintillaient au ciel, éternellement impassibles, et comme la veille, la lune tendait sa corne d’argent sur la voûte azurée. Rome, le cœur palpitant, veillait et attendait les Barbares comme le condamné qui, la tête posée sur le billot, s’apprête à recevoir le coup inévitable déjà suspendu au-dessus de sa tête.
Pendant ce temps, les Vandales s’avançaient lentement depuis le port, sûrement, méthodiquement, comme des triomphateurs sur la voie romaine déserte. Ces Germains aux longues tresses blondes marchaient en bon ordre, par centuries, au pas, en guerriers bien disciplinés. Devant eux, les auxiliaires du désert, les Numides à la peau brune et aux cheveux noirs comme de la poix, faisaient caracoler et virevolter impétueusement de magnifiques pur sang qu’ils montaient sans étriers. Genseric, le roi des Vandales, chevauchait au milieu de l’expédition. Du haut de sa selle, il souriait d’un air insouciant et satisfait à la vue de son peuple en marche. Le vieux guerrier expérimenté savait depuis longtemps par ses espions qu’il n’y avait pas de résistance sérieuse à craindre de la part des Romains et que cette fois il n’allait pas au-devant d’une bataille décisive, mais d’un butin facile. En effet aucun ennemi n’apparaissait. Seulement, devant la Porta Portuensis, à l’endroit où la route bien nivelée entre dans la ville, le pape Léon, paré de tous ses insignes et entouré de la troupe resplendissante de son clergé, se porta à la rencontre du roi. C’était ce même pontife, qui quelques années auparavant, avait obtenu du terrible Attila qu’il épargnât Rome ; car le païen à sa prière avait accédé avec une incompréhensible bonne grâce. Genseric descendit aussitôt de cheval en apercevant le majestueux vieillard à barbe blanche et s’avança vers lui, poliment, en boitant (son pied droit était trop court). Mais il ne baisa point la main ornée de l’anneau de saint Pierre ni ne plia dévotement le genou ; car c’était un Arien, hérétique, et il ne regardait le pape que comme l’usurpateur du christianisme. Il écouta avec un froid dédain la harangue en latin dans laquelle le saint père le conjurait de ménager la Cité sainte. Il fit répondre par son interprète qu’on se rassurât : on n’avait rien d’inhumain à redouter de lui ; il était lui-même un soldat et un chrétien. Il ne brûlerait ni ne détruirait Rome, bien que cette ville despotique en eût rasé des milliers d’autres. Dans sa magnanimité, il épargnerait même les biens de l’Église et les femmes, et il se contenterait de piller « sine ferro et ignei », selon le droit du vainqueur et du plus fort. Mais il invitait les autorités – et Genseric prononça ces mots d’un ton menaçant, tandis que son écuyer l’aidait déjà à se remettre en selle – à lui ouvrir les portes sans délai.
Les choses se passèrent comme Genseric l’avait exigé. Aucune lance ne fut brandie, les épées restèrent au fourreau. Une heure plus tard, Rome entière appartenait aux Vandales. Mais la troupe victorieuse des pirates ne se répandit pas à travers la ville sans défense comme une horde indisciplinée. Domptés par la main de fer du roi, ces grands et robustes guerriers aux cheveux de lin entrèrent en rangs serrés par la Via Triumphalis, en se contentant de jeter de temps à autre des yeux curieux sur ces milliers de statues aux yeux blancs dont les lèvres muettes semblaient leur promettre un riche butin. Aussitôt après, Genseric en personne se rendit au Palatinum, la demeure abandonnée de l’empereur. Mais ce ne fut pas pour y recevoir les hommages intéressés des sénateurs tremblants de crainte, ni pour y faire préparer un festin : c’est à peine s’il accorda un regard aux présents par lesquels la riche bourgeoisie espérait l’amadouer. Penché sur une carte, le rude soldat élabora immédiatement un plan qui lui permettrait de piller la ville rapidement et de fond en comble. Chaque district fut confié à une centurie et chaque centurion rendu responsable de la conduite de ses hommes. On assista alors non pas à une mise à sac furieuse et désordonnée, mais à une razzia calculée et organisée. Tout d’abord, sur l’ordre de Genseric, les portes furent fermées et gardées par des factionnaires, afin que pas une agrafe, pas une pièce, que rien dans l’immense cité ne lui échappât. Puis ses soldats réquisitionnèrent les embarcations, les véhicules, les bêtes de somme et des milliers d’esclaves pour transporter au plus vite, dans leur repaire d’Afrique, tout ce que Rome contenait de richesses. C’est alors seulement que le pillage commença, calme, systématique et conduit avec un grand sens pratique. Pendant treize jours, les Barbares dépouillèrent et morcelèrent la ville, commodément, savamment, comme un boucher dépèce un bœuf. Chaque centurie commandée par un prince vandale et accompagnée d’un scribe, allait de maison en maison, de temple en temple, et sortait tout ce qui s’y trouvait de précieux et de transportable : les vases d’or et d’argent, les colliers, pièces de monnaie, bijoux, les chaînes d’ambre du Nord, les fourrures de Transylvanie, la malachite du Pont et les épées forgées de Perse. On força des artisans à détacher avec précaution la mosaïque des murs des temples et à desceller les dalles de porphyre des péristyles. Tout fut exécuté avec prudence, adresse et précision. Des ouvriers descendirent les cintres de bronze des arcs de triomphe avec des cabestans pour ne pas les abîmer, on fit démonter tuile après tuile par des esclaves le toit doré du temple de Jupiter Capitolin, après avoir pillé l’intérieur de l’édifice. Genseric fit seulement scier ou briser à coups de marteau les colonnes d’airain, trop monumentales pour pouvoir être transportées rapidement, afin d’en prendre tout au moins le métal. Quand ils eurent vidé de fond en comble les demeures des vivants, les Vandales violèrent celles des morts, les tumuli. Leurs mains sacrilèges plongèrent dans les sarcophages de pierre et arrachèrent les peignes de diamant de la chevelure des princesses défuntes, et les bracelets d’or de leurs squelettes décharnés ; ils volèrent aux cadavres leurs miroirs métalliques et leurs chevalières ; leurs doigts avides s’emparèrent même de l’obole qu’on mettait dans la bouche des morts pour qu’ils pussent payer le nocher les transportant dans le royaume de Pluton. Le produit général des diverses rapines fut ensuite rassemblé en tas séparés à un endroit déterminé. La victoire aux ailes d’or y voisinait avec la châsse sertie de pierreries qui contenait les ossements d’un saint et les dés à jouer d’une grande dame. Des lingots d’or et d’argent s’empilaient près de tissus de pourpre, de la verrerie fine s’amoncelait à côté de métaux grossiers. Le scribe notait chaque chose en lettres runiques pleines de raideur sur un grand parchemin pour donner à cette spoliation une certaine apparence de légalité. Genseric en personne accompagné de sa suite circulait en boitant au milieu de ce chaos, touchait chaque objet de son bâton, examinait les bijoux, souriait et appréciait. Il regardait partir avec satisfaction les chariots, puis les embarcations, remplis jusqu’au bord. Pas une maison ne brûla, pas une goutte de sang ne fut versée. Régulièrement, sans heurt, comme des bennes qui montent et qui descendent dans une mine, deux files de voitures, l’une chargée, l’autre vide, voyagèrent pendant treize jours de là ville à la mer et de la mer à la ville. Bientôt les bœufs et les mulets haletèrent sous la charge : jamais de mémoire d’homme, avant ce sac des Vandales, on n’avait raflé pareil butin en si peu de temps.
Treize jours durant, on n’entendit plus le son de la voix humaine dans cette cité surpeuplée. Personne ne parlait haut, hormis les Vandales. Personne ne riait. Dans les maisons les lyres étaient muettes et on ne chantait plus dans les temples. On ne percevait que les coups de marteau qui déplaçaient ce qu’on avait toujours cru immuable, le fracas des blocs de pierre qui s’écroulaient, le grincement des chariots surchargés et le sourd mugissement des bêtes de trait harassées de fatigue, que les conducteurs fouettaient sans arrêt. Parfois les chiens, auxquels les hommes tremblant pour leur propre vie oubliaient de donner à manger, se mettaient à hurler ; parfois les notes graves d’une tuba retentissaient sur les remparts quand on relevait la garde. Mais les Romains calfeutrés chez eux retenaient leur souffle. La cité victorieuse de l’univers semblait avoir cessé de vivre, et quand le vent de la nuit s’engouffrait dans les ruelles désertes, on eût dit le gémissement étouffé d’un blessé qui sent son sang s’échapper jusqu’à la dernière goutte.
En ce treizième soir du pillage de Rome par les Vandales, sur la rive gauche du Tibre, à l’endroit où le fleuve jaune se replie paresseusement comme un serpent bien repu, la communauté juive s’était réunie dans la maison de Moïse Abthalion. Ce n’était pas un des grands de la communauté ni un connaisseur de la Loi, mais un vieil et rude artisan, et s’ils avaient choisi sa maison pour s’y rencontrer, c’est parce que son atelier au sol de terre battue était plus spacieux que leurs demeures exiguës et incommodes. Depuis treize jours, ils s’assemblaient ainsi quotidiennement, enveloppés dans leurs suaires blancs, avec des mines sombres, accablées, et ils priaient à l’ombre des volets clos parmi les rouleaux accrochés, les étoffes teintes et les cuveaux profonds, avec une obstination sourde et quasi machinale. Ils n’avaient pas encore eu jusque-là à souffrir des Vandales. Deux ou trois fois, des escouades, accompagnées de leurs chefs et de leurs scribes, s’étaient engagées dans l’étroite et laide rue aux Juifs, où à la suite de multiples inondations, l’humidité s’était installée entre les pierres des maisons et suintait à travers les murs des larmes froides. Un coup d’œil méprisant avait suffi à ces pillards pour reconnaître qu’on ne pourrait rien tirer de cette misère. Là, pas de brillants péristyles dallés de marbre, pas de tricliniums aux dorures éclatantes, ni statues ni vases de bronze. Ils étaient donc passés avec indifférence, et nulle razzia, nulle imposition n’était à craindre. Pourtant les cœurs des Juifs de Rome étaient affligés : un pressentiment alarmant les oppressait. Un malheur qui fondait sur la ville, sur le pays qu’ils habitaient – ils savaient cela depuis des générations – finissait toujours par rejaillir sur eux. Dans la prospérité, les peuples les oubliaient et ne s’occupaient pas d’eux. Les princes bâtissaient, faisaient des embellissements et vivaient dans le luxe, cependant que la plèbe prenait un plaisir grossier aux chasses et aux jeux. Mais quand une calamité survenait, on les en rendait responsables. Gare à eux si l’ennemi était victorieux, si une ville était mise à sac, si la peste ou quelque autre mal désolait une contrée ! Tous les maux de l’univers retombaient inévitablement sur eux, ils le savaient, et ils savaient aussi depuis longtemps qu’ils devaient accepter leur destin sans murmurer, car toujours et partout ils étaient peu nombreux, toujours et partout faibles et impuissants. Leur seule arme était la prière.
Les Juifs de Rome priaient donc chaque soir jusqu’à une heure avancée de la nuit, en ces temps sombres et périlleux du sac : que pouvait faire d’autre le Juste dans un monde inique et cruel, où la force triomphe éternellement, sinon se détourner du monde et se tourner vers Dieu ? C’était la même chose depuis des années et des années. Blonds ou bruns, tous avides de butin, les Barbares déferlaient tantôt du sud, tantôt de l’est et de l’ouest, et à peine une bande avait-elle passé qu’une autre lui succédait. Les impies se battaient dans tout l’univers et ne laissaient pas les hommes pieux en paix. Ils avaient pris Jeruscholajim, Babylone et Alexandrie ; maintenant c’était le tour de Rome. Où l’on voulait se reposer, régnait le tumulte, où l’on cherchait la tranquillité, on rencontrait la guerre : on ne pouvait éviter son destin. Ce n’était que dans la prière qu’on trouvait protection, quiétude et consolation en ce monde bouleversé. Car merveilleuse est la prière. Elle calme la peur, par sa promesse ; elle apaise l’âme terrifiée par la force de ses litanies ; elle élève vers Dieu la tristesse du cœur sur ses ailes bourdonnantes. C’est pourquoi il est bon de prier dans le malheur, et meilleur encore de prier ensemble, car toute douleur partagée s’allège et le bien plaît davantage à Dieu lorsqu’il est fait en commun.
Ainsi les Juifs de Rome étaient-ils rassemblés, et un pieux murmure s’échappait de leurs barbes, léger et continu comme sous les fenêtres le clapotis du Tibre, qui battait obstinément et sans violence les planches des lavoirs, ses flots caressant mollement les rives. Nul ne regardait son voisin et pourtant ils balançaient en cadence leurs vieilles épaules branlantes, tout en chantant et en marmonnant les mêmes psaumes qu’ils avaient déjà répétés des centaines et des milliers de fois, et que leurs pères et leurs grands-pères avaient ressassés avant eux. Leurs lèvres savaient à peine ce qu’elles disaient, leurs sens ce qu’ils ressentaient, ce bruit doux et plaintif semblait provenir d’un rêve confus.
Soudain ils tressaillirent ; les échines ployées se redressèrent toutes à la fois. Dehors le marteau venait de s’abattre avec fracas. Et les Juifs expatriés avaient déjà à cette époque une peur innée de tout ce qui était imprévu. Que pouvait-on attendre de bon d’une porte qui s’ouvrait la nuit ? Le murmure s’arrêta net, comme tranché par des ciseaux ; dans le silence, on perçut plus distinctement le gargouillis monotone et incessant de l’eau. Tous tendaient l’oreille, la gorge serrée. Le marteau retomba encore une fois, une main impatiente secoua la porte de la rue. « ’y vais », dit Abthalion comme s’il se parlait à lui-même, et il sortit sans bruit. Un violent courant d’air inclina fortement la flamme du cierge collé sur la table ; elle se mit tout à coup à frissonner très fort, comme le cœur de tous ces hommes.
Ils ne reprirent haleine qu’en reconnaissant le nouvel arrivant. C’était Hyrcanos ben Hillel, le trésorier des deniers impériaux, l’orgueil de la communauté, le seul Juif qui eût accès au palais. Il avait été autorisé par faveur spéciale de la Cour à demeurer de l’autre côté de Trastevere et à porter d’élégants vêtements de couleur ; mais en ce moment, son manteau était déchiré et son visage souillé.
Tous l’entourèrent, impatients de l’entendre, car ils devinaient qu’il apportait une nouvelle – et pourtant bouleversés d’avance par le malheur que son émotion laissait pressentir.
Hyrcanos ben Hillel respira profondément. On sentait que les mots étaient arrêtés dans son gosier et ne voulaient pas sortir. Enfin il gémit :
– C’en est fait ! ils l’ont pris, ils l’ont trouvé !
– Trouvé qui ? Trouvé quoi ? Ils haletaient bruyamment.
– Le chandelier ! La menorah ! À l’arrivée des Barbares, je l’avais dissimulé dans la cuisine sous la desserte. J’avais laissé exprès les autres objets sacrés dans le trésor : la table des pains de proposition, les trompettes d’argent, la verge d’Aaron et les encensoirs ; trop de domestiques en effet connaissaient nos richesses, pour que je pusse les cacher toutes. Il n’y avait qu’une seule chose que je désirais sauver parmi les pieux ustensiles du temple : le chandelier de Moïse, le candélabre de la maison de Schelomo, la menorah. Déjà, ils avaient tout ramassé, déjà ils avaient vidé la pièce et cessé leurs recherches ; déjà mon cœur se sentait rassuré à la pensée que nous conserverions au moins un de nos objets de sainteté. Mais un des esclaves (que son âme se dessèche !) m’avait vu le cacher et me trahit auprès des brigands pour racheter sa liberté. Il leur indiqua l’endroit ; ils le déterrèrent. Ils possèdent à présent tout ce qui se trouvait autrefois dans le Saint des Saints, dans la maison de Schelomo, l’autel et les vases, les tablettes sacerdotales et la menorah ! Aujourd’hui même, cette nuit, les Vandales emporteront le chandelier vers leurs navires.
Ils restèrent un moment sans voix. Puis des cris incohérents jaillirent de leurs lèvres blêmes :
– Le chandelier !… Encore !… Malheur !… La menorah !… Le flambeau de Dieu !… Malheur… Malheur !… Le candélabre de l’autel divin !… La menorah !
Les Juifs se cognaient les uns aux autres, titubant comme des ivrognes ; ils se frappaient la poitrine à coups de poing, se tenaient les hanches en geignant comme sous le coup d’une douleur physique. Ces vieillards pondérés vociféraient comme des gens subitement éblouis, aveuglés.
« Silence », commanda soudain une voix impérieuse. Tout le monde se tut aussitôt. Car celui qui avait lancé cet ordre était le chef de la communauté, le plus vieux, le plus sage d’entre eux, un docteur de l’Écriture, rabbi Eliezer, celui qu’ils appelaient « Kab ve Nake », c’est-à-dire le « Pur et Serein ». Il avait près de quatre-vingts ans et une barbe de neige encadrait son visage. Des pensées douloureuses avaient creusé sur son front de cruels sillons, mais sous ses sourcils touffus son œil était resté doux et limpide comme une étoile. Il leva la main – elle était étroite, jaune et ridée, comme les nombreux parchemins qu’elle avait écrits dans sa vie – et balaya l’espace d’un geste horizontal semblant vouloir chasser le bruit comme on chasse une fumée pernicieuse, et faire place nette pour des paroles sensées.
– Silence ! répéta-t-il. Les enfants crient dans le danger, les hommes réfléchissent. Asseyez-vous et délibérons. L’esprit est plus dispos lorsque le corps repose.
Confus, ils s’installèrent sur des bancs et des escabeaux. Rabbi Eliezer parla doucement, sans regarder personne ; on eût dit qu’il raisonnait avec lui-même :
« C’est un malheur, un très grand malheur ! Il y a longtemps qu’on nous les avait pris, les objets sacrés, et personne ne les a jamais vus dans le trésor impérial, excepté Hyrcanos ben Hillel. Toutefois nous les savions cachés là, tout près de nous, depuis Titus. L’exil nous semblait moins amer à la pensée que nos reliques, qui avaient tant voyagé à travers les siècles, qui avaient été à Babel et à Jeruscholajim et étaient toujours rentrées au bercail, se reposaient à présent, prisonnières certes, mais dans la même ville que nous. Nous n’avions pas le droit de déposer du pain sur l’autel, et pourtant nous pensions à lui toutes les fois que nous rompions notre pain. Il nous était interdit d’allumer le chandelier et cependant chaque fois que nous faisions de la lumière, nos pensées allaient à la menorah condamnée à l’obscurité et à l’isolement dans une maison étrangère. Les objets sacrés n’étaient plus en notre possession, mais nous les savions en lieu sûr et bien cachés. Et voilà qu’aujourd’hui le chandelier sacré va se remettre en route, non comme nous le croyions, pour regagner sa patrie, mais on l’emporte au loin, et qui peut savoir où… Cependant, ne nous lamentons pas. Les gémissements n’avancent à rien. Examinons ce qu’il faut faire. »
Les hommes l’écoutaient sans mot dire, le front penché. La main du vieillard n’avait cessé d’errer dans sa barbe, de haut en bas. Toujours comme en se parlant à lui-même, il continua :
« Le chandelier est en or pur et j’ai souvent cherché pourquoi Dieu avait voulu que notre présent fût aussi coûteux. Pourquoi a-t-il exigé de Moïse qu’il pesât si lourd, qu’il eût sept branches et fût décoré de fleurs et de guirlandes ciselées ? Je me suis parfois demandé si cela n’était pas un danger pour lui, car le mal vient éternellement de la richesse et les trésors attirent les voleurs. Mais je constate une fois de plus combien nos pensées sont frivoles, car tout ce que l’Éternel ordonne a une signification qui dépasse notre savoir et notre raison. Je comprends, à présent ! C’est seulement parce que nos reliques ont de la valeur qu’elles se sont conservées à travers les siècles. Si elles avaient été d’un métal vulgaire, les pillards les eussent brisées sans scrupule et en auraient fait des glaives ou des chaînes. Ils ne les ont gardées qu’en raison de leur prix, sans soupçonner leur sainteté. Un brigand les vole à un autre, personne n’ose les détruire et chacune de leurs pérégrinations les ramène à Dieu.





























