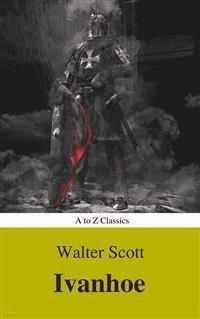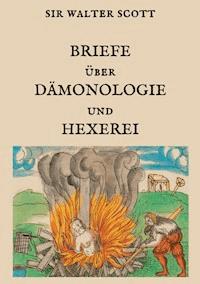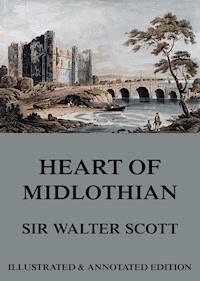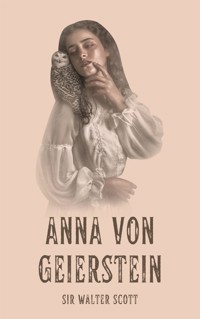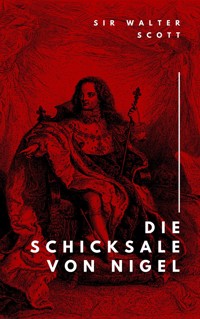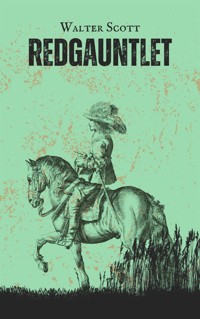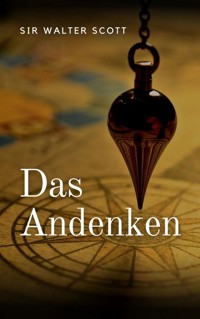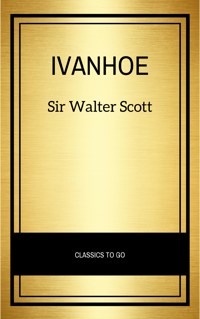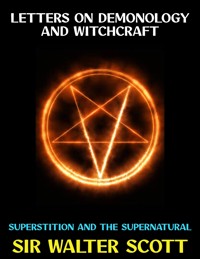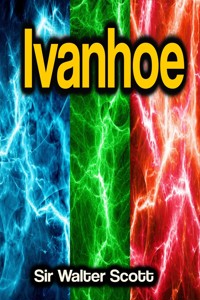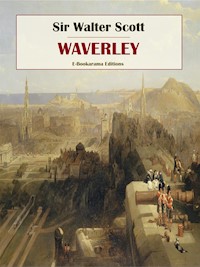18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Paru en 1831, "Le château dangereux" est un roman historique de l’auteur écossais Sir Walter Scott, son dernier roman, pour un ultime voyage à travers l’Écosse.
Inspiré d'un fait authentique, le récit se déroule en Écosse, dans le South Lanarkshire, durant la Première Guerre d’indépendance de l’Écosse. En 1306, le château de Douglas est défendu par sir John de Walton, assisté du jeune chevalier Aymer de Valence. Ils sont partisans du roi d’Angleterre, contre les forces commandées par Robert Bruce et sir James Douglas. Une noble et belle Anglaise, Augusta de Berkeley, promet sa fortune et sa main au chevalier qui tiendra le château un an et un jour. La dame, qui s'était réfugiée au château sous un déguisement, court le risque d’être traitée d’espionne par sir John. Elle est capturée par Douglas qui propose à sir John de l’échanger moyennant la reddition du château. Sir John est cruellement embarrassé lorsque survient heureusement l'ordre de rendre la place. Augusta de Berkeley sera quant à elle rendue à son amant...
Emprisonnements, combats, évasions, grimoires, fantômes, chevaliers sortis du brouillard… Voici le Moyen Âge flamboyant vu par Walter Scott ! Il y exalte un idéal chevaleresque et restitue avec une remarquable authenticité l’esprit et l’âme des Highlands en dépeignant la nature profonde de l’Écosse et de son peuple.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sir Walter Scott
Le château dangereux
table des matières
LE CHÂTEAU DANGEREUX
Chapitre 1. Les Deux Voyageurs.
Chapitre 2. Les Archers.
Chapitre 3. Le Ménestrel et le Chevalier.
Chapitre 4 L’Histoire
Chapitre 5. Thomas-le-Rimeur.
Chapitre 6. Mésintelligence.
Chapitre 7. La Chasse.
Chapitre 8. Le Ménestrel.
Chapitre 9. Le Fossoyeur.
Chapitre 10. Le Pèlerin.
Chapitre 11. Explication.
Chapitre 12 Le Billet.
Chapitre 13 Le Secret.
Chapitre 14. Le Chevalier de la tombe.
Chapitre 15. La Route.
Chapitre 16. Turnbull.
Chapitre 17. La Rencontre.
Chapitre 18. Les Prophéties.
Chapitre 19. Le Défi.
Chapitre 20. La Reddition du Château.
LE CHÂTEAU DANGEREUX
Sir Walter Scott
Lorsque je m’arrêtai près de la tour sans toiture, où la fleur sauvage parfume l’air humide, où le hibou se plaint dans son berceau de lierre, et dit l’heure de minuit à la clarté de la lune ; les vents dormaient, l’air était assoupi, les étoiles brillaient immobiles dans les cieux ; le renard hurlait sur la colline, et les échos lointains du vallon répétaient ses cris.
ROBERT BURNE
Chapitre 1. Les Deux Voyageurs.
On a vu des armées prendre la fuite à ce terrible nom : oui, le nom de Douglas mort a gagné des batailles.
John Home.
C’était à la fin d’un des premiers jours d’automne, où la nature, dans une froide province d’Ecosse, se réveillait de son sommeil de l’hiver, et où l’air du moins, sinon encore la végétation, donnait cette promesse d’un adoucissement dans la rigueur de la saison. On vit deux voyageurs dont l’apparence, à cette époque reculée, annonçait suffisamment la vie errante qui, en général, assurait un libre passage à travers un pays même dangereux. Ils venaient du sud-ouest, à peu de milles du château de Douglas, et faisaient route, à ce qu’il semblait, dans la direction de la rivière de ce nom, dont la petite vallée facilitait l’approche de cette fameuse forteresse féodale. Ce cours d’eau, petit en comparaison de l’étendue de sa renommée, servait comme d’égout aux campagnes du voisinage, et en même temps procurait les moyens d’arriver, quoique par une voie difficile, au village et au château. Les hauts-seigneurs à qui ce château avait appartenu durant des siècles auraient pu sans doute, s’ils l’avaient voulu, rendre cette route plus unie et plus commode ; mais ils n’avaient encore que bien peu brillé ces génies qui, par la suite, ont appris à tout le monde qu’il vaut mieux prendre le chemin le plus long en faisant un circuit autour du pied de la montagne, que la gravir en ligne droite d’un côté, et la descendre directement de l’autre, sans s’écarter d’un seul pas pour suivre un chemin plus aisé ; moins encore songeait-on à ces merveilles qui sont dernièrement sorties du cerveau de Mac Adam. Mais, à dire vrai, comment les anciens Douglas auraient-ils pu appliquer ses théories, quand même ils les eussent connues aussi perfectionnées qu’elles le sont aujourd’hui ? Les machines servant au transport des objets et munies de roues, excepté du genre le plus grossier et pour les plus simples opérations de l’agriculture, étaient absolument inconnues. La femme même la plus délicate n’avait pour toute ressource qu’un cheval, ou, en cas de grave indisposition, une litière. Les hommes se servaient de leurs membres vigoureux ou de robustes chevaux pour se transporter d’un lieu dans un autre ; et les voyageurs, les voyageuses particulièrement, n’éprouvaient pas de petites incommodités dans la nature raboteuse du pays. Parfois un torrent grossi leur barrait le passage et les forçait d’attendre que les eaux eussent diminué de violence. Souvent la rive d’une petite rivière était emportée par suite d’une tempête, d’une grande inondation ou de quelque autre convulsion de la nature ; et alors il fallait s’en remettre à sa connaissance des lieux, ou prendre les meilleures informations possibles pour diriger sa route de manière à surmonter des obstacles si terribles.
Le Douglas sort d’un amphithéâtre de montagnes qui bornent la vallée au sud-ouest, et c’est de leurs tributs ainsi qu’à l’aide des orages qu’il entretient son mince filet d’eau. L’aspect général du pays est le même que celui des collines pastorales du sud de l’Ecosse, formant comme d’ordinaire de pâles et sauvages métairies, dont la plupart ont été, à une époque encore plus éloignée de la date de cette histoire, recouvertes d’arbres, comme plusieurs d’entre elles l’attestent encore en portant le nom de Shaw, c’est-à-dire forêt naturelle. Sur les bords même du Douglas le terrain était plat, capable de produire d’abondantes moissons d’avoine et de seigle, et permettait aux habitans de tirer tout l’usage possible de ces productions. A peu de distance des bords de la rivière, si l’on en exceptait quelques endroits plus favorisés, le sol susceptible de culture était de plus en plus entrecoupé de prairies et de bois, qui, bois et prairies, venaient se terminer par de tristes marécages en partie inaccessibles.
C’était surtout une époque de guerre, et nécessairement il fallait bien que toute circonstance de simple commodité cédât au sentiment exclusif du péril ; c’est, pourquoi les habitans, au lieu de chercher à rendre meilleures les routes qui les mettaient en communication avec d’autres cantons, étaient charmés que les difficultés naturelles qui les entouraient ne les missent pas dans la nécessité de construire des fortifications, et d’empêcher qu’on arrivât chez eux des pays moins difficiles à parcourir. Leurs besoins, à peu d’exceptions près, étaient complétement satisfaits, comme nous l’avons déja dit, par les chétives productions qu’ils arrachaient par le travail et à leurs montagnes et à leurs holms, ces espèces de plaines leur permettant d’exercer leur agriculture bornée, tandis que les parties les moins ingrates des montagnes et les clairières des forêts leur offraient des pâturages pour leurs bestiaux de toute espèce. Comme les profondeurs de ces antiques forêts naturelles, qui n’avaient été pas même explorées jusqu’au fond, étaient rarement troublées, surtout depuis que les seigneurs du district avaient mis de côté, durant cette période guerrière, leur occupation jadis constante, la chasse, différentes sortes de gibier s’étaient considérablement multipliées, au point que, en traversant les parties les plus désertes du pays montagneux et triste que nous décrivons, on voyait parfois non seulement plusieurs variétés de daims, mais encore ces troupeaux sauvages particuliers à l’Ecosse, ainsi que d’autres animaux qui indiquaient la grossièreté et même la barbarie de l’époque. On surprenait fréquemment le chat sauvage dans les noirs ravins ou dans les halliers marécageux, et le loup, déja étranger aux districts plus populeux du Lothian, se maintenait dans cette contrée contre les empiétemens de l’homme, et était encore une terreur pour ceux qui ont fini par l’expulser complétement de leur île. Dans l’hiver surtout ces sauvages animaux (et l’hiver n’était encore qu’à peine écoulé) étaient ordinairement poussés par le manque de nourriture à une extrême hardiesse, et avaient coutume de fréquenter par bandes nombreuses les champs de bataille, les cimetières abandonnés, même quelquefois les habitations humaines, pour y guetter des enfans, proie, hélas ! sans défense, avec autant de familiarité que le renard s’aventure de nos jours à rôder autour du poulailler de la fermière.
De ce que nous avons dit, nos lecteurs, s’ils ont fait (car qui ne l’a point fait aujourd’hui ?) leur tour d’Ecosse, pourront se former une idée assez exacte de l’état sauvage où était encore la partie supérieure de la vallée de Douglas, pendant les premières années du XIV e siècle. Le soleil couchant jetait ses rayons dorés sur un pays marécageux qui présentait vers l’ouest des nappes d’eau plus larges, et était borné par les monts que l’on nommait le grand Cairntable et le petit. Le premier de ces deux monts était, pour ainsi dire, le père des montagnes du voisinage, source de plus de cent rivières, et sans contredit le plus élevé de toute la chaîne, conservant encore sur sa sombre crête et dans les ravins dont ses flancs étaient sillonnés, des restes considérables de ces antiques forêts dont toutes les éminences de cette contrée étaient jadis couvertes, et surtout les collines dans lesquelles les rivières, tant celles qui coulent vers l’est que celles qui s’en vont à l’ouest se décharger dans la Solway, cachent comme autant d’ermites leur source première et peu abondante.
Le paysage était encore éclairé par la réflexion du soleil couchant, tantôt renvoyé par des marais ou des cours d’eau, tantôt s’arrêtant sur d’énormes rochers grisâtres qui encombraient alors le sol, mais que le travail de l’agriculture a depuis fait disparaître, et tantôt se contentant de dorer les bords d’un ruisseau, prenant alors successivement une teinte grise, verte ou rougeâtre, suivant que le terrain lui-même présentait des rocs, du gazon et de la bruyère, ou formait de loin comme un rempart de porphyre d’un rouge foncé. Parfois aussi l’œil s’arrêtait sur la vaste étendue d’un marécage brunâtre et sombre, tandis que les jaunes rayons du soleil étaient renvoyés par un petit lac, avec une nappe d’eau claire, dont le brillant, comme celui des yeux dans la figure humaine, donne la vie et le mouvement à tous les traits d’alentour.
Le plus âgé et le plus robuste des deux voyageurs dont nous avons parlé était un homme bien et même richement habillé, par rapport aux modes du temps, et portait sur son dos, suivant la coutume des ménestrels ambulans, une caisse qui renfermait une petite harpe, une guitare, une viole ou quelque autre instrument de musique propre à l’accompagnement de la voix ; la caisse de cuir l’annonçait d’une manière incontestable, quoique sans indiquer la nature exacte de l’instrument. La couleur du pourpoint de ce voyageur était bleue, celle de ses chausses, ou culotte, était violette, avec des taillades qui montraient une doublure de même couleur que la jaquette. Un manteau aurait dû, suivant la coutume ordinaire, recouvrir ce costume, mais la chaleur du soleil, quoique la saison nouvelle fût encore si peu avancée, avait forcé le ménestrel de le plier aussi mince que possible, et d’en former un paquet long qu’il avait attaché autour de ses épaules, comme la redingote militaire des soldats d’infanterie de nos jours. La netteté avec laquelle ce manteau était arrangé dénotait la précision d’un voyageur qui connaissait depuis long-temps et par expérience toutes les ressources nécessaires contre les changemens de temps. Une grande quantité de rubans étroits ou aiguillettes, formant les ganses avec lesquelles nos ancêtres attachaient leur pourpoint et leurs chausses, constituait une espèce de cordon tout composé de nœuds, bleus et violets, qui entourait le corps du voyageur, et se trouvait ainsi correspondre pour la couleur avec les deux parties de l’habillement que ces cordons étaient destinés à réunir. La toque ordinairement portée avec ce riche costume était de l’espèce avec laquelle Henri VIII et son fils Edouard VI sont habituellement représentés. Elle était plus propre, vu la riche étoffe dont elle était faite, à briller dans un lieu public qu’à garantir d’un orage ou d’une averse. On y remarquait deux couleurs, car elle était composée de différentes taillades bleues et violettes ; et l’homme qui la portait, sans doute pour se donner un certain air de distinction, l’avait ornée d’une plume de dimension considérable, et aussi des couleurs favorites. Les traits au dessus desquels se balançait cette espèce de panache n’avaient absolument rien de remarquable pour l’expression ; cependant, dans un pays si triste que l’ouest de l’Ecosse, il aurait été difficile de passer près de cet individu sans lui accorder plus d’attention qu’il en aurait excitée si on l’eût rencontré dans un lieu où la nature du paysage aurait été plus propre à captiver les regards des passans.
Un œil vif, un air sociable qui semblait dire : « Oui, regardez-moi, je suis un homme qui vaut la peine d’être remarqué et qui mérite bien votre attention, » donnaient néanmoins de l’individu une idée qui pouvait être favorable ou défavorable, suivant le caractère des personnes que rencontrait le voyageur. Un chevalier ou un soldat aurait pu s’imaginer simplement qu’il avait rencontré un joyeux gaillard, bien capable de chanter une chanson, de conter une histoire un peu leste, et de boire sa part d’un flacon, doué enfin de toutes les qualités qui constituent un gai camarade d’hôtellerie, sinon que peut-être il ne mettait pas trop d’empressement à payer un écot. D’un autre côté, un ecclésiastique aurait trouvé que le personnage habillé de bleu et de violet avait des mœurs un peu trop relâchées, et ne savait pas assez contenir sa gaîté dans les justes bornes pour que sa compagnie pût convenir à un ministre des autels. Cependant on voyait sur la physionomie de l’homme de chant une certaine assurance, d’où il était permis de conclure qu’il n’aurait pas été plus déplacé dans des scènes sérieuses que dans des parties de plaisir. Un riche voyageur (et le nombre n’en était pas considérable à cette époque) aurait pu redouter en lui un voleur de profession, ou un homme capable de profiter de l’occasion pour devenir tel ; une femme aurait craint d’être maltraitée par lui, et un jeune homme, une personne timide, eût songé tout de suite à un meurtre ou à de coupables violences. Néanmoins, s’il ne portait pas d’armes cachées, le ménestrel était mal équipé pour entreprendre aucune voie de fait. Sa seule arme visible était un petit sabre recourbé, semblable à ce que nous appelons aujourd’hui un coutelas ; et l’époque aurait justifié tout le monde, si pacifiques que fussent les intentions, de s’armer ainsi contre les dangers de la route. Si un regard lancé à cet homme pouvait sous quelque rapport donner une mauvaise idée de lui à ceux qui le rencontraient en chemin, un coup d’œil jeté sur son compagnon, autant qu’il était possible de conjecturer quel il était, car son manteau lui cachait une partie du visage, aurait pleinement disculpé et même garanti son camarade.
Le plus jeune voyageur paraissait être de la première jeunesse, doux et gentil garçon, qui portait la robe d’Esclavonie, vêtement ordinaire du pèlerin, plus serrée autour de son corps que la rigueur du temps semblait l’exiger ou même le permettre. Sa figure, vue imparfaitement sous le capuchon de son costume de pèlerin, était prévenante au plus haut degré, et quoiqu’il portât aussi une épée, il était facile de voir que c’était plutôt pour se conformer à l’usage que pour s’en servir dans un but criminel. On pouvait remarquer des traces de chagrin sur son front, et de larmes sur ses joues ; telle était même sa tristesse, qu’elle semblait exciter la sympathie de son compagnon plus indifférent, qui d’ailleurs ressentait aussi sa part de la douleur qui laissait de pareilles traces sur une si aimable physionomie. Ils causaient ensemble, et, le plus âgé des deux, tout en prenant l’air respectueux qui convient à l’inférieur parlant à son supérieur, semblait, par le ton et les gestes, témoigner à son camarade de route autant d’intérêt que d’affection.
« Bertram, mon ami dit le jeune voyageur, de combien sommes-nous encore éloignés du château de Douglas ? Nous avons déja parcouru plus de trente milles ; et c’était là, disais-tu, la distance de Cammock au château… ou comment appelles-tu la dernière hôtellerie que nous avons quittée à la pointe du jour ?
– « Cumnock, ma très chère dame… Je vous demande dix mille fois pardon, mon gracieux jeune seigneur. »
« Appelle-moi Augustin, lui répliqua son camarade, si tu veux parler comme il convient le mieux pour le moment. »
« Oh ! pour ce qui est de cela, dit Bertram, si votre seigneurie peut condescendre jusqu’à mettre de côté sa qualité, mon savoir vivre ne m’est si solidement cousu au corps, que je ne puisse le quitter et le reprendre ensuite sans en perdre quelque lambeau ; et puisque votre seigneurie, à qui j’ai juré obéissance, a bien voulu m’ordonner que j’eusse à vous traiter comme mon pauvre fils, il serait honteux à moi de ne pas vous témoigner l’affection d’un père, d’autant plus que je puis bien jurer mes grands dieux que je vous dois des attentions toutes paternelles, quoique je n’ignore pas qu’entre nous deux ce soit le fils qui ait joué le rôle du père, le père qui ait été contenu par la tendresse et la libéralité du fils ; car quand est-ce que j’ai eu faim ou soif, et que la grande table de Berkely n’a point satisfait tous mes besoins ? »
« Je voudrais, répliqua la jeune personne, dont le costume de pèlerin était arrangé de manière à lui donner l’air d’un homme, je voudrais qu’il en eût toujours été ainsi. Mais que servent les montagnes de bœuf et les océans de beurre que produisent, dit-on, nos domaines, s’il y a un cœur affamé parmi nos vassaux, et surtout si c’est toi, Bertram, toi qui as servi pendant plus de trente ans comme ménestrel dans notre maison, qui dois éprouver un pareil mal ? »
« Assurément, madame, répondit Bertram, ce serait une catastrophe semblable à celle qu’on raconte du baron de Fastenough, lorsque sa dernière souris mourut de faim dans la papeterie même ; et si j’échappe à ce voyage sans une telle calamité, je me croirai pour le reste de ma vie hors d’atteinte de la soif ou de la faim. »
– « Tu as déja souffert une ou deux fois de pareils dangers, mon pauvre ami. »
– « Ce que j’ai pu souffrir jusqu’à présent n’est rien en comparaison ; et je serais un ingrat si je donnais un nom si sérieux à l’inconvénient de manquer un déjeûner ou d’arriver trop tard pour dîner. Mais je ne comprends pas en vérité que votre seigneurie puisse endurer si long-temps un accoutrement si lourd. Vous devez sentir aussi que ce n’est pas une plaisanterie que de voyager dans ces montagnes, dont les Ecossais nous donnent si bonne mesure dans leurs milles : et quant au château de Douglas, ma foi, il est encore éloigné de cinq milles environ, pour ne rien dire de ce qu’on appelle en Ecosse un bittock, ce qui équivaut bien a un mille de plus. »
« Il s’agit alors de savoir, dit la jeune personne en potassant un soupir, ce que nous ferons quand, après être venus de si loin, nous trouverons fermées les portes du château, car elles le seront bien avant notre arrivée. »
« J’en donnerais ma parole, répondit Bertram. Les portes de Douglas, confiées à la garde de sir John de Walton, ne s’ouvrent pas si aisément que celles de la dépense de notre château lorsqu’elles sont bien huilées ; et si votre seigneurie veut suivre mon conseil, nous retournerons vers le sud, et en deux jours au plus tard nous serons dans un pays où l’on peut satisfaire les besoins de son estomac dans le plus bref délai possible, comme le proclament toutes les enseignes des auberges ; et le secret de ce petit voyage ne sera connu de personne en ce monde que de nous, aussi vrai que je suis un ménestrel juré et un homme d’honneur. »
– « Je te remercie du conseil, mon honnête Bertram, mais je ne puis en profiter. Si ta connaissance de ce triste pays pouvait t’indiquer quelque maison décente, qu’elle appartînt à des gens riches ou pauvres, je m’y établirais volontiers ; si l’on voulait me le permettre, jusqu’à demain au matin. Les portes du château de Douglas seront alors ouvertes pour des étrangers d’une apparence aussi pacifique que la nôtre, et… et… je l’espère, nous trouverons bien le temps de faire à notre toilette les changemens qui pourront nous assurer un bon accueil, de passer le peigne dans nos cheveux, vous comprenez enfin. »
« Ah ! madame, s’il ne s’agissait pas de sir John de Walton, il me semble que je me hasarderais à vous répondre qu’une figure non lavée, une chevelure en désordre, et un air plus effronté que ne l’est d’ordinaire et que ne peut l’être celui de votre seigneurie, seraient un déguisement plus convenable pour le rôle de fils d’un ménestrel que vous désirez remplir dans la fête qui se prépare. »
– « Comment souffrez-vous en effet que vos jeunes élèves ; soient si malpropres et si effrontés, Bertram ? Quant à moi, je ne les imiterai pas en ce point ; et que sir John soit actuellement au château de Douglas ou n’y soit pas ; je me présenterai devant les soldats qui remplissent les honorables fonctions de portier, le visage propre et la chevelure quelque peu en ordre. Quant à m’en revenir sans avoir vu un château qui m’apparaît presque dans tous mes rêves… Bref, Bertram, tu peux t’en aller, mais je ne te suivrai pas. »
– « Et si jamais je quitte votre seigneurie dans une pareille situation, à présent surtout que votre fantaisie est presque satisfaite, il faudra que ce soit le diable lui-même, le diable en personne, ni plus ni moins, qui m’arrache de votre côté. Quant à un logement, il y a non loin d’ici la maison d’un certain Tom Dickson de Hazelside, une des plus honnêtes gens de la vallée, et qui, quoique simple cultivateur, occupait comme guerrier, lorsque j’étais dans ce pays, un rang aussi haut que tous les nobles gentilshommes qui combattaient autour de Douglas. »
– « Il est donc soldat ? »
– « Lorsque son pays, ou son seigneur, a besoin de son épée… et, à vrai dire, ils jouissent rarement des douceurs de la paix ; mais d’ailleurs il n’a d’ennemis que les loups qui viennent attaquer ses troupeaux. »
– « Mais n’oublie pas, mon fidèle guide, que le sang qui coule dans nos veines est anglais, et que par conséquent nous devons redouter tous ceux qui se proclament ennemis de la Croix-Rouge.
– « Que la foi de cet homme ne vous effraie pas. Vous pouvez vous fier à lui comme au plus digne chevalier et gentilhomme du monde. Il nous sera facile de le décider à nous recevoir avec un air ou une chanson ; et ceci peut vous rappeler que j’ai la résolution, pourvu que votre seigneurie le veuille bien, de temporiser un peu avec les Ecossais, pauvres gens qui aiment tant la musique et qui, n’eussent-ils qu’un sou d’argent, le donneraient volontiers pour encourager la gaie science ; je vous promets, dis-je, qu’ils nous accueilleront aussi bien que si nous étions nés sur leurs sauvages montagnes ; et pour toutes les commodités que pourra fournir la maison de Dickson, le fils de l’homme-joie, ma jolie maîtresse n’exprimera pas un désir en vain. Maintenant voulez-vous être assez bonne pour dire à votre ami dévoué, à votre père adoptif, ou plutôt à votre fidèle serviteur, à votre loyal guide, quel est votre bon plaisir dans cette affaire ?
– « Oh ! assurément nous accepterons l’hospitalité de l’Ecossais, puisque vous engagez votre parole de ménestrel que c’est un homme digne de confiance… Vous l’appelez Tom Dickson, n’est-ce pas ? »
– « Oui, tel est son nom ; et la vue de ce troupeau m’indique que nous sommes en ce moment sur ses propriétés. »
– « Vraiment ? dit la jeune femme avec quelque surprise ; et comment êtes-vous assez habile pour le savoir ? »
– « J’aperçois la première lettre de son nom marqué sur ces brebis. Ah ! le savoir est ce qui mène un homme par le monde, aussi bien que s’il avait l’anneau par la vertu duquel les vieux ménestrels disent qu’Adam comprenait le langage des bêtes dans le paradis. Ah ! madame, il y a plus d’esprit sous une blouse de berger que ne se l’imagine une dame qui coud deux morceaux de belle étoffe dans un pavillon d’été. »
– « Soit, bon Bertram. Et quoique je ne sois pas si profondément versée dans la connaissance du langage écrit que tu l’es, toi, il m’est impossible d’en reconnaître jamais l’utilité plus qu’en ce moment. Rendons-nous donc par le court chemin à la maison de Tom Dickson, que ce troupeau indique être dans le voisinage. J’espère que nous n’avons pas loin à aller, quoique l’idée de savoir que notre voyage est abrégé de quelques milles m’a tellement remise de ma fatigue, qu’il me semble que je pourrais faire le reste de la route en dansant. »
Chapitre 2. Les Archers.
Rosalinde. Eh bien ! voici la forêt des Ardennes.
Touchstone.Hélas ! à présent, que je suis dans les Ardennes, je suis plus insensé. Quand j’étais à la maison, j’étais dans un endroit meilleur ; mais des voyageurs doivent être toujours contens.
Rosalinde. Sois-le donc, bon Touchstone. Vois-tu, qui vient là ?… Un jeune homme et un vieux, d’un pas solennel.
SHAKSPEARE . Comme il vous plaira. Sc. IV, acte II.
Tandis que les voyageurs causaient ensemble, ils atteignirent un détour du sentier d’où le pays se développait plus au loin qu’au milieu des terrains brisés qu’ils avaient jusqu’alors parcourus. Une vallée à travers laquelle coulait un petit ruisseau tributaire présentait tous les traits sauvages, mais non déplaisans, d’un vallon solitaire et verdoyant, planté çà et là de bouquets d’aunes, de noisetiers et de chênes taillis, qui avaient maintenu leur position dans le creux de la vallée, quoiqu’ils eussent disparu des flancs plus rapides et plus exposés de la montagne. La ferme ou la maison seigneuriale (car, à en juger par la grandeur et l’apparence de l’édifice, ce pouvait être l’un ou l’autre) était un bâtiment large, mais bas, dont les murailles et les portes étaient assez solides pour résister à toutes les bandes de voleurs ordinaires. Il n’y avait rien pourtant qui pût la défendre contre une force majeure ; car, dans un pays ravagé par la guerre, le fermier était, alors comme aujourd’hui ; obligé de souffrir sa part des grands maux qui accompagnent un tel état de choses ; et sa condition, qui ne fut jamais digne d’envie, devenait bien pire encore en ce qu’elle ne présentait aucune sécurité. A un demi-mille plus loin environ, on voyait un bâtiment gothique de très petite étendue, d’où dépendait une chapelle presque ruinée : le ménestrel prétendait que c’était l’abbaye de Sainte-Bride. « Autant que je puis savoir, dit-il, on a toléré l’existence de ce couvent, de même qu’on permet à deux ou trois vieux moines ainsi qu’à autant de nonnes qui y demeurent d’y servir Dieu et quelquefois de donner asile à des voyageurs écossais. Ils ont en conséquence contracté des engagemens avec sir John de Walton, et accepté pour supérieur un ecclésiastique sur lequel il croit pouvoir compter. Mais quand il arrive aux voyageurs de laisser échapper quelques secrets, on croit qu’ils finissent toujours par arriver d’une manière ou d’une autre aux oreilles du gouverneur anglais : c’est pourquoi, à moins que votre seigneurie ne le veuille absolument, je pense que nous ferons bien de ne pas aller leur demander l’hospitalité. »
– « Certainement non, si tu peux me procurer un logement où nous aurons des hôtes plus discrets. »
En ce moment deux formes humaines furent vues s’approchant aussi de la ferme, mais dans une direction opposée à celle de nos deux voyageurs, et parlant si haut, car ils paraissaient se disputer, que le ménestrel et sa compagne purent distinguer les voix, quoique la distance fût considérable. Après avoir regardé quelques minutes en plaçant sa main au dessus de ses yeux, Bertram s’écria enfin : « Par Notre-Dame ! c’est mon vieil ami Tom Dickson, j’en suis sûr… Pourquoi donc est-il de si mauvaise humeur contre ce jeune garçon qui peut bien être, je crois, ce petit bambin éveillé, son fils Charles, qui ne faisait que courir et tresser du jonc, il y a quelque vingt ans ? Il est heureux néanmoins que nous trouvions nos amis dehors ; car, j’en réponds, Tom a une bonne pièce de bœuf dans sa marmite, avant de s’aller mettre au lit, et il faudrait qu’il eût bien changé pour qu’un vieil ami n’en eût point sa part ; et qui sait, si nous étions arrivés plus tard, à quelle heure ils pourraient avoir jugé convenable de tirer leurs verrous et de débarder leurs portes si près d’une garnison ennemie ? car, à donner aux choses leurs véritable nom, c’est ainsi qu’il faut appeler une garnison anglaise dans le château d’un noble écossais. »
« Imbécile, répliqua la jeune dame, tu juges sir John de Walton comme tu jugerais quelque grossier paysan pour qui l’occasion de faire ce qu’il veut est une tentation et une excuse de se montrer cruel et tyran. Mais je puis te donner ma parole que, laissant de côté la querelle des royaumes qui, bien entendu, se videra loyalement de part et d’autre sur des champs de bataille, tu reconnaîtras que les Anglais et les Ecossais, sur ce domaine et dans les limites de l’autorité de sir John de Walton, vivent ensemble comme fait ce troupeau de moutons et de chèvres sous un même chien : ennemi que ces animaux fuient en certaines occasions, mais autour duquel néanmoins ils viendraient aussitôt chercher protection si un loup venait à se montrer. »
« Ce n’est pas à votre seigneurie, répliqua Bertram, que je me permettrais d’exposer mon opinion sur ce point ; mais le jeune chevalier, lorsqu’il est recouvert des pieds à la tête de son armure, est bien différent du jeune homme qui se livre au plaisir dans un riche salon au milieu d’une réunion de belles ; et quand on soupe au coin du feu d’un autre, quand votre hôte de tous les hommes du monde se trouve être Douglas-le-Noir, on a raison de tenir ses yeux sur lui pendant qu’on fait son repas… Mais il vaudrait mieux que je cherchasse à nous procurer des vivres et un abri pour ce soir, que de rester ici à bâiller et à parler des affaires d’autrui. » A ces mots, il se mit à crier d’une voix de tonnerre : « Dickson ! holà ! hé ! Thomas Dickson ! ne veux-tu pas reconnaître un vieil ami qui est si bien disposé à mettre ton hospitalité à contribution pour son souper et son logement de la nuit ? »
L’Ecossais, dont l’attention fut excitée par ces cris, regarda d’abord le long de la rivière, puis il leva les yeux sur les flancs nus de la montagne, et enfin les abaissa sur les deux personnes qui en descendaient.
Comme trouvant la soirée trop froide lorsqu’il laissa la partie abritée du vallon pour aller à leur rencontre, le fermier du vallon de Douglas s’enveloppa plus étroitement dans le plaid grisâtre qui, dès une époque très reculée, avait été mis en usage par les bergers du sud de l’Ecosse, dont la forme donne un air romanesque aux paysans et aux classes moyennes, et qui, quoique moins brillant et moins fastueux de couleurs, est aussi pittoresque dans son arrangement que le manteau plus miliaire, le manteau de tartan des montagnards. Quand ils approchèrent l’un de l’autre, la dame put voir que l’ami de son guide était un homme vigoureux et athlétique, lequel avait déja passé le milieu de la vie et montrait des marques de l’approche mais non des infirmités de l’âge sur un visage qui avait été exposé à de nombreuses tempêtes. Des yeux vifs, qui semblaient tout observer, donnaient des signes de la vigilance dont avait acquis l’habitude un homme qui avait long-temps vécu dans un pays où il avait toujours eu besoin de regarder autour de lui avec précaution. Ses traits étaient encore gonflés de colère, et le beau jeune homme qui l’accompagnait paraissait aussi mécontent qu’un fils qui a reçu des preuves sévères de l’indignation paternelle, et qui, à en juger par la sombre expression mêlée à une apparence de honte sur sa physionomie, semblait en même temps dévoré de colère et de remords.
« Ne vous souvenez-vous pas de moi, mon vieil ami, demanda Bertram, lorsqu’ils furent assez près pour s’entendre ; ou les vingt années qui ont passé sur nos têtes depuis que nous nous sommes vus ont-elles emporté avec elles, tout souvenir de Bertram, le ménestrel anglais ? »
« En vérité, répondit l’Ecossais, ce n’est pas que je n’aie vu assez de vos compatriotes pour me souvenir de vous, et je n’ai jamais pu entendre quelqu’un d’entre eux siffler seulement,
Là ! maintenant le jour se lève,
sans songer à quelque air de votre joyeuse viole; et cependant faut-il que nous soyons bêtes pour que j’aie oublié jusqu’à la mine de mon vieil ami, et que je l’aie à peine reconnu de loin. Mais nous sommes en peine depuis un certain temps : il y a un millier de vos compatriotes qui tiennent garnison dans le château périlleux de Douglas qu’on aperçoit d’ici, aussi bien que dans d’autres places de la vallée, et ce n’est qu’un bien triste spectacle pour un véritable Ecossais… ma pauvre maison n’a pas même échappé à l’honneur d’une garnison d’hommes d’armes, outre deux ou trois coquins d’archers, un ou deux méchans galopins qu’on nomme pages, et gens de cette espèce, qui ne permettront jamais à un homme de dire : Ceci est à moi, même au coin de son propre feu. Ne prenez donc pas mauvaise opinion de moi, vieux camarade, si je vous fais accueil un peu plus froid que celui que vous auriez droit d’attendre d’un ami d’autrefois ; car, par Sainte-Bride de Douglas ! il me reste bien peu de chose avec quoi je puisse souhaiter la bienvenue… »
« Souhaitée avec peu, elle sera aussi bonne, répliqua Bertram. Mon fils, fais ta révérence au vieil ami de ton père. Augustin commence son apprentissage de mon joyeux métier, mais il aura besoin de quelque exercice avant de pouvoir en supporter les fatigues. Si vous pouvez lui faire donner quelque chose à manger, et lui procurer ensuite un lit où il pourra dormir en repos, nous aurons certainement tous les deux ce qu’il nous faut ; car j’ose dire que, quand vous voyagiez avec mon ami Charles dans ce pays, si ce grand jeune homme est bien ma connaissance Charles, vous n’aviez plus vous-même besoin de rien quand il avait ce qu’il lui fallait. »
« Oh ! que le diable m’emporte si je recommencerais à présent ! répliqua le fermier écossais ; je ne sais pas de quoi les garçons d’aujourd’hui sont faits… ce n’est pas de la même étoffe que leurs pères assurément… ils sont engendrés non de la bruyère qui ne craint ni vent ni pluie, mais de quelque plante délicate d’un pays lointain, qui ne poussera que si vous l’élevez sous un verre : la peste puisse la faire mourir ! Le brave seigneur de Douglas, dont j’ai été le compagnon d’armes (et je puis le prouver) ne désirait pas, du temps qu’il était page, d’être nourri et logé comme il faudrait que le fût aujourd’hui votre ami Charles pour être content. »
« Voyons, dit Bertram, ce n’est pas que mon Augustin soit délicat, mais, pour d’autres raisons, je vous prierai encore de lui donner un lit, et un lit séparé, car il a été dernièrement malade. »
« Oui, je comprends, répliqua Dickson, votre fils a un commencement de cette maladie qui se termine si souvent par cette mort noire dont vous mourez vous autres Anglais. Nous avons beaucoup entendu parler des ravages qu’elle a exercés dans le sud. Vient-elle par ici ? »
Bertram répondit affirmativement par un signe de tête.
« Eh bien, la maison de mon père, continua le fermier, a plus d’une chambre ; et votre fils en aura une des mieux aérées et des plus commodes. Quant au souper, vous mangerez votre part de celui qu’on a préparé pour vos compatriotes ; quoique je voudrais plutôt avoir leur chambre que leur compagnie ; mais, puisqu’il faut que j’en nourrisse une vingtaine, ils ne s’opposeront pas à la requête d’un aussi habile ménestrel que toi, demandant l’hospitalité pour une nuit. Je suis honteux de dire qu’il faut que je fasse ce qu’ils veulent dans ma propre maison. Ventrebleu ! si mon brave seigneur était en possession de ses biens, j’ai encore assez de cœur et de force pour les chasser tous de chez moi comme… comme… »
« Pour parler franchement, ajouta Bertram, comme cette bande d’Anglais vagabonds venus de Redesdale que je vous ai vu expulser de votre maison, telle qu’une portée de petits chiens aveugles, si bien qu’aucun d’entre eux ne retourna la tête pour voir qui leur faisait cette politesse, avant qu’ils ne fussent à mi-chemin de Cairntable. »
« Oui, répliqua l’Ecossais en se redressant et en grandissant d’au moins six pouces ; alors j’avais une maison à moi, un motif et un bras pour la défendre ; maintenant je suis… Qu’importe qui je sois ! le plus noble seigneur d’Ecosse est aussi à plaindre que moi. »
« Vraiment, mon ami, reprit Bertram, vous considérez maintenant la chose sous le juste point de vue. Je ne dis pas qu’en ce monde l’homme le plus sage, le plus riche ou le plus fort a le droit de tyranniser ses voisins, parce qu’il est le plus faible, le plus ignorant, le plus pauvre ; mais encore, s’il s’engage dans une pareille dispute, il faut qu’il se soumette au cours des choses : or, dans une bataille, ce sera toujours la richesse, la force, la science, qui triompheront. »
« Avec votre permission cependant, répondit Dickson, le parti le plus faible, s’il réunit tous ses efforts et tous ses moyens, peut à la longue exercer contre l’auteur de ses maux une vengeance qui le dédommagera du moins de sa soumission temporaire ; et il agit bien simplement comme homme, bien sottement comme Ecossais, soit qu’il endure ces injustices avec l’insensibilité d’un idiot, soit qu’il cherche à s’en venger avant que le temps marqué par le ciel soit arrivé… Mais si je vous parle ainsi, je vous empêcherai comme j’en ai déja empêché plusieurs de vos compatriotes, d’accepter une bouchée de pain et un logement pour la nuit dans une maison où vous pourriez ne vous éveiller au matin que pour vider avec du sang une querelle nationale. »
« Ne craignez rien, répliqua Bertram, il y a longtemps que nous nous connaissons, et je ne redoute pas plus de rencontrer de la haine dans votre maison que vous ne pensez à m’y voir venir dans l’intention d’aggraver encore les maux dont vous vous plaignez. »
« Soit ! c’est pourquoi vous êtes, mon vieil ami, le bienvenu dans ma demeure, tout comme quand les hôtes que j’y recevais jadis n’y entraient que sur mon invitation… Quant à vous, mon jeune ami monsieur Augustin, nous prendrons autant soin de vous que si vous arriviez avec un front serein et des joues roses, comme il convient mieux aux doctes de la gaie science.
« Mais pourquoi, si je puis vous faire cette question, dit Bertram, étiez-vous donc tout à l’heure si fâché contre mon jeune ami Charles ?
Le jeune homme répondit avant que son père eût le temps de parler, « Mon père, mon cher monsieur, peut colorer la chose comme bon lui semblera, toujours est-il que la tête des gens fins et sages faiblit beaucoup dans ces temps de troubles. Il a vu deux ou trois loups se jeter sur trois de nos plus beaux moutons, et, parce que j’ai crié pour donner l’alarme à la garnison anglaise, il s’est mis en colère contre moi, mais dans une colère a m’assassiner, parce que j’ai arraché ces pauvres bêtes, aux dents qui allaient les dévorer. »
« Voici une étrange histoire sur votre compte, mon vieil ami, dit Bertram. Etes-vous donc de connivence avec les loups pour qu’ils vous volent votre troupeau ? »
« Allons, parlons d’autre chose, si vous m’aimez vraiment, répondit le cultivateur. Cependant Charles aurait pu dans son récit se rapprocher un peu davantage de la vérité s’il avait voulu ; mais parlons d’autre chose. »
Le ménestrel s’apercevant que l’Ecossais était vexé et embarrassé d’une pareille anecdote, n’insista point davantage.
Au moment où ils passaient le seuil de la maison de Thomas Dickson, ils entendirent deux soldats anglais qui causaient à l’intérieur. « En repos, Anthony, disait une voix, en repos ! pour l’amour du sens commun, sinon des manières communes et des usages ; Robin Hood lui-même ne se mettait jamais à table avant que le rôti fût prêt. »
« Prêt ! répliqua une autre grosse voix ; c’est un rôti d’un méchant bout de viande, et encore ce coquin de Dickson ne nous aurait-il servi que petite part de sa méchante viande, si le digne sir John de Walton n’eût donné l’ordre exprès aux soldats qui occupent les avant-postes d’apporter à leurs camarades les provisions qui ne leur sont pas nécessaires pour leur propre subsistance. »
« Silence, Anthony, silence, gare à toi ! répliqua le compagnon ; car si jamais j’ai entendu venir notre hôte, je l’entends à présent : cesse donc de grogner, puisque notre capitaine, comme nous le savons tous, a défendu, sous des peines sévères, toute querelle entre ses hommes et les gens du pays.
« A coup sûr, répliqua Anthony, je n’ai rien fait qui puisse en occasionner une ; mais je voudrais être également certain des bonnes intentions de ce sombre Thomas Dickson à l’égard des soldats anglais, car je vais rarement me coucher dans cette maudite maison sans m’attendre à avoir la bouche aussi large ouverte qu’une huître altérée avant de me réveiller au lendemain. Le voilà qui vient cependant, ajouta Anthony en baissant de ton, et j’espère être excommunié s’il n’amène pas avec lui cet animal furieux, son fils Charles, avec deux autres étrangers dont la faim sera assez grande, j’en répondrais, pour avaler tout le souper, s’ils ne nous font pas d’autre mal. »
« Fi, fi donc Anthony ! murmura le camarade ; jamais archer meilleur que toi ne porta l’uniforme vert, et cependant tu affectes d’avoir peur de deux voyageurs fatigués, et tu t’alarmes de l’invasion que leur appétit pourra faire sur le repas du soir. Nous sommes quatre ou cinq de nous ici ; nous avons nos arcs et nos flèches à notre portée, et nous ne craignons pas que notre souper nous soit ravi ou que notre part nous soit disputée par une douzaine d’Ecossais établis ou vagabonds. Comment dites-vous ? ajouta-t-il en se tournant vers Dickson, que nous dites-vous donc, quartier-maître ? Vous savez bien que, d’après des ordres précis qui nous ont été donnés, nous devons nous enquérir du genre d’occupations des hôtes que vous pouvez recevoir outre nous, qui n’habitons pas votre maison de notre plein gré ; vous êtes aussi prêt pour le souper, je parie, que le souper l’est pour vous, et je vous retarderai seulement vous et mon ami Anthony, qui commence terriblement à s’impatienter, jusqu’à ce que vous répondiez aux deux ou trois questions d’usage. »
« Bande-l’arc, répondit Dickson, tu es un honnête garçon ; et quoiqu’il soit un peu dur d’avoir à conter l’histoire de ses amis, parce qu’ils viennent par hasard passer une nuit ou deux dans votre maison ; cependant je me soumettrai aux circonstances, et je ne ferai pas une inutile opposition. Vous noterez donc sur votre journal que voici, que, le quatorzième jour avant le dimanche des Rameaux, Thomas Dickson a amené dans sa maison d’Hazelside, où vous tenez garnison par ordre du gouverneur anglais sir John de Walton, deux étrangers auxquels ledit Thomas Dickson a promis des rafraîchissemens et un lit jusqu’au lendemain, s’il n’y a là rien d’illégitime. »
« Mais que sont-ils ces étrangers ? » demanda Anthony un peu vivement.
« Il ferait beau voir, murmura Thomas Dickson, qu’un honnête homme fût forcé de répondre à toutes les questions de tout méchant vaurien !… » Mais il changea de ton et continua. « Le plus âgé de mes hôtes se nomme Bertram, ancien ménestrel anglais, qui a mission particulière de se rendre au château de Douglas, et qui communiquera les nouvelles dont il est porteur à sir John de Walton lui-même. Je l’ai connu pendant vingt ans, et je n’ai jamais rien entendu dire sur son compte ; sinon que c’était un digne et brave homme. Le plus jeune étranger est son fils, à peine rétabli de la maladie anglaise qui a fait rage des pieds et des mains dans le West-Moreland et dans le Cumberland. »
« Dis-moi, demanda Bande-l’arc, ce même Bertram n’était-il pas depuis une année environ au service de quelque noble dame de votre pays ? »
« Je l’ai entendu dire, » répliqua Dickson.
« En ce cas, nous courrons, je pense, peu de risque, répartit Bande-l’arc, en permettant à ce vieillard et à son fils, de continuer leur route vers le château. »
« Vous êtes mon aîné en âge et en adresse, répliqua Anthony ; mais je puis vous rappeler que ce n’est pas tout-à-fait notre devoir que de laisser un jeune homme, qui a été si récemment attaqué d’une maladie contagieuse, pénétrer dans une garnison de mille hommes de tout rang ; et je doute si notre commandant n’aimerait pas mieux apprendre que Douglas-le-Noir, avec cent diables aussi noirs que lui, puisque telle est sa couleur, a pris possession de l’avant-poste d’Hazelside à coups de sabre et de hache d’armes, que de savoir qu’une personne infectée de cette maladie infernale est entrée paisiblement et par la porte grande ouverte du château. »
« Il y a quelque chose dans ce que tu dis là, Anthony, répliqua son camarade ; et considérant que notre gouverneur, puisqu’il s’est chargé de la maudite besogne de défendre un château qui est regardé comme beaucoup plus périlleux qu’aucun autre d’Ecosse, est devenu un des hommes les plus jaloux et les plus circonspects qui soient au monde, nous ferions mieux ; je crois, de l’informer du fait et de prendre ses ordres pour savoir ce qu’il nous faut faire de ce jeune garçon. »
« Me voilà content, dit l’archer ; et, d’abord, ce me semble, je voudrais un peu, afin de montrer que nous savons comment se pratiquent les choses en pareil cas, adresser certaines questions au jeune homme… combien de temps a duré sa maladie, par quels médecins il a été soigné, depuis quand il est guéri, et comment sa guérison peut être certifiée ? etc.