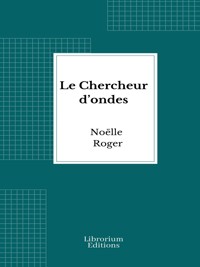
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Jean Lanouze posa sa plume, laissa tomber son front dans ses deux mains, ferma les yeux, puis se remit à écrire :
… Une force inconsciente que notre cerveau colore au passage de souvenirs, d’impressions, d’images ; une force organique qui se sert de l’intelligence, mais la domine et la précède… (Voir mon précédent roman, le Petit-Fils de Pascal…)
Et, s’interrompant de nouveau, il fit comparaître devant lui l’œuvre inachevée, conclusion d’une sorte de trilogie dans laquelle il avait étudié la personnalité humaine, vacillant et trouble complexe où l’instinct, l’hérédité, la pensée des autres laissent d’insaisissables apports… Quatre années de travaux, de réflexions, d’études psychologiques… il s’avouait n’être guère plus avancé qu’au premier jour.
Du moins posait-il des questions qu’un autre résoudrait peut-être quand la connaissance de l’homme aurait fait quelque progrès.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Noëlle Roger
LE CHERCHEUR D’ONDES
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385745912
PROLOGUE
Rien de bien ou de mal en ce monde qui ne soit l’ouvrage de la pensée.
Hamlet.
— Le témoin suivant, dit le président du tribunal.
Il y eut dans la salle bondée un frémissement de curiosité tandis que s’avançait une haute silhouette élégante ; les femmes se penchèrent comme attirées par cette tête brune, auréolée de gloire, et déjà se disputaient le profil net, un instant aperçu.
— Jean Lanouze, le romancier !
— Comme il est jeune !
— J’adore son dernier livre !
— Oui… mais vous savez bien ce que l’on raconte…
— Quoi donc ?
Le silence se rétablit et l’on écouta Jean Lanouze, immobile à la barre et qui prêtait serment de dire toute la vérité.
Son âge ? Vraiment il n’avait que trente-quatre ans ! Il avait couru le monde, écrit des romans sensationnels, fait la guerre ; ce jour-là, il portait ses rubans. Comment était-il mêlé à cette ténébreuse affaire qui passionnait tout Paris : l’assassinat d’un journaliste par un misérable placier en vin ?
— Quelles étaient vos relations avec l’accusé ? demanda le président.
La voix bien timbrée de Jean Lanouze répondit avec une fausse désinvolture :
— Il venait une fois ou deux par an prendre une commande.
— Depuis combien de temps le connaissiez-vous ?
— Depuis la guerre. Il servait dans la même compagnie que moi, en 15.
Lanouze n’ajouta pas qu’il avait guéri Bourlat un jour de cafard et qu’il s’était attaché à lui comme on s’attache à ceux qu’on a sauvés.
— Vous l’avez vu le jour du crime, spécifia le président ; vous rappelez-vous à quelle heure ?
— L’après-midi, vers 2 heures…
— Avez-vous remarqué en lui quelque chose d’insolite ?
— Pas le moins du monde.
— Pouvez-vous raconter votre conversation ?
— Il semblait abattu, ses affaires allaient mal. Il m’a dit avoir copié des adresses dans l’annuaire des gens de lettres, ouvert sur ma table, pendant qu’on m’appelait au téléphone. Je l’ai autorisé à se servir de ma recommandation : c’est tout.
— Avez-vous prononcé des noms ?
— Aucun.
— Vous a-t-il dit qu’il allait chez la victime en sortant de chez vous ?
— Non.
— Vous en êtes absolument sûr ?
Jean Lanouze, redressé, sembla grandir encore ; dans le silence haletant de l’auditoire, il déclara :
— Absolument. J’ignorais même qu’il eût pris l’adresse de Maurice Pacard.
— Je désire poser une question au témoin, intervint l’avocat de l’accusé. M. Jean Lanouze était-il en relations avec la victime ?
Lanouze se tourna vers lui et répondit :
— Lointaines.
— À l’heure où M. Jean Lanouze reçut la visite de mon client, il savait, sans doute, que Maurice Pacard l’avait accusé de plagiat ? Trois jours avant le crime, le Mercure publiait un long article prouvant que le dernier roman de M. Lanouze est le démarquage d’un roman tchécoslovaque inconnu. Peut-être M. Lanouze s’apprêtait-il à envoyer ses témoins à Maurice Pacard ?
— Cette question n’a rien à voir ici, répliqua le romancier avec hauteur.
L’avocat, soulevé sur son banc, poursuivait :
— M. Lanouze, dans sa préoccupation, a-t-il pu laisser échapper des paroles qu’il a oubliées ou même dont il n’aurait pas eu conscience ?
— Je suis certain que non.
— Je demande que mon client soit entendu, dit brusquement le défenseur.
Le public murmurait. Une telle insistance paraissait odieuse. D’ailleurs l’accusé n’avait jamais varié dans ses réponses. Une fois de plus, il répéta qu’il ne savait rien.
Il ignorait tout de l’affaire Pacard-Lanouze. Il ne savait pas pourquoi il était allé chez Maurice Pacard. Il avait marché dans la rue, il se souvint d’une adresse notée, monta trois étages. Il n’avait jamais vu M. Pacard et n’avait contre lui aucun grief : il ne savait pas pourquoi il avait déchargé son arme. C’était comme si quelqu’un d’autre agissait en lui, et il demeura stupéfait en face du cadavre… Il ne pouvait rien expliquer…
Une figure de malchanceux que la prison préventive avait déjà blêmie, une voix neutre, une expression d’absence, l’aspect d’un honnête homme trahi par la vie. Personne ne pouvait comprendre les raisons du meurtre ; ni le tribunal, ni les avocats, ni le jury, et lui, pas davantage. Maurice Pacard avait-il rudoyé le quémandeur ? Mais le placier n’avait même pas formulé d’offres. L’enquête établissait que le coup de feu fut tiré à l’instant même où Bourlat venait d’être introduit dans le bureau. La servante à peine refermait-elle la porte…
— Le témoin suivant, prononça le président du tribunal.
Assis à l’extrémité d’un banc, la tête penchée, Jean Lanouze écouta distraitement le juge et les avocats poser des questions oiseuses. Il eut l’impression d’étouffer dans cette salle surchauffée et le désir de s’en aller au grand air. Mais il se sentait rivé à sa place, étreint par une angoisse qu’il cherchait en vain à définir. Pour la centième fois, il s’affirmait à lui-même qu’il n’avait point parlé à Bourlat des vilenies que Pacard lançait sur son compte. D’ailleurs, même s’il avait parlé, pourquoi Bourlat se serait-il érigé en justicier ? Un homme soucieux, marié, qui entretenait difficilement son ménage… que lui importait une querelle de gens de lettres ! Lanouze se rappelait sa stupéfaction en ouvrant le journal du soir qui relatait le crime. Et tout de suite, il avait commencé à dévider la scène de leur entrevue, seconde par seconde, telle qu’il la revoyait maintenant dans un éclair, le tribunal aboli, le redoutable silence s’appesantissant en lui-même, et, dans ce silence, il faisait comparaître chacune des paroles qu’ils avaient échangées.
Son cabinet de travail, sa table et lui, Lanouze, au retour d’un week-end, lisant l’article infâme ; le flot de rage qui l’avait envahi… Plagiaire ! Une calomnie si habilement étayée trouverait mille échos chez les confrères jaloux ; il ne connaissait même pas cet ouvrage que Pacard l’accusait d’imiter. Et il se voyait honni, flétri : ne reste-t-il pas toujours quelque chose de telles accusations ? Et cela, au moment où il était sur le point d’obtenir le grand prix de littérature ; de se voir reconnu comme le premier des jeunes romanciers, chef d’école, toutes les revues ouvertes, sans parler des traductions et des films. Tout cela qui s’écroulait à cause d’un misérable envieux. Lanouze sentait sa haine autour de lui épaisse, compacte, il lui semblait qu’en étendant la main il pourrait la toucher. C’est à cet instant qu’il sortit du tiroir son revolver. Il allait s’exercer immédiatement, retrouver sa précision de tireur adroit, il exigerait un duel à mort. Et, comme il faisait jouer la gâchette, la porte s’ouvrit et son domestique introduisit Bourlat, « l’ancien soldat de Monsieur qui vient pour les commandes ». Lanouze machinalement laissa tomber les paroles d’usage ; il avait en face de lui une figure défaite, quelconque, inutile, qui n’arrivait pas à s’interposer entre lui et sa préoccupation. Bourlat parlait et Lanouze n’entendait pas ses phrases timides. « Alors, comme d’habitude, n’est-ce pas ? » Était-ce Bourlat, était-ce lui qui répétait ces mots ? Et puis, le téléphone dans la pièce à côté. Un ami l’appelant, lui apportant des condoléances où Lanouze discernait de l’ironie : « Non, vraiment ? tu ne connaissais pas le bouquin ? Tout de même il va fort ! Non, on ne peut pas laisser passer ça. »
Certaines gens ne manquent jamais l’occasion d’attiser la colère… Quand Lanouze rentra dans son cabinet de travail, il crut voir, à côté de Bourlat penché sur l’annuaire où lui-même venait de relever l’adresse de son ennemi, le faciès ricanant de Pacard ; Pacard multiplié par d’invisibles miroirs envahissait la chambre. Il y eut un silence où Lanouze entendait grincer la plume de Bourlat. Ah ! se délivrer de cet importun ! Il se rappelait avoir compté des billets et réglé la facture pour en finir, et puis il prononça : « Bonne chance ! » Et même il fut étonné du contraste entre cette parole bienveillante et son déchaînement intérieur. Enfin Bourlat était parti. Voilà. Il n’y avait rien de plus. Rien que l’affaire du revolver… ce revolver cherché en vain sur la table encombrée. Lanouze avait retourné le tapis, secoué les rideaux, par bonheur il n’appela pas le domestique. Dieu sait où il avait fourré ce revolver… Ce fut le soir qu’il comprit. Singulière ironie ! Son revolver braqué par un ignorant avait tué Pacard. Seulement, il préféra ne pas signaler ce détail à la justice. À force de vouloir de la clarté, elle arrive à tout embrouiller. Lanouze accusé d’avoir chargé un malheureux de sa vengeance, il ne manquait plus que cela !
La lecture du premier interrogatoire l’avait rassuré. Bourlat ne savait rien, ne se rappelait rien ; de sa visite à Lanouze il ne rapportait que l’accueil amical du romancier.
Restait la chose elle-même, suffisamment inexplicable. Le hasard, bien sûr… La première adresse notée… Et puis un coup de démence. Peut-être Pacard avait-il ricané en voyant l’intrus. Oui, mais Bourlat portait le revolver dans sa poche. Bourlat volant le revolver de Lanouze… Bourlat affirmant qu’il ne savait plus où il s’était procuré son arme…
Le romancier releva la tête ; il écartait de toute sa force l’idée qui s’infiltrait parfois en lui pendant ses nuits d’insomnie : une suggestion inconsciente ? Sa pensée inexprimée, se communiquant à un être sans volonté, une sorte de médium ? Inexprimée… Aurait-il prononcé à son insu le nom qui l’obsédait ? Il venait de jurer le contraire, de bonne foi… mais pouvons-nous jamais être sûr de nous-même ? D’ailleurs, le journal était là, déployé sur la table, le nom de Lanouze et le nom de Pacard s’affrontant. Comme il aurait été plus simple d’imaginer Bourlat vengeant celui qui l’avait sauvé !
Un soudain silence éveilla l’écrivain. L’attention de la salle refluait autour d’une jeune femme qui se tenait à la barre. Il distinguait un profil menu entre le feutre noir et le col de faux astrakan. Une voix claire jetait des mots indignés qui tombaient comme un viatique sur la forme accablée de Bourlat.
— Monsieur le président, c’est impossible que mon mari ait tué comme ça, de lui-même… Non, voyez-vous, je ne peux pas le croire… Un homme aussi doux, aussi rangé… En trois ans de ménage pas une mauvaise parole ! Si vous le voyiez avec sa fillette sur les genoux !
La voix nette vacilla. La main eut un geste balayant l’émotion. Et les arguments puérils continuèrent leur vaine ronde autour du fait incompréhensible.
Bourlat soulevé sur son banc ne quittait plus des yeux sa femme. Il semblait renaître parce qu’elle était là, avec ses chaudes inflexions, ses cheveux bruns frisant sur la nuque pâle que découvrait la fourrure impatiemment rejetée. Un instant elle se tourna vers lui, leurs regards se croisèrent. Lanouze eut la vision d’un pauvre bonheur qui allait s’effondrer.
Ainsi dans la médiocre existence de Bourlat il y avait cette revanche : il était aimé par cette femme, jolie et courageuse. Mystère des cœurs…
— Il est timide, monsieur le président, mais il en sait beaucoup plus qu’on ne pense… Il est d’une condition au-dessus de la mienne, et jamais il ne me l’a reproché. Bien sûr, ces derniers mois, les affaires allaient mal…
Le jury, ce jury parisien, si nerveux, si déconcertant parfois, se laisserait-il convaincre ? Un peu de bonne volonté suffirait pour absoudre.
Et Lanouze retomba dans sa propre misère. La silhouette noire accrochée à la barre avait disparu. Des voix inutiles continuaient d’ajouter des paroles.
Le tumulte brusquement déchaîné l’avertit que l’audience était levée.
Devant le Palais, Lanouze rencontra ses amis, les Gérard Daurelle, et il remarqua le masque souffrant de Gérard, ce visage blême, contracté de tics nerveux, tandis que la belle figure de Claudie, à ses côtés, resplendissait comme une lampe au chevet d’un malade. À cette minute, Gérard lui sembla condamné, plus proche de la mort peut-être que le misérable dont les hommes agitaient la destinée.
— Très curieux, ce cas, fit Daurelle en abordant le romancier.
— Mais quel ennui pour vous, cher ami, d’avoir été absurdement mêlé à tout cela ! se récria Claudie.
Lanouze serrait leurs mains, évitant de répondre, lorsque Gérard demanda :
— Ne t’arrive-t-il jamais de te sentir habité par la pensée d’un autre ?
Et il plongeait dans les yeux du romancier son étrange regard lucide de névropathe. Lanouze voulut plaisanter :
— Les miennes sont déjà trop lourdes pour moi !
— Oh ! Gérard, s’écria la jeune femme, ne sois habité que par ma pensée !
Et elle murmura un mot à son oreille. « Peut-elle encore aimer ce malade ? » songeait distraitement Lanouze.
Mais Gérard poursuivit, comme étranger à leur présence :
— Se sentir déposséder de soi-même par un autre plus puissant… Quelle impression étrange et douloureuse !
— Voudrais-tu insinuer, commença Lanouze, glacial, que Bourlat…
— Oh ! je n’insinue rien du tout, répliqua Gérard. Il a pu être impressionné, entre ta maison et celle de Maurice, par une affiche de cinéma, un geste, une menace surprise au vol, que sais-je ? et il a été conquis par une volonté étrangère.
— C’est un anormal, en ce cas ! s’écria sa femme.
— Oui… mais nous sommes tous des anormaux.
« Toi, spécialement », songeait Lanouze qui se hâtait de prendre congé.
Il marchait à grands pas le long des quais, la tête penchée, suivant le long du trottoir les jeux de la lumière et de l’ombre, s’efforçant de s’arracher à sa préoccupation. Comme on choisit un livre pour oublier un point névralgique, il appelait une image capable de le distraire ; il accueillit la figure de Claudie, telle qu’elle lui était apparue tout à l’heure, d’une fraîcheur si vive sous le réverbère. Il sourit et l’emporta dans son rêve. L’avait-il aimée autrefois sans le savoir, lorsqu’elle était l’amie d’une petite sœur qu’il devait perdre un peu plus tard ? Une jeune fille qu’on rencontre chaque jour et qui vous associe à ses délicats bonheurs… Il se souvenait de quelques-unes de ses robes et de cet éclat de rire qu’elle ne retrouvait plus. Il prêtait des livres, apportait des fleurs. Et puis, un soir, dans un bal, baissant ses yeux trop brillants, elle lui avait annoncé ses fiançailles avec Gérard. La souffrance qu’il éprouva l’avertit. Il fit un voyage en Suède, travailla, se crut immunisé. Aujourd’hui, il éprouvait pour elle une amitié attendrie et il traitait Gérard en frère plus jeune auquel il donnait parfois quelque rude conseil : s’abandonne-t-on ainsi à la neurasthénie !
Mais en vain Lanouze essayait de rapprocher des souvenirs flottants, des sentiments sans importance. Tout à coup il s’arrêta et s’appuya contre le mur du quai comme pris de vertige. Inutile de chercher des alibis. Inutile d’échapper plus longtemps à la question posée dans un affreux silence : « Si cet homme, demain, est condamné à mort, ne devrais-je pas intervenir ? demander des experts, des psychiatres ? savoir si de tels cas sont connus, classés ? parler du revolver en tout cas ? mon revolver que je n’ai pas voulu reconnaître et qui était là pour tuer Pacard et qui a peut-être conduit Bourlat… »
Il coupa violemment son monologue intérieur. « Divagations de romancier, voilà ce qu’ils diront. Avouer l’histoire du revolver ? Folie ! Les hommes ont coutume de transformer en mensonges les vérités obscures… »
Une voix en lui-même insistait : « Mais si Bourlat est condamné à mort… »
Il essuya la sueur froide inondant son front.
* * *
La même salle, le lendemain, plus énervée ; le masque de Bourlat noyé d’hébétude ; le réquisitoire ; ce substitut n’en finissait pas de réclamer la tête de l’accusé : l’ordre et la morale exigeaient que la société fût mise à l’abri d’un être dangereux qui, sous prétexte de placer sa marchandise, tuait à domicile…
« Il ne peut pas dire autre chose… » songeait Lanouze avec irritation.
Épuisé par sa nuit blanche, il sentait grandir son angoisse. La défense lui parut faible. Il aurait voulu plaider lui-même. Des périodes irrésistibles l’obsédaient. Comme il aurait su incriminer le hasard, cet agent secret de notre destin, et toujours prêt à nous trahir !
Soudain attentif, il entendit écarter la thèse d’une suggestion même involontaire, puisque M. Jean Lanouze et le prévenu s’accordaient à déclarer que le nom de Pacard n’avait pas été prononcé.
L’avocat, tourné vers le jury impassible, lui tendait à deux mains sa péroraison : il offrait l’aveu spontané, les ternes vertus de son client, cette pauvre existence qui n’avait pas de tache. De période en période, revenait le mot de « circonstance atténuante ». Lanouze crispait ses poings contre son visage : « Mais il faut réclamer l’acquittement, voyons ! »
L’audience suspendue, il alla fumer une cigarette le long du quai, revint, traversa comme un automate la salle des pas perdus retentissant de vaines paroles.
Et puis le verdict : les circonstances atténuantes accordées ; Bourlat s’en tirait avec dix ans de travaux forcés.
Lanouze s’éclipsa, évitant les rencontres et même les Gérard Daurelle qui le cherchaient. Il avait besoin de contempler sa délivrance…
« Obtenir la grâce. Je connais un peu le directeur des grâces. Je lui ferai comprendre… Il faut que Bourlat bénéficie de cette obscurité. »
Réfugié dans son cabinet de travail, il prit un livre au hasard, Shakespeare, justement, le meilleur des toniques. Il lisait sans comprendre les mots lorsqu’une phrase tout à coup s’éclaira d’une lumière inattendue : « Rien de bien ou de mal en ce monde qui ne soit l’ouvrage de la pensée… »
Lanouze laissa tomber le livre et il rêvait, le front dans sa main :
« La pensée… ma pensée… qui a fait de moi un meurtrier involontaire… peut-être. »
I
Je ne sais d’où me viennent ces pensées, ni comment elles m’arrivent, ma volonté n’y est pour rien.
Mozart.
… La pensée, interprète clairvoyant de nos instincts sourds, aveugles, muets…
Jean Lanouze posa sa plume, laissa tomber son front dans ses deux mains, ferma les yeux, puis se remit à écrire :
… Une force inconsciente que notre cerveau colore au passage de souvenirs, d’impressions, d’images ; une force organique qui se sert de l’intelligence, mais la domine et la précède… (Voir mon précédent roman, le Petit-Fils de Pascal…)
Et, s’interrompant de nouveau, il fit comparaître devant lui l’œuvre inachevée, conclusion d’une sorte de trilogie dans laquelle il avait étudié la personnalité humaine, vacillant et trouble complexe où l’instinct, l’hérédité, la pensée des autres laissent d’insaisissables apports… Quatre années de travaux, de réflexions, d’études psychologiques… il s’avouait n’être guère plus avancé qu’au premier jour.
Du moins posait-il des questions qu’un autre résoudrait peut-être quand la connaissance de l’homme aurait fait quelque progrès.
Peut-être l’avenir verrait-il en Lanouze un précurseur. Il avait renoncé aux romans à scandale et à succès de ses brillants débuts, il était devenu le romancier grave, apprécié par une élite et que le grand public ignore, et cela, depuis… depuis qu’une question abominable s’était posée devant sa conscience. Une question insoluble d’ailleurs. Il eut un geste pour l’écarter – le même geste inutile recommencé depuis quatre ans… depuis l’affaire.
Il avait revu Bourlat, gracié, réfugié dans sa province ; une maisonnette, un jardin, le sourire de la femme qui disait : « Je savais bien qu’il n’était pas coupable ! » Aux questions de Lanouze il avait répondu avec une sincérité évidente. Il ne se rappelait rien. Une sorte de ténèbres l’avaient envahi pendant des heures, des jours. En vain le romancier voulut-il vérifier cette puissance incompréhensible qu’il s’accusait d’avoir détenue. Mais Bourlat s’avérait rebelle à toute suggestion.
Et Lanouze avait beau concentrer sa pensée, il n’arrivait même pas à obtenir que son valet de chambre se retournât… Il savait désormais que rien n’est clair en ce monde alors que l’esprit est assoiffé de clarté.
Quatre ans… Avait-il été heureux tout ce temps-là, avec cet inconnu qu’il portait au fond de lui-même ? Son travail, son amitié pour Claudie… Une amitié qui devenait plus active depuis que Gérard essayait de guérir sa neurasthénie dans les cliniques et passait d’une cure d’isolement à une cure d’altitude. Sous prétexte de distraire Claudie, Lanouze montait chez elle à l’heure du thé. Il lui faisait la lecture des pages achevées, il guettait une approbation silencieuse et le fugitif éclat des yeux noirs lorsqu’il découvrait dans le parterre coloré de ses phrases une fleur éclose exprès pour elle. Il l’écoutait dire à voix basse : « Comme c’est vrai ! » Elle avait une façon de se taire qui permettait aux paroles de prolonger leurs résonances intérieures. Il n’osait pas lui avouer : « Ma pensée se réfléchit dans la vôtre… » De loin en loin, elle consentait à venir chez lui, quelques instants, pour choisir un livre. Mais, ces jours-là, Claudie, plus lointaine, semblait amener avec elle la présence invisible de Gérard à qui elle dédiait son sourire.





























