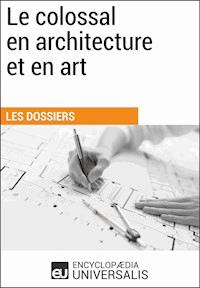
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La racine indo-européenne
kol désigne, selon les linguistes, un élément fiché en terre, dressé comme un pilier. Le mot grec
kolossos est employé par Hérodote pour désigner les statues égyptiennes, debout ou assises, les jambes serrées, les bras le long du corps et donc plus ou moins assimilables à des piliers par leur silhouette semblable à celle d'une momie. Composante fondamentale de l'imagination humaine, le colossal fascine et repousse à la fois. Il exprime tour à tour l’ambition poussée jusqu’à la mégalomanie de l'artiste et celle des empires ou des régimes, souvent totalitaires, qui utilisent ses services. Hors des normes, il exalte l'individu et l'opprime d’un même mouvement.
Ce
Dossier Universalis, composé d’articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis, rend compte de ces aspects multiples, des alignements de Carnac à la Grande Muraille de Chine en passant par Saint-Pierre de Rome et l’île de Pâques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782341002103
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Kaspars Grinvalds/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans ce dossier, consacré au Colossal en architecture et en art, publié par Encyclopædia Universalis.
Vous pouvez accéder simplement aux articles de ce dossier à partir de la Table des matières.Pour une recherche plus ciblée, utilisez l’Index, qui analyse avec précision le contenu des articles et multiplie les accès aux sujets traités.
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
Le colossal en architecture et en art
La racine indo-européenne kol désigne, selon les linguistes, un élément fiché en terre, dressé comme un pilier.
Le mot grec kolossos est employé par Hérodote pour désigner les statues égyptiennes, debout ou assises, les jambes serrées, les bras le long du corps et donc plus ou moins assimilables à des piliers par leur silhouette semblable à celle d’une momie. Il désigne aussi les statues confectionnées pour remplacer un défunt (idée du double d’une personne), pour marquer le seuil d’une demeure (idée d’un lien entre l’extérieur et l’intérieur) ou pour garantir l’alliance entre une colonie et la cité mère.
Composante fondamentale de l’imagination humaine, le colossal fascine et repousse à la fois. Il exprime tour à tour l’ambition poussée jusqu’à la mégalomanie de l’artiste et celle des empires ou des régimes, souvent totalitaires, qui utilisent ses services. Hors des normes, il exalte l’individu et l’opprime d’un même mouvement. Ce dossier, composé d’articles empruntés au fonds de l’Encyclopædia Universalis, rend compte de ces aspects multiples, des alignements de Carnac à la Grande Muraille de Chine en passant par Saint-Pierre de Rome et l’île de Pâques.
E.U.
ABU SIMBEL
De tous les sites de la Nubie égyptienne (ou basse Nubie), celui d’Abu Simbel (déformation d’Ibsamboul qui était son nom au XIXe siècle) est certainement le plus connu. Son sauvetage spectaculaire, réalisé sous les auspices de l’U.N.E.S.C.O. lors de la construction du grand barrage d’Assouan (Saad el-Aali), lui a conféré une notoriété supplémentaire.
Abu Simbel : le site et les deux temples. Plan du site d'Abu Simbel et des deux temples.
• Le site
À environ 280 km au sud d’Assouan, sur la rive gauche du Nil, Ramsès II, qui fut un grand bâtisseur en Égypte et en Nubie (Beit el-Wali, Gerf Hussein, Wadi es-Sebua, El-Derr et Akhsha portent son nom), a choisi un double éperon rocheux pour tailler dans le grès deux temples consacrés à sa gloire et à celle de l’une de ses épouses, Nefertari, dont nous connaissons la tombe creusée dans la vallée des Reines à Thèbes. L’architecture religieuse en Nubie, telle qu’elle fleurit sous la XIXe dynastie tout particulièrement, a des caractéristiques propres qui, sans être inconnues en Égypte même, n’y sont que rarement présentes. Les temples nubiens sont en effet des hémi-spéos, c’est-à-dire des édifices partiellement creusés dans le roc et partiellement construits (salle hypostyle et avant-cour) ou, comme dans le cas d’Abu Simbel, de véritables spéos ou hypogées entièrement taillés dans le rocher.
Le site est mentionné pour la première fois en 1813 par le voyageur suisse Ludwig Burckhardt, et le grand temple est ouvert en 1817 par l’archéologue et aventurier italien Belzoni qui a pénétré avec difficulté dans un monument très largement ensablé. Le site d’Abu Simbel semble avoir été choisi par Ramsès II lui-même, car on n’y a retrouvé aucune trace d’occupation antérieure. Les temples ont vraisemblablement été construits vers l’an 30 du règne du pharaon.
• Le grand temple
Le plus méridional des deux édifices, et aussi le plus grand, a été consacré par Ramsès II au dieu Rê-Horakhty ainsi qu’à la forme divinisée du roi lui-même, et porte le simple nom de « Maison de Ramsès aimé d’Amon ». Il est orienté vers l’est de manière telle que, deux fois par an, aux équinoxes, les rayons du soleil levant, pénétrant dans le temple par l’étroite porte d’entrée, venaient frapper de face et éclairer les statues au fond du naos.
La porte d’accès au temenos permet de pénétrer dans l’avant-cour, puis sur la terrasse, tandis que le niveau du sol s’élève graduellement. La façade de grès rose est large de près de 40 mètres et haute d’une trentaine de mètres. Elle culmine au-dessus du niveau de la mer de près de 200 mètres, ayant été rehaussée d’une soixantaine de mètres environ après le déplacement des temples. De part et d’autre de l’étroite porte d’entrée, quatre gigantesques colosses de Ramsès II assis, d’une vingtaine de mètres de hauteur et taillés dans le roc, gardent l’accès de l’édifice. En dépit de leur monumentalité, les colosses sont d’une exécution parfaite. Le roi, vêtu d’un pagne, mains posées sur les genoux, coiffé du némès surmonté du pschent (réunion de la couronne rouge de Basse-Égypte et de la couronne blanche de Haute-Égypte) est flanqué de membres de sa famille : sa mère, la reine Touy, la grande épouse Nefertari et quelques-uns de ses nombreux enfants. Sur les colosses sud, on notera la présence de nombreux graffiti dont un en grec, laissés par des mercenaires de l’armée de Psammétique II, conduite par les généraux Potasimto et Amasis, qui guerroya en Nubie. Une niche surmonte la porte, dans laquelle le dieu Rê-Horakhty à tête de faucon et corps d’homme, tenant le sceptre ouser et accompagné de la déesse Maât, représente, sous forme de cryptogramme, le prénom du roi : Ousermaâtrê. Au sommet de la façade, vingt-deux cynocéphales, disposés en frise, adressent une adoration perpétuelle au soleil levant auquel ils font face.
On pénètre ensuite dans une salle souterraine qui remplace la cour à ciel ouvert des temples de type classique. Le plafond en est maintenu par deux rangées de quatre piliers carrés de type osiriaque auxquels sont adossées de part et d’autre de l’allée centrale les statues d’Osiris momifié à l’effigie de Ramsès tandis que les trois autres faces sont occupées par les images des dieux majeurs du panthéon ramesside. Sur les parois de la salle sont gravées des scènes rituelles, mais aussi des faits de guerre. Ainsi, la paroi nord a été entièrement consacrée à l’épisode célèbre de la bataille de Kadech qui vit s’affronter, en l’an 5 du règne de Ramsès II, les Égyptiens aux Hittites et à leurs alliés de Syro-Palestine. Cette bataille, pour n’être pas décisive, eut néanmoins des conséquences historiques importantes puisque la paix fut conclue entre les anciens ennemis, paix qui sera même scellée plus tard par un mariage entre Ramsès II et une fille du souverain hittite ; une stèle à l’extérieur du temple commémore l’événement. Ce récit de la bataille de Kadech, gravé à la gloire du souverain, est d’une exceptionnelle richesse de détails et tout à la fois d’une sûreté et d’une rapidité de trait qui sont les caractéristiques de l’art ramesside à son apogée. Cette même bataille prendra l’allure d’un poème épique sous la plume du scribe Pentaour et sera gravée sur les parois de plusieurs temples, en Égypte même (à Abydos, Karnak, Louxor, au Ramesseum).
L’hypogée est prolongé par une deuxième salle, l’hypostyle, soutenue par quatre piliers carrés, ornés des représentations du roi et des dieux. Sur les murs, des scènes rituelles nous montrent le roi, désormais accompagné de la reine Nefertari, dans l’exercice du culte, en particulier l’adoration de la barque divine (sur les parois nord et sud). Après avoir traversé un vestibule, on accède à la dernière salle, le saint des saints. À la différence des temples construits, elle ne contenait pas de naos destiné à abriter l’image du dieu. Quatre statues sont taillées à même le roc dans la paroi du fond, elles représentent Ptah, Amon-Rê, Ramsès II lui-même et Rê-Horakhty : le roi s’est fait portraiturer à l’égal des trois dieux majeurs de l’empire, adorés dans les temples de Memphis, Karnak et Héliopolis, et objets de la vénération officielle, et s’est ainsi divinisé. De cette manière, il était amené – lui ou son substitut en la personne du prêtre officiant – à se rendre à lui-même un culte de son vivant. Un pas était franchi dans la conception de la divinité du pharaon, non pas en tant qu’individu mais comme détenteur d’une charge qui faisait de lui un dieu et non plus le fils d’un dieu. Au milieu de la salle subsiste le socle qui supportait jadis la barque divine portative abritant les effigies des dieux. Pour compléter la description, on mentionnera encore les différentes salles latérales utilisées comme magasins ; une chapelle rupestre au sud du temple qui servit de reposoir pour la barque et enfin, au nord de la terrasse, une petite cour à ciel ouvert destinée au culte solaire qui contenait quatre cynocéphales en adoration, flanqués de deux obélisques, un petit naos protégeant un scarabée et un cynocéphale, images du dieu Khépri et du dieu Thot ; tout ce mobilier est conservé aujourd’hui au musée du Caire.
Ramsès II faisant des offrandes à Horus. Ramsès II faisant des offrandes à Horus. Relief peint. XIXe dynastie. Grand temple dédié à Horus et Ramsès II. Abu Simbel, Égypte. (H. Champollion/ AKG)
• Le petit temple
À cent cinquante mètres environ au nord du grand temple s’ouvre, vers l’est, le temple consacré à Hathor, dame d’Ibchek (aujourd’hui Faras) et à la reine Nefertari. Il est généralement connu sous le nom de petit temple, par opposition au précédent, et dénommé en égyptien « Nefertari pour qui se lève Rê-(Horakhty) ». Il obéit aux mêmes principes que son voisin puisqu’il est aussi la transposition rupestre d’un temple bâti à l’air libre. La façade, plus petite, est ornée de six statues colossales taillées dans les renfoncements ménagés entre sept contreforts inclinés en talus. Ces colosses atteignent une dizaine de mètres de hauteur ; ceux qui flanquent la porte et ceux des extrémités représentent Ramsès II, debout cette fois. Ils encadrent les deux statues centrales de la reine, debout, dans l’attitude de la marche, vêtue et coiffée à l’image de la déesse Hathor ; sa lourde perruque surmontée de cornes de vache enserre le disque solaire surmonté de deux hautes plumes. Le roi est entouré de ses fils, la reine de ses filles. L’hypogée est d’une superficie plus réduite et présente un plan simplifié par rapport à celui du grand temple.
On pénètre d’abord dans une salle hypostyle soutenue par huit piliers carrés dont les chapiteaux figurent le visage d’Hathor, reproduit quatre fois. Dans ce temple féminin, les divinités invoquées sont avant tout des déesses : Hathor, la dame des lieux, Satis, Anoukis, Ourethekaou et Mout. De part et d’autre de la porte, on retrouve la scène traditionnelle de l’exécution d’un prisonnier par le roi ; mais ici, exceptionnellement, la reine y assiste. Les autres scènes nous montrent le roi ou la reine accomplissant des offrandes rituelles devant les déesses.
Une triple porte donne accès à un vestibule plus large que profond, prolongé par des salles latérales non décorées. Le vestibule est décoré du même genre de scènes que la salle hypostyle ; y figure en outre la déification de la reine par les deux déesses, Hathor et Isis.
L’hypogée s’achève par le sanctuaire ; sur le mur de fond est figurée la vache Hathor, représentée de face en ronde bosse, sortant du rocher ; l’image du roi est placée devant son poitrail, thème caractéristique des sanctuaires hathoriques (Deir el-Bahari par exemple). Sur la paroi nord, Ramsès II offre l’encens devant le roi et la reine divinisés, c’est-à-dire lui-même et son épouse, tandis que, symétriquement, Nefertari accomplit le même geste devant les déesses Mout et Hathor.
Les deux temples ont ainsi été construits à la gloire non seulement du dieu soleil Rê-Horakhty et de la déesse Hathor qui joue le rôle de parèdre, mais aussi à celle du roi et de la reine qui reçoivent un culte de leur vivant, selon des principes théologiques qui prennent tout leur développement sous le règne de Ramsès II.
Les temples d’Abu Simbel, mis en péril par la construction du grand barrage d’Assouan, furent, avec les autres temples de basse Nubie, l’objet d’une vaste campagne de sauvetage internationale, dirigée par l’U.N.E.S.C.O. à la demande de l’Égypte et qui se déroula de 1963 à 1968. Le déplacement des deux temples, qui présentait des difficultés considérables, fut indubitablement une grande prouesse technique. Le sommet des collines ayant été arasé, on commença par renforcer la pierre, trop friable, dans laquelle étaient creusés les temples avant de les découper en 1 036 blocs, dont certains pesaient jusqu’à 30 tonnes. Ces blocs ayant été numérotés et stockés, on procéda ensuite à la reconstruction des monuments, en respectant leur orientation primitive et leur position respective, quelque 60 mètres plus haut, hors d’atteinte des eaux. Chacun des temples a été protégé par une superstructure de béton voûtée, dissimulée par les collines qui ont été reconstituées. On retrouve ainsi aujourd’hui le même paysage que jadis.
Christiane M. ZIVIE-COCHE
ACROPOLE D’ATHÈNES
Presque toute ville grecque est composée de deux éléments que la configuration du site distingue d’emblée : ville haute et ville basse – celle-ci vouée à l’habitat et aux activités civiles et commerciales ; celle-là, l’acropole, réservée à la défense et aux dieux protecteurs de la cité. Cette dissociation topographique des fonctions, qui ne s’est faite souvent que très lentement, s’observe très tôt dans le cas exceptionnel de l’Acropole par excellence : celle d’Athènes.
• L’Acropole préhistorique et mycénienne
Des buttes rocheuses dont le chapelet s’égrène du nord au sud dans l’ample cuvette que circonscrivent l’Hymette, le Pentélique et le Parnès, l’Acropole, avec son plateau artificiellement agrandi de 27 000 mètres carrés qui culmine à 156 mètres, n’est ni la plus haute ni la plus vaste. Sans doute est-ce aux deux sources qui la flanquent, au sud (Asclépieion) et au nord-ouest (Clepsydra), qu’elle dut d’être probablement habitée dès 5000 avant J.-C. environ : bien qu’aucune trace d’occupation de cette époque n’ait pu être recueillie sur le rocher même en raison des aménagements ultérieurs, l’existence d’un habitat du néolithique récent est attestée dans ses parages. Durant le IIe millénaire avant J.-C., marqué par l’installation en Grèce des peuplades indo-européennes qui constitueront sa population jusqu’au terme de l’Antiquité, les traces d’occupation autour de l’Acropole restent d’abord ténues : tessons de l’Helladique ancien (2200-1900) dans les grottes du flanc sud ; puits et tombe de l’Helladique moyen (1900-1600), toujours sur le flanc sud. Mais il faut attendre la civilisation mycénienne (Helladique récent : 1550-1050) pour que l’Acropole entre vraiment dans l’histoire : entre 1250 et 1200 est construite autour du plateau une imposante muraille en appareil cyclopéen, de 3 à 4 mètres d’épaisseur, qui donne au site la configuration qu’il conserveraI), sauf du côté sud, où des travaux de terrassement ultérieurs élargiront encore le plateau.
Pré-Parthénon et Parthénon d'Ictinos. Le Pré-Parthénon inachevé (a) et le patrhénon d'Ictinos (b). D'après J. Travlos, Bidlexikon zur Tpopographie des antiken Athen, V. Ernst Wasmuth, Tübingen, 1971.
Acropole d'Athènes de l'époque préhistorique au IIe siècle. Acropole d'Athènes. I. L'Acropole préhistorique et mycénienne. II. L'Acropole vers 500 avant J.-C. III. L'Acropole au iie siècle après J.-C. V. Ernst Wasmuth, Tübingen, 1971 (d'après J. Travlos, « Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen »).
L’entrée principale se trouve à l’ouest, du seul côté où le rocher soit aisément accessible, tandis que le flanc sud est agrandi par des terrassements qui accentuent la forte déclivité du terrain ; à l’est et au nord, le rempart mycénien s’établit au-dessus de l’à-pic du rocher dominant la zone où s’établira à l’époque archaïque un nouveau centre politique : l’agora. Qu’abritait cette muraille, sur laquelle se greffait à l’ouest une enceinte basse, dite Pelargicon, comparable à celle de l’acropole de Tirynthe ? L’analogie avec les grands sites mycéniens voudrait que ç’ait été un palais – résidence des rois dont les légendes locales conservaient encore à l’époque classique la mémoire très vivace. C’est le plus valeureux d’entre eux, Thésée, pourfendeur de monstres à l’instar d’Héraclès, qui aurait réuni sous son autorité toutes les bourgades avoisinantes, unifiant ainsi l’Attique au profit d’Athènes. Mais, de ce palais mycénien, absolument rien ne subsiste : tout au plus peut-on considérer comme son accès particulier la rampe coudée qu’on observe encore sur le flanc nord, devant la façade est de l’Érechthéion. Cette disparition radicale est d’autant plus étonnante qu’Athènes semble avoir été moins touchée par la catastrophe de 1200 avant J.-C. que la plupart des grands sites mycéniens. Une preuve indirecte de l’existence de ce palais serait toutefois fournie par les cultes chthoniens qui se perpétueront dans la zone nord du plateau : un arbre sacré dans une cour, une chapelle dont la crypte abrite un serpent sacré ne sont pas impossibles dans un palais mycénien. Vestige plus tangible de cette première phase monumentale, un passage dérobé, aménagé dans une faille naturelle du rocher, sur sa face nord-ouest, permettait d’atteindre un puits situé à 25 mètres sous le niveau du plateau fortifié ; ainsi la citadelle était assurée de ne point manquer d’eau, préoccupation qu’on retrouve dans toutes les forteresses mycéniennes. Enfin, devant la grande entrée ouest, dont le dispositif est impossible à restituer, se dressait, sur un piton rocheux qui deviendra le bastion d’Athéna Nikè, un petit sanctuaire rupestre.
• L’Acropole géométrique et archaïque
On ignore comment cette Acropole mycénienne, capitale d’une petite principauté, périclita entre 1200 et 1000. À en juger par les tombes submycéniennes et protogéométriques trouvées entre l’Aréopage et l’Éridanos, il n’y a pas eu solution de continuité à Athènes : le site n’a pas cessé d’être habité, mais la royauté centralisatrice a dû disparaître, et avec elle les bâtiments de l’Acropole qui la symbolisaient, tandis que les cultes anciens subsistaient. Ainsi s’esquisse, durant les siècles obscurs de l’époque géométrique (1100-700), une Acropole désormais réservée aux grands cultes de la cité, tandis que le pouvoir politique qui l’a désertée s’établit dans la basse ville. L’architecture balbutiante de cette époque n’a guère laissé de traces : deux cubes de pôros, inclus dans les fondations du « Vieux Temple » d’Athéna, ont été parfois interprétés comme les fondations du porche d’entrée d’un édicule absidal, premier abri de la statue de culte d’Athéna : le xoanon en bois d’olivier tombé du ciel, statue-pieu primitive, parée chaque année de nouveaux atours qui lui donnaient une allure plus humaine. En tout cas, l’existence d’un sanctuaire important est attestée par les fragments de chaudrons votifs trouvés sur l’Acropole : dans les figurines décorant puis étayant les anses s’affirme vite, durant le VIIIe siècle, le sens plastique des artisans bronziers d’Athènes, à qui l’on attribue désormais l’invention de ces figures d’appui, dont certaines comptent parmi les plus anciennes représentations mythologiques (Thésée et le Minotaure).
Ce n’est qu’avec le Vieux Temple d’Athéna – ainsi désigné dans les inscriptions qui consignent la comptabilité des constructions du Ve siècle – que l’Acropole reprend forme pour nous. Sur le plateau sacré, toujours ceint de la muraille mycénienne, se dresse à la fin du VIIe siècle avant J.-C. un grand temple dorique, dont les fondations sont visibles entre l’Érechthéion et le ParthénonII). Le plan qu’on y lit est singulier : au lieu de la longue chambre habituelle (cella) abritant la statue de culte, comprise à l’est et à l’ouest entre deux vestibules plus ou moins profonds (pronaos et opisthodome), on trouve à l’est une cella courte, la partie ouest du temple étant divisée en trois pièces. Cette disposition, qui sera reprise par l’Érechthéion, est dictée par la volonté d’abriter sous un même toit les différents cultes installés dans cette zone depuis l’époque mycénienne. L’ampleur de ce bâtiment dorique (43,15 m × 21,30 m) atteste la rapidité de la mutation qu’a connue l’architecture grecque durant la seconde moitié du VIIe siècle. Depuis les études de W. Dörpfeld (1885-1890), le Vieux Temple est au centre de discussions toujours ranimées : que faut-il lui attribuer, parmi les fragments d’architecture et de sculpture retrouvés sur le plateau, notamment dans la fosse située entre le Parthénon et le musée actuel ? Question complexe et capitale, car ces fragments sont trop nombreux pour un seul bâtiment. Selon la thèse formulée par W. Dinsmoor en 1947 et communément admise depuis, selon laquelle aurait existé à l’emplacement du futur Parthénon un autre temple, datant du VIe siècle, c’est ce temple, que rien n’atteste sur le terrain, qui serait désigné dans une inscription sous le nom de Hecatompedon, c’est-à-dire « temple de cent pieds ». Cette thèse a été récusée par Immo Beyer : il n’y aurait eu qu’un temple archaïque sur l’Acropole, mais trois fois remanié pour l’accorder à l’évolution très rapide du goût et des techniques. Dans une première phase, antérieure à 625, le temple aurait eu une colonnade en bois, remplacée vers 600 par une colonnade en pôros de 6 × 12 colonnes, ce qui rendrait compte de la particularité sur laquelle Dörpfeld fondait lui aussi l’idée de deux phases de construction : les fondations des murs sont en calcaire de l’Acropole, tandis que ceux de la colonnade qui les entoure sont en calcaire de Cara. À ces deux phases correspondraient également des sculptures tympanales différentes : à la première, le groupe de la lionne déchirant un taureau ; à la seconde, à l’ouest, le groupe de deux lions déchirant un taureau flanqué à gauche d’Héraclès luttant contre Triton, monstre marin dont la queue de dauphin meuble l’angle du fronton, tandis que l’angle droit est occupé tout entier par un autre monstre anguipède à triple tête humaine, à l’expression d’ailleurs débonnaire ; à l’est, le groupe central manquant serait flanqué à droite d’une scène mythologique : l’introduction d’Héraclès dans l’Olympe en présence d’Athéna, sa protectrice. Cette solution, qui a l’élégance économe de la vérité, est étayée par des rapprochements stylistiques très précis avec les représentations céramiques contemporaines, qui permettent de supposer un écart chronologique d’une génération entre les deux groupes lion-taureau, le premier imité d’un modèle hittite, le second d’un modèle assyrien. Le caractère composite des frontons de la seconde phase, où voisinent les deux registres nouveaux de l’iconographie du VIIe siècle : le bestiaire symbolique emprunté à l’Orient et la geste des dieux et des héros, qui se fixe au même moment dans les poèmes homériques, ne doit pas surprendre ; un peu plus tard, vers 590, on l’observe également au fronton du temple d’Artémis à Corfou. Quoi qu’il en soit, ces fragments, d’un calcaire tendre qui appelle la polychromie et la retient plus que le marbre, sont pour nous les plus précieux témoins de la sculpture grecque à ses débuts, lorsque, échappant au petit format de la sculpture de bois et de bronze du début du VIIe siècle, elle se risque, avec la fougue et la fantaisie qui caractérisent l’époque, à des dimensions et à des matériaux nouveaux, tout en restant fidèle au vif bariolage de ses origines. De cette bigarrure étonnante, qui ne laisse pas d’offusquer le goût moderne, d’autres fragments un peu plus récents témoignent également : compositions tympanales de beaucoup plus modestes dimensions, qu’il faut replacer au fronton de ces chapelles votives qu’on appelle des trésors. Trois d’entre elles sont assez bien conservées : le « fronton de l’Hydre » (vers 590), où Héraclès est représenté aux prises avec l’hydre de Lerne, tandis que le crabe gigantesque dépêché par Héra pour venir en aide au monstre en difficulté occupe l’angle gauche ; le « fronton rouge » (vers 570), où Héraclès, comme au fronton du Vieux Temple, lutte avec Triton ; le « fronton de l’olivier », enfin (vers 570), où apparaissent à la fois, chose unique, un édifice et un élément de nature qui ont permis à certains d’y reconnaître Achille épiant Troïlos, le plus jeune fils de Priam, qu’il va mettre à mort. Rien ne subsiste au sol de ces trésors, qu’on a supposés récemment dressés dans un « enclos de cent pieds » (Hecatompedon) qui aurait occupé, au sud du Vieux Temple, l’emplacement du futur Parthénon.
Pré-Parthénon et Parthénon d'Ictinos. Le Pré-Parthénon inachevé (a) et le patrhénon d'Ictinos (b). D'après J. Travlos, Bidlexikon zur Tpopographie des antiken Athen, V. Ernst Wasmuth, Tübingen, 1971.
Durant la tyrannie de Pisistrate et de ses fils (560-510), l’Acropole redevint le siège du pouvoir politique : le tyran y résidait sous la protection de sa garde personnelle. Comme dans bien d’autres cités au VIe siècle, la tyrannie ne fut pas à Athènes une période d’oppression farouche, mais plutôt, entre l’oligarchie du VIIe et la démocratie du Ve siècle, un détour par le despotisme éclairé, qui réduisit l’influence des grands propriétaires terriens au profit des classes laborieuses : petits paysans et artisans qui commencent à exporter. Une politique de grands travaux et d’« animation culturelle » renforce l’assise sociale de ce régime : Pisistrate fonde les Grandes Dionysies, dans le cadre desquelles le théâtre va se développer au flanc sud de l’Acropole, et donne à la fête ancienne d’Athéna Polias (protectrice de la cité) l’éclat et la solennité d’une véritable fête nationale, à laquelle prend part toute la communauté athénienne : les Grandes Panathénées célébrées depuis 566 avant J.-C., après divers concours dont le prix est constitué par l’huile des oliviers sacrés contenue dans des amphores « panathénaïques » d’un type particulier, culminent avec une procession à laquelle participent tous les corps constitués. Partant du Dipylon (la Porte double), elle traverse l’agora et gagne l’Acropole où les jeunes filles remettent à Athéna le nouveau péplos brodé qu’elles ont tissé pour sa statue de culte ; une hécatombe (« sacrifice de cent bœufs ») réunit enfin autour de l’autel situé en face du Vieux Temple, à l’est, tous les participants, qui s’en partagent les dépouilles.
La prospérité croissante d’Athènes durant la seconde moitié du VIe siècle trouve son écho sur l’Acropole. Vers 520, le fronton est du Vieux Temple reçoit un nouveau décor sculpté qui marque l’évolution des techniques et du goût ; la juxtaposition de motifs orientalisants – monstres et animaux sauvages – et de scènes mythologiques est remplacée par une composition dramatique unique dont la valeur symbolique est évidente : la lutte des dieux contre les géants, sculptée désormais dans le marbre, occupe tout l’espace tympanal, donnant lieu à des recherches plastiques nouvelles dans les attitudes et le rendu de la musculature ; presque au centre, égide déployée, Athéna terrassant un géant justifie son surnom de Promachos, « qui combat au premier rang ». Parallèlement, le plateau sacré se pare d’ex-voto de toutes sortes, surtout des statues de jeunes filles, les corés. Profanées en 480 par les envahisseurs perses, elles ont été retrouvées au nord-ouest de l’Érechthéion, pieusement déposées dans une fosse. Certaines, qui ne restèrent exposées que peu de temps, ont conservé en partie leurs vives couleurs. En dépit d’une virtuosité qui confine à la facticité durant le dernier quart du VIe





























