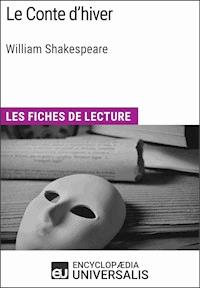
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encyclopaedia Universalis
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis
Le Conte d’hiver, qui compte parmi les quatre dernières pièces de William Shakespeare (1564-1616), appartient au genre hybride des « romances », ou tragi-comédies romanesques, au même titre que
La Tempête.
Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Le Conte d'hiver de William Shakespeare
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.
A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universalis, une gamme complète de resssources numériques pour la recherche documentaire et l’enseignement.
ISBN : 9782852295810
© Encyclopædia Universalis France, 2019. Tous droits réservés.
Photo de couverture : © Nito/Shutterstock
Retrouvez notre catalogue sur www.boutique.universalis.fr
Pour tout problème relatif aux ebooks Universalis, merci de nous contacter directement sur notre site internet :http://www.universalis.fr/assistance/espace-contact/contact
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Encyclopædia Universalis.
Ce volume présente des notices sur des œuvres clés de la littérature ou de la pensée autour d’un thème, ici Le Conte d'hiver, William Shakespeare (Les Fiches de lecture d'Universalis).
Afin de consulter dans les meilleures conditions cet ouvrage, nous vous conseillons d'utiliser, parmi les polices de caractères que propose votre tablette ou votre liseuse, une fonte adaptée aux ouvrages de référence. À défaut, vous risquez de voir certains caractères spéciaux remplacés par des carrés vides (□).
LE CONTE d’HIVER, William Shakespeare (Fiche de lecture)
Le Conte d’hiver, qui compte parmi les quatre dernières pièces de William Shakespeare (1564-1616), appartient au genre hybride des « romances », ou tragi-comédies romanesques, au même titre que La Tempête. Joué en 1611, il est publié pour la première fois en 1623 dans les œuvres complètes (posthumes) de Shakespeare. Son titre évoque les histoires merveilleuses qu’on racontait durant les veillées d’hiver. L’intrigue s’inspire de celle d’un roman de Robert Greene, Pandosto. The Triumph of Time (1588). À son habitude, le dramaturge modifie considérablement ses sources, et fait d’une histoire de jalousie une tragédie complexe qui offre une réflexion subtile sur les rapports entre l’art et la nature, et en particulier sur l’essence de l’illusion théâtrale.
• Retrouver ce qui est perdu
La pièce s’organise comme un diptyque, avec en son cœur une ellipse temporelle de seize années (annoncée par le prologue allégorique du Temps, au début de l’acte IV) qui sépare l’histoire tragique de la jalousie de Léonte, roi de Sicile, placée sous le signe de l’hiver et de la mort, et une intrigue de comédie centrée, elle, sur les amours contrariées de Perdita et de Florizel dans un monde de pastorale. C’est ce détour par le monde vert qui va permettre finalement la rédemption de Léonte et la régénération du royaume prédites par l’oracle qu’il a défié si scandaleusement : « le roi vivra sans héritier, si ce qui est perdu n’est pas retrouvé » (acte III, scène 2).
Cette première section est en effet une froide tragédie passionnelle, qui se déroule au royaume de Sicile : Léonte est atteint d’un délire de jalousie aussi subit que violent ; soupçonnant sa femme Hermione d’avoir entretenu une liaison adultère avec son ami d’enfance Polixène, roi de Bohême, il la fait jeter en prison et charge Camillo d’assassiner son « rival », ce qui provoque la fuite des deux hommes. Antigone, serviteur de Léonte, est chargé d’assassiner la petite fille dont Hermione a accouché. Après avoir désobéi au roi en abandonnant l’enfant sur un rivage lointain de Bohême, il périt au cours de son voyage. Mais des bergers recueillent la petite fille, qui sera nommée Perdita. Cette première partie mène d’une seule portée à la dramatique parodie de procès (III, 2), où Léonte continue de se comporter en tyran. Suit un coup de théâtre : l’annonce de la mort de son fils, tombé malade de chagrin, provoque l’évanouissement d’Hermione, portée hors de la scène et dont la fidèle suivante, Paulina, ne tarde pas à annoncer la mort. Devant tant de désastres où il voit la main de la Providence, Léonte est subitement guéri de sa jalousie maladive et décide de consacrer le reste de son existence à expier ses fautes.
La seconde partie, située en été, en Bohême, se présente comme une pastorale quelque peu dévoyée : loin d’être oisifs ou idéalisés, les bergers y sont montrés comme des hommes du peuple ordinaires, sujets à la jalousie ou à la cupidité, tandis que le gueux Autolycus, tour à tour colporteur, bandit de grand chemin et faux mendiant, détrousse ceux qui croisent son chemin. En outre, l’amour n’y est pas au-dessus des lois : Florizel, fils du roi Polixène et amoureux de la jeune bergère Perdita, passe ses journées au milieu des bergers, jusqu’au jour où son père, au cours de la fête des bergers, vient l’arracher à son rêve éveillé en menaçant de le déshériter (IV, 4).
Le contraste entre les mondes de Sicile et de Bohême s’estompe : la même tyrannie y règne, la même injustice, avec des effets analogues ; dans les deux cas, la comédie vire au tragique. C’est d’ailleurs la répétition de cette scène primordiale qui semble amener le dénouement, puisque sur les conseils de Camillo, Florizel, talonné par son père, s’enfuit avec Perdita en Sicile, où il est accueilli par Léonte, repentant. Le dernier acte marque la réconciliation de tous les anciens ennemis, et les retrouvailles de Léonte et de Perdita (dont les bergers produisent les langes royaux), comme de Polixène et de Florizel. Enfin, Paulina dévoile la statue d’Hermione qu’un célèbre artiste, dit-elle, vient de terminer, et par la magie orphique d’un rituel poétique rappelle l’épouse de Léonte à la vie. Le merveilleux, qui est ici mis en scène, est bien sûr en trompe l’œil : Hermione n’est pas morte à l’acte III, mais est demeurée cachée pendant seize ans pour châtier Léonte. Il faut voir là, sans doute, toute l’ambiguïté de cette pièce ironique sur la réconciliation et sur le pardon. En dépit de l’oracle qu’il semble réaliser, le dénouement est en effet amené, non par quelque deus ex machina ou par la Providence divine, mais par une série de coïncidences favorisées par la poursuite d’intérêts et de passions privés : ainsi c’est l’appât du gain qui amène Autolycus à conduire les deux jeunes gens en Sicile ; c’est son désir de retourner dans son pays natal qui pousse Camillo à recommander à Florizel de fuir en Sicile. Enfin, c’est par désir de vengeance qu’Hermione, assistée de Paulina, se cache pendant seize années. La réconciliation, si elle est bien possible, n’efface pas tout à fait le souvenir de la faute commise.





























