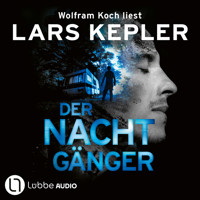Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le conteur du Sahel est l'histoire d'un jeune sahélien ambitieux qui fait beaucoup de projets pour son émancipation matérielle et sociale. Il connaitra bien des déboires de la vie dans ce Sahel rongé par la pauvreté. Seule porte de sortie, devenir artiste conteur et joueur de kora. Une fresque de l'Afrique à la recherche de son avenir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les évènements et les personnages de ce roman sont fictifs.
Cependant, le personnage principal est une composition à partir de plusieurs personnages qui ont été proches de l’auteur.
Peinture d’une rue de Nungu — Paulette de Jésus
SOMMAIRE
1 L’enfance perturbée
2 Les rêves du jeune sahélien
3 L’éveil désenchanté
4 Je serai conteur et artiste
5 On se reverra, si Dieu le veut
6 Annexes : Scènes d’Afrique
7 Cartes
Citations
Proverbes africains
- « Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures »
- « Assieds-toi au pied d’un arbre, et avec le temps, tu verras l’univers défiler devant toi »
- « Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d’entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur »
A. de St-Exupéry.
- « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux » — « Le Petit Prince ».
Photo JYST-Le berger flûtiste
1 L’enfance perturbée
Né dans une famille pauvre d’agriculteurs — Le père meurt à la cinquantaine — confié à son oncle maternel.
Photos JYST — joueuse de Kora
« … Ainsi, disait Diargogne l’araignée à Leuk-le-Lièvre, tu feras la connaissance de l’Homme. C’est un animal dangereux, qui se tient droit comme un filao et qui se déplace sur deux pattes seulement. Méfie-toi surtout de son air bon enfant… »1.
Les enfants écoutent émerveillés le vieux conteur du village de Pandiagou. Il alterne paroles et musique de Kora, en cette belle nuit de clair de lune. Et même les moustiques qui les piquent régulièrement ne peuvent interrompre l’émerveillement de ces petits garçons, qui « boivent » sans modération les narrations du vieux Mandja. C’est un de ces vieux sages de village, fatigué par une longue vie de labeur, qui n’a plus que la « transmission » comme rôle social. Le visage marqué par les scarifications ethniques, la dentition parsemée de trous, la barbe laineuse et d’un blanc immaculé, Mandja est assis sur une natte tressée avec les roseaux cueillis au bord du marigot.
Lardja, un petit enfant d’une dizaine d’années, est de la partie. Le conte est de Senghor, un savant poète d’un lointain pays appelé Sénégal. Celui-ci a beaucoup voyagé en Afrique, mais aussi chez les blancs en Europe. C’est donc une histoire digne d’intérêt, a dit le vieux conteur en début de soirée. Ah ! pense le petit Lardja : si même les savants font des contes… alors…
Lardja est l’un des quatre enfants de l’agriculteur Tandja. La famille habite Pandiagou depuis toujours ; depuis au moins quatre générations. C’est une famille très pauvre qui vit de peu. Le père a néanmoins réussi à bâtir en lisière du village, trois cases regroupées autour d’une cour ; au milieu trônent le grenier de mil et un poulailler. Pour assurer un peu d’intimité, une clôture en nattes de pailles tressées et de piquets de bois d’acacias, délimite la cour familiale. La mère Poniagou occupe avec ses deux filles, Tompoia et Bapoia, l’une des cases de la famille. La seconde case est occupée par le père Tandja. La troisième abrite les deux garçons de la famille, Lardja et son grand frère Canfidini.
Lardja est un garçon plein d’énergie et très robuste, malgré sa petite taille. Dans le groupe de garçons de son âge, il fait figure de « leader » pour tout ; pour jouer, se battre et embêter les jeunes filles. C’est lui qui bat généralement le rappel, les nuits de pleine lune, pour solliciter Mandja, pour des veillées de contes. Le vieil homme habite au centre du village ; ce qui rassure les parents des petits garçons, qui vont en bande chez le conteur. « Toc, toc, toc », de petits coups à la porte du vieux Mandja. « Grand-père, peux-tu sortir de ta case pour nous conter des histoires ? » disent en cœurs les garçons.
Dans la journée les hommes de la famille de Lardja vont aux champs, situés dans les bas-fonds ; là où la terre est la plus fertile grâce au marigot qui y serpente. Les femmes sont occupées aux tâches ménagères et à l’approvisionnement en eau du foyer. À Pandiagou, l’eau est une denrée rare et précieuse, que toutes les femmes du village se disputent tôt le matin, aux rares puits qui en fournissent. Les sœurs de Lardja veillent jalousement sur les quelques poules et pintades qui leur permettent de varier de temps à autre les repas de la famille. À l’arrière des cases, Poniagou et ses filles font un peu de maraîchage, pour avoir des gombos, des tomates, des feuilles d’épinard et d’oseille.
La nuit tombée, la petite famille de Lardja se retrouve autour du repas de pâte de mil accompagnée de sauce de fleurs et de feuilles de baobab. Parfois la sauce est enrichie de gombos, et plus rarement de « viande de brousse » ou de poulet.
En fin de matinée, après les durs labeurs des champs, ce sont les restes de nourriture de la veille qui servent de déjeuner. Et quand il n’y en a pas assez, les tubercules et les fruits sauvages glanés dans les bois environnants sont les bienvenues.
À cinquante ans, le père Tondja a une santé fragile. Il est usé par le travail et les maladies qui ont jalonné sa vie depuis l’enfance. L’homme était costaud à l’adolescence. Mais aujourd’hui, il passe rarement une journée sans douleur, sans fièvre ou migraine. C’est le lot des pauvres gens comme lui, qui affrontent les rigueurs du sahel, les sécheresses et les famines. Heureusement, Lardja et son frère Canfidini sont là pour assurer la continuité des travaux des champs.
Tondja a consulté la plupart des guérisseurs et charlatans de la région pour sa santé. Il n’a pas les moyens d’aller, ni aux dispensaires de Nungu, chef-lieu de la région, ni à ceux de Wagdogo, capitale du pays des « hommes intègres ». Il se contente des breuvages et des sacrifices que lui recommandent les guérisseurs. Pour expliquer ses maladies chroniques non identifiées, on a parlé de « génies » qui lui veulent du mal. Tondja consulte régulièrement un ami « joueur de sable2 » ; et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le désespoir le gagne de jour en jour et toute la famille le ressent.
La mère de famille Poniagou est une bonne femme qui aime énormément ses enfants ; ses seules richesses ! Elle a été mariée très jeune, à quinze ans, et n’a connu d’homme que Tondja. Son père l’avait « donnée » à ce dernier, en reconnaissance d’une longue amitié entre le père de Tondja et le sien. N’eût été le handicap mental de sa fille cadette Bapoia, elle se considérerait comme une mère comblée. En effet, elle est comme la plupart de ces mères sahéliennes, résignée à la pauvreté matérielle, mais heureuse d’être « reine-mère ». Elle a un demi-frère, Nidja, qui habite Nungu et qu’elle aime bien. Il lui arrive souvent de lui rendre visite durant deux ou trois jours, avec sa fille aînée Tompoia. Les femmes de son demi-frère la respectent beaucoup, et la mettent presque au « même rang » que leur mari Nidja. D’ailleurs, elles la nomment « mon mari ». Poniagou en profite pendant ses séjours, pour se reposer, se faire « bichonner » par les femmes de ce demi-frère plutôt riche. Les repas chez Nidja sont bien plus copieux que ceux qu’elle prépare pour sa famille de Pandiagou. Les sauces sont garnies de bonnes viandes bien grasses, et les plats de riz des femmes rivalisent d’excellence. Quand Poniagou et sa fille reviennent au village, à Pandiagou, le reste de la famille ne manque pas de constater les bienfaits du séjour à Nungu, sur leur moral et leur santé.
Canfidini, l’aîné des deux garçons, est travailleur et courageux. Il a trois ans de plus que Lardja et fait office de « chef de famille adjoint ». Toutes les tâches difficiles que le père n’est plus à même de réaliser lui échoient. Il est très précieux. En plus des travaux champêtres, Canfidini travaille souvent avec le forgeron du village, qui lui a appris à fabriquer des houes et des coupe-coupe. Il les vend les jours de marché, pour arrondir les fins de mois de la famille. Canfidini, à la différence de Lardja, n’est pas très extraverti. Il a « muri » trop vite, pour être un soutien de ses parents dans les travaux. Dans sa vie de jeune villageois, seule « l’initiation à la vie d’homme » lui a donné une occasion de socialisation avec les garçons de sa génération. À douze ans, il a été enrôlé avec son frère Lardja aux semaines initiatiques organisées par les « anciens » de Pandiagou. Les jeunes enrôlés sont isolés dans un camp aménagé hors du village en pleine brousse. On y est tout d’abord circoncis, puis on reçoit au visage des cicatrices d’identité ethnique. On y apprend les règles pour être bon père de famille, bon chasseur respectueux des coutumes. Les luttes traditionnelles de combat, les danses ethniques sont au menu. Au bout de la dizaine de semaines que dure l’initiation, le groupe des garçons est soudé par les épreuves et une amitié générationnelle. Leurs encadreurs ne leur font pas de cadeaux lorsque les rites ne sont pas respectés. La fin de l’initiation est couronnée par des fêtes « monstres » dans le village. Ce jour-là, les initiés sont habillés de masques et d’accoutrements de danseurs, pour déambuler dans la cité au son des tam-tams. Ils sont couverts de cadeaux et autorisés à beaucoup d’extravagances.
Lardja et son frère font donc partie de la même génération initiatique. Mais les frères diffèrent totalement par leurs ambitions. Le premier veut croquer la vie à pleine dent. Il ne veut pas être un paysan « trimeur et miséreux ». L’horizon du second ne dépasse pas les frontières de son village.
La sœur aînée de la fratrie, Tompoia, a aussi connu l’excision des femmes. Il paraît que c’est plus douloureux et plus traumatisant que la circoncision des hommes. Mais dans ce petit village qui vit déjà sous influence de religions étrangères, une croyance débile veut qu’une femme excisée soit plus « sage », est plus respectable et donc plus convoitée pour le mariage. On a ainsi pu lui trouver un mari à seize ans tout juste. Mais ça n’a pas été facile de lui trouver un jeune homme qui ne soit pas un parent proche. Bien que la dot soit à la charge du marié, il a fallu tout de même économiser pour acheter à Tompoia les ustensiles de cuisine, les pagnes en étoffes de coton local et quelques bijoux pour les cérémonies de mariage. Poniagou, la mère et Tondja, le père, ont puisé dans leurs maigres économies pour sauver la face. Le frère Canfidini a confectionné une marmite en aluminium grâce à son travail à la forge du village, et l’a offerte à sa sœur en guise de cadeau de mariage. Celui-ci s’est fait par étapes : une délégation de la famille du futur époux a d’abord rencontré la famille « élargie » de Tompoia, pour un accord de fiançailles. À l’occasion, on a offert des cadeaux, on a plaisanté, on a bu du dolo3 et on a mangé ensemble pour sceller l’évènement. Le jour du mariage, les époux ont revêtu leurs plus beaux vêtements, faits de tissus en bandes de cotonnade. De vieux sages ont béni l’union, au nom des ancêtres, et au son de la musique des griots. Pas de prêtre catholique ni d’Iman. Pas plus de cérémonie à l’état civil. Les familles sont « animistes4 » ; c’est un mariage de pure tradition locale. Tompoia quitte ainsi sa famille à seize ans, pour rejoindre son mari.
La sœur cadette Bapoia est une fille « non mariable ». Elle est atteinte d’une maladie mentale qui fait d’elle « l’idiote du village ». Et bien qu’elle fût physiquement jolie, aucun jeune homme ne semble vouloir en faire sa femme. Elle doit se contenter d’aider sa mère à la maison. Cette dernière fait pourtant beaucoup pour les soins de sa fille. Poniagou la tresse toutes les semaines, maquille ses yeux avec une espèce de poudre noir brillant. Elle partage avec sa fille handicapée, ses plus jolis pagnes. C’est fusionnel entre les deux femmes ; pour compenser l’infortune de Bapoia. La crainte des parents, est qu’elle soit enceinte et qu’on ne sache pas de qui. Alors la mère Poniagou ne la laisse jamais aller seule au marché pour éviter de mauvaises rencontres. C’est Lardja qui fait souvent le garde du corps, quand de temps à autre elle doit sortir. À quelque chose malheur est bon. Poniagou espère qu’avec Bapoia, elle ne finira pas seule sa vie de paysanne.
Photos JYST — Le grenier du cultivateur
La saison des pluies vient de commencer. Les villageois sont heureux de ces averses qui depuis deux jours arrosent les plaines et remplissent les marigots. Chacun sort les précieuses graines de mil et de maïs sélectionnées à la dernière récolte, pour servir de semi cette année. Il faut aussi préparer les parcelles de champs pour la semence. Telle est l’actualité du moment au village de Pandiagou. Il ne faut pas rater la saison, car les pluies ne sont jamais garanties dans ces contrées du sahel. Ce jour-là, Tandja décide d’organiser une semaine spéciale de travaux champêtres, en emmenant ses deux garçons et sa fille handicapée sur leurs parcelles de champ près du marigot. Pendant que les hommes labourent vigoureusement la terre, Bapoia assure la collecte des mauvaises herbes pour en faire des tas à brûler. À l’aide de grandes calebasses, elle approvisionne en eau potable, son père et ses deux frères pour les désaltérer ; car ici il fait chaud, très chaud. Peut-être que demain, le beau-fils viendra les aider avec la sœur aînée Tompoia. C’est un devoir sacré au sahel, d’aider les beaux-parents à certains moments clés des travaux champêtres. Les efforts des hommes sont rythmés par les chants traditionnels, pour se donner du courage.
Le soleil est au zénith, lorsque Tondja ressent un gros vertige qui l’oblige à s’asseoir. Il pense que le mal est passager, comme d’habitude. Il n’en est rien. Plus les minutes passent, plus il sent sa poitrine se bloquer et sa respiration s’amoindrir. Les deux garçons qui étaient aux quatre coins du champ sont alertés par les cris de leur sœur Bapoia qui les appelle au secours. Laissant leurs houes, ils accourent le plus vite qu’ils peuvent, pour assister le père. Tondja est conscient que son heure est venue. Il discerne à peine les visages de ses deux garçons penchés au-dessus de lui. Ces derniers, en larmes, tentent de maintenir le vieil homme à la vie en le secouant, en massant son thorax. « Père, ne nous quitte pas, ce n’est pas juste ; ce n’est pas le moment pour toi de nous abandonner », pleurent les enfants. Dans un dernier effort surhumain de lucidité, Tondja réussit à prononcer quelques mots : « Canfidini, c’est toi l’aîné… C’est toi qui dois prendre soin du fétiche de nos ancêtres qui se trouve dans la grosse peau d’antilope, au-dessus de mon lit. Je t’ai déjà indiqué par le passé, les rites nécessaires pour conserver la protection de nos aïeuls… C’est maintenant à toi d’en prendre soin… Je vous aime… Je vous bénis… » Puis le père expire, définitivement. On dira plus tard que les chiens qui ont hurlé sans discontinuer cette nuit derrière les cases de la famille de Tondja, annonçaient le passage de la « Faucheuse ».
Pour la mère de famille, la saison commence mal, très mal. Elle voit sa cour se remplir rapidement de tous les habitants du quartier qui ont appris le décès. Tondja est en effet très connu et très respecté dans le village. La solidarité se met en place. Suivant les coutumes, il faut que le défunt soit enterré avant l’aurore qui suit la mort.
Lardja est orphelin de père à quinze ans. L’adolescent a quitté l’école très tôt. Son maître disait de lui qu’il est trop dissipé pour faire des études. Il valait mieux qu’il aide ses parents pour les travaux champêtres et le maraîchage, ou qu’il tente sa chance dans un commerce à la ville. Faire le paysan comme son père toute la vie ? Ça n’est pas du tempérament de Lardja. Il suggère à sa mère de l’envoyer vivre avec l’oncle de Nungu, pour aider ce dernier dans ses activités de commerce de bétails. Poniagou se rallie à l’idée. Elle n’a pas d’autre solution pour son fils. Avec le décès du père, les responsabilités et les charges sont trop lourdes pour elle. L’oncle sollicité, accepte sans hésiter de devenir le tuteur de Lardja. C’était sa façon à lui, Nidja, d’être solidaire de sa demi-sœur Poniagou dans le malheur. Et puis, il y a vu aussi l’opportunité d’une main-d’œuvre très utile, pour son commerce. Derrière la solidarité, des intérêts !
Photo JSYT
1« La belle histoire de Leuk-le-Lièvre » de Léopold Sedar Senghor et Abdoulaye Sadji
2 Géomancien
3 Le « dolo » est une bière locale à base de mil et de levure.
4