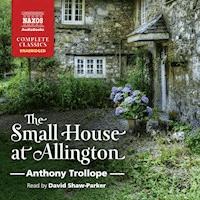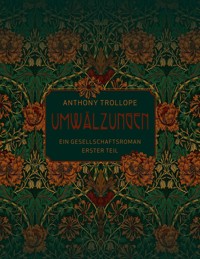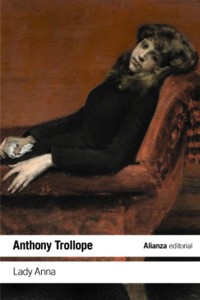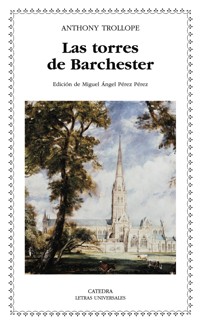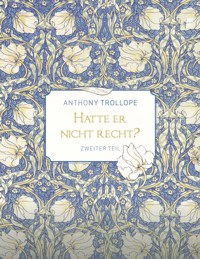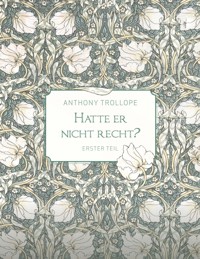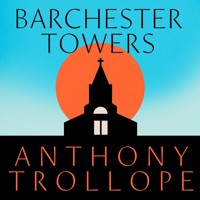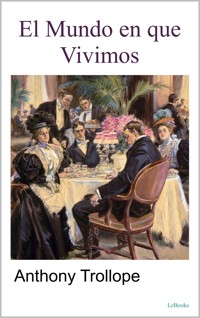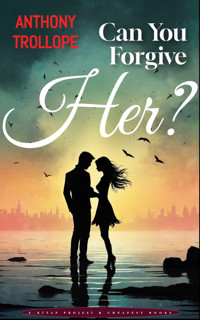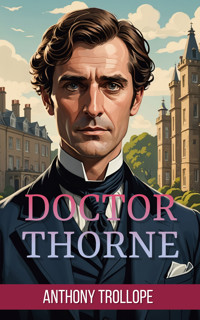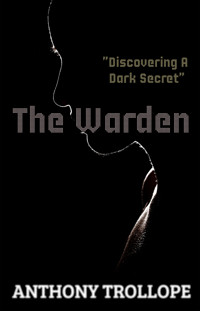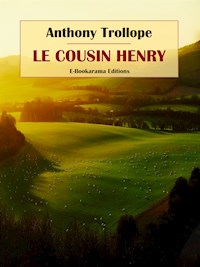
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Indefer Jones a longuement hésité avant d’établir son testament. Il aimerait tant pouvoir laisser ses terres de Llanfeare à sa nièce Isabel. Celle-ci vit avec lui depuis des années et est appréciée de tous les fermiers et villageois. Mais Indefer Jones veut respecter la tradition et se décide en faveur de son neveu Henry. Il le connaît à peine et ne le porte pas dans son estime mais c’est un mâle. Indefer Jones a néanmoins une idée pour régler son cas de conscience : et si Isabel épousait son cousin Henry ?
Anthony Trollope utilise une thématique très anglaise dans ce court roman, la propriété ne peut revenir qu’à un homme. C’était déjà la problématique de "Raison et sentiment" de Jane Austen. Les femmes sont les laissées pour compte de la succession anglaise ! Alors même qu’il n’a jamais rencontré son neveu auparavant Indefer Jones préfère lui laisser ses biens plutôt qu’à Isabel qui lui tient compagnie chaque jour. L’oncle sera rongé par des doutes et des regrets jusqu’à son dernier souffle.
"Le cousin Henry" est finalement une nouvelle occasion pour Anthony Trollope de déployer son immense talent pour les analyses psychologiques. Fin connaisseur de la nature humaine, il nous montre l’effet dévastateur de l’argent de l’héritage d’Indefer Jones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anthony Trollope
Le cousin Henry
table des matières
LE COUSIN HENRY
CHAPITRE PREMIER - L’ONCLE INDEFER
CHAPITRE II - ISABEL BRODRICK
CHAPITRE III - LE COUSIN HENRY
CHAPITRE IV - MORT DE L’ONCLE INDEFER
CHAPITRE V - AVANT LES FUNÉRAILLES
CHAPITRE VI - L’EXPLICATION DE M. APJOHN
CHAPITRE VII - RECHERCHE DU TESTAMENT
CHAPITRE VIII - LA LECTURE DU TESTAMENT
CHAPITRE IX - SEUL À LLANFEARE.
CHAPITRE X - LE COUSIN HENRY FAIT UN RÊVE
CHAPITRE XI - ISABEL À HEREFORD
CHAPITRE XII - M. OWEN
CHAPITRE XIII - LA GAZETTE DE CARMARTHEN
CHAPITRE XIV - UNE POURSUITE EN DIFFAMATION
CHAPITRE XV - LE COUSIN HENRY FAIT UNE NOUVELLE TENTATIVE
CHAPITRE XVI - À HEREFORD
CHAPITRE XVII - M. CHEEKEY
CHAPITRE XVIII - LE COUSIN HENRY VA À CARMARTHEN
CHAPITRE XIX - M. APJOHN DEMANDE DU SECOURS
CHAPITRE XX - Hésitations
CHAPITRE XXI - LE SUCCÈS DE M. APJOHN
CHAPITRE XXII - LE COUSIN HENRY QUITTE LLANFEARE
CHAPITRE XXIII - LA DEMANDE D’ISABEL
CHAPITRE XXIV - CONCLUSION
LE COUSIN HENRY
Anthony Trollope
CHAPITRE PREMIER - L’ONCLE INDEFER
Un vieillard et une jeune fille étaient assis dans la salle à manger d’une maison de campagne du comté de Carmarthen, située sur des rochers qui dominent la mer.
« C’est pour moi un cas de conscience, ma chère, » dit le vieillard.
– Pour moi aussi, mon oncle ; et comme ma conscience à moi est d’accord avec mes sentiments, tandis que la vôtre n’est pas…
– Vous pensez alors que je ne dois pas écouter ma conscience ?
– Je ne dis pas cela.
– Quoi donc ?
– Si je pouvais seulement vous faire comprendre combien mes sentiments… ou plutôt combien mon antipathie est forte, et combien il m’est impossible de la vaincre, alors…
– Eh bien ?
– Alors, vous sauriez que moi, je ne céderai jamais, et vous consulteriez votre conscience, pour savoir si ce qu’elle vous suggère est, ou non, un devoir absolu. Vous pouvez être assuré de ceci ; jamais je ne dirai un mot qui soit en opposition avec ce que vous conseille votre conscience. Si une parole de ce genre est prononcée, elle le sera par vous. »
La conversation demeura longtemps interrompue. Pendant le silence d’une heure qui suivit, la jeune fille alla et vint hors de la salle et dans la salle, puis s’assit et se remit à son ouvrage. Le vieillard reprit brusquement le sujet qu’ils avaient discuté.
« J’obéirai à ma conscience.
– C’est votre devoir, oncle Indefer ; à quoi obéirait-on, sinon à sa conscience ?
– Et pourtant, j’en aurai le cœur brisé.
– Non, non, non.
– Et vous serez ruinée.
– Cela n’est rien. Je supporterai aisément ma ruine, mais non votre douleur.
– Pourquoi faut-il qu’il en soit ainsi ?
– Vous l’avez dit vous-même, parce que votre conscience vous l’ordonne. Même pour vous épargner une grande douleur – bien que vous soyez ce que j’ai de plus cher au monde – je ne saurais épouser mon cousin Henry. J’aimerais mieux que nous pussions mourir ensemble ; j’aimerais mieux vivre malheureuse, tout enfin, plutôt que cela. Ne suis-je pas toujours prête à vous obéir dans les choses possibles ?
– Je l’avais cru jusqu’ici.
– Mais il est impossible à une jeune femme qui se respecte d’accepter l’autorité d’un homme qui lui inspire de l’horreur. Faites, par rapport à la vieille maison, ce que votre conscience vous dictera. Serai-je moins tendre pour vous pendant votre vie, parce que je devrai partir après votre mort ? Croyez-vous que, dans mon cœur, je doive accuser votre justice et votre bonté ? Jamais ! C’est un accident relativement de peu d’importance, qui ne m’atteint pas dans mes sentiments ; mais être la femme d’un homme que je méprise !… » Là-dessus, elle se leva et sortit de la salle.
Un mois s’écoula avant que le vieillard reprît le même sujet. Il le fit assis dans la même pièce, à la même heure du jour, à quatre heures environ, quand la table eut été desservie.
« Isabel, dit-il, il n’y a pas d’autre parti à prendre.
– À propos de quoi, oncle Indefer ? »
Elle savait très bien à propos de quoi il avait pris un parti. S’il s’était agi d’un service que la jeune femme pût rendre à son vieil oncle, il n’y aurait eu entre eux aucune hésitation, aucune réticence. Jamais fille ne fut plus tendre, jamais père plus confiant. Mais, sur ce sujet, elle ne voulait répondre qu’à des questions nettement posées.
– À propos de votre cousin et de la propriété.
– Alors, au nom de Dieu, ne vous tourmentez pas davantage, et n’attendez aucune aide de qui ne peut vous en donner. Vous pensez que la propriété doit passer à un homme et non à une femme ?
– Je voudrais qu’elle allât à un Jones.
– Je ne suis pas un Jones, ni destinée à le devenir.
– Vous m’êtes une parente aussi proche et mille fois plus chère que lui.
– Mais cela n’empêche pas que je ne suis pas un Jones. Mon nom est Isabel Brodrick. Une femme qui n’est pas née Jones peut avoir la bonne chance de le devenir par le mariage ; mais ce ne sera jamais mon cas.
– Vous ne devriez pas parler en riant de ce que je considère comme un devoir.
– Cher, bien cher oncle, dit-elle en le caressant, si j’ai paru rire – et elle avait ri en effet en parlant de la chance de devenir un Jones – c’est seulement pour vous faire comprendre le peu d’importance que j’attache à tout ceci, quant à ce qui me concerne.
– Mais c’est une chose importante – terriblement importante !
– Très bien. Alors que deux choses soient irrévocablement fixées dans votre esprit, et agissez en conséquence : l’une, que vous devez laisser Llanfeare à votre neveu Henry Jones ; l’autre, que je n’épouserai pas votre neveu Henry Jones. Quand tout ceci sera réglé, ce sera comme si la vieille propriété n’avait jamais cessé d’être transmise de mâle en mâle.
– Je voudrais que cela fût !
– Moi aussi ; cela vous eût épargné bien du souci.
– Mais ce n’est pas la même chose ; – ce ne peut être la même chose. En rachetant les terres que votre grand-père avait vendues, j’ai dépensé l’argent que j’avais réservé pour vous.
– Ce sera tout à fait la même chose pour moi, et je serai heureuse de penser que le vieux bien de famille sera transmis dans les conditions que vous voulez. Je puis être fière de la famille, bien que je ne doive jamais en porter le nom.
– Vous ne vous souciez pas plus de la famille que d’un fétu de paille.
– Vous ne devriez pas parler ainsi, oncle Indefer ; cela n’est pas. Je me soucie assez de la famille pour sympathiser entièrement avec vous dans tout ce que vous faites, mais pas assez de la propriété pour en obtenir une part en sacrifiant ma personne.
– Je ne sais pourquoi vous avez si mauvaise opinion de Henry.
– Et qu’est-ce qui me donnerait de lui une assez bonne opinion pour que je consentisse à devenir sa femme ? Je ne le sais vraiment pas. En épousant un homme, une femme doit l’aimer en tout ; satisfaire ses moindres désirs doit être son souci ; lui rendre jusqu’aux plus vulgaires services doit être son plaisir. Croyez-vous que j’éprouve un tel sentiment à l’égard de Henry Jones ?
– Tout cela, c’est de la poésie, et vous parlez trop comme vos livres.
– Je me ferais honte à moi-même si j’allais à l’autel avec lui. Renoncez à cette idée, oncle Indefer, enlevez-la de votre esprit comme une chimère qu’elle est. C’est la seule chose que je ne puisse ni ne veuille faire, même pour vous. C’est la seule chose que vous ne devriez pas me demander. Disposez de la propriété comme il vous plaît, – comme vous le croyez bon.
– Mais cela ne me plaît pas de faire ce que vous dites.
– Comme votre conscience vous l’ordonne, alors. Quant à ma personne, la seule petite chose que je possède au monde, j’en disposerai selon mon goût et selon ma conscience. »
Elle prononça ces derniers mots avec une certaine brusquerie, et quitta la chambre avec un air d’orgueil blessé. C’était une petite comédie, qu’elle jouait à dessein. Si elle affectait une certaine dureté à l’égard de son oncle, si elle s’obstinait à ne rien lui céder, il s’obstinerait, lui aussi, à exécuter son projet, et en souffrirait moins. C’était pour elle un devoir de lui faire comprendre qu’il avait le droit de disposer à son gré de la propriété, puisqu’elle-même prétendait disposer également de sa personne. Non seulement elle ne dirait pas un mot pour le dissuader de modifier ses intentions précédentes, mais encore elle lui rendrait ce changement récent moins pénible, en l’amenant à penser qu’il était justifié par sa manière d’être envers lui. C’était en effet tout un changement qui s’était fait dans les idées du vieillard, et même dans ses intentions déclarées. Llanfeare appartenait aux Indefer Jones depuis plusieurs générations. Quand le dernier propriétaire était mort, vingt ans auparavant, un seul de ses dix enfants survivait, l’aîné, à qui la propriété appartenait en ce moment. Quatre ou cinq autres, nés successivement après lui, étaient morts sans enfants. Puis était venu un Henry Jones, qui avait quitté le pays, s’était marié, était devenu le père de cet Henry Jones dont il a déjà été question, et était mort lui aussi. Le plus jeune, une fille, avait épousé un avoué nommé Brodrick, et était mort, ne laissant pas d’autre enfant qu’Isabel. M. Brodrick s’était remarié et était alors le père d’une nombreuse famille à Hereford. Il n’était pas dans une très bonne situation de fortune. La seconde madame Brodrick avait trop montré sa préférence pour ses propres enfants, et Isabel, à l’âge de quinze ans, était allée habiter avec son oncle, célibataire. C’était à Llanfeare qu’elle avait vécu pendant les dix dernières années, faisant de temps en temps une visite à son père, à Hereford.
M. Indefer Jones, qui avait en ce moment entre soixante-dix et quatre-vingts ans, avait été toute sa vie tourmenté par des réflexions, des craintes, des espérances relativement à la propriété de famille sur laquelle il était né, dans laquelle il avait toujours vécu, en possession de laquelle il devait certainement mourir, et dont il devait disposer à son gré pour l’avenir. La propriété lui avait été substituée avant sa naissance, du vivant de son grand-père, alors que son père allait se marier ; mais la substitution s’était arrêtée à lui. Quant à lui, il ne s’était pas marié. Son grand-père, s’étant livré à de folles dépenses et ayant été souvent à court d’argent, avait trouvé plus commode de posséder un bien non substitué. Les circonstances avaient amené aussi son fils à réaliser de l’argent sur la propriété. Ainsi, non seulement depuis qu’il était lui-même en possession, mais dès avant la mort de son père, notre Indefer avait dû réfléchir à la transmission future de Llanfeare. À cinquante ans il était célibataire, et il n’était pas vraisemblable qu’il dût cessera de l’être. Son frère Henry vivait encore, mais il avait déshonoré la famille : il s’était, enfui avec une femme mariée, qu’il avait épousée après un divorce ; il était assidu aux courses et fréquentait les salles de billard ; il s’était rendu odieux à son frère Indefer. Néanmoins, le fils qui était né de ce mariage, Henry, avait été élevé à ses frais et quelquefois reçu à Llanfeare. Il n’y avait plu à personne : c’était un enfant sournois, menteur, et comme les domestiques eux-mêmes le disaient, ce n’était pas un Jones. Cependant, Isabel avait été amenée à Llanfeare. Henry s’était fait renvoyer d’Oxford pour une faute qui n’était pas sans gravité, et son oncle s’était dit et avait déclaré à tout le monde que Llanfeare ne lui appartiendrait jamais.
Isabel lui avait inspiré tant d’affection que, deux ans à peine après son arrivée à Llanfeare, elle y était devenue la maîtresse. Tout ce qu’elle faisait, son oncle le trouvait bien ; tout ce qu’elle aurait demandé, elle l’eût obtenu ; mais elle ne demandait rien. À cette époque, le cousin avait été placé dans des bureaux, à Londres, et était devenu – du moins, on le disait – un travailleur sérieux. Cependant, quand il lui était permis de se montrer à Llanfeare, il continuait à déplaire à tout le monde, sauf peut-être au vieillard. Il était certain que, dans son emploi, il se rendait utile, et il semblait qu’il eût perdu l’habitude de faire des dettes et d’envoyer les billets à Llanfeare, pratique qu’il avait suivie au commencement de sa carrière.
Pendant tout ce temps, le vieillard était dans la plus pénible hésitation au sujet de la transmission de la propriété. Son testament était toujours à la portée de sa main. Jusqu’au moment où Isabel atteignit vingt et un ans, ce testament avait été fait en faveur de Henry, avec cette clause pourtant, qu’une somme d’argent, que possédait le testateur, appartiendrait à Isabel. Ensuite, son antipathie pour son neveu changea ses intentions : il fit un autre testament, en faveur de sa nièce. Les choses en restèrent là pendant trois ans ; mais ce furent pour lui trois années de tourments. Il s’était fait difficilement à la pensée que la propriété passerait en dehors de ce qu’il appelait la ligne mâle directe. Selon lui, c’était par accident que le pouvoir de disposer de la propriété était dans ses mains. C’était un principe auquel il fallait obéir religieusement que, dans l’Angleterre, une terre passât du père au fils aîné, et, à défaut du fils, à l’héritier mâle le plus proche. L’Angleterre ne serait pas ruinée parce que Llanfeare serait transmis en dehors de l’ordre régulier, mais l’Angleterre serait ruinée si les Anglais n’accomplissaient pas les devoirs qui leur incombaient à chacun dans la situation à laquelle Dieu les avait appelés ; et, dans ce cas, son devoir à lui était de maintenir le vieil ordre de choses.
Cependant, un nouveau souci était venu s’ajouter aux autres. Après qu’il se fut décidé à agir contrairement à ses principes et à donner satisfaction à ses sentiments, après qu’il eut déclaré à son neveu et à sa nièce qu’Isabel serait son héritière, il eut une consolation dans ses ennuis : il put racheter un morceau de terre que son père avait vendu. Il avait toujours souffert de voir ces quelques arpents détachés de la propriété, non parce que son bien en était amoindri, mais parce que, selon lui, un propriétaire ne devait pas se permettre de diminuer sa terre, pendant qu’il l’avait en sa possession. Afin de pouvoir les racheter, il avait économisé de l’argent depuis que Llanfeare était entre ses mains. Puis était survenue la nécessité de pourvoir à l’avenir d’Isabel. Mais quand il eut en gémissant, décidé, qu’Isabel serait son héritière, il avait pu employer l’argent à l’accomplissement de son premier dessein, et il l’y avait employé en effet. Alors, il n’avait pu supporter les reproches de sa conscience, et il avait fait un nouveau testament.
On verra comment il avait essayé de concilier les choses. Quand on sut que Henry Jones était un travailleur sérieux, dans les bureaux de Londres auxquels il était attaché, qu’il avait jeté ses premiers feux, l’oncle Indefer commença à se demander si tout ne pouvait pas être arrangé par un mariage entre les cousins. « Il y a bien lieu de parler de ses feux, » avait dit Isabel en plaisantant, quand l’idée de ce mariage lui avait été suggérée pour la première fois. « Je les trouve bien éteints. Il n’ose regarder personne en face. » Son oncle s’était alors fâché de ce que, par une sotte observation, elle empêchait leur bonheur à tous.
Mais son irritation contre elle s’apaisait toujours vite ; et, avant le moment où notre histoire commence, il s’était déjà aperçu qu’Isabel redoutait moins sa colère, que lui-même celle de sa nièce. Elle avait une fermeté que rien ne pouvait vaincre. Elle avait grandi sous ses yeux, forte, courageuse, quelquefois presque hardie, avec une pointe d’originalité ; quand elle avait estimé qu’une chose était juste ou injuste, elle ne revenait pas sur son jugement. Il avait eu, ou peu s’en fallait, peur d’elle, quand il s’était vu forcé de lui dire la décision à laquelle sa conscience l’avait obligé. Mais le testament était fait – le troisième, peut-être le quatrième ou le cinquième qu’il s’était fait devoir d’écrire, depuis le commencement de ses hésitations. Par ce testament, sur lequel il se promit de ne plus revenir, il laissait Llanfeare à son neveu, à la seule condition qu’il ajoutât le nom d’Indefer à celui de Jones, et stipulait, par certaines clauses, la reprise de la substitution. Enfin, tout ce qu’il posséderait à sa mort, excepté Llanfeare et le mobilier de la maison, il le laissait à sa nièce Isabel.
« Il faut vendre les chevaux, lui dit-il, quinze jours environ après la conversation que nous avons rapportée.
– Pourquoi donc ?
– Mon testament est fait, et vous devez avoir si peu, qu’il nous faut mettre de côté le plus d’argent possible avant ma mort.
– Mon Dieu ! Quel tourment !
– Croyez-vous que ce ne soit pas une terrible pensée pour moi que celle du peu de bien que je puis vous faire ? Peut-être vivrai-je encore deux ans ; nous pourrons économiser six ou sept cents livres par an. J’ai mis sur la terre une charge de quatre mille livres. La propriété est peu de chose, après tout ; elle ne rapporte pas plus de quinze cents livres par an.
– Je ne veux pas entendre parler de vendre les chevaux, et qu’il n’en soit plus question. Pendant vingt ans, vous avez tous les jours parcouru la propriété, et ce serait pour moi une souffrance de vous voir changer cette habitude. Vous avez fait pour le mieux ; laissez tout cela maintenant dans la main de Dieu. Je vous en prie, ne parlons plus de cette affaire. Si seulement vous saviez combien l’entrée en possession de mon cousin me laissera peu de regrets ! »
CHAPITRE II - ISABEL BRODRICK
Quand M. Indefer Jones parlait de vivre encore deux ans, il montrait plus d’espoir que les médecins n’en donnaient à Isabel. Le docteur de Carmarthen visitait Llanfeare deux fois par semaine ; il était entré dans l’intimité et dans la confiance d’Isabel, et il lui avait dit que « la chandelle était consumée à peu près jusqu’à la bobèche. » Ce n’était pas qu’Indefer eût une maladie bien accusée : c’était un vieillard usé. Sans doute il pouvait encore se faire voiturer, chaque jour dans la propriété, se lever après le déjeuner, dîner au milieu du jour, suivant sa vieille habitude, faire en un mot bien des choses que ne ferait pas un homme véritablement malade ; mais le docteur pensait qu’il ne pouvait plus durer longtemps ; comme il l’avait dit, « la chandelle était consumée jusqu’à la bobèche ».
Cependant, l’intelligence du vieillard n’avait pas visiblement décliné. Il ne s’était jamais beaucoup intéressé aux choses de l’esprit ; mais le peu qu’il avait toujours fait, il le faisait encore. Il lisait tous les jours, du commencement à la fin, un exemplaire du journal le plus profondément conservateur qui se publiât alors, et, avec celui-là, un numéro hebdomadaire du Guardian occupait la somme des heures réservées à l’étude. Chaque dimanche, il lisait deux sermons, le docteur lui ayant défendu d’aller à l’église, à cause des courants d’air ; il pensait apparemment qu’il serait peu digne de lui de faire de cet inconvénient un prétexte pour éviter un devoir ennuyeux. Il consacrait religieusement une heure par jour à la lecture de la Bible. Le reste de son temps, il le donnait au soin de sa propriété. Rien ne lui faisait plus de plaisir que la venue d’un de ses fermiers ; il les connaissait tous si bien que, malgré son grand âge, il n’oubliait jamais le nom de leurs enfants. La pensée d’élever la redevance d’un fermier lui semblait abominable. Autour de la maison, il y avait environ deux cents acres de terres qu’il était censé affermer. Sur ces terres, il maintenait une demi-douzaine d’hommes vieux et usés, dans des conditions telles qu’il ne recevait jamais rien d’eux ; sur ce sujet, il n’aurait écouté les remontrances de personne, pas même d’Isabel.
Tel que nous l’avons dépeint, Indefer aurait été un heureux vieillard pendant ses dernières années, si son esprit n’avait été tourmenté chaque jour et à toute heure par le souci toujours présent de la transmission de la propriété. Un cœur plus tendre ne pouvait battre dans une poitrine humaine. Tout ce qu’il avait d’amour dans le cœur, il l’avait donné à Isabel. Nul homme n’avait éprouvé avec plus de vivacité que lui le sentiment du devoir dont il était possédé ; et, sous l’empire de ce sentiment, il se disait à lui-même que, dans la destination à donner à sa propriété, il était obligé de se conformer à la coutume établie dans la classe à laquelle il appartenait. Cette pensée l’avait rendu malheureux ; elle l’agitait de sentiments contradictoires ; et maintenant qu’il approchait de l’heure de la séparation, il souffrait de laisser Isabel sans ressources suffisantes.
Mais la chose était faite ; le nouveau testament était écrit et lié au-dessus du paquet qui contenait les précédents. Alors naturellement il eut de nouveau la pensée, presque l’espérance, que quelque incident pourrait encore concilier les choses et amener un mariage entre les deux cousins. Isabel s’était déclarée si catégoriquement sur ce sujet, qu’il n’osa pas lui faire une nouvelle demande. Cependant, il pensait qu’il n’existait pas de raison sérieuse qui les empêchât de devenir mari et femme. Henry, autant qu’il pût le savoir, avait renoncé à ses mauvaises habitudes. Comme homme, il n’était pas désagréable ; il avait l’abord plutôt froid ; il était grand, et ses traits étaient réguliers, ses cheveux d’un blond clair, ses yeux bleu gris ; on ne pouvait dire de lui qu’il n’était pas distingué, mais rien ne faisait dire qu’il le fût. Le défaut qu’il avait de ne pas regarder les gens en face n’avait pas frappé le vieillard aussi vivement qu’Isabel ; il n’aurait pas plu à son oncle, sans le lien de parenté qui les unissait ; peut-être même, sans ce lien, aurait-il continué de lui déplaire, comme dans le principe. Au point où en étaient les choses, Henry pouvait encore tenter de gagner son affection, et pourquoi pas aussi celle d’Isabel ? Mais il n’osa pas commander à Isabel d’essayer d’aimer son cousin.
« Je crois que j’aurais du plaisir à le revoir ici, dit-il à sa nièce.
– Certainement, plus les fermiers le verront, mieux cela vaudra. Je puis toujours aller à Hereford.
– Pourquoi vous enfuir loin de moi ?
– Non, pas loin de vous, mon oncle, mais loin de lui.
– Et pourquoi de lui ?
– Parce que je ne l’aime pas.
– Faut-il toujours fuir les personnes qu’on n’aime pas ?
– Oui, quand ces personnes, ou quand cette personne est un homme auquel on a fait un devoir de m’aimer. »
En parlant ainsi, elle regardait fixement son oncle, en souriant, mais sa physionomie montrait assez qu’elle posait indirectement à son oncle une question délicate. Il n’osa pas répondre, mais l’expression de son visage était un aveu. Il avait fait connaître son désir à son neveu.
– Ce n’est pas que j’aie le moins du monde peur de lui, » continua-t-elle ; « peut-être vaut-il mieux le voir ; et, s’il me parle, en finir avec lui. Combien de temps restera-t-il ?
– Un mois, je suppose. Il peut venir pour un mois.
– Alors, je resterai pendant la première semaine. Je dois aller à Hereford avant la fin de l’été. Dois-je lui écrire ? » Les choses furent arrangées comme elle l’avait proposé. Elle écrivait toutes les lettres de son oncle, même celles qu’il adressait à son neveu, à moins qu’il n’eût par hasard quelque chose de particulier à lui communiquer. Dans la circonstance présente, elle lui fit l’invitation dans ces termes :
« Llanfeare, 17 juin 1877, lundi.
« Mon cher Henry.
« Mon oncle désire que vous veniez ici vers le 1 er juillet, pour rester un mois. Le 1 er juillet sera un lundi.
Ne voyagez pas un dimanche, comme vous l’avez fait la dernière fois : cela le contrarie. Je serai ici au commencement de votre séjour ; j’irai ensuite à Hereford. Ce n’est qu’en plein été que je puis quitter mon oncle.
« Votre affectionnée cousine,
« Isabel Brodrick. »
Elle s’était souvent reproché à elle-même de signer de cette manière, et elle l’avait fait bien à contrecœur. Mais à l’égard d’un cousin, c’était la formule habituelle, comme c’est la coutume d’appeler un indifférent « Mon cher monsieur », quoiqu’il ne soit pas cher le moins du monde. Elle s’était donc résignée à ce mensonge.
Il faut faire connaître au lecteur un autre incident de la vie d’Isabel. Elle avait l’habitude d’aller à Hereford au moins une fois par an, et de passer un mois chez son père. Elle avait fait annuellement ces visites depuis qu’elle vivait à Llanfeare, et elle était arrivée ainsi à se créer des relations avec plusieurs habitants d’Hereford. Parmi ceux qui étaient devenus ses amis était un jeune ecclésiastique, William Owen, chanoine de second ordre attaché à la cathédrale, et qui, pendant sa dernière visite, lui avait demandé d’être sa femme. À ce moment, elle pensait être héritière de son oncle, et, se regardant comme la propriétaire probable de Llanfeare, elle s’était crue obligée de tenir compte, avant tout, de ses futurs devoirs et de l’obéissance qu’elle devait à son bienfaiteur. Elle ne dit jamais à celui qui l’aimait, et elle ne s’avoua jamais complètement à elle-même, qu’elle l’aurait accepté, si elle n’eût été ainsi enchaînée ; mais nous pouvons dire au lecteur qu’il en était ainsi. Si elle s’était sentie tout à fait libre, elle se serait donnée à l’homme qui lui avait offert son amour. Mais, dans sa situation d’héritière, elle lui répondit, sans lui donner d’espoir, sans lui rien dire de ses propres sentiments, et parlant d’elle-même comme si elle dépendait absolument de son oncle. « Il a décidé, » lui dit-elle, « qu’après sa mort la propriété doit être à moi. » Le jeune chanoine, qui ignorait cette circonstance, se redressa avec un mouvement d’orgueil blessé, et déclara qu’il n’avait pas eu l’intention de demander la main de la maîtresse de Llanfeare. « Ce ne serait pas une considération pour moi, » continua-t-elle, lisant la pensée du jeune homme sur sa physionomie. « Je n’aurais pas été déterminée par un motif de ce genre. Mais comme mon oncle veut faire de moi sa fille, je lui dois l’obéissance d’une fille. Il n’est pas probable qu’il consente à ce mariage. »
Il n’y avait plus eu de communications entre eux jusqu’au jour où Isabel, de retour à Llanfeare, lui avait écrit que son oncle était opposé au mariage, et qu’il n’y fallait plus penser.
Cette rupture avait fait beaucoup de peine à Isabel, mais elle était en partie l’auteur de sa propre souffrance : elle avait trop dissimulé à son oncle ses sentiments. Quand elle dit au vieillard l’offre qui lui avait été faite, elle en parla comme d’une chose qui lui était presque indifférente.
« William Owen ! » avait dit Indefer, en répétant le nom, « son grand-père tenait l’hôtel à Pembroke !
– Je le crois, dit tranquillement Isabel.
– Et vous voudriez faire de lui le propriétaire de Llanfeare ?
– Je n’ai pas dit cela, répondit Isabel. Je vous ai soumis une proposition qu’on me faisait, et je vous ai demandé ce que vous en pensiez. »
Le vieillard alors secoua la tête, et tout fut dit. Isabel avait écrit la lettre qui informait William que la décision du vieillard était définitive.
Dans tout cet entretien, Isabel n’avait fait aucune allusion à l’amour qu’elle éprouvait. Si elle l’avait fait, son oncle n’aurait pu la presser au sujet du mariage avec son cousin. Mais elle était restée si froide en parlant du jeune ecclésiastique, que, dans la pensée de son oncle, la chose lui tenait très peu au cœur : cet amour était au contraire l’intérêt et le bonheur de sa vie. Et pourtant quand le vieillard, revenant à la charge, lui demanda encore d’aplanir toutes les difficultés par un mariage avec son cousin, elle dut soutenir la conversation comme s’il n’y avait pas eu à Hereford un William Owen qui l’aimait et qu’elle aimait aussi.
Cependant le vieillard se rappelait tout cela : il se rappelait que, quand il avait formellement écarté le chanoine, il l’avait fait par devoir, pour empêcher que Llanfeare ne fût la possession d’un petit-fils d’hôtelier. Que le petit-fils du vieux Thomas Owen, du Lion de Pembroke, régnât à Llanfeare à la place d’un Indefer Jones, c’eût été une abomination qu’il avait été de son devoir de prévenir. Mais les choses étaient différentes maintenant qu’il allait laisser la jeune fille sans fortune, sans un ami, sans un abri qui fût à elle ! Et pourtant, si son nom était Brodrick, elle n’en était pas moins une Jones ; et son père, quoique un simple avoué, était d’une famille presque aussi bonne que la sienne. Dans aucun cas, elle ne pouvait épouser le petit-fils du vieux Thomas Owen. Aussi n’était-il jamais, jusqu’à ce moment, revenu sur la proposition de mariage. Si Isabel lui en avait parlé de nouveau, sa réponse aurait peut-être été moins formelle ; mais elle non plus n’avait depuis lors prononcé le nom de William.
Tout cela était pour Isabel une source de pénibles réflexions ; elle ne disait rien, mais elle pensait encore à celui qui l’aimait ; et il faut reconnaître que, bien qu’elle ne parlât pas de son avenir, elle ne pouvait s’empêcher d’y penser. Elle avait ri à l’idée de solliciter l’héritage, et elle n’aurait jamais voulu ajouter ainsi aux soucis de son oncle ; mais elle comprenait aussi bien que tout autre la différence qu’il y avait entre la position naguère promise de propriétaire de Llanfeare, et celle à laquelle elle serait réduite, comme la bru d’une belle-mère qui ne l’aimait pas. Elle savait aussi qu’elle avait été froide pour William Owen, qu’elle ne lui avait donné aucune espèce d’encouragement en lui laissant croire qu’elle le repoussait parce qu’elle était l’héritière de son oncle. Elle savait aussi ou croyait savoir qu’elle ne possédait pas ces avantages personnels qui font persévérer un homme dans son amour, en dépit des difficultés. Elle n’avait plus entendu parler de William Owen pendant les neuf derniers mois. De temps en temps, elle recevait une lettre de l’une de ses sœurs plus jeunes qui, elles aussi, commençaient à ressentir l’amour et ses soucis. Mais ces lettres ne contenaient pas un mot qui concernât William. Aussi peut-on dire que le dernier changement survenu dans les intentions de son oncle avait été de toute façon pour elle un rude coup.
Mais elle ne proféra jamais une plainte ; jamais son visage ne trahit son chagrin. À qui eût-elle confié sa peine ? Elle avait toujours été réservée avec sa famille sur le sujet de l’héritage ; son père avait montré une égale réserve. La famille d’Hereford la jugeait obstinée et dédaigneuse, peut-être parce qu’elle se montrait telle dans ses relations avec sa belle-mère.
Quoi qu’il en soit, il n’y avait entre elle et sa famille nul échange de confidences au sujet de Llanfeare. Son père ne doutait pas qu’elle ne dût hériter la propriété.
Confiante en elle-même, elle l’était dans une certaine mesure. Elle se croyait une volonté forte et une âme capable de souffrir. Mais sous d’autres rapports, elle se jugeait avec plus d’humilité ; elle ne reconnaissait en elle rien de ce charme féminin qui séduit les hommes. Sa personne physique pouvait attirer l’attention : elle était assez grande, forte, active et d’une agréable physionomie. Son front était large et beau ; ses yeux gris étaient brillants et intelligents ; son nez et sa bouche étaient bien faits ; pas un trait de son visage n’était commun. Mais il y avait chez elle quelque chose de rude ; son teint avait peut-être trop d’éclat ; ses yeux, plus sévères pour elle-même que ceux des autres personnes, voyaient là un défaut. Les fermiers des environs et leurs femmes déclaraient que miss Isabel était la plus belle femme de la Galles du Sud. Avec les fermiers et leurs femmes, elle était en excellents termes : elle connaissait tous leurs usages, et s’intéressait à tous leurs besoins. Elle ne se souciait que peu de la noblesse des environs. Son oncle n’aimait pas à réunir nombreuse compagnie, et elle s’était entièrement conformée aux goûts de son oncle. Aussi ne connaissait-elle pas plus les jeunes gens du pays qu’elle n’était connue d’eux ; et, comme elle n’avait pas d’amitiés, elle se disait qu’elle n’était pas comme les autres jeunes filles, qu’elle était rude, sans charme, impopulaire.
Bientôt arriva l’époque de la venue de Henry Jones. À mesure qu’elle approchait, l’oncle Indefer était de jour en jour de moins en moins à son aise. Isabel n’avait plus dit un mot contre son cousin. Quand il lui avait été proposé comme futur époux, elle avait déclaré son aversion pour lui. À ce moment, le vieillard avait abandonné son projet, ou tout au moins n’en parlait plus. Aussi Isabel nommait Henry et faisait allusion à son arrivée, comme s’il se fût agi du premier hôte venu. Elle veillait à ce que sa chambre fût prête, et à ce qu’il se trouvât confortablement à Llanfeare. Ne serait-il pas bon de commander pour lui un dîner à part ? Trois heures de l’après-midi, ne serait-ce pas une mauvaise heure pour un homme habitué à la vie de Londres ? « Si elle ne lui convient pas, » dit le vieillard avec irritation, il retournera à Londres. » Cette irritation ne s’adressait pas à la jeune fille, mais à l’homme qui, par le seul fait de sa naissance, soulevait ainsi tout un océan d’ennuis.
« Je vous ai dit mes intentions, dit l’oncle à son neveu le soir de son arrivée.
– Je vous suis assurément très obligé, mon cher oncle.
– Vous n’avez pas à m’être le moins du monde obligé. J’ai fait ce que je considère comme un devoir. Je puis prendre d’autres dispositions, si je trouve que vous ne méritez pas d’être mon héritier. Quant à Isabel, elle mérite tout le bien qu’on pourrait lui faire. Elle ne m’a jamais causé le moindre déplaisir. Je ne crois pas qu’il y ait au monde une meilleure créature qu’elle. Mais comme vous êtes l’héritier mâle, je crois régulier que vous me succédiez dans la propriété, à moins que vous ne vous en montriez indigne. »