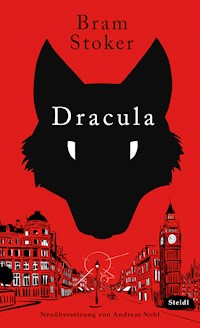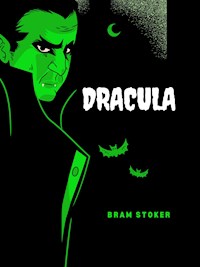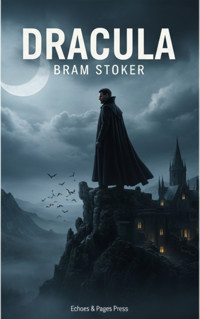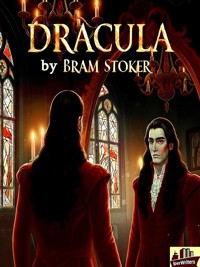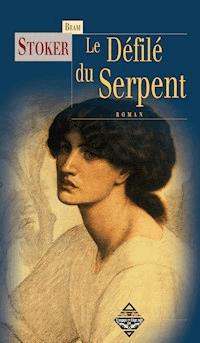
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terre de Brume
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dévorez le premier roman de Stocker, auteur mythique du sanglant Dracula
Arthur Severn, jeune Anglais qui vient d’hériter de la fortune de sa tante, découvre le Connemara. Il s’y éprend de Norah Joyce, dont le père est honteusement spolié par Murtagh Murdock, l’odieux Gombeen Man, usurier rural détesté par toute la communauté paysanne. Il aide son ami Dick Sutherland, géologue, à sonder la « tourbière mouvante » qui, à en croire divers récits, serait à la fois le repaire ultime du Roi des Serpents et le lieu où est enfoui le célèbre trésor perdu par les Français en 1798. C’est l’ouest de l’Irlande, balayé par les pluies et les tempêtes, qui sert de cadre naturel et grandiose à cette histoire d’amour, de cupidité et de dépossession : la « tourbière mouvante » est le lieu inattendu et dangereux d’une exploration à la fois historique, scientifique et fantastique. L’évocation d’une nature à la fois sublime et tourmentée est le prélude et l’accompagnement de l’aventure intérieure qui verra Arthur renaître à une nouvelle vie… Le Défilé du Serpent était resté inédit en français jusqu'à ce jour…
Shleenanaher— « le Défilé du Serpent » — exerce une étrange fascination sur tous ceux qui l’approchent, qu’il s’agisse des autochtones ou d’Arthur Severn, « l’étranger ».
EXTRAIT
Entre deux montagnes de gris et de vert, car le rocher affleurait entre les touffes de verdure émeraude, la vallée, presque aussi étroite qu’une gorge, s’en allait plein ouest vers la mer. Il y avait juste assez de place pour la chaussée, à demi entaillée dans la roche, à côté de l’étroite bande que formait le lac sombre d’une profondeur apparemment insondable loin en contrebas, entre des parois verticales de roche menaçante. La vallée s’ouvrit et la pente se fit raide, le lac devenant un torrent bordé d’écume qui s’élargissait en mares et en lacs miniatures en atteignant le niveau le plus bas. La montagne s’élevait doucement par paliers semblables à des terrasses où la civilisation se laissait entrevoir furtivement, émergeant de la désolation presque primordiale qui nous enserrait : bouquets d’arbres, chaumières, contours irréguliers des champs clos de murs de pierre, avec des tas de tourbe noirs pour les feux de l’hiver, empilés çà et là. Loin au-delà, il y avait la mer, le grand Atlantique, avec un littoral follement irrégulier parsemé d’une myriade de petits groupes d’îlots rocheux ; une mer d’un bleu profond, avec un trait de faible lumière blanche au lointain horizon et, quand le bord de l’eau était visible dans les trouées de la côte rocheuse, ici et là frangée d’une ligne d’écume à l’endroit où les vagues se brisaient sur les rochers ou bien dévalaient en énormes rouleaux sur l’étendue unie des sables.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- « De page en page, la nature prend une place de plus en plus importante, et l'étrange magie qu'elle dégage se pare de reflets surnaturels. Toute cette partie est portée par une poésie farouche et par un sens du mystère qui font vite oublier les conventions de l'histoire d'amour et le conformisme de la fin, qui voit la sauvage Irlandaise devenir une parfaite petite Anglaise... Stoker n'est sans doute qu'un petit maître, mais il mérite largement qu'on le redécouvre, et cela bien au-delà du personnage légendaire qui l'a rendu célèbre. » - Télérama
A PROPOS DE L’AUTEUR
Bram Stoker est né à Dublin en 1847. Après une jeunesse précaire et difficile, il se lança dans le journalisme ses études terminées. En 1871 lui vint l’idée de ce qui allait devenir un des plus célèbres romans de littérature fantastique, Dracula (1897). Il rédigea de nombreuses autres œuvres, parmi lesquelles Le Joyau des Sept Étoiles, disponible pour la première fois en version intégrale dans la collection Terres Fantastiques, et Le Repaire du Ver blanc. Il mourut à Londres en 1912.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mes vifs remerciements à Clíona ní Ríordáin que j’ai mise à contribution pour la traduction des expressions gaéliques.
Pour Nicole Fierobe, ma plus fidèle (re)lectrice.
PRÉFACE
Publié d’abord dans The People en 1889, puis sous forme de livre en 1891, The Snake’s Pass (Le Défilé du Serpent) inaugure une production romanesque qui se déploie sur plus de dix ans (The Lair of the White Worm, Le Repaire du Ver Blanc paraît en 1911). Premier roman, certes, mais Abraham Stoker (1847-1912) n’est pas un inconnu. Cet ancien étudiant de Trinity College devenu fonctionnaire, comme son père avant lui, est en effet l’auteur d’un ouvrage qui fait autorité : The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland, 1878, (Devoirs des employés des juges de paix en Irlande). C’est un homme qui a beaucoup voyagé et beaucoup appris sur l’Irlande rurale du XIXe siècle : il s’en souviendra dans Le Défilé du Serpent. Rédacteur de chroniques théâtrales dans le Dublin Evening Mail et le Warder, il est enthousiasmé par le talent d’Henry Irving qu’il découvre dès 1866 dans Captain Absolute de Richard Brinsley Sheridan. Dix ans plus tard, à l’occasion d’une représentation d’Hamlet à Dublin, il rencontre le célèbre acteur, et c’est le début d’une longue amitié. Il devient régisseur du Lyceum Theatre, fonction qu’il occupera jusqu’à la mort d’Irving en 1905. Installé à Londres, à Cheyne Walk, près de parc de Battersea, après son mariage avec Florence Balcombe en 1878, il se trouve plongé dans une intense vie mondaine et culturelle. Il est un familier des Wilde (Oscar Wilde avait courtisé Florence Balcombe), reçoit Alfred Tennyson, Dante Gabriel Rossetti, ou encore George Eliot, Arthur Conan Doyle et Mark Twain. Il correspond avec le poète américain Walt Whitman, qu’il rencontrera au cours d’une tournée américaine du Lyceum Theatre, et dont il sera l’un des premiers à défendre l’œuvre en Angleterre (une édition de Leaves of Grass sort en 1868 en Angleterre, treize ans après l’édition américaine).
Recueil de nouvelles pour enfants, Under the Sunset paraît en 1882, mais c’est The Snake’s Pass qui, remarqué par la critique, loué aussi bien par le premier ministre Gladstone que par le poète Tennyson, lance la carrière littéraire de Stoker. Se succèdent alors des romans d’amour et d’aventures (Miss Betty, 1898 ; The Man, 1905 ; Lady Athlyne, 1908) et des romans de mystère et de suspense : The Mystery of the Sea, 1902 (Le Mystère de la Mer) ; The Lady of the Shroud, 1909 (La Dame au Linceul) ; The Lair of the White Worm, 1911 (Le Repaire du Ver Blanc) et, bien sûr, Dracula (1897) où Oscar Wilde voit « le plus beau roman du siècle ». Dracula’s Guest and Other Weird Stories (L’invité de Dracula et autres histoires étranges) ne sera publié qu’en 1914.
Dans ses dernières années, la santé de ce « géant aux cheveux roux » (graves problèmes rénaux) qui avait été un enfant délicat, décline peu à peu. En outre, des ennuis financiers conduisent à la liquidation du Lyceum Theatre après la mort d’Irving qui affecte profondément Stoker. Il rédige encore deux volumes de mémoires (Personal Reminiscences of Henry Irving, 1906), et un ouvrage sur les grands mystificateurs de l’histoire (Famous Impostors, 1910). Il meurt le 2 avril 1912, le Times saluant « un écrivain flamboyant ».
Le Défilé du Serpent est le seul roman « irlandais » de Stoker, si on entend par là un roman dont l’action se déroule en Irlande et, en outre, un roman qui prend en compte les réalités géographiques, sociales et culturelles de l’Irlande, en particulier la question des relations avec l’Angleterre. En 1891, l’Union législative entre les deux pays a presqu’un siècle d’existence, et elle marche vers son terme. Mouvements nationalistes, autonomistes ou franchement indépendantistes, coexistent avec maintes formes d’agitation agraire, liée à la question de la possession des terres : les moonlighters apparaissent dans The Snake’s Pass. La Grande Famine, traumatisme majeur, ébranle les fondements mêmes de la société. La domination de « l’Ascendancy », classe possédante et essentiellement protestante, est très affaiblie au sein d’une population catholique. Membre de l’Ascendancy lui-même, Stoker était bien au fait de ce contexte où se mêlait l’aspiration à l’émancipation politique et économique pour la majorité des Irlandais et, pour une minorité, une nostalgie plus ou moins résignée devant la disparition des hiérarchies traditionnelles. Quoi de plus naturel que son « roman irlandais » reflète, jusqu’à un certain point, cet état des choses ? Dans cette optique, Stoker s’aventure sur le chemin de crête entre chronique rurale, roman sentimental et récit fantastique. Il n’était pas le seul à faire ce choix.
Dès 1846, dans Le Prophète noir : un Récit de la Famine en Irlande1, William Carleton avait mobilisé les ressources du « gothique » pour dépeindre le sort effroyable des Irlandais qui mouraient de faim par milliers. Dans Hurrish, une Étude (1886), Emily Lawless, saupoudre son évocation de la violence rurale d’éléments horribles empruntés au roman noir. Avant d’opter pour le réalisme tranchant de La Vraie Charlotte (The Real Charlotte, 1894), roman de ce qui a été appelé « l’été indien de l’Ascendancy anglo-irlandaise », Somerville et Ross (Edith Somerville et sa cousine Violet Martin) font un détour par le « gothique » (Un Cousin irlandais, 1889), mais un « gothique » qui, déjà, se mêle à la peinture sociale.
On pourrait citer bien d’autres romans, romans purement réalistes ou romans hybrides — au sens où le cadre du réel cède sous la pression de forces obscures incontrôlées — où, sous l’intrigue, perce un véritable désir didactique, celui de faire connaître l’Irlande aux lecteurs, celui de dissiper des zones d’ombre ou de réparer des injustices. Se dessine ainsi, à côté de la tradition « gothique » illustrée en Irlande par Charles Robert Maturin et Sheridan Le Fanu, une seconde ascendance du Défilé du Serpent, représentée au premier chef par Maria Edgeworth. Dans Castle Rackrent (1800), elle fournit à son lecteur des notes nombreuses, détaillées, et un copieux glossaire. Dans La Jeune Irlandaise (The Wild Irish Girl, 1806), Lady Morgan fait un tableau précis de la société contemporaine fondée sur une connaissance approfondie de l’Histoire, assorti d’innombrables considérations sur tout ce qui a trait à l’Irlande (musique, langage, médecine, botanique…). Comme elle, les frères Banim, qui décrivent avec minutie le monde paysan (Contes de la Famille O’Hara, 1825 et 1826), fournissent des notes explicatives. On n’en finirait pas de dresser la liste de ces auteurs qui, chacun à sa façon, veulent montrer l’Irlande sous ce qu’ils croient être son vrai jour — ils visent surtout un lectorat anglais —, révéler la misère de l’immense majorité des Irlandais, mais aussi leurs qualités propres, la grandeur de leur civilisation, qui sont ignorées ou niées, stigmatiser l’indifférence ou le dédain qu’on leur manifeste, enfin proposer des solutions pour un avenir meilleur.
La vérité, c’est qu’il n’y a pas d’écrivains strictement réalistes, à visée didactique, pas plus qu’il n’y a de romanciers strictement fantastiques. L’imaginaire, singulièrement celui qui plonge ses racines dans la tradition ou le mythe irlandais, joue toujours un rôle, et c’est dans cette perspective que se situe Le Défilé du Serpent.
Le jeune Arthur Severn est invité par des amis dans le comté de Clare, mais, auparavant, ayant tout son temps, il décide de s’en aller plus à l’ouest pour parfaire sa connaissance des affaires irlandaises, dessein louable, en tout point conforme aux devoirs d’un riche héritier anglais qui vient de terminer son « grand tour » sur le continent. Ce qui l’attend dans la calèche d’Andy, c’est d’abord l’expérience d’une plongée soudaine dans un milieu naturel sublime, à la fois grandiose et effrayant, évoqué à la manière de Lady Morgan (La Jeune Irlandaise) et de Maturin (The Milesian Chief, 1812), c’est-à-dire capable d’opérer un changement radical dans la psyché de l’observateur. Le paysage est hors norme, Arthur se trouve littéralement dans une autre réalité. Il faut que s’opère ce dépaysement pour qu’il lui soit possible d’entendre, et de comprendre, une histoire jusque-là ignorée de lui, des histoires étranges plutôt, où la topographie et la science sont contaminées par le légendaire et l’irrationnel. Les terrains apparemment les plus solides — il ne s’agit pas ici d’une simple métaphore — se dérobent sous les pieds des personnages en effaçant les repères connus. Dès cette première visite, Arthur se demande avec une sorte d’angoisse, si la Colline le « possédera », comme elle en a « possédé » beaucoup d’autres : sa question n’est pas vaine puisqu’il reviendra, attiré par un magnétisme souverain où se conjuguent les forces de la curiosité scientifique et celles de l’amour. Tout commence par cette violente tempête qui sert de toile de fond à l’entrée en scène des personnages (Joyce, Murdock, Moynahan), avec une soudaine théâtralisation de l’action dans un espace clos, la shebeen de la Veuve Kelligan ; tout finit par une prodigieuse convulsion de la nature où les mêmes personnages sont soumis à la loi d’une justice divine rétributive dont le Père Ryan souligne les mystérieux cheminements :
Et, quant à toi, Phelim Joyce, puisses-tu prendre à cœur la leçon de la bonté de Dieu ! Tu pensais, quand on s’est emparé de ta terre et ta maison qu’on t’avait fait grand tort, et que Dieu t’avait déserté ; pourtant, ses voies sont si impénétrables que ce sont ces choses-là qui, justement, t’ont sauvé, toi et tout ce qui t’appartient.
Au bout du compte, tout rentre dans l’ordre après le grand chamboulement, dont l’origine est à rechercher dans le comportement indigne des hommes, ou plutôt dans celui qui est à la fois le gombeen man, l’impitoyable usurier qui édifie sa fortune sur la misère de ceux qui l’entourent, et le digne héritier du « villain » gothique de la tradition. Il appartient de plein droit à l’histoire de l’Irlande et à un imaginaire qui traverse tout le roman noir, figure d’épouvante qui ajoute sa cupidité criminelle à la dureté des temps : qu’on songe par exemple à Darky Skinadre dont Carleton fait « le Génie de la Famine » dans Le Prophète Noir. La tourbière mouvante qui engloutit Murtagh Murdock efface les signes d’une oppression et d’une injustice séculaires, tandis qu’Arthur — « le Prince des fées » — et son ami Dick édifient sur la tabula rasa, un petit paradis, « un pays des fées », avec jardins exquis et eaux courantes. Après une jeunesse apathique, Arthur devient le type même du propriétaire éclairé et paternaliste qui ne se laisse pas griser par l’étendue de sa fortune, mais ne songe qu’à en faire bon usage. De plus, son mariage avec la belle Irlandaise scelle, au moins sur le plan symbolique, une réconciliation entre deux pays que tout oppose depuis longtemps. Andy établit une équivalence malicieuse entre Norah et la tourbière. Or, celle-ci est si caractéristique de l’Irlande qu’à travers elle s’établit une équivalence entre Norah et l’Irlande. D’ailleurs Norah correspond trait pour trait à à la personnification de l’Irlande que L. P. Curtis décrit en ces termes :
Une femme majestueuse autant que triste et sage… aux longs cheveux noirs tombant sur le dos, aux grands yeux mélancoliques dans un visage d’une parfaite symétrie.
William Hughes partage l’avis de Nicholas Daly et David Glover : « La cour faite à Norah Joyce par A. Severn, est un emblème de l’alliance entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. » On pourrait reprocher à Stoker d’idéaliser de façon naïve, conservatrice — et même franchement déplaisante dans la mesure où Arthur favorise l’émigration des paysans irlandais en leur achetant leurs terres — une situation complexe qui ne se dénouera qu’à travers le sang et les larmes. Or, il ne fait que suivre un schéma mis en place par Lady Morgan dans The Wild Irish Girl où le jeune Anglais, Horatio Mortimer épouse Glorvina, « la sauvage Irlandaise » : dans les deux cas, en même temps qu’il s’éprend de la belle Irlandaise, le héros apprend à connaître à la fois le passé glorieux (les légendes, les traditions) et le présent tragique de l’Irlande (les gombeen men et les moonlighters). Il ne s’agit là que d’une esquisse de solution romanesque au problème des relations conflictuelles entre l’Irlande et l’Angleterre au cours du XIXe siècle.
Dans Le Défilé du Serpent, le retour à l’ordre s’effectue d’abord sur le terrain, la topographie retrouvant son état initial : Dick montre bien que le paysage est redevenu ce qu’il était au temps jadis. Il s’effectue ensuite dans les esprits : Norah n’hésite pas longtemps à adopter la condition sociale — anglaise — de celui qu’elle doit épouser pour être digne de lui, et se glisse volontairement, avec l’aval de son père, dans le moule socio-culturel de la gentry. Nulle rébellion, mais une acceptation heureuse de ce qui est pour elle une promotion sociale : elle sacrifie sa jupe rouge traditionnelle pour sauver Arthur, au risque assumé de perdre une partie de son identité, de son « irlandité » ; elle se constitue une nouvelle garde-robe conforme aux exigences du cercle social où elle va pénétrer. Le modèle prôné par Stoker n’est pas indigène : si l’Irlande veut avancer sur la voie de progrès, elle ne pourra le faire qu’en suivant le modèle britannique (ce que font aussi par ailleurs Phelim Joyce, qui devient un homme d’affaires avisé, et son fils, un brillant ingénieur en Angleterre).
Norah ne sombre pas dans la schizophrénie, mais il est dit clairement qu’il y a deux Norah : la ravissante paysanne qu’Arthur émerveillé découvre sur la roche plate de Knockcalltecrore, et la jeune dame parfaitement éduquée qui l’attend sous le porche de l’église le jour de son mariage, qui lui demande s’il est « satisfait », véritable soumission à la référence britannique. L’ancienne Norah s’efface — « J’embrassai Norah Joyce pour la dernière fois » — au profit de Mrs Arthur Severn. Il s’agit d’une mise aux normes, il faut bien appeler les choses par leur nom, qui donne l’impression d’un acquiescement résigné et assez nostalgique à un ordre des choses que Stoker sait menacé : il en donnera la preuve dans Dracula. Après Seamus Deane, Terry Eagleton, et Chris Morash qui écrit : « Carmilla et Dracula traitent tous deux de l’Irlande bien qu’il soient précisément situés en Europe de l’est », j’ai tenté (« Dracula roman irlandais, vraiment ? ») de montrer les profondes résonances irlandaises du chef-d’œuvre de Stoker. Gageons que Stoker n’est pas dupe, et qu’il y a dans la conclusion qu’il donne à son beau conte irlandais une part de lucidité, et qu’il lui plaît de prendre ainsi ses désirs pour des réalités…
Un conte certes, puisqu’il y est question de fées et de lutins, de leprachauns, de tout ce « bon peuple » qui hante les campagnes irlandaises et dont il est beaucoup question autour du feu de tourbe dans une shebeen, un verre de punch ou de poteen à la main. Andy, qui s’y connaît en matière de conquêtes féminines, sait de quoi il retourne dès le début. Il convie donc celui qu’il appelle familièrement « Master Art » à cesser de poursuivre l’insaisissable sylphide de Knockcalltecrore pour se tourner vers la créature de chair et de sang de Knocknacar. De chair et de sang certes, car c’est bien de ça qu’est faite la femme idéale dont les deux hommes tentent de dessiner le portrait, au cours d’une séance de questions/réponses où Andy attire malicieusement son maître sur le terrain piégé de la matérialité du corps féminin, qui ne doit être ni trop gras ni trop maigre mais « entrelardé, comme du lard de poitrine ». Nous voici loin des fées… Ce cocher facétieux est un avatar d’un type bien connu dans la littérature, le « stage Irishman », sorte de caricature de l’Irlandais typique, buveur, bavard et irresponsable, dont le public anglais était friand, mais qui déclenchera la colère des nationalistes irlandais. Stoker ne donne pas dans ce travers, bien au contraire il réhabilite le personnage : Andy est certes bavard et buveur, mais il est plein de bon sens, d’un grand dévouement, et il sait renseigner ou mettre en garde son maître qui, il faut l’avouer, manque singulièrement de perspicacité. Et surtout, il joue le rôle capital d’intermédiaire entre les deux cultures : grâce à lui Arthur s’acclimate, fait la connaissance de ceux qui peuvent raconter les anciennes légendes, découvre ces fameuses tourbières qui sont à la fois source de bien-être et d’effroi. Pour Andy, le réel et l’imaginaire coexistent sans se détruire mutuellement. La « tourbière mouvante » de Knockcalltecrore est étroitement associée à Murdock, non seulement par le cheminement normal de l’intrigue, mais plus encore et, avec insistance, par les rêves d’Arthur. Marie-Noëlle Zeender a bien montré qu’ils « annoncent la catastrophe et résolvent symboliquement par étapes successives, les énigmes de la tourbière… Murdock, par exemple, se confond avec le Roi des Serpents. » Deux exemples :
Ainsi Murdock avait toujours un rôle dans les scènes sinistres et se trouvait mêlé de façon inextricable avec le Roi des Serpents. Ils échangeaient librement leur personnalité et, à un moment, je vis le Gombeen Man défier saint Patrick, tandis qu’à un autre le Serpent semblait lutter avec Joyce, et après s’être enroulé autour de la montagne, n’être défait que par un coup puissant donné par le père de Norah, et se précipiter dans la mer à travers le Shleenanaher.
Puis Norah et moi marchions ensemble sans but quand soudain un énorme serpent qui avait le visage maléfique de Murdock dressa ses anneaux à nos côtés, et en un instant Norah me fut arrachée et emportée dans la tourbière, et moi j’étais impuissant à la sauver ou même à l’aider.
En dernier ressort, par sa passion du lucre insensée, par ses agissements irraisonnés, en dépit des avertissements de Dick, le gombeen man transforme un danger potentiel, évitable, en cataclysme incontrôlable, exemple de cette colère chtonienne qu’on se plaît à déceler dans les convulsions de la nature, les avalanches, les éruptions ou les tremblements de terre. « Tapis de mort », la tourbière est parcourue d’étranges soubresauts, elle s’anime et se gonfle chaque jour davantage, semblable à un puissant animal qui s’apprête à bondir. Avec M.-N. Zeender notons ici que la tourbière est un « océan de putréfaction qui évoque déjà le cloaque du monstrueux Ver Blanc du dernier roman de l’auteur ». Apparaît le plus hideux de tous les animaux, celui qui provoque la plus grande répulsion, qui est à l’origine de tous les maux de l’humanité : le « Roi des Serpents » avait en effet trouvé refuge au sein de la tourbière d’où saint Patrick s’était efforcé de le déloger. Ainsi se trouvent réconciliés une réalité géologique décrite par Dick avec un soin minutieux, et une légende, rapportée par Jerry Scanlan, qui met aux prises paganisme et christianisme dans « l’île des saints et des savants » : de son propre gré, le Roi des Serpents se précipite dans l’océan en ouvrant dans le roc une brèche connue désormais sous le nom de « Shleenanaher » (« Défilé du serpent ») ; des siècles plus tard, « la tourbière mouvante » brise tous les obstacles pour emprunter à son tour le Shleenanaher : « Puis, à travers le Défilé, les millions de tonnes de vase, de boue, de tourbe, de terre et de fragments rocheux se précipitèrent dans la mer. » Dick a raison : « Il y a une base scientifique à la légende. » On saura gré à l’auteur d’avoir été au nombre de ceux, ils sont rares, qui ont attiré l’attention sur cette convergence féconde.
Mais la tourbière n’est pas seulement une entité menaçante, son rôle est plus complexe. Elle « livre ses secrets au lendemain de la catastrophe », elle recèle en effet de multiples et stupéfiantes richesses : le coffre au trésor laissé là par les Français lors de l’expédition du général Humbert en 1798 ; la « couronne d’or perdue » de la légende contée au coin du feu de la shebeen un soir de tempête ; les inscriptions ogham — « Ogham ! l’une des écritures les plus anciennes et les moins connues » — ; et pour finir, un mirifique filon de pierre à chaux. En un mot, dans la tourbière sont superposées les strates successives et complémentaires de la légende, de l’histoire et de la science : c’est une véritable mémoire de l’Irlande, et c’est tout à l’honneur de Stoker d’en avoir eu l’intuition dans Le Défilé du Serpent, en rassemblant, fût-ce de façon un peu naïve, les fils du récit à la fin de son livre. Seamus Heaney, (Prix Nobel de littérature en 1995) donnera de cette intuition une formulation précise :
Ainsi, se fit jour en moi l’idée que la tourbière était la mémoire du paysage, ou un paysage qui se souvenait de tout ce qui lui était arrivé, et de ce qui était arrivé en lui… une grande partie de l’héritage matériel irlandais le plus précieux a été « trouvé dans une tourbière ».
Dans Le Défilé du Serpent, la tourbière est ce qu’elle sera dans la poésie de Heaney, ce que par ailleurs j’essayais de définir comme « le lieu de tous les commencements, de toutes les naissances et de toutes les renaissances ». C’est grâce à son intérêt pour la tourbière qu’Arthur fera la connaissance de Norah, c’est de l’emprise de la « tourbière mouvante » qu’il sera sauvé par le courage et la force de Norah, c’est dans la tourbière que Joyce récupérera le trésor des Français qu’il restituera en toute justice au peuple irlandais, c’est dans la brèche où elle est passée que Dick découvrira la pierre à chaux, c’està-dire de quoi construire l’avenir, au sens le plus matériel du terme. La tourbe est instable et dangereuse, mais paradoxalement, c’est elle, par l’intérêt qu’elle suscite, par les recherches menées à son sujet, qui assure la prospérité de la région et permet la naissance d’un nouveau jardin d’Éden.
Faut-il alors regretter que Stoker n’ait pas continué dans cette voie et, pour le reste de son œuvre, se soit définitivement éloigné des terres irlandaises ? Sûrement pas. Parce qu’il a déjà dit beaucoup de choses sur son pays dans Le Défilé du Serpent, et en outre parce qu’il a mis en place un registre narratif, avec ses thèmes et ses personnages, dont il ne s’écartera jamais beaucoup, même si géographiquement, l’action se situe bien loin de l’ouest irlandais. Comme Murtagh Murdock préfigure le comte Dracula, Dick Sutherland et Arthur Severn préfigurent les quatre hommes qui se liguent pour défendre Mina Harker et Lucy Westenra ; on a vu que le Roi des Serpents annonce le hideux Ver blanc. Et surtout, la tourmente qui balaie les routes de l’ouest, la vie inquiétante de la tourbière, le pouvoir de la Colline de Knockcalltecrore de « tenir », de « posséder », ceux qui sont assez audacieux ou assez fous pour la défier, comme les cauchemars dont l’horreur jette Arthur en bas de son lit, préludent à ce grand dérangement qui règne dans les romans à venir de Stoker : les forces de la nature déchaînées se combinent à un surnaturel séculaire, dont le temps n’a pas affaibli le pouvoir, pour donner à l’intrigue cette étrangeté propre aux récits fantastiques.
Claude FIEROBE
TEXTES CITÉS
Barbara BELFORD, Bram Stoker : A Biography of the Author of Dracula, London, Weidenfield and Nicolson, 1996.
William CARLETON, Le Prophète Noir, Un Récit de la Famine en Irlande, Rennes, Terre de Brume, 2006.
L. P. CURTIS, Apes and Angels, The Irishman in Victorian Caricature, Newton Abbot, David and Charles, 1971.
Nicolas DALY, « Irish Roots : The Romance of History in Bram Stoker’s The Snakes’s Pass », Literature and History, 4/2, 1995, pp.42-70.
Seamus DEANE, Strange Country, Modernity and Nationhood in Irish Writing since 1790, Oxford, Clarendon, 1997.
Terry EAGLETON, Heathcliff and the Great Hunger, London-NewYork, Studies in Irish Culture, Verso Books, 1995.
Claude FIEROBE, « La tourbière comme mémoire et mythe dans la poésie de Seamus Heaney », Études Irlandaises, n° XIII-I, nouvelle série, juin 1988, pp.127-138.
Claude FIEROBE, « Dracula roman irlandais, vraiment ? », Claude FIEROBE éd., Dracula, Mythe et métamorphoses, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2005.
David GLOVER, Vampires, Mummies, and Liberals, Durham, NC, Duke UP, 1996.
Seamus HEANEY, Preoccupations, Selected Prose 1968-1978, London-Boston, Faber and Faber, 1980.
William HUGHES, Beyond Dracula, Bram Stoker’s Fiction in its Cultural Context, Houndsmill, Basingstoke, Macmillan, 2000.
Chris MORASH, « The Time is Out of Joint (O Cursed Spite) », Bruce STEWART, ed., That Other World : The Supernatural and the Fantastic in Irish Literaure and its Contexts, 2 vols., Gerrards Cross, Colin Smythe, 1998, pp. 123-143.
Marie-Noëlle ZEENDER, « L’Irlande Romantique et Fantastique dans The Snake’s Pass », Études Irlandaises, n° XVIII-I, nouvelle série, juin 1993, pp. 39-48.
1.Le Prophète noir, William Carleton, préface de Claude Fierobe, coll. « Terres mystérieuses », Terre de Brume, Rennes, 2006.
CHAPITRE PREMIER
UNE SOUDAINE TEMPÊTE
Entre deux montagnes de gris et de vert, car le rocher affleurait entre les touffes de verdure émeraude, la vallée, presque aussi étroite qu’une gorge, s’en allait plein ouest vers la mer. Il y avait juste assez de place pour la chaussée, à demi entaillée dans la roche, à côté de l’étroite bande que formait le lac sombre d’une profondeur apparemment insondable loin en contrebas, entre des parois verticales de roche menaçante. La vallée s’ouvrit et la pente se fit raide, le lac devenant un torrent bordé d’écume qui s’élargissait en mares et en lacs miniatures en atteignant le niveau le plus bas. La montagne s’élevait doucement par paliers semblables à des terrasses où la civilisation se laissait entrevoir furtivement, émergeant de la désolation presque primordiale qui nous enserrait : bouquets d’arbres, chaumières, contours irréguliers des champs clos de murs de pierre, avec des tas de tourbe noirs pour les feux de l’hiver, empilés çà et là. Loin au-delà, il y avait la mer, le grand Atlantique, avec un littoral follement irrégulier parsemé d’une myriade de petits groupes d’îlots rocheux ; une mer d’un bleu profond, avec un trait de faible lumière blanche au lointain horizon et, quand le bord de l’eau était visible dans les trouées de la côte rocheuse, ici et là frangée d’une ligne d’écume à l’endroit où les vagues se brisaient sur les rochers ou bien dévalaient en énormes rouleaux sur l’étendue unie des sables.
Le ciel était une révélation pour moi, et semblait presque effacer mes souvenirs de ciels d’une grande beauté ; pourtant je revenais du sud et j’avais ressenti l’ivresse de cette nuit d’Italie où, dans le ciel d’un bleu profond, le chant du rossignol semble suspendu comme si le son et la couleur n’étaient que les expressions différentes d’un même sentiment.
Tout l’ouest était une masse somptueuse de violet, de soufre et d’or, et de grands amas de nuages de tempête s’amoncelaient au point que les cieux eux-mêmes paraissaient chargés d’un fardeau trop lourd à supporter. Des nuages violets, dont le centre était presque noir et dont la lisière extrême se teintait d’un or ardent ; de grandes traînées et des masses nuageuses du jaune le plus pâle qui soit, s’assombrissant pour devenir safran et rouge-feu, semblaient s’emparer du proche couchant pour en faire rejaillir l’éclat sur le ciel de l’est.
C’était la plus belle vue que j’eusse jamais contemplée et, accoutumé seulement, comme je l’avais été jusque là, à la beauté pastorale d’une campagne d’herbages, avec des visites occasionnelles au domaine bien boisé de ma grand-tante dans le sud de l’Angleterre, rien de surprenant à ce qu’elle retienne mon attention et captive mon imagination. Même les six mois de mon court voyage en Europe, tout juste terminé, ne m’avaient rien montré de la sorte.
La terre, la mer et l’air, tout témoignait du triomphe de la Nature et proclamait sa majesté et sa beauté sauvages. L’air était calme, d’un calme de mauvais augure. Tout était si calme que, dans le silence qui semblait nous opprimer comme les murs d’une prison, nous parvenait le grondement de la mer lointaine, la grand houle de l’Atlantique se brisant en ressac sur les rochers ou prenant d’assaut les cavernes creusées dans le rivage.
Même Andy, le cocher, très impressionné, était pour l’occasion réduit à un silence relatif. Jusque-là, durant un voyage de presque quarante milles, il m’avait fait partager ses expériences, exposant ses vues, exprimant ses opinions ; en fait, il m’avait déversé le savoir qu’il avait accumulé à propos de toute la région et des ses habitants, y compris, leurs noms, leurs histoires, leurs affaires de cœur, leurs espoirs et leurs peurs, tout ce qui concourt à faire la vie et l’intérêt d’un coin de campagne.
Aucun barbier, si l’on prend ce commerçant comme illustration de l’idée que se fait le peuple de la loquacité in excelsis, n’est plus obstinément bavard qu’un cocher irlandais à qui a été accordé le don de la parole. Il n’y a absolument aucune limite à ses capacités, car toute modification de l’environnement offre un thème nouveau et met sur le tapis une multitude d’objets exigeant un long discours.
Je fus bien aise que ce « brillant éclair de silence » eût lieu à cet instant précis, car non seulement je souhaitais boire des yeux, pour m’en imprégner, la splendeur nouvelle et grandiose de la scène qui s’ouvrait devant moi, mais je voulais comprendre aussi pleinement que possible quelle sorte de pensée profonde elle éveillait en moi. Cela avait pu être la grandeur et la beauté de la scène, ou peut-être était-ce le tonnerre qui emplissait l’air en ce soir de juillet, mais je me sentais pris d’une étrange exaltation et, en même temps pénétré d’un sentiment nouveau de la réalité des choses. En traversant cette vallée qui s’ouvrait, avec le puissant Atlantique au-delà et les nuages qui s’amoncelaient au-dessus de nos têtes, c’était presque comme si je passais vers une vie nouvelle et plus réelle.
D’une certaine manière, il m’avait semblé récemment que je m’éveillais. Mon voyage à l’étranger avait dissipé peu à peu mes vieilles idées engourdies, ou, peut-être, avait triomphé des forces négatives ayant jusque-là dominé ma vie. À présent, cette explosion glorieuse de beauté naturelle et sauvage — la majesté de la nature dans toute sa plénitude — paraissait avoir achevé de me réveiller, et il me semblait que pour la première fois, les yeux ouverts, je regardais la beauté et la réalité du monde.
Jusqu’alors, j’avais mené une vie apathique, et j’étais de maintes façons plus jeune, et de toute façon plus dépourvu de connaissance du monde que les autres jeunes gens de mon âge. Je venais seulement de sortir de l’adolescence, et de tout ce qui va avec l’adolescence, pour entrer dans l’âge d’homme, et même alors je n’étais guère à l’aise dans ma nouvelle position.
Pour la première fois de ma vie, j’avais eu des vacances, de vraies vacances, celles qu’on peut prendre quand on peut choisir sa propre façon de s’amuser.
J’avais été élevé d’un manière extrêmement paisible par un vieil ecclésiastique et son épouse dans l’ouest de l’Angleterre et, à l’exception de mes condisciples, pas plus d’un seul à la fois en toutes occasions, j’avais eu peu de compagnie. Tout compte fait, je connaissais très peu de monde. J’étais le pupille d’une grand-tante riche et excentrique, d’un naturel sévère et intransigeant. Quand mes père et mère périrent en mer, en me laissant, moi, enfant unique, sans la moindre ressource, elle se chargea de payer ma scolarité et de me mettre le pied à l’étrier, si je montrais assez d’aptitude pour une profession quelconque. Mon père avait été pratiquement mis à l’écart par sa famille en raison de son mariage avec ce qu’elle considérait comme une personne de condition inférieure et, pour eux deux, on m’avait dit que la vie avait été assez difficile. Je n’étais qu’un tout petit garçon quand ils se perdirent dans le brouillard en traversant la Manche, et le vide que me causa leur perte me fit paraître probablement encore plus obtus que je n’étais. Comme je ne m’attirais pas beaucoup d’ennuis et que je ne me montrais pas d’un caractère particulièrement agité, ma tante, je suppose, considéra comme acquis que j’étais très bien là où j’étais : quand, au cours de ma croissance, on ne put plus entretenir la fiction que j’étais écolier, on appela « tuteur » au lieu de « précepteur » le vieil ecclésiastique, et je passai avec lui les années que les jeunes hommes de la classe plus aisée passent d’habitude à l’université. Ce changement nominal de situation ne compta pas beaucoup pour moi, si ce n’est qu’on m’enseigna à monter et à tirer au fusil, et qu’on me donna, dans l’ensemble, les rudiments d’une éducation propre à faire de moi un gentilhomme campagnard. Selon moi, mon précepteur avait quelque accord secret avec ma grand-tante, mais il ne me fit jamais la moindre allusion que ce soit aux sentiments qu’elle avait pour moi. Chaque année, je passais une partie de mes vacances chez elle, un magnifique domaine de campagne. Là, j’étais toujours traité par la vieille dame avec une stricte sévérité, mais avec les meilleures manières qui soient, et avec affection et respect par les serviteurs. Il y avait une multitude de cousins, garçons et filles, en visite à la maison, mais je peux dire honnêtement qu’aucun d’eux ne me traita jamais cordialement. C’était peut-être ma faute, ou la conséquence malheureuse de ma timidité, mais je ne rencontrais jamais l’un d’eux sans qu’on me fît sentir que « je n’étais pas des leurs ».
Je peux maintenant comprendre que leur attitude à mon égard se nourrissait de leurs soupçons, et je me souviens en effet de ce jour où la vieille dame, qui avait été si sévère avec moi toute ma vie, me fit venir alors qu’elle gisait sur son lit de mort et, prenant ma main dans la sienne et la tenant serrée, dit en cherchant sa respiration :
– Arthur, j’espère ne pas m’être trompée, mais je t’ai élevé de façon à ce que le monde ait pour toi du bon ainsi que du mauvais, du bonheur aussi bien que du malheur, pour que tu puisses trouver des plaisirs là où tu pensais qu’il n’y en avait que peu. Ta jeunesse, mon cher enfant, n’a pas été heureuse, mais c’est parce que moi, qui aimais ton cher père comme s’il avait été mon propre fils, et avec qui j’ai eu la faiblesse de me brouiller jusqu’à ce qu’il soit trop tard, je voulais que tu deviennes un homme bon et heureux.
Elle ne dit rien de plus, mais ferma les yeux en me tenant toujours la main. Je craignais de la retirer de peur de la déranger, mais bientôt l’étreinte se relâcha et je me rendis compte qu’elle était morte.
Je n’avais jamais vu quelqu’un de mort, encore moins quelqu’un mourir, et cet événement me fit forte impression. Mais la jeunesse a du ressort, et la vieille dame n’avait jamais eu une grande place dans mon cœur.
À la lecture du testament, on découvrit que j’étais l’héritier de tous ses biens, et que je serais appelé à prendre place parmi les magnats du comté. Je ne pouvais pas d’emblée assumer ce rôle et, comme j’étais d’un naturel réservé, je décidai de passer au moins quelques mois à voyager. C’est ce que je fis et, à mon retour, après un périple de six mois, j’acceptai l’invitation cordiale de quelques-uns des amis que je m’étais faits en voyageant et leur rendis donc visite dans leur demeure du comté de Clare.
Disposant de mon temps, ayant une ou deux semaines de battement, je m’étais arrêté à l’idée d’améliorer ma connaissance des affaires irlandaises en faisant un détour par quelques-uns des comtés de l’ouest pour rejoindre celui de Clare.
À cette époque, je commençais juste à comprendre que la vie offre de nombreux plaisirs. Chaque jour, un monde nouveau plein d’intérêt semblait s’ouvrir devant moi. L’expérience tentée par ma grand-tante pouvait être encore couronnée de succès.
C’est alors que j’avais pris clairement conscience de la transformation effectuée en moi : elle m’était apparue avec la soudaineté inattendue du premier rayon de l’aube à travers les brumes du matin. Ce devait être pour moi un instant mémorable et, comme je voulais conserver l’intégralité de ce souvenir, je m’efforçai de ne rien manquer de la scène où une telle révélation s’était faite en moi pour la première fois. Dans mon esprit je m’étais fixé un point central propre à servir de support à ma mémoire, un promontoire situé juste sous le trajet direct du soleil, quand je fus interrompu par une remarque qui ne s’adressait pas à moi mais, apparemment, à l’univers en général :
– Musha1 ! C’est qu’il vient vite.
– Qu’est-ce qui vient ? demandai-je.
– L’orage ! Vous voyez pas comme ces nuages filent ? Ma foi, beau temps qu’ce s’ra pour les canards, et ça dans pas longtemps !
Je ne prêtai pas grande attention à ses paroles car le spectacle occupait toutes mes pensées. Nous descendions rapidement et, en approchant du bas de la vallée, le promontoire semblait prendre un relief plus hardi pour commencer à dessiner le contour d’une colline arrondie d’assez nobles proportions.
– Dis-moi, Andy, comment appelle-t-on la colline là-bas ?
– La colline qu’est là-bas, c’est ça ? Eh bien, on l’appelle Shleenanaher.
– Alors c’est la Montagne de Shleenanaher ?
– Pardieu non ! La montagne s’appelle Knockcalltecrore. C’est de l’irlandais.
– Et qu’est-ce que ça signifie ?
– Ma foi, je crois que c’est un p’tit nom pour dire la Colline de la Couronne d’Or Perdue.
– Et que veut dire Shleenanaher, Andy ?
– Sûr qu’c’est une petite fente entre les rochers là-bas qu’on appelle Shleenanaher.
– Et qu’est-ce que ça signifie ? C’est de l’irlandais, je suppose ?
– Tout juste ! C’est bien de l’irlandais, et ça veut dire le Défilé du Serpent.
– Vraiment ! Et peux-tu me dire pourquoi on l’appelle ainsi ?
– Pardieu ! Des tas d’raisons qu’on donne, pour l’appeler comme ça. Attendez qu’on voie Jerry Scanlan ou Bat Moynahan, là-bas, à Carnacliff ! Sûr qu’y connaissent toutes les légendes et les histoires de la baronnie, et qu’y les racontent toutes, si ça vous chante. Fichtre ! Musha, le voilà qu’arrive !
En effet, il arrivait pour de bon. L’orage sembla envahir toute la vallée en un seul instant ; une clameur succéda au silence, des nuages de pluie poussés par le vent obscurcirent l’air. C’était comme si un tuyau avait explosé, et la trombe d’eau se déversa si soudainement que je fus trempé jusqu’aux os avant d’avoir pu m’envelopper de mon imperméable. La jument parut d’abord effrayée, mais Andy la tenait d’une main ferme en lui prodiguant des paroles rassurantes et, passé le premier assaut de la tempête, elle continua d’une allure aussi calme et imperturbable qu’auparavant, les éclairs et les coups de tonnerre ne causant que de légères dérobades.
La splendeur de cet orage reste ancrée dans ma mémoire. Les éclairs surgissaient en nappes éclatantes qui semblaient fendre le ciel et jetaient des lueurs bizarres parmi les collines parcourues d’ombres étranges et profondes. Chaque coup de tonnerre éclatait à présent avec une violence alarmante juste au-dessus de nos têtes ; il résonnait, ballotté d’un flanc de colline à l’autre, grondant et se répercutant dans le lointain, et ses éclats de voix les plus distants se perdaient dans le fracas de ceux qui le suivaient.
Nous poursuivions notre route dans la tourmente déchaînée, de plus en plus vite ; mais la tourmente ne se calmait pas d’un iota. Andy était trop absorbé par sa tâche pour parler ; quant à moi, j’occupais tout mon temps à me maintenir sur la calèche qui vacillait et tanguait, et à cramponner mon chapeau et mon imperméable pour me protéger au mieux des trombes d’eau. Andy paraissait être au-dessus de toute considération de confort personnel. Il releva le col de son manteau, voilà tout, et bientôt fut aussi luisant que mon plaid imperméable. À dire vrai, il semblait dans l’ensemble être aussi à l’aise que moi, ou même mieux, car nous étions tous deux aussi mouillés qu’on pouvait l’être et, tandis que je m’efforçais péniblement de me protéger de la pluie, il était quitte de toute responsabilité et de tout souci en ce domaine.
Finalement, alors que nous abordions un long bout de route à plat, il se tourna vers moi :
– M’sieur, ça n’sert à rien d’continuer comme ça jusqu’à Carnaclif. Cette tempête va durer des heures. Je connais bien ça, dans ces montagnes, quand donne l’vent du nord-est. Ce s’rait pas mieux qu’on s’abrite un moment ?
– Bien sûr que si, dis-je. Essaie tout de suite. Où peux-tu aller ?
– M’sieur, y’a un coin à deux pas, la shebeen2 d’la Veuve Kelligan, au carrefour de Glennashaughlin. C’est tout près. Hue, vieille crécelle ! Chez la Veuve Kelligan, à toute allure !
Ce fut presque comme si la jument le comprenait et partageait ses souhaits, car elle prit de la vitesse pour s’engager dans un chemin qui s’ouvrait un peu sur notre gauche. En quelques minutes nous atteignîmes le carrefour, et également la shebeen de la Veuve Kelligan, une chaumière basse blanchie à la chaux, au fond d’un creux entre des hauts talus dans le coin sud-ouest de la croix. Andy sauta à terre et se précipita vers la porte.
– Voilà un monsieur qui n’est pas d’ici, Widdy, occupe-toi de lui, cria-t-il au moment où j’entrais.
Je n’avais pas encore réussi à fermer la porte derrière moi qu’il dételait la jument avant de la mettre à l’écurie, un appentis construit derrière la maison contre le haut talus.
L’orage avait, semble-t-il, déjà envoyé toute une troupe vers l’abri hospitalier de Mrs Kelligan. Un grand feu de tourbe ronflait dans la cheminée et, tout autour, debout, assis ou couchés, dans un nuage de vapeur, presque une douzaine de gens, hommes et femmes, étaient rassemblés. La pièce était grande et la cheminée si profonde que tout un chacun, ou presque, y trouvait une place. Le toit était noir, chevrons et chaume sans distinction ; des coqs et des poules en nombre avaient trouvé refuge dans les chevrons à l’extrémité de la pièce. Au-dessus du feu, une grosse marmite pendait à un fil de fer, et une odeur délicieuse de whiskey et de harengs grillés, appétissante au-delà de toute expression, envahissait la pièce.
À mon entrée, tout le monde se leva, et je me trouvai installé sur un siège bien chaud tout près du feu, tandis que des salutations variées bourdonnaient autour de moi. La chaleur me faisait le plus grand bien, et j’essayais d’exprimer ma gratitude pour l’abri et pour l’accueil, tâche où je me sentais très emprunté, quand Andy pénétra dans la pièce par la porte de derrière en lançant : « Que Dieu garde toute la compagnie ! »
Il jouissait à l’évidence d’une grande popularité, car une véritable pluie d’expressions cordiales se déversa sur lui. Il fut placé près du feu, lui aussi, et on lui mit entre les mains un bol de punch fumant, semblable à celui qu’on avait déjà mis dans les miennes. Andy eut tôt fait de goûter le punch. Je fis de même, et je peux dire honnêtement que s’il y prit plus de plaisir que moi, il dut vraiment passer quelques minutes de grand bonheur. Il ne lui fallut pas longtemps pour mettre tout le monde à l’aise, à commencer par lui-même.
– Hourra ! dit-il. Musha ! mais on arrive juste à temps. La mère, est-ce que le hareng est cuit ? Amène le panier et verse les patates ; elles sont à point, ou alors mes sens m’induisent en erreur. M’sieur, on a une chance formidable ! Il y a du hareng, et ç’aurait pu être seulement patates et bras tendu.
– Qu’est-ce que c’est ? demandai-je.
– Oh, c’est quand il n’y a qu’un seul hareng pour un tas de gens, trop peu pour que chacun y goûte, alors on l’met au milieu et on tend les patates vers lui pour qu’il lui donne du fumet.
Tout le monde donna un coup de main pour préparer le souper. Un grand panier à pommes de terre, qui aurait pu en contenir environ deux cents livres, fut retourné, la marmite fut retirée du feu et son contenu, une grosse masse de pommes de terre fumantes, renversé dessus. On prit du gros sel dans une boîte, et une poignée en fut placée de chaque côté du panier. Les harengs furent coupés en morceaux, on en donna un morceau à tout le monde : le dîner était servi.
Il n’y avait pas d’assiettes, pas de couteaux, pas de cuillères, pas de cérémonie, pas de préséance, et il n’y avait pas non plus d’animosité, de jalousie ou de gloutonnerie. Je n’ai jamais pris part à un repas plus heureux, ni ne me suis régalé davantage. Tel qu’il était, il était parfait. Les pommes de terre étaient bonnes et cuites à la perfection, on les prenait avec les doigts, on les pelait comme on pouvait, on les trempait dans le sel et on mangeait jusqu’à être rassasié.
Pendant le repas plusieurs inconnus entrèrent encore et, selon eux, il n’y avait aucun signe d’apaisement de la tempête. À dire vrai, une telle confirmation n’était guère nécessaire, car les furieux coups de fouet de la pluie et les hurlements de la tourmente qui cinglait la façade de la maison en disaient assez long pour convaincre l’entendement le plus borné.
Le dîner fini et le panier retiré, nous nous resserrâmes autour du feu, allumâmes notre pipe, une grande cruche de punch fumant fit son apparition et la conversation devint générale. Bien sûr, étant pour eux un étranger, j’accaparai une bonne partie de l’attention.
Andy fit de son mieux pour que les choses m’intéressent et, quand il déclara, à ma demande, que j’espérais être autorisé à offrir le punch de la soirée, sa popularité en fut augmentée, et la mienne établie. Après avoir attiré l’attention sur plusieurs sujets évoquant des histoires, des plaisanteries et des anecdotes locales, il déclara :
– C’monsieur m’demandait juste avant qu’arrive l’orage pourquoi le Shleenanaher s’appelait comme ça. Je lui ai dit que personne ne pourrait lui dire aussi bien que Jerry Scanlan ou Bat Moynahan, et tous les deux sont ici, pour sûr. Allons, les gars, vous ne voulez pas obliger le monsieur qu’est pas d’ici, en lui racontant c’que vous savez d’ces histoires à propos de la colline ?
– Avec le plus grand plaisir, dit Jerry Scanlan, un homme de haute stature, d’âge moyen, au long visage rasé de près, l’œil plein d’humour, les coins de son col de chemise lui montant presque jusqu’aux yeux par devant, tandis que l’arrière se perdait dans les profondeurs du col de son manteau de ratine.
« Pardieu, Monsieur, je vais vous raconter tout c’que j’ai entendu. Sûr qu’il y a une légende, et qu’il y a une histoire, musha ! mais des légendes et des histoires il y en a quelques-unes, mais il y a une légende au-dessus de toutes les autres, dis donc la Mère Kelligan, remplis mon verre, j’suis pas beau parleur quand j’ai l’gosier sec. Dites-moi, Monsieur, est-ce qu’on offre le punch aux Membres du Parlement quand ils parlent ?
Je secouai la tête.
– Musha ! alors, moi on ne m’aura jamais comme député tant qu’on n’aura pas changé la loi ! Merci, Mrs Kelligan, c’est tout bon pour moi. Et maintenant, cette légende qu’on raconte de Shleenanaher.
1.Musha ! : En vérité ! Mon Dieu !
2.Shebeen : Débit de boissons illégal, (de l’irlandais séibin), orthographié aussi « sheebeen » en d’autres endroits du livre.
CHAPITRE II
LA COURONNE D’OR PERDUE
« Eh bien, dans les vieux temps anciens, avant que saint Patrick bannisse les serpents hors d’Irlande, la colline là-bas était un endroit d’une importance tout à fait formidable. Car, plus que certain, c’était le Roi des Serpents lui-même, et personne d’autre, qui y vivait. Dans ces temps-là, il y avait, tout en haut de la colline, un p’tit lac de rien du tout, avec des arbres et des laiches et des choses com’ça qui poussaient autour, et c’était là que le Roi des Serpents faisait son nid, ou quel que soit le nom que les serpents donnent à leur maison. Gloire à Dieu ! Mais tous autant que nous sommes, nous ne savons rien du tout d’eux, rien du tout, depuis que saint Patrick les a pris en main.
Ici, il fut interrompu par un vieil homme dans le coin de la cheminée :
– Tu as raison, acushla1, le petit bout de lac est toujours là, sauf que probable qu’il est à sec à présent, à sec, et tous les arbres ont disparu.
– Bon, poursuivit Jerry, pas mécontent qu’on corrobore son histoire, le Roi des Serpents était formidablement important, vraiment. Plus de dix fois plus gros que n’importe quel serpent que n’importe qui ait jamais d’ses yeux vu, et il avait sur le dessus de sa tête une couronne d’or avec dedans une grosse pierre précieuse qui prenait la couleur de la lumière, qu’elle vienne du soleil ou de la lune, et tous les serpents, chacun son tour, devait apporter de la nourriture et la laisser pour lui le soir à la fraîche, alors il sortait la manger et il retournait chez lui. Et on dit que chaque fois qu’deux serpents s’disputaient, ils devaient venir vers le Roi qui tranchait entre eux, et il disait à chacun où il devait vivre et ce qu’il devait faire. Et, une fois par an, on devait lui apporter un bébé vivant, et on dit qu’il attendait jusqu’à la pleine lune, et alors on entendait une plainte déchirante qui faisait frémir tout le monde à des milles à la ronde, et puis il y avait un mauvais silence, et les nuages venaient cacher la lune, et pendant trois jours on ne la revoyait plus.
– Oh, grand Dieu ! murmura une des femmes, mais c’était épouvantable, et elle se balança d’avant en arrière, tout son instinct maternel en éveil.
– Mais, il n’y avait pas un homme pour faire quelque chose ? dit un jeune garçon solidement bâti, portant le maillot orange et vert du Gaelic Athletic Club, les yeux étincelants et les dents serrées.
– Musha ! Comment il aurait fait ? Certain qu’aucun homme n’a jamais vu le Roi des Serpents !
– Alors, comment savait-on quelque chose sur lui ? demanda-t-il d’un air de doute.
– Voyons, un d’leurs enfants n’était-il pas enlevé chaque année ? Mais, de toute façon, maintenant, c’est fini tout ça ! Et c’est un fait qu’un homme n’y est jamais allé. Et on dit qu’une femme qu’avait perdu son enfant, elle a monté sur la colline en courant ; mais c’qu’elle a vu, personne n’a pu le dire, car quand on l’a retrouvée elle était folle à lier, les cheveux blancs et des yeux de cadavre, et le matin d’après on l’a trouvée morte dans son lit, une marque autour du cou comme si elle avait été étranglée, et la marque avait la forme d’un serpent. Alors, il y a eu bien des peines et bien des peurs, et quand saint Patrick s’en prit aux serpents, on alluma des feux de joie partout dans le pays. Jamais on n’avait vu un déménagement comme quand les serpents s’en sont venus de partout, en frétillant, en rampant et en s’tortillant.
Ici le narrateur prit une pose théâtrale et, avec l’habileté d’un véritable improvisateur, par ses attitudes et ses gestes, avec les bras et les jambes, mima dans le détail les évolutions des serpents.
– Ils sont tous partis vers l’ouest, en semblant se diriger vers cette montagne qu’est ici. Du nord et du sud et de l’est ils sont arrivés par millions et par milliers et par centaines, car quant saint Patrick leur a donné l’ordre de sortir, il leur a juste dit de s’en aller, mais il n’a pas nommé l’endroit, et il était là-haut, sur le sommet du Mont Brandon2, avec ses habits religieux, la crosse à la main, et les serpents qui se déplaçaient au-dessous de lui et qui partaient tous vers le nord, et il s’dit : « Il faut que je m’occupe de ça. »
« Et il est descendu de dessus la montagne pour suivre les serpents, et il les a vus partir vers la colline après celle qu’on appelle Knockcalltecrore. Et à c’moment, ils étaient tous venus de toute l’Irlande, et ils étaient tous autour de la montagne, sauf du côté de la mer, tous la tête pointée vers le haut de la colline et la queue en direction du Saint, si bien qu’ils ne le voyaient pas, et ils ont émis un grand sifflement, et puis un autre, et un autre, comme un, deux, trois ! Et, au troisième sifflement, le Roi des Serpents s’est dressé hors du p’tiot marécage au sommet de la colline et sa couronne d’or étincelait ; et, sûr que c’était le temps des moissons, et la lune était levée, et le soleil se couchait, si bien que la grosse pierre de la couronne avait la lumière du soleil et de la lune à la fois, et elle brillait si fort que jusque dans le Lenster les gens croyaient que tout le pays était en feu. Mais quand le Saint l’a vu, toute sa personne a paru s’enfler et devenir de plus en plus grosse, et il a levé sa crosse, et il a montré l’ouest et il a dit, d’une voix comme une tempête : « Tous à la mer, vous les serpents ! Tout de suite ! À la mer ! »
« Et à l’instant, d’un seul mouvement et avec un sifflement tel que l’air a paru s’remplir de cascades, tous les serpents qu’étaient autour de la colline sont partis vers la mer en se tortillant comme s’ils avaient le feu à la queue. Il y en avait tant qu’ils remplissaient la mer jusqu’à plus loin que Cusheen Island, et ceux qu’étaient derrière ont dû glisser sur leur corps. Et la mer s’est remplie jusqu’à ce qu’elle envoie une vague haute comme une montagne rouler à travers l’Atlantique et finir par toucher le rivage de l’Amérique, sauf que, plus que probable, c’n’était pas l’Amérique alors, parce qu’on ne l’a découverte que bien après. Et il y avait tant de serpents qu’on dit pour de bon que tout le sable blanc emporté sur la côte depuis les Blasket jusqu’à Achill Head est fait avec leurs os.
Ici Andy l’interrompit :
– Mais, Jerry, tu ne nous a pas dit si le Roi des Serpents était parti lui aussi.
– Musha ! mais c’est qu’t’es bien pressé ! Comment est-ce que je peux vous raconter toute la légende d’un seul coup ; et, en plus quand j’ai la bouche si sèche que je peux à peine parler… et qu’j’ai bu tout mon punch…
Il retourna son verre sur la table d’un air de résignation comique. Mrs Kelligan saisit l’allusion et lui remplit son verre tandis qu’il continuait :
– Bon ! Quand les serpents se sont mis aux bains de mer en oubliant de revenir pour se sécher, leur vieux Roi s’est enfoncé d’nouveau dans le lac, et saint Patrick roule les yeux et se dit :
« – Musha ! Est-ce que je rêve, ou bien quoi ? Ou c’est qu’il se moque de moi ? Il a l’intention de me défier ? »
« Et voyant qu’on ne lui prêtait aucune attention, il lève sa crosse et crie :
« – Hello ! Toi ! Viens ici. Je veux te voir ! » En parlant, Jerry se livra à toute une pantomime appropriée, illustrant par chacun de ses gestes les paroles du Saint et du Serpent.
« Alors le Roi des Serpents sort la tête du lac et dit :
« – Qui m’appelle ?
« – C’est moi, dit saint Patrick, et il était si déboussolé que le Serpent prétende rester après qu’on lui ait dit de s’en aller que, pendant un moment ça ne lui a pas même semblé bizarre qu’il puisse parler.
« – Alors qu’est-ce que tu veux de moi ? dit le Serpent.
« – Je veux savoir pourquoi tu n’as pas quitté le sol irlandais avec tous les autres serpents, dit le Saint.
« – Tu as dit aux serpents de s’en aller, dit le Roi, et je suis leur Roi, voilà ce que je suis ; et tes paroles ne s’appliquaient pas à moi. Et là-dessus, comme un éclair, il replonge dans le lac.
« – Ça alors ! » Saint Patrick a été si déconcerté d’cette impudence qu’il lui a fallu réfléchir un instant avant de crier de nouveau :
« – Hé ! toi, écoute !
« – Qu’est-ce que tu veux encore ? dit le Roi des Serpents, en r’sortant la tête.
« – Je veux savoir pourquoi tu n’as pas obéi à mes ordres, dit le Saint. Et le Roi l’a regardé en riant, et il avait l’air terriblement mauvais, je peux vous le dire, car à c’moment le soleil était couché et la lune était levée, et la pierre de sa couronne jetait une lumière pâle et froide à vous faire frissonner que d’la voir. « Et, dit-il, aussi lentement et sèchement qu’un procureur (sauf votre respect) quand il a une mauvaise affaire.
« – Je n’ai pas obéi, dit-il, parce que j’dénie cette juridiction.
« – Que veux-tu dire ? a demandé saint Patrick.
« – Parce que, qu’il dit, c’est ma propriété, qu’il dit, par droit de prescription, qu’il dit, j’suis tout l’gouvern’ment ici, et j’ai lancé un exeat m’donnant l’ordre à moi-même de n’pas partir sans ma permission à moi, et il se renfile dans la mare.
« – Ça alors ! Le Saint commençait à être fichtrement en colère, et il lève sa crosse et il le rappelle :
« – Hé ! viens ici, toi ! Et le Serpent fait surface.
« – « Alors ! le Saint, que veux-tu à présent ? Est-ce que je n’vais pas être débarrassé de toi pour de bon ?
« – Tu pars ou tu ne pars pas ? dit le Saint.
« – Je suis Roi ici, et je ne pars pas.
« – Alors, dit le Saint, je te dépose !
« – Tu ne peux pas, dit le Serpent, tant que j’ai la couronne.
« – Alors, je te la prendrai, dit saint Patrick.
« – Attrape-moi d’abord ! » dit le Serpent. Et là-dessus, il replonge sous l’eau, et voilà qu’elle commence à faire des bulles et à bouillonner. Vraiment, le bon Saint était abasourdi, car sous ses yeux l’eau commençait à disparaître du p’tit lac, et le sol de la colline commençait à être secoué comme si le gros Serpent allait et venait à toute allure au plus profond de la terre sous la colline.
« Alors le Saint, debout au bord du lac vide, leva sa crosse et ordonna au Serpent d’apparaître. Et en baissant les yeux, voyez donc ! il y avait le Roi des Serpents enroulé au fond du lac, et pourtant comment il était venu là, le Saint n’en avait pas la moindre idée, car il n’était pas là quand il avait commencé à l’appeler. Puis le Serpent leva la tête et, voilà qu’il ne portait pas de couronne !
« – Où est ta couronne ? dit le Saint.
« – Cachée », dit le Serpent avec un regard mauvais.
« – Où est-elle cachée ?
« – Elle est cachée dans la montagne ! Enterrée là où ni toi ni tes semblables n’pourront y toucher d’ici mille ans, et il eut encore le même regard mauvais.
« – Dis-moi où on peut la trouver ? dit le Saint d’un ton sévère.
« Alors, avec le même regard mauvais et un sourire encore plus méchant qu’avant, le Serpent dit :
« – As-tu vu l’eau qu’était dans le lac ?
« – Bien sûr, dit saint Patrick.





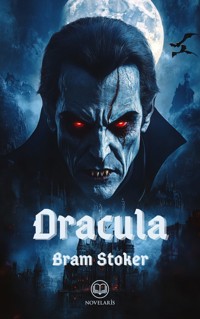

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)