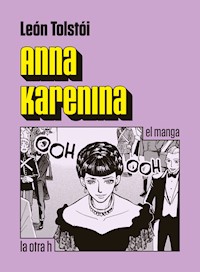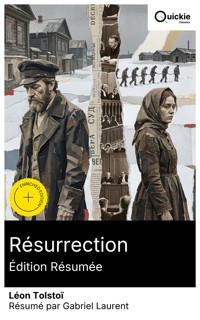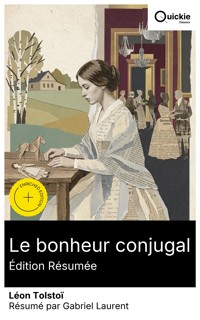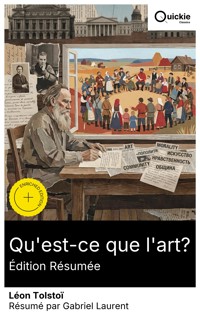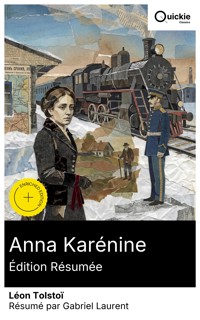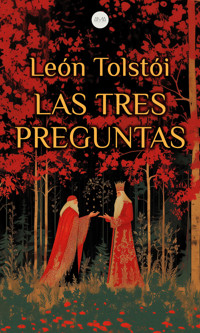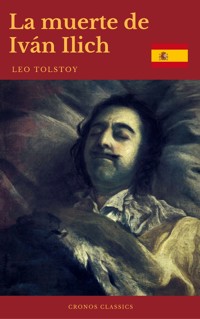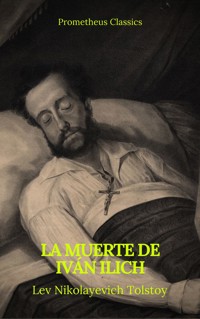Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Écrit en 1904, mais publié de façon posthume en 1911,
Le Faux Coupon est une des dernières œuvres de Léon Tolstoï.
Deux lycéens, pour payer une dette, commettent un faux. Passant de main en main, celui-ci va semer le malheur mais aussi la rédemption. En montrant l'enchaînement terrible des actes humains et de leurs conséquences, Tolstoï donne à son récit l'intemporalité des paraboles bibliques.
Traduction et préface de Pierre Skorov, 2009.
EXTRAIT
Fiodor Mikhaïlovitch Smokovnikov, président de la Cour des comptes, homme qui tirait une fierté particulière de son incorruptible honnêteté, libéral austère, non seulement libre penseur, mais haïssant toute manifestation dévotieuse qu’il considérait comme un reste de superstition, était rentré de son bureau de fort méchante humeur. Le gouverneur de la province lui avait envoyé une note stupide, et qui pouvait laisser supposer que Fiodor Mikhaïlovitch avait agi malhonnêtement. Fiodor Mikhaïlovitch en fut piqué au plus vif et écrivit aussitôt une réponse énergique et venimeuse.
À la maison, il paraissait à Fiodor Mikhaïlovitch que chacun cherchait à le contrarier.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Léon Tolstoï, nom francisé de Lev Nikolaïevitch Tolstoï, né le 28 août 1828 à Iasnaïa Poliana et mort le 7 novembre 1910 à Astapovo, en Russie, est un écrivain célèbre surtout pour ses romans et nouvelles qui dépeignent la vie du peuple russe à l'époque des tsars, mais aussi pour ses essais, dans lesquels il prenait position par rapport aux pouvoirs civils et ecclésiastiques et voulait mettre en lumière les grands enjeux de la civilisation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Léon Tolstoï
Толстой Лев Николаевич
1828-1910
LE FAUX COUPON
Фальшивый купон
1911
Traduction et préface de Pierre Skorov, 2009.
© La Bibliothèque russe et slave, 2016
© Pierre Skorov, 2009, 2016
Couverture : Bartolomé Esteban MURILLO, La Petite Vendeuse de fruits (1670-1680)
PRÉFACE
Le comte Léon Tolstoï, l’un des plus illustres écrivains du monde et figure emblématique de la littérature russe, naît en 1828 dans le domaine familial de Iasnaia Poliana. Dans sa Confession (1882), l’écrivain distingue quatre étapes majeures de sa vie. Après une enfance et une adolescence heureuses, Tolstoï entre dans l’armée et combat à Sébastopol pendant la guerre de Crimée. En 1862 il se marie, se retire à Iasnaia Poliana et se consacre à sa famille, à la gestion de ses propriétés et à l’écriture. Ses œuvres les plus célèbres, Guerre et Paix (1869) et Anna Karénine (1877), sont écrites durant cette période. La dernière période de sa vie est marquée par une recherche de plus en plus fervente de la vérité, qui s’accompagne d’une aspiration au dénuement, d’une reconsidération radicale des traditions esthétiques, d’une remise en question de la religion orthodoxe officielle qui entraîne son excommunication en 1901. C’est pendant cette période que Tolstoï écrit La Mort d’Ivan Ilitch (1886), La Sonate à Kreutzer (1891), Résurrection (1899), mais aussi des traités philosophiques : Ce en quoi je crois (1884), Le Royaume de Dieu est en vous (1894), Qu’est-ce que l’Art ? (1897).
Autant que sa vie, l’art de Tolstoï est marqué par un profond conflit entre sa nature sensuelle et une aspiration incessante vers le perfectionnement spirituel, entre son génie artistique et la recherche rationnelle du sens. Comme l’écrit Dmitrii Méréjkovskii, critique, historien et philosophe russe du début du XXe siècle, « Tourguéniev est enivré par la beauté, Dostoïévskii par la souffrance humaine, et Tolstoï par la soif de vérité. (...) La réalité qu’ils décrivent s’en trouve affectée, comme les contours d’un objet que reflète une surface ondoyante1. » Vers la fin de sa vie, l’œuvre de Tolstoï devient ainsi de plus en plus conditionnée par ses préoccupations philosophiques et éthiques.
La majeure partie du Faux Coupon est écrite entre 1902 et 1904, peu avant la mort de l’écrivain en 1910. Le contenu moral de cette parabole prime indubitablement sur sa forme. Trois idées centrales se distinguent, auxquelles les différentes lignes du récit servent d’illustration.
L’enchaînement saccadé des épisodes montre avec une exactitude presque mathématique que la moindre des fautes est susceptible d’engendrer massacres et souffrances. Il n’y a donc pas d’acte humain qui soit insignifiant ; l’homme est responsable pour le moindre de ses actes et pour toutes les conséquences qui en découlent jusqu’à la fin des temps.
La raison humaine est pourtant incapable de prévoir et de considérer la multitude infinie de conséquences qu’engendre chaque action. Une vie juste, illustrée par plusieurs personnages du récit, consiste à suivre les préceptes de l’Évangile et à pratiquer l’amour intuitif du prochain sans chercher à donner un fondement rationnel à sa foi.
Enfin, « tendre la seconde joue » apparaît dans Le Faux Coupon comme l’unique moyen d’endiguer le Mal. C’est en effet par la vengeance et le châtiment que le Mal se propage en s’amplifiant. Le récit montre que seul le refus passif du Mal, et non une lutte active, est capable d’absorber l’onde sismique du Mal et d’y mettre une fin.
Ce schéma philosophique est exposé dans un style sec et rugueux, souvent négligé, qui favorise la force didactique au détriment du réalisme et de l’agrément stylistique. Le récit s’interrompt brusquement ; certains passages sont répétitifs, d’autres contradictoires. Ceci est en partie dû à la nature inachevée de ce texte sur lequel Tolstoï a travaillé par intermittence. Ce style contribue pourtant directement à l’objectif du récit : il focalise l’attention du lecteur sur son contenu éthique. L’une des caractéristiques les plus frappantes de ce style est la contraction du temps narratif. Nabokov affirme très justement que le temps dans les romans de Tolstoï est remarquablement proche du lecteur : il s’écoule à l’allure de sa montre et c’est ce qui rend l’univers de Guerre et Paix ou d’Anna Karénine si familier et la narration si absorbante2. Le Faux Coupon suscite une perception du temps très différente. Les descriptions autant que les dialogues sont subordonnés à une logique non pas de narration, mais de démonstration. Comme dans une parabole biblique, le temps est en même temps condensé et inexistant.
Ce récit révèle les thèmes qui préoccupaient particulièrement Tolstoï vers la fin de sa vie. Il offre par ailleurs l’exemple d’un style singulier, en rupture avec les chefs-d’œuvre universellement connus de l’écrivain et même avec d’autres récits de la même période. C’est là son intérêt historiographique. Dans un contexte plus large, le laconisme et la densité du Faux Coupon, une construction en brefs tableaux juxtaposés, une rupture abrupte du récit (que l’on peut légitimement supposer voulue par l’écrivain), préfigurent la littérature moderniste de l’entre-deux-guerres, et font du Faux Coupon une expérimentation stylistique originale. D’un point de vue éthique, ce récit demeure d’une actualité aussi permanente que n’importe laquelle des paraboles de la Bible.
Pierre SKOROV
1. D. Méréjkovskii, L. Tolstoï i Dostoïévskii. Vetchnyé spoutniki, (Moscou: Respoublika, 1995), pp. 466-67. (Trad. du russe P. Skorov)
2. V. Nabokov, Lektsii po Russkoi literature (Moscou, Nezavisimaia Gazeta, 1996), p. 225.
PREMIÈRE PARTIE
I
Fiodor Mikhaïlovitch Smokovnikov, président de la Cour des comptes, homme qui tirait une fierté particulière de son incorruptible honnêteté, libéral austère, non seulement libre penseur, mais haïssant toute manifestation dévotieuse qu’il considérait comme un reste de superstition, était rentré de son bureau de fort méchante humeur. Le gouverneur de la province lui avait envoyé une note stupide, et qui pouvait laisser supposer que Fiodor Mikhaïlovitch avait agi malhonnêtement. Fiodor Mikhaïlovitch en fut piqué au plus vif et écrivit aussitôt une réponse énergique et venimeuse.
À la maison, il paraissait à Fiodor Mikhaïlovitch que chacun cherchait à le contrarier.
Il était cinq heures moins cinq. Il pensait que le dîner serait servi tout de suite, mais le dîner n’était pas prêt. Fiodor Mikhaïlovitch claqua la porte et s’en alla dans sa chambre. Quelqu’un frappa. « Qui diable est-ce encore ? » pense-t-il et cria :
— Qui est là ?
Dans la chambre entra un garçon de quinze ans, le fils de Fiodor Mikhaïlovitch, élève de cinquième du lycée.
— Qu’est-ce que tu veux ?
— C’est aujourd’hui le premier du mois.
— Quoi ? L’argent ?
Il était établi que, le premier de chaque mois, le père donnait à son fils trois roubles d’argent de poche. Fiodor Mikhaïlovitch fronça les sourcils, tira son portefeuille, y chercha, en sortit un coupon de deux roubles cinquante ; puis prit son porte-monnaie et compta encore cinquante kopeks, en petite monnaie. Le fils se taisait et ne prenait pas l’argent.
— S’il te plaît, Papa, donne moi une avance.
— Comment ?
— Je ne te l’aurais pas demandé, mais j’ai emprunté sur parole d’honneur, j’ai promis de rembourser. En honnête homme, je ne puis pas... Il me faudrait encore trois roubles... Je t’assure que je ne t’en demanderai plus... Je ne demanderai plus... Je veux dire, ce n’est pas que je ne t’en demanderai plus, mais simplement... s’il te plaît, Papa.
— Je t’ai dit...
— Mais, Papa... une seule fois...
— Tu reçois trois roubles par mois, et ce n’est toujours pas assez... À ton âge, je ne recevais pas même cinquante kopeks.
— Maintenant tous mes camarades ont beaucoup plus. Petrov, Ivanitski reçoivent cinquante roubles.
— Et moi je te dis que cette conduite-là est digne d’un fripon. J’ai dit.
— Eh bien quoi, vous avez dit. Vous ne vous mettez pas dans ma situation, et moi je suis obligé d’agir comme lâche. Cela ne vous fait rien, à vous.
— Dehors, garnement ! Ouste !
Fiodor Mikhaïlovitch bondit et se jeta vers son fils.
— Dehors ! C’est le fouet que vous méritez.
Le fils prit peur et s’offensa, mais le ressentiment l’emporta sur l’effroi, et, tête baissée, il marcha rapidement vers la porte. Fiodor Mikhaïlovitch n’avait pas voulu le frapper, mais il se réjouissait de sa colère, et longtemps encore ses cris mêlés d’injures résonnèrent dans le dos de son fils.
Quand la femme de chambre annonça que Monsieur était servi, Fiodor Mikhaïlovitch se leva.
— Ce n’est pas trop tôt ! dit-il. Je n’ai presque plus faim.
Et, refrogné, il alla se mettre à table.
Au dîner, sa femme entama une conversation, mais il grommela une réponse désobligeante et elle se tut. Le fils aussi se taisait, le nez dans son assiette. On mangea sans rien dire et c’est toujours sans rien dire qu’on se leva de table et qu’on se sépara.
Après le dîner, le lycéen retourna dans sa chambre, tira de sa poche le coupon et la monnaie, jeta le tout sur la table, enleva son uniforme et mit un veston. Il commença par prendre une grammaire latine très usée, puis verrouilla la porte, jeta l’argent dans un tiroir, sortit d’un autre tiroir des gaines à cigarettes, en remplit une, la boucha de coton et se mit à fumer. Il passa deux bonnes heures sur sa grammaire et ses cahiers, sans rien y comprendre, puis se leva et se mit à marcher de long en large dans sa chambre, se remémorant toute la scène avec son père. Tous les mots blessants de son père et surtout son visage haineux lui revenaient en mémoire comme s’il l’entendait et le voyait à nouveau devant lui. « Garnement !... C’est le fouet que tu mérites ! » Et plus les souvenirs affluaient, plus il sentait qu’il détestait son père. Il se rappelait de quelle manière son père lui avait dit : « Un escroc, voilà ce que tu seras. Tiens-le-toi pour dit. » — « Eh bien à ce train, il y a de quoi devenir un escroc. Il a beau parler, lui. Il a oublié qu’il a été jeune, lui aussi. Quel crime ai-je donc commis ?... Je n’ai fait qu’aller au théâtre, j’ai manqué d’argent, j’ai emprunté à Pétia Grouchetski... Quel mal y a-t-il à cela ?... Un autre aurait eu pitié de moi, il m’aurait demandé ce qui m’est arrivé, et lui ne pense qu’à soi et hurle des injures. Lui, quand il manque de quelque chose, il crie à faire trembler les murs, et moi, je suis un escroc. Non, il a beau être mon père, je ne l’aime pas. Je ne sais pas si c’est pareil pour les autres, mais moi, je ne l’aime pas. »
La femme de chambre frappa à la porte. Elle apportait un billet.
— On a demandé que Monsieur fasse impérativement une réponse.
Le billet disait : « Pour la troisième fois je te demande de me rendre les six roubles que tu m’as empruntés ; mais tu te dérobes. Les gens honnêtes n’agissent pas ainsi. Je te prie de me les envoyer immédiatement par le porteur du présent. J’en ai moi-même affreusement besoin. Ne peux-tu donc pas les trouver ? Selon que tu me les rendras ou non, ton camarade qui t’estime ou te méprise Grouchetski.
— « Et voilà. Quel cochon tout de même... Il ne peut pas attendre. Je vais faire une nouvelle tentative. »
Mitia alla trouver sa mère. C’était son dernier espoir.
Sa mère était très bonne et ne savait pas dire non ; sans doute l’eût-elle aidé, mais ce jour-là elle était très préoccupée par la maladie du petit Pétia, âgé de deux ans. Elle gronda Mitia parce qu’il était venu brusquement et avait fait du bruit, et elle lui refusa aussitôt. Il grommela quelque chose entre ses dents et s’en alla. Elle eut pitié de son fils et le rappela.
— Attends, Mitia ! dit-elle. Je n’ai pas d’argent aujourd’hui, mais je pourrai m’en procurer demain.
Mais Mitia débordait encore de rage contre son père.
— C’est aujourd’hui que j’ai besoin, pas demain. Puisque c’est ainsi, sachez que je m’en vais trouver un camarade.
Il sortit en claquant la porte.
« Il n’y a rien à faire, il me dira où je peux engager ma montre », pensa-t-il en tâtant la montre dans sa poche.
Mitia prit dans son tiroir le coupon et les pièces de monnaie, mit son manteau et alla voir Makhine.
II
Makhine était lycéen et portait la moustache. Il jouait aux cartes, connaissait les femmes il et avait toujours de l’argent. Il habitait chez sa tante. Mitia savait que Makhine était un quelqu’un de peu recommandable, mais quand il se trouvait avec lui, malgré soi, il subissait son influence. Makhine était à la maison et s’apprêtait pour aller au théâtre : sa chambre sale embaumait le savon parfumé et l’eau de Cologne.
— C’est mal parti, mon vieux, dit Makhine, quand Mitia lui conta son malheur, lui montra le coupon et les cinquante kopeks, et lui avoua qu’il lui fallait neuf roubles. — Bien sûr, on peut engager la montre, mais on peut aussi faire mieux, dit Makhine avec un clin d’œil.
— Comment cela, mieux ?
— C’est très simple. — Makhine prit le coupon. — On met 1 devant 2.50 et ça fera 12.50.
— Mais est-ce qu’il existe des coupons pareils ?
— Comment donc ! Et les coupons attachés aux coupons de mille roubles ? Une fois j’en ai écoulé un pareil.
— Pas possible !
— Alors ? On y va ? demanda Makhine en prenant une plume et lissant le coupon d’un doigt de la main gauche.
— Mais ce n’est pas bien.
— Eh, quelle foutaise !
« Et en effet », pensa Mitia. Et il se rappela de nouveau les injures de son père : « Escroc. » « Eh bien ! je serai un escroc. »
Il regarda le visage de Makhine. Makhine le dévisageait en souriant tranquillement.
— Eh bien ! Tu marches ?
— Vas-y.
Makhine traça soigneusement le chiffre un.
— Et maintenant, allons dans un magasin. Tiens, là, au coin : des accessoires de photographie. J’ai justement besoin d’un cadre pour cette petite personne.
Il prit la photographie d’une fille aux grands yeux, à la chevelure abondante et à la gorge splendide.
— N’est-ce pas un amour ?
— Si, si. Mais comment...
— Très simplement, tu verras. Viens.
Makhine s’habilla et ils sortirent ensemble.
III
Le timbre de la porte d’entrée de la boutique de photographie sonna. Les lycéens entrèrent, parcourant du regard la boutique déserte et ses rayons remplis d’accessoires, et les vitrines sur le comptoir. Une femme laide au visage doux entra par la porte de l’arrière-boutique et, se plaçant derrière le comptoir, demanda ce qu’ils désiraient.
— Un joli petit cadre, madame.
— À quel prix ? demanda la dame, en faisant défiler adroitement des cadres divers entre ses mains aux articulations gonflées, couvertes de mitaines. Ceux-ci sont à cinquante kopeks, ceux-ci sont plus chers. En voici un qui est très joli, c’est une nouveauté, un rouble vingt.
— Eh bien, va pour celui-ci. Mais ne pourriez-vous pas nous faire une petite réduction ? Je vous en donne un rouble.
— Chez nous on ne marchande pas, répondit la dame avec dignité.
— Eh bien, soit ! dit Makhine, en posant le coupon sur la vitrine. Donnez-moi le cadre et la monnaie, mais faites vite. Nous devons être à l’heure au théâtre.
— Vous avez encore le temps, dit la dame ; et de ses yeux myopes elle se mit à examiner le coupon.
— Ce sera charmant dans ce cadre, pas vrai ? dit Makhine, s’adressant à Mitia.
— N’auriez-vous pas de monnaie ? demanda la vendeuse.
— Je le regrette bien, mais non. Mon père m’a donné cela, il faut bien que je le change.
— Mais n’avez-vous donc pas un rouble et vingt kopeks ?
— Nous n’avons que cinquante kopeks. Mais quoi, avez-vous donc peur qu’on cherche à vous tromper en faisant passer un faux coupon ?
— Non, pas du tout.
— Autrement, rendez-moi le coupon. Nous le changerons ailleurs.
— Alors combien vous dois-je ?
— Eh bien, onze roubles et des kopeks.